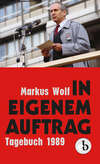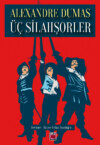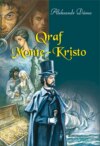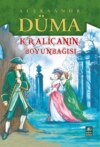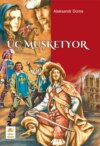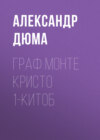Kitabı oku: «Le vicomte de Bragelonne, Tome IV.», sayfa 8
– C'est vrai, dit Percerin; mais le temps nous fait faute, et à cela, vous en conviendrez, monsieur l'évêque, je ne puis rien.
– Alors la chose manquera, dit Aramis tranquillement, et cela faute de vérité dans les couleurs.
Cependant Le Brun copiait étoffes et ornements avec la plus grande fidélité, ce que regardait Aramis avec une impatience mal dissimulée.
– Voyons, voyons, quel diable d'imbroglio joue-t-on ici? continua de se demander le mousquetaire.
– Décidément, cela n'ira point, dit Aramis; monsieur Le Brun, fermez vos boites et roulez vos toiles.
– Mais c'est qu'aussi, monsieur, s'écria le peintre dépité, le jour est détestable ici.
– Une idée, monsieur Le Brun, une idée! Si on avait un échantillon des étoffes, par exemple, et qu'avec le temps et dans un meilleur jour…
– Oh! alors, s'écria Le Brun, je répondrais de tout.
– Bon! dit d'Artagnan, ce doit être là le noeud de l'action; on a besoin d'un échantillon de chaque étoffe. Mordious! Le donnera-t- il, ce Percerin?
Percerin, battu dans ses derniers retranchements, dupe, d'ailleurs, de la feinte bonhomie d'Aramis, coupa cinq échantillons qu'il remit à l'évêque de Vannes.
– J'aime mieux cela. N'est-ce pas, dit Aramis à d'Artagnan, c'est votre avis, hein?
– Mon avis, mon cher Aramis, dit d'Artagnan c'est que vous êtes toujours le même.
– Et, par conséquent, toujours votre ami, dit l'évêque avec un son de voix charmant.
– Oui, oui, dit tout haut d'Artagnan. Puis tout bas: Si je suis ta dupe, double jésuite, je ne veux pas être ton complice, au moins, et, pour ne pas être ton complice, il est temps que je sorte d'ici. Adieu, Aramis, ajouta-t-il tout haut; adieu, je vais rejoindre Porthos.
– Alors attendez-moi, fit Aramis en empochant les échantillons, car j'ai fini, et je ne serai pas fâché de dire un dernier mot à notre ami.
Le Brun plia bagage, Percerin rentra ses habits dans l'armoire, Aramis pressa sa poche de la main pour s'assurer que les échantillons y étaient bien renfermés, et tous sortirent du cabinet.
Chapitre CCXI – Où Molière prit peut-être sa première idée du Bourgeois gentilhomme
D'Artagnan retrouva Porthos dans la salle voisine; non plus Porthos irrité, non plus Porthos désappointé, mais Porthos épanoui, radieux, charmant, et causant avec Molière, qui le regardait avec une sorte d'idolâtrie et comme un homme qui, non seulement n'a jamais rien vu de mieux, mais qui encore n'a jamais rien vu de pareil.
Aramis alla droit à Porthos, lui présenta sa main fine et blanche, qui alla s'engloutir dans la main gigantesque de son vieil ami, opération qu'Aramis ne risquait jamais sans une espèce d'inquiétude. Mais, la pression amicale s'étant accomplie sans trop de souffrance, l'évêque de Vannes se retourna du côté de Molière.
– Eh bien, monsieur, lui dit-il, viendrez-vous avec moi à Saint-
Mandé?
– J'irai partout où vous voudrez, Monseigneur, répondit Molière.
– À Saint-Mandé! s'écria Porthos, surpris de voir ainsi le fier évêque de Vannes en familiarité avec un garçon tailleur. Quoi! Aramis, vous emmenez monsieur à Saint-Mandé?
– Oui, dit Aramis en souriant, le temps presse.
– Et puis mon cher Porthos, continua d'Artagnan, M. Molière n'est pas tout à fait ce qu'il paraît être.
– Comment? demanda Porthos.
– Oui, monsieur est un des premiers commis de maître Percerin, il est attendu à Saint-Mandé pour essayer aux épicuriens les habits de fête qui ont été commandés par M. Fouquet.
– C'est justement cela, dit Molière. Oui, monsieur.
– Venez donc, mon cher monsieur Molière, dit Aramis, si toutefois vous avez fini avec M. du Vallon.
– Nous avons fini, répliqua Porthos.
– Et vous êtes satisfait? demanda d'Artagnan.
– Complètement satisfait, répondit Porthos.
Molière prit congé de Porthos avec force saluts et serra la main que lui tendit furtivement le capitaine des mousquetaires.
– Monsieur, acheva Porthos en minaudant, monsieur, soyez exact, surtout.
– Vous aurez votre habit dès demain, monsieur le baron, répondit
Molière.
Et il partit avec Aramis.
Alors d'Artagnan, prenant le bras de Porthos:
– Que vous a donc fait ce tailleur, mon cher Porthos, demanda-t- il, pour que vous soyez si content de lui?
– Ce qu'il m'a fait, mon ami! Ce qu'il m'a fait! s'écria Porthos avec enthousiasme.
– Oui, je vous demande ce qu'il vous a fait.
– Mon ami, il a su faire ce qu'aucun tailleur n'avait jamais fait: il m'a pris mesure sans me toucher.
– Ah bah! Contez-moi cela, mon ami.
– D'abord, mon ami, on a été chercher je ne sais où une suite de mannequins de toutes les tailles espérant qu'il s'en trouverait un de la mienne, mais le plus grand, qui était celui du tambour-major des Suisses, était de deux pouces trop court et d'un demi-pied trop maigre.
– Ah! vraiment?
– C'est comme j'ai l'honneur de vous le dire mon cher d'Artagnan. Mais c'est un grand homme ou tout au moins un grand tailleur que ce M. Molière; il n'a pas été le moins du monde embarrassé pour cela.
– Et qu'a-t-il fait?
– Oh! une chose bien simple. C'est inouï, par ma foi! Comment! on est assez grossier pour n'avoir pas trouvé tout de suite ce moyen? Que de peines et d'humiliations on m'eût épargnées!
– Sans compter les habits, mon cher Porthos.
– Oui, trente habits.
– Eh bien, mon cher Porthos, voyons, dites-moi la méthode de
M. Molière.
– Molière? vous l'appelez ainsi, n'est-ce pas? Je tiens à me rappeler son nom.
– Oui, ou Poquelin, si vous l'aimez mieux.
– Non, j'aime mieux Molière. Quand je voudrai me rappeler son nom, je penserai à volière, et, comme j'en ai une à Pierrefonds…
– À merveille, mon ami. Et sa méthode, à ce M. Molière?
– La voici. Au lieu de me démembrer comme font tous ces bélîtres, de me faire courber les reins, de me faire plier les articulations, toutes pratiques déshonorantes et basses…
D'Artagnan fit un signe approbatif de la tête.
– «Monsieur, m'a-t-il dit, un galant homme doit se mesurer lui- même. Faites-moi le plaisir de vous approcher de ce miroir.» Alors je me suis approché du miroir. Je dois avouer que je ne comprenais pas parfaitement ce que ce brave M. Volière voulait de moi.
– Molière.
– Ah! oui, Molière, Molière. Et, comme la peur d'être mesuré me tenait toujours: «Prenez garde, lui ai-je dit, à ce que vous m'allez faire; je suis fort chatouilleux, je vous en préviens.» Mais lui, de sa voix douce car c'est un garçon courtois, mon ami, il faut en convenir, mais lui, de sa voix douce: «Monsieur, dit- il, pour que l'habit aille bien, il faut qu'il soit fait à votre image. Votre image est exactement réfléchie par le miroir. Nous allons prendre mesure sur votre image.»
– En effet, dit d'Artagnan, vous vous voyiez au miroir; mais comment a-t on trouvé un miroir où vous pussiez vous voir tout entier?
– Mon cher, c'est le propre miroir où le roi se regarde.
– Oui; mais le roi a un pied et demi de moins que vous.
– Eh bien, je ne sais pas comment cela se fait c'était sans doute une manière de flatter le roi, mais le miroir était trop grand pour moi. Il est vrai que sa hauteur était faite de trois glaces de Venise superposées et sa largeur des mêmes glaces juxtaposées.
– Oh! mon ami, les admirables mots que vous possédez là! Où diable en avez-vous fait collection?
– À Belle-Île. Aramis les expliquait à l'architecte.
– Ah! très bien! Revenons à la glace, cher ami.
– Alors, ce brave M. Volière…
– Molière.
– Oui, Molière, c'est juste. Vous allez voir, mon cher ami, que voilà maintenant que je vais trop me souvenir de son nom. Ce brave M. Molière se mit donc à tracer avec un peu de blanc d'Espagne des lignes sur le miroir, le tout en suivant le dessin de mes bras et de mes épaules, et cela tout en professant cette maxime que je trouvai admirable: «Il faut qu'un habit ne gêne pas celui qui le porte.»
– En effet, dit d'Artagnan, voilà une belle maxime, qui n'est pas toujours mise en pratique.
– C'est pour cela que je la trouvai d'autant plus étonnante, surtout lorsqu'il la développa.
– Ah! Il développa cette maxime?
– Parbleu!
– Voyons le développement.
« – Attendu, continua-t-il, que l'on peut, dans une circonstance difficile, ou dans une situation gênante, avoir son habit sur l'épaule, et désirer ne pas ôter son habit…»
– C'est vrai, dit d'Artagnan.
« – Ainsi», continua M. Volière…
– Molière!
– Molière, oui. «Ainsi continua M. Molière, vous avez besoin de tirer l'épée, monsieur, et vous avez votre habit sur le dos. Comment faites-vous?
« – Je l'ôte, répondis-je.
« – Eh bien, non, répondit-il à son tour.
« – Comment! non?
« – Je dis qu'il faut que l'habit soit si bien fait, qu'il ne vous gêne aucunement, même pour tirer l'épée.
« – Ah! ah!
« – Mettez-vous en garde», poursuivit-il. J'y tombai avec un si merveilleux aplomb, que deux carreaux de la fenêtre en sautèrent. «Ce n'est rien, ce n'est rien, dit-il, restez comme cela.» Je levai le bras gauche en l'air, l'avant-bras plié gracieusement, la manchette rabattue et le poignet circonflexe, tandis que le bras droit à demi étendu garantissait la ceinture avec le coude, et la poitrine avec le poignet.
– Oui, dit d'Artagnan, la vraie garde, la garde académique.
– Vous avez dit le mot, cher ami. Pendant ce temps, Volière…
– Molière!
– Tenez, décidément, mon cher ami, j'aime mieux l'appeler…
Comment avez-vous dit son autre nom?
– Poquelin.
– J'aime mieux l'appeler Poquelin.
– Et comment vous souviendrez-vous mieux de ce nom que de l'autre?
– Vous comprenez… Il s'appelle Poquelin, n'est-ce pas?
– Oui.
– Je me rappellerai madame Coquenard.
– Bon.
– Je changerai Coque en Poque, nard en lin, et au lieu de
Coquenard, j'aurai Poquelin.
– C'est merveilleux! s'écria d'Artagnan abasourdi… Allez, mon ami, je vous écoute avec admiration.
– Ce Coquelin esquissa donc mon bras sur le miroir.
– Poquelin. Pardon.
– Comment ai-je donc dit?
– Vous avez dit Coquelin.
– Ah! c'est juste. Ce Poquelin esquissa donc mon bras sur le miroir; mais il y mit le temps; il me regardait beaucoup; le fait est que j'étais très beau. «Cela vous fatigue? demanda-t-il. – Un peu, répondis-je en pliant sur les jarrets; cependant le peux tenir encore une heure. – Non, non, je ne le souffrirai pas! Nous avons ici des garçons complaisants qui se feront un devoir de vous soutenir les bras, comme autrefois on soutenait ceux des prophètes quand ils invoquaient le Seigneur. – Très bien! répondis-je. – Cela ne vous humiliera pas? – Mon ami, lui dis-je, il y a, je le crois, une grande différence entre être soutenu et être mesuré.»
– La distinction est pleine de sens, interrompit d'Artagnan.
– Alors, continua Porthos, il fit un signe; deux garçons s'approchèrent; l'un me soutint le bras gauche, tandis que l'autre, avec infiniment d'adresse, me soutenait le bras droit.
« – Un troisième garçon! dit-il.
«Un troisième garçon s'approcha.
« – Soutenez les reins de monsieur, dit-il.
«Le garçon me soutint les reins.»
– De sorte que vous posiez? demanda d'Artagnan.
– Absolument, et Poquenard me dessinait sur la glace.
– Poquelin, mon ami.
– Poquelin, vous avez raison. Tenez, décidément, j'aime encore mieux l'appeler Volière.
– Oui, et que ce soit fini, n'est-ce pas?
– Pendant ce temps-là, Volière me dessinait sur la glace.
– C'était galant.
– J'aime fort cette méthode: elle est respectueuse et met chacun à sa place.
– Et cela se termina?..
– Sans que personne m'eût touché, mon ami.
– Excepté les trois garçons qui vous soutenaient?
– Sans doute; mais je vous ai déjà exposé, je crois, la différence qu'il y a entre soutenir et mesurer.
– C'est vrai, répondit d'Artagnan, qui se dit ensuite à lui-même: Ma foi! ou je me trompe fort, ou j'ai valu là une bonne aubaine à ce coquin de Molière, et nous en verrons bien certainement la scène tirée au naturel dans quelque comédie.
Porthos souriait.
– Quelle chose vous fait rire? lui demanda d'Artagnan.
– Faut-il vous l'avouer? Eh bien, je ris de ce que j'ai tant de bonheur.
– Oh! cela, c'est vrai; je ne connais pas d'homme plus heureux que vous. Mais quel est le nouveau bonheur qui vous arrive?
– Eh bien, mon cher, félicitez-moi.
– Je ne demande pas mieux.
– Il paraît que je suis le premier à qui l'on ait pris mesure de cette façon-là.
– Vous en êtes sûr?
– À peu près. Certains signes d'intelligence échangés entre
Volière et les autres garçons me l'ont bien indiqué.
– Eh bien, mon cher ami, cela ne me surprend pas de la part de
Molière.
– Volière, mon ami!
– Oh! non, non, par exemple! je veux bien vous laisser dire Volière à vous; mais je continuerai, moi, à dire Molière. Eh bien, cela, disais-je donc, ne m'étonne point de la part de Molière qui est un garçon ingénieux, et à qui vous avez inspiré cette belle idée.
– Elle lui servira plus tard, j'en suis sûr.
– Comment donc, si elle lui servira! Je le crois bien, qu'elle lui servira, et même beaucoup! Car, voyez-vous, mon ami, Molière est, de tous nos tailleurs connus, celui qui habille le mieux nos barons, nos comtes et nos marquis… à leur mesure.
Sur ce mot, dont nous ne discuterons ni l'à-propos ni la profondeur, d'Artagnan et Porthos sortirent de chez maître Percerin et rejoignirent leur carrosse. Nous les y laisserons, s'il plaît au lecteur, pour revenir auprès de Molière et d'Aramis à Saint-Mandé.
Chapitre CCXII – La ruche, les abeilles et le miel
L'évêque de Vannes, fort marri d'avoir rencontré d'Artagnan chez maître Percerin, revint d'assez mauvaise humeur à Saint-Mandé.
Molière, au contraire, tout enchanté d'avoir trouvé un si bon croquis à faire, et de savoir où retrouver l'original, quand du croquis il voudrait faire un tableau, Molière y rentra de la plus joyeuse humeur.
Tout le premier étage, du côté gauche, était occupé par les épicuriens les plus célèbres dans Paris et les plus familiers dans la maison, employés chacun dans son compartiment, comme des abeilles dans leurs alvéoles, à produire un miel destiné au gâteau royal que M. Fouquet comptait servir à Sa Majesté Louis XIV pendant la fête de Vaux.
Pélisson, la tête dans sa main, creusait les fondations du prologue des Fâcheux, comédie en trois actes, que devait faire représenter Poquelin de Molière, comme disait d'Artagnan, et Coquelin de Volière, comme disait Porthos.
Loret, dans toute la naïveté de son état de gazetier, les gazetiers de tout temps ont été naïfs, Loret composait le récit des fêtes de Vaux avant que ces fêtes eussent eu lieu.
La Fontaine vaguait au milieu des uns et des autres, ombre égarée, distraite, gênante, insupportable, qui bourdonnait et susurrait à l'épaule de chacun mille inepties poétiques. Il gêna tant de fois Pélisson, que celui-ci, relevant la tête avec humeur.
– Au moins, La Fontaine, dit-il, cueillez-moi une rime, puisque vous dites que vous vous promenez dans les jardins du Parnasse.
– Quelle rime voulez-vous? demanda le fablier, comme l'appelait madame de Sévigné.
– Je veux une rime à lumière.
– Ornière, répondit La Fontaine.
– Eh! mon cher ami, impossible de parler d'ornières quand on vante les délices de Vaux dit Loret.
– D'ailleurs, cela ne rime pas, répondit Pélisson.
– Comment! cela ne rime pas? s'écria La Fontaine surpris.
– Oui, vous avez une détestable habitude mon cher; habitude qui vous empêchera toujours d'être un poète de premier ordre. Vous rimez lâchement!
– Oh! oh! vous trouvez, Pélisson?
– Eh! oui, mon cher, je trouve. Rappelez-vous qu'une rime n'est jamais bonne tant qu'il s'en peut trouver une meilleure.
– Alors, je n'écrirai plus jamais qu'en prose, dit La Fontaine, qui avait pris au sérieux le reproche de Pélisson. Ah! je m'en étais souvent douté, que je n'étais qu'un maraud de poète! oui, c'est la vérité pure.
– Ne dites pas cela, mon cher; vous devenez trop exclusif, et vous avez du bon dans vos fables.
– Et pour commencer, continua La Fontaine poursuivant son idée, je vais brûler une centaine de vers que je venais de faire.
– Où sont-ils, vos vers?
– Dans ma tête.
– Eh bien, s'ils sont dans votre tête, vous ne pouvez pas les brûler?
– C'est vrai, dit La Fontaine. Si je ne les brûle pas, cependant…
– Eh bien, qu'arrivera-t-il si vous ne les brûlez pas?
– Il arrivera qu'ils me resteront dans l'esprit, et que je ne les oublierai jamais.
– Diable! fit Loret, voilà qui est dangereux; on en devient fou!
– Diable, diable, diable! comment faire? répéta La Fontaine.
– J'ai trouvé un moyen, moi, dit Molière, qui venait d'entrer sur les derniers mots.
– Lequel?
– Écrivez-les d'abord, et brûlez-les ensuite.
– Comme c'est simple! Eh bien, je n'eusse jamais inventé cela.
Qu'il a d'esprit, ce diable de Molière! dit La Fontaine.
Puis, se frappant le front:
– Ah! tu ne seras jamais qu'un âne, Jean de La Fontaine, ajouta- t-il.
– Que dites-vous là, mon ami? interrompit Molière en s'approchant du poète, dont il avait entendu l'aparté.
– Je dis que je ne serai jamais qu'un âne, mon cher confrère, répondit La Fontaine avec un gros soupir et les yeux tout bouffis de tristesse. Oui, mon ami, continua-t-il avec une tristesse croissante, il paraît que je rime lâchement.
– C'est un tort.
– Vous voyez bien! Je suis un faquin!
– Qui a dit cela?
– Parbleu! c'est Pélisson. N'est-ce pas, Pélisson?
Pélisson, replongé dans sa composition, se garda bien de répondre.
– Mais, si Pélisson a dit que vous étiez un faquin s'écria
Molière, Pélisson vous a gravement offensé.
– Vous croyez?..
– Ah! mon cher, je vous conseille, puisque vous êtes gentilhomme, de ne pas laisser impunie une pareille injure.
– Heu! fit La Fontaine.
– Vous êtes-vous jamais battu?
– Une fois, mon ami, avec un lieutenant de chevau-légers.
– Que vous avait-il fait?
– Il paraît qu'il avait séduit ma femme.
– Ah! ah! dit Molière pâlissant légèrement.
Mais comme, à l'aveu formulé par La Fontaine, les autres s'étaient retournés, Molière garda sur ses lèvres le sourire railleur qui avait failli s'en effacer, et, continuant de faire parler La Fontaine:
– Et qu'est-il résulté de ce duel?
– Il est résulté que, sur le terrain, mon adversaire me désarma, puis me fit des excuses, me promettant de ne plus remettre les pieds à la maison.
– Et vous vous tîntes pour satisfait? demanda Molière.
– Non pas, au contraire! Je ramassai mon épée: «Pardon, monsieur, lui dis-je, je ne me suis pas battu avec vous parce que vous étiez l'amant de ma femme, mais parce qu'on m'a dit que je devais me battre. Or, comme je n'ai jamais été heureux que depuis ce temps- là, faites-moi le plaisir de continuer d'aller à la maison, comme par le passé, ou, morbleu! recommençons.» De sorte, continua La Fontaine, qu'il fut forcé de rester l'amant de ma femme, et que je continue d'être le plus heureux mari de la terre.
Tous éclatèrent de rire. Molière seul passa sa main sur ses yeux. Pourquoi? Peut-être pour essuyer une larme, peut-être pour étouffer un soupir. Hélas! on le sait, Molière était moraliste mais Molière n'était pas philosophe.
– C'est égal, dit-il revenant au point de départ de la discussion, Pélisson vous a offensé.
– Ah! c'est vrai, je l'avais déjà oublié, moi.
– Et je vais l'appeler de votre part.
– Cela se peut faire, si vous le jugez indispensable.
– Je le juge indispensable, et j'y vais.
– Attendez, fit La Fontaine. Je veux avoir votre avis.
– Sur quoi?.. Sur cette offense?
– Non, dites-moi si, réellement, lumière ne rime pas avec ornière.
– Moi, je les ferais rimer.
– Parbleu! je le savais bien.
– Et j'ai fait cent mille vers pareils dans ma vie.
– Cent mille? s'écria La Fontaine. Quatre fois la Pucelle que médite M. Chapelain! Est-ce aussi sur ce sujet que vous avez fait cent mille vers, cher ami?
– Mais, écoutez donc, éternel distrait! dit Molière.
– Il est certain, continua La Fontaine, que légume par exemple rime avec_ posthume_.
– Au pluriel surtout.
– Oui, surtout au pluriel; attendu qu'alors, il rime, non plus par trois lettres, mais par quatre; c'est comme ornière avec lumière. Mettez ornières et lumières au pluriel mon cher Pélisson, dit La Fontaine en allant frapper sur l'épaule de son confrère, dont il avait complètement oublié l'injure, et cela rimera.
– Hein! fit Pélisson.
– Dame! Molière le dit, et Molière s'y connaît, il avoue lui-même avoir fait cent mille vers.
– Allons, dit Molière en riant, le voilà parti!
– C'est comme rivage, qui rime admirablement avec herbage, j'en mettrais ma tête au feu.
– Mais… fit Molière.
– Je vous dis cela, continua La Fontaine, parce que vous faites un divertissement pour Sceaux, n'est-ce pas?
– Oui, les Fâcheux.
– Ah! les Fâcheux, c'est cela; oui, je me souviens. Eh bien, j'avais imaginé qu'un prologue ferait très bien à votre divertissement.
– Sans doute, cela irait à merveille.
– Ah! vous êtes de mon avis?
– J'en suis si bien, que je vous avais prié de le faire, ce prologue.
– Vous m'avez prié de le faire, moi?
– Oui, vous; et même, sur votre refus, je vous ai prié de le demander à Pélisson, qui le fait en ce moment.
– Ah! c'est donc cela que fait Pélisson? Ma foi! mon cher
Molière, vous pourriez bien avoir raison quelquefois.
– Quand cela?
– Quand vous dites que je suis distrait. C'est un vilain défaut; je m'en corrigerai, et je vais vous faire votre prologue.
– Mais puisque c'est Pélisson qui le fait!
– C'est juste! Ah! double brute que je suis! Loret a eu bien raison de dire que j'étais un faquin!
– Ce n'est pas Loret qui l'a dit, mon ami.
– Eh bien, celui qui l'a dit, peu m'importe lequel! Ainsi, votre divertissement s'appelle les Fâcheux. Eh bien, est-ce que vous ne feriez pas rimer heureux avec fâcheux?
– À la rigueur, oui.
– Et même avec capricieux?
– Oh! non, cette fois, non!
– Ce serait hasardé, n'est-ce pas? Mais, enfin, pourquoi serait- ce hasardé?
– Parce que la désinence est trop différente.
– Je supposais, moi, dit La Fontaine en quittant Molière pour aller trouver Loret, je supposais…
– Que supposiez-vous? dit Loret au milieu d'une phrase. Voyons, dites vite.
– C'est vous qui faites le prologue des Fâcheux, n'est-ce pas?
– Eh! non, mordieu! c'est Pélisson!
– Ah! c'est Pélisson! s'écria La Fontaine, qui alla trouver
Pélisson. Je supposais, continua-t-il, que la nymphe de Vaux…
– Ah! jolie! s'écria Loret. La nymphe de Vaux! Merci, La Fontaine; vous venez de me donner les deux derniers vers de ma gazette.
Et l'on vit la nymphe de Vaux Donner le prix à leurs travaux.
– À la bonne heure! voilà qui est rimé, dit Pélisson: si vous rimiez comme cela, La Fontaine, à la bonne heure!
– Mais il paraît que je rime comme cela, puisque Loret dit que c'est moi qui lui ai donné les deux vers qu'il vient de dire.
– Eh bien, si vous rimez comme cela, voyons dites, de quelle façon commenceriez-vous mon prologue?
– Je dirais, par exemple: Ô nymphe… qui… Après qui, je mettrais un verbe à la deuxième personne du pluriel du présent de l'indicatif, et je continuerais ainsi: cette grotte profonde.
– Mais le verbe, le verbe? demanda Pélisson.
– Pour venir admirer le plus grand roi du monde, continua La Fontaine.
– Mais le verbe, le verbe? insista obstinément Pélisson. Cette seconde personne du pluriel du présent de l'indicatif?
– Eh bien: quittez.
Ô nymphe qui quittez cette grotte profonde Pour venir admirer le plus grand roi du monde.
– Vous mettriez: qui quittez, vous?
– Pourquoi pas?
– Qui… qui!
– Ah! mon cher, fit La Fontaine, vous êtes horriblement pédant!
– Sans compter, dit Molière, que, dans le second vers, venir admirer est faible, mon cher La Fontaine.
– Alors, vous voyez bien que je suis un pleutre, un faquin, comme vous disiez.
– Je n'ai jamais dit cela.
– Comme disait Loret, alors.
– Ce n'est pas Loret non plus; c'est Pélisson.
– Eh bien, Pélisson avait cent fois raison. Mais ce qui me fâche surtout, mon cher Molière, c'est que je crois que nous n'aurons pas nos habits d'épicuriens.
– Vous comptiez sur le vôtre pour la fête?
– Oui, pour la fête, et puis pour après la fête. Ma femme de ménage m'a prévenu que le mien était un peu mûr.
– Diable! votre femme de ménage a raison: il est plus que mûr!
– Ah! voyez-vous, reprit La Fontaine, c'est que je l'ai oublié à terre dans mon cabinet, et ma chatte…
– Eh bien, votre chatte?
– Ma chatte a fait ses chats dessus, ce qui l'a un peu fané.
Molière éclata de rire. Pélisson et Loret suivirent son exemple.
En ce moment, l'évêque de Vannes parut, tenant sous son bras un rouleau de plans et de parchemins.
Comme si l'ange de la mort eût glacé toutes les imaginations folles et rieuses, comme si cette figure pâle eût effarouché les grâces auxquelles sacrifiait Xénocrate, le silence s'établit aussitôt dans l'atelier, et chacun reprit son sang-froid et sa plume.
Aramis distribua des billets d'invitation aux assistants, et leur adressa des remerciements de la part de M. Fouquet. Le surintendant, disait-il retenu dans son cabinet par le travail, ne pouvait les venir voir, mais les priait de lui envoyer un peu de leur travail du jour pour lui faire oublier la fatigue de son travail de la nuit.
À ces mots, on vit tous les fronts s'abaisser. La Fontaine lui- même se mit à une table et fit courir sur le vélin une plume rapide; Pélisson remit au net son prologue; Molière donna cinquante vers nouvellement crayonnés que lui avait inspirés sa visite chez Percerin; Loret, son article sur les fêtes merveilleuses qu'il prophétisait, et Aramis chargé de butin comme le roi des abeilles, ce gros bourdon noir aux ornements de pourpre et d'or rentra dans son appartement, silencieux et affairé. Mais, avant de rentrer:
– Songez, dit-il, chers messieurs, que nous partons tous demain au soir.
– En ce cas, il faut que je prévienne chez moi, dit Molière.
– Ah! oui, pauvre Molière! fit Loret en souriant il aime chez lui.
– Il aime, oui, répliqua Molière avec son doux et triste sourire; il aime, ce qui ne veut pas dire on l'aime.
– Moi, dit La Fontaine, on m'aime à Château-Thierry, j'en suis bien sûr.
En ce moment, Aramis rentra après une disparition d'un instant.
– Quelqu'un vient-il avec moi? demanda-t-il. Je passe par Paris, après avoir entretenu M. Fouquet un quart d'heure. J'offre mon carrosse.
– Bon, à moi! dit Molière. J'accepte; je suis pressé.
– Moi, je dînerai ici, dit Loret. M. de Gourville m'a promis des écrevisses.
Il m'a promis des écrevisses…
Cherche la rime, La Fontaine.»
Aramis sortit en riant comme il savait rire. Molière le suivit. Ils étaient au bas de l'escalier lorsque La Fontaine entrebâilla la porte et cria:
Moyennant que tu l'écrivisses, Il t'a promis des écrevisses.
Les éclats de rire des épicuriens redoublèrent et parvinrent jusqu'aux oreilles de Fouquet, au moment où Aramis ouvrait la porte de son cabinet.
Quant à Molière, il s'était chargé de commander les chevaux, tandis qu'Aramis allait échanger avec le surintendant les quelques mots qu'il avait à lui dire.
– Oh! comme ils rient là-haut! dit Fouquet avec un soupir.
– Vous ne riez pas, vous, Monseigneur?
– Je ne ris plus, monsieur d'Herblay.
– La fête approche.
– L'argent s'éloigne.
– Ne vous ai-je pas dit que c'était mon affaire?
– Vous m'avez promis des millions.
– Vous les aurez le lendemain de l'entrée du roi à Vaux.
Fouquet regarda profondément Aramis, et passa sa main glacée sur son front humide. Aramis comprit que le surintendant doutait de lui, ou sentait son impuissance à avoir de l'argent. Comment Fouquet pouvait-il supposer qu'un pauvre évêque, ex-abbé, ex- mousquetaire, en trouverait?
– Pourquoi douter? dit Aramis.:
Fouquet sourit et secoua la tête.
– Homme de peu de foi! ajouta l'évêque.
– Mon cher monsieur d'Herblay, répondit Fouquet, si je tombe…
– Eh bien, si vous tombez…
– Je tomberai du moins de si haut, que je me briserai en tombant.
Puis, secouant la tête comme pour échapper à lui-même:
– D'où venez-vous, dit-il, cher ami?
– De Paris.
– De Paris? Ah!
– Oui, de chez Percerin.
– Et qu'avez-vous été faire vous-même chez Percerin; car je ne suppose pas que vous attachiez une si grande importance aux habits de nos poètes?
– Non; j'ai été commander une surprise.
– Une surprise?
– Oui, que vous ferez au roi.
– Coûtera-t-elle cher?
– Oh! cent pistoles, que vous donnerez à Le Brun.
– Une peinture? Ah! tant mieux! Et que doit représenter cette peinture?
– Je vous conterai cela; puis, du même coup, quoi que vous en disiez, j'ai visité les habits de nos poètes.
– Bah! et ils seront élégants, riches?
– Superbes! Il n'y aura pas beaucoup de grands seigneurs qui en auront de pareils. On verra la différence qu'il y a entre les courtisans de la richesse et ceux de l'amitié.
– Toujours spirituel et généreux, cher prélat!
– À votre école.
Fouquet lui serra la main.
– Et où allez-vous? dit-il.
– Je vais à Paris, quand vous m'aurez donné une lettre.
– Une lettre pour qui?
– Une lettre pour M. de Lyonne.
– Et que lui voulez-vous, à Lyonne?
– Je veux lui faire signer une lettre de cachet.
– Une lettre de cachet! Vous voulez faire mettre quelqu'un à la
Bastille?
– Non, au contraire, j'en veux faire sortir quelqu'un.
– Ah! Et qui cela?
– Un pauvre diable, un jeune homme, un enfant, qui est embastillé, voilà tantôt dix ans, pour deux vers latins qu'il a faits contre les jésuites.
– Pour deux vers latins! Et, pour deux vers latins, il est en prison depuis dix ans, le malheureux?
– Oui.
– Et il n'a pas commis d'autre crime?
– À part ces deux vers, il est innocent comme vous et moi.
– Votre parole?
– Sur l'honneur!
– Et il se nomme?..
– Seldon.
– Ah! c'est trop fort, par exemple! Et vous saviez cela, et vous ne me l'avez pas dit?
– Ce n'est qu'hier que sa mère s'est adressée à moi, Monseigneur.
– Et cette femme est pauvre?
– Dans la misère la plus profonde.
– Mon Dieu! dit Fouquet, vous permettez parfois de telles injustices, que je comprends qu'il y ait des malheureux qui doutent de vous! Tenez, monsieur d'Herblay.
Et Fouquet, prenant une plume, écrivit rapidement quelques lignes à son collègue Lyonne.
Aramis prit la lettre et s'apprêta à sortir.
– Attendez, dit Fouquet.
Il ouvrit son tiroir et lui remit dix billets de caisse qui s'y trouvaient. Chaque billet était de mille livres.
– Tenez, dit-il, faites sortir le fils, et remettez ceci à la mère; mais surtout ne lui dites pas…
– Quoi, Monseigneur?
– Qu'elle est de dix mille livres plus riche que moi; elle dirait que je suis un triste surintendant. Allez, et j'espère que Dieu bénira ceux qui pensent à ses pauvres.
– C'est ce que j'espère aussi, répliqua Aramis en baisant la main de Fouquet.
Et il sortit rapidement, emportant la lettre pour Lyonne, les bons de caisse pour la mère de Seldon et emmenant Molière, qui commençait à s'impatienter.