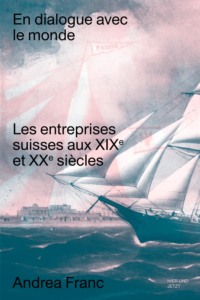Kitabı oku: «En dialogue avec le monde», sayfa 3
Subsidiarité, souveraineté, autodétermination
Subsidiarité est le terme juridique désignant le principe de l’autonomie au niveau le plus bas possible. À l’époque moderne, la théorie de la subsidiarité est d’abord formulée par le pape Pie XI, en 1931, dans la doctrine sociale catholique. Dans ce contexte, elle se veut un code de conduite éthique, qui incite les individus à assumer la responsabilité de leurs actes. Elle est ensuite développée par des économistes libéraux comme Friedrich August von Hayek qui soulignent le droit de l’individu à la liberté ainsi que l’importance de cette théorie pour la performance économique et la préservation du marché en tant que processus de découverte. Le principe de subsidiarité est au cœur du concept réglementaire de l’économie sociale de marché tel qu’appliqué en Allemagne après la Seconde Guerre mondiale. Il est inscrit à l’article 5 du traité de Maastricht sur l’Union européenne de 1992 et à l’article 5a de la nouvelle Constitution fédérale de 1999. L’article 5 est donc commun à la Constitution fédérale de la Confédération suisse et au traité sur l’Union européenne. La souveraineté, ou plus communément l’autodétermination, désigne l’autodétermination juridique exclusive.
Directoire commercial de Saint-Gall-Appenzell
La chambre de commerce de loin la plus ancienne de Suisse est la Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Gall-Appenzell. À la fin du Moyen-Âge, des marchands saint-gallois se réunissent au sein de la société du Notenstein pour organiser leur commerce de toile de lin à l’échelle européenne. L’un des premiers registres des membres date du 15 août 1466. La famille de commerçants Zyli, membre de la société du Notenstein dès le début, se lance dans l’activité bancaire au XVIIIe siècle. Le siège de l’entreprise se trouve dans la « Haus zum Notenstein », près de la porte Brühl, en bordure des vieux quartiers de Saint-Gall. Dans les années 1630, la société moyenâgeuse du Notenstein est dépassée avec ses quelques familles membres. Les entrepreneurs de la ville se constituent alors en assemblée générale et, quelques années plus tard, c’est la naissance de la corporation commerciale de Saint-Gall, dirigée par un directoire. Le Directoire commercial de Saint-Gall - ainsi dénommé à partir de ce moment-là et jusque dans les années 1990 - assume localement des tâches de politique financière et de marché et défend les intérêts des négociants saint-gallois à l’encontre des cantons fédéraux et des pays étrangers. Les commerçants de Saint-Gall sont confrontés à la concurrence venant d’Appenzell. Au XVIIIe siècle, la famille Zellweger, réformée, façonne le commerce de toiles de lin, puis du coton brut et de tissus de coton. Cette famille dirige des entreprises textiles prospères et installe des filiales à Lyon, Gênes et Barcelone. Pendant le Blocus continental napoléonien au début du XIXe siècle, les commerçants suisses en général et ceux de Saint-Gall et d’Appenzell en particulier bataillent pour préserver le libreéchange. Président du Directoire de 1863 à 1886, le commerçant saint-gallois Carl Emil Viktor von Gonzenbach joue un rôle majeur lors de la création de l’Union suisse du commerce et de l’industrie. Comme cette corporation commerciale n’accepte que des citoyens de la ville de St-Gall, une chambre de commerce et de l’industrie se crée au niveau cantonal en 1875 ; à l’instar du Directoire commercial, elle devient également membre de l’USCI en 1887. Au XXe siècle, Ueli Forster, entrepreneur textile de Saint-Gall, est membre du Directoire commercial et, après la fusion de celui-ci avec la Chambre de commerce et d’industrie cantonale en la Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Gall-Appenzell en 1991, il en devient le premier président. En 2001, Forster reprend la présidence d’Economiesuisse, nouvellement créée.

La maison de la société du Notenstein à côté de la porte Brühl à Saint-Gall, XVIIe siècle.
Le Blocus continental napoléonien (1803–1813)
La Suisse prise dans une guerre économique mondiale
Les guerres napoléoniennes coûtent la vie à des millions de personnes. La domination napoléonienne s’accompagne par ailleurs d’une longue guerre économique – surtout contre l’Angleterre – qui appauvrit l’ensemble du continent européen. La France ayant connu un état proche de la guerre civile pendant la décennie qui suit la Révolution française de 1789, le règne de Napoléon paraît souvent sous un jour positif dans l’historiographie. Napoléon Bonaparte devient en 1799 l’un des trois consuls à la tête de la France, se fait sacrer empereur en 1804 et est exilé par les Alliés sur l’île britannique d’Elbe en 1815.
Au XVIIIe siècle, la France, ancienne puissance économique, stagne et accumule les dettes sous le règne du Roi-Soleil Louis XIV et de ses successeurs. Pendant ce temps, l’Angleterre et les Pays-Bas se bâtissent un empire dans le Nouveau Monde, en Amérique et en Asie. La Suisse et certaines régions allemandes bénéficient de cette expansion politique au niveau économique en appuyant leur prospérité sur le commerce et la transformation industrielle de denrées coloniales. Au temps de la Révolution déjà, l’élite dirigeante de France considère cela d’un mauvais œil. Après sa prise du pouvoir, Napoléon s’attèle d’abord à briser la suprématie économique de l’Angleterre. Il annihile ensuite celle des Pays-Bas en les annexant purement et simplement et en intronisant son frère Louis comme roi. Napoléon exige des autres pays du continent européen qu’ils rompent tout contact avec l’Angleterre et s’inscrivent dès lors dans un système dit continental. Non seulement l’importation de marchandises anglaises est interdite, mais aucun Anglais n’est autorisé à fouler le sol du continent européen. Conscient qu’il n’a pas les moyens militaires de conquérir les colonies d’outre-mer des Anglais et des Néerlandais, il annexe sans autre forme de procès les Pays-Bas, puis coupe les flux commerciaux des colonies et des États-Unis d’Amérique – qui viennent d’acquérir leur indépendance – vers l’Angleterre. Il accepte que le Blocus précipite des millions d’européens dans la misère, d’autant plus qu’il sacrifie des centaines de milliers de soldats sur les champs de bataille. Napoléon a une piètre opinion de la Confédération et il l’exprime aux émissaires suisses dès 1802 : « Vous ne pouvez avoir de grandes finances. Vous êtes un pays pauvre. » Cela ne l’empêche pourtant pas de dilapider le trésor public de Berne qu’il s’est approprié pour financer sa campagne d’Égypte ni, une fois devenu empereur en 1804, d’ajouter officiellement en 1806, après la signature de l’acte de Médiation de 1803, le titre de « médiateur de la Confédération suisse » à sa titulature. Après le traité de Vienne, il y adjoindra celui de « seigneur de Rhäzüns » en 1810, les Autrichiens lui ayant cédé la seigneurie et le château.
Les Britanniques savent mettre à profit leur victoire lors de la bataille de Trafalgar en 1805, et leurs forces navales coupent complètement la France de ses colonies d’outre-mer. Face au Blocus continental, les Britanniques contrôlent aussi les navires neutres, se prémunissent contre la piraterie et aident leur flotte marchande à ouvrir – plus que jamais – de nouveaux marchés outre-mer. Pays enclavé, la Suisse marche dans le sillage de la Grande-Bretagne. Ainsi s’esquisse, au début du XIXe siècle, le futur grand rôle géopolitique et économique de la Grande-Bretagne, même si la France de Napoléon paraît dans un premier temps invincible sur le continent. En Suisse, en plein bouleversements politiques à la suite de l’Helvétique et de la Médiation de 1803, l’heure des directoires commerciaux cantonaux est venue. L’appareil étatique de l’ancienne Confédération est dissous et, à partir de 1798, des formes de régime sans cesse différentes sont imposées à la Suisse, à la va-vite. Pendant ce temps, des organisations commerciales comme le Directoire commercial de Saint-Gall subsistent et défendent les intérêts des négociants suisses et de l’industrie. En 1798, il n’existe officiellement plus que les chambres de commerce de Saint-Gall et de Zurich, mais de nouvelles se forment aussitôt dans les autres cantons. Pendant que les chambres de commerce cantonales supervisent concrètement les activités de contrebande des commerçants, le canton directeur de Berne en la personne de Niklaus Rudolf von Wattenwyl, Landammann de la Suisse et président de la Diète, tente d’apaiser l’ambassadeur de France en Suisse et de négocier la réduction des droits de douane. Tandis que les incessantes hausses tarifaires et restrictions à l’importation imposées par Napoléon finissent par condamner de jure les débouchés en France, principal partenaire commercial de la Suisse pendant trois siècles, la Suisse devient de facto la plaque tournante du continent pour les matières premières. Que les commerçants suisses ne respectent pas le Blocus contrarie énormément le chargé d’affaires de France en Suisse. Il les qualifie d’ailleurs de « contrebandiers » et de « fraudeurs ». Au même moment, Napoléon lève une armée de 8000 mercenaires en Suisse, dont les derniers survivants défendent les ponts sur la rivière biélorusse Bérézina, lors de la campagne de Russie en 1812. Malgré l’intervention des Suisses sur les bords de la Bérézina, le fragile équilibre entre la France et la Suisse depuis la Paix perpétuelle de 1516 – privilèges commerciaux français contre mercenaires suisses – ne tient littéralement plus qu’à un fil de soie grège. Dans la principauté de Neuchâtel, au curieux statut double de canton et de principauté restituée au roi de Prusse, la destruction par le feu des marchandises britanniques est décrétée en 1810. La Suisse est alors au creux de la vague causée par le Blocus continental.
Si la Confédération subit déjà les effets des mesures protectionnistes françaises avant le Blocus décrété en 1803, la guerre économique éclate réellement en octobre de cette même année. En effet, la France décide de frapper les exportations suisses de cotonnades de lourdes taxes avant de les interdire totalement en février 1806. Même le transit de produits manufacturés suisses vers l’Espagne est prohibé. Napoléon proscrit en 1804 toute exportation vers la Suisse de chanvre et de lin belges ou alsaciens ; en 1805, les livraisons de soie grège piémontaise sont également interdites. Sous la pression politique extérieure, la Diète se rallie en 1806 à l’interdiction d’importer des marchandises britanniques, à la seule exception, admise par le gouvernement français, des filés mécaniques, produit de base des tisserands suisses. L’application de ces mesures est confiée aux cantons frontaliers, et le trafic commercial avec le nord et l’est est restreint et doit passer par treize postes de douane seulement. Durant les années suivantes, la Suisse importe du Levant presque tout le coton brut, en particulier égyptien, indispensable à la survie de son industrie textile.
Par le décret de Trianon d’août 1810, toutes les denrées coloniales – sauf françaises – sont frappées d’une taxe douanière pouvant atteindre 50 pour cent de leur valeur. Des tribunaux spéciaux sont alors créés pour réprimer la contrebande. Les inspecteurs de Napoléon dressent des listes noires des sociétés suisses faisant prétendument de la contrebande et veulent confisquer leurs stocks de marchandises. Les États frontaliers reçoivent l’ordre d’instaurer un blocus complet contre la Suisse. La mise sous séquestre des denrées coloniales et produits manufacturés anglais, couplée à l’interdiction d’exporter des denrées coloniales et du coton levantin de l’Italie, du Bade, du Wurtemberg et de la Bavière vers la Suisse provoquent du chômage dans l’est du pays et ruinent des maisons de commerce à Bâle et à Zurich. En octobre 1810, les troupes italiennes occupent le Tessin, avec l’accord de Napoléon, sous prétexte de lutter contre la contrebande. Par un appel urgent évoquant la situation économique précaire des cantons, le Landamman von Wattenwyl obtient fin décembre 1810 que Napoléon autorise à nouveau l’importation de coton levantin et que la Confédération du Rhin lève son interdiction de transit en 1811. Jusqu’à la fin du règne napoléonien par la bataille de Leipzig en 1813, la Suisse connaît faillites, famine et chômage. Le déclin de l’industrie de la broderie est prévisible.
Sur le plan international, la nature du commerce mondial change profondément à l’époque du Blocus, mais aussi les idées qui ont façonné la vision du monde de la population européenne – ce qui se répercute à nouveau sur le commerce mondial. En 1807, en pleine guerre commerciale napoléonienne, le Parlement britannique interdit le trafic transatlantique d’esclaves. Ainsi prend fin le commerce triangulaire, structure sous-jacente du commerce mondial au XVIIIe siècle. Jusqu’au début du XIXe siècle, les esclaves sont considérés comme des denrées coloniales, au même titre que le coton, le sucre de canne, le thé, les épices ou le tabac. L’abolition de 1807 rend aux esclaves leur dignité d’êtres humains. Les sociétés européennes commencent à prendre conscience des conditions de travail dans lesquelles les produits coloniaux sont fabriqués et, d’une manière générale, des conditions de vie des populations d’outremer. Le philosophe genevois Jean-Jacques Rousseau, fils d’un horloger huguenot, a déjà sévèrement condamné l’esclavage au XVIIIe siècle et, par ses œuvres, ouvert la voie à la Révolution française. Au début du XIXe siècle, les Lumières pressenties par Rousseau et d’autres philosophes se traduisent par des lois concrètes conférant une orientation différente au commerce mondial.
Napoléon inscrit les commerçants suisses sur une « liste noire ». Lettre du chargé d’affaires de France, Rouyer, à la Diète fédérale, 11 octobre 1810
Monsieur le Landamman,
Sa Majesté l’Empereur a reçu de nouveaux renseignements sur les nombreuses expéditions de marchandises anglaises et de denrées coloniales qu’on dirige habituellement sur la Suisse. Tous les capitalistes anglais qui avaient par eux-mêmes ou par leurs correspondants des entrepôts dans les villes hanséatiques, dans le Holstein, en Hollande et dans plusieurs parties de l’Allemagne, se sont efforcés de transporter en Helvétie leurs magasins, depuis que partout ailleurs des tarifs ou des lois prohibitifs sont uniformément établis. Toutes les routes d’Allemagne sont encombrées de ces marchandises, qu’on fait passer en Suisse, et les expéditionnaires vont jusqu’à doubler et tripler les prix de transport pour augmenter le nombre des envois.
On a particulièrement remarqué que les cotons d’Amérique, les « Twists » ou « Fils de coton » débarqués dans les premiers mois de cette année ou jetés en contrebande sur les côtes de la Baltique, ont été successivement dirigés vers la Suisse, que les commissionnaires établis dans les principales villes d’Allemagne, craignant le séquestre des marchandises de fabriques anglaises et des denrées coloniales, font prendre la même direction à celles qu’ils avaient déjà dans leurs magasins, qu’ils les adressent principalement à Bâle, Berne, Zurich, Winterthour et Schaffhouse. La maison des frères Mérian de Bâle s’occupe avec plus d’activité que toutes autres de ces expéditions. Je joins ici la liste qui m’a été envoyée par mon gouvernement, des négociants suisses auxquels des envois de coton anglais, de marchandises et denrées coloniales continuent d’être habituellement expédiés par leurs correspondants d’Allemagne, surtout par ceux de Leipzig et de Francfort. Toutes ces marchandises ne proviennent pas de prises faites par les corsaires et de ventes de cargaisons confisquées. On regarde la plupart de ces expéditions comme le résultat d’un concert frauduleux entre les négociants, et ceux-ci recueillent en dernier résultat les principaux avantages de cette contrebande, qui se fait en Suisse avec plus d’activité que partout ailleurs, quoi qu’elle y soit prohibée par les lois.
Il n’est pas possible que cet ordre de choses subsiste plus longtemps. La Suisse doit marcher dans le sens des pays qui l’environnent, et les mêmes mesures doivent y être mises à exécution.
[…]
Agréez, Monsieur le Landamman, etc.
Le chargé d’affaires de France en Suisse, Rouyer
Au XVIIIe siècle, les marchands suisses, comme d’autres commerçants européens, prennent des parts dans des «négriers». Ces navires chargés d’armes, de textiles et de bijoux se rendent en Afrique de l’Ouest pour y troquer leur cargaison contre des esclaves qu’ils transportent ensuite vers l’Amérique, où ils les échangent contre des matières premières, notamment du coton. Ces dernières décennies, les chercheurs en histoire économique se sont posé la question de savoir si la révolution industrielle en Europe, et à plus forte raison en Suisse, l’un des premiers pays industrialisés, aurait été possible sans commerce triangulaire. D’après des recherches toutes récentes, cette révolution a surtout été alimentée par l’innovation technologique et seulement à 15 pour cent par les investissements provenant des bénéfices réalisés avec le commerce triangulaire. À cela s’ajoute que les avancées technologiques et scientifiques encouragent le développement d’une nouvelle vision de l’homme et du monde. Celle-ci prévoit la liberté et l’égalité des droits pour tous les humains et accorde un tout nouveau sens aux petites gens. Le philosophe écossais Adam Smith déclare à la fin du XVIIIe siècle que le boucher, le boulanger ou le brasseur sont ceux qui, comme guidés par une main invisible, approvisionnent l’humanité en viande, pain et bière. Tandis que Napoléon tente d’asservir l’ensemble du continent européen par la force, l’abolition de l’esclavage ouvre une nouvelle ère du commerce mondial. Haïti, où l’intervention militaire de Napoléon coûte encore la vie à un demi-million de personnes, est en 1804 la première nation composée d’anciens esclaves à déclarer son indépendance. Selon la pensée des Lumières qui commence à faire école, il ne faut pas seulement interdire la traite des êtres humains, mais aussi permettre à tous les individus de commercer librement.
Pendant que les savants d’Angleterre et d’Écosse développent la théorie du libre-échange et de l’économie de marché, les commerçants et les organismes commerciaux de Suisse pratiquent le libre-échange au sens tant moderne que médiéval du terme. Jusqu’à la fin du Blocus continental, les marchands suisses commercent « librement », dans la plus pure tradition médiévale, à savoir comme contrebandiers hors des embargos imposés par décision dictatoriale de Napoléon. Après le Blocus, la Confédération suisse peut de nouveau façonner sa politique économique extérieure en toute souveraineté. La Constitution de l’Acte de Médiation de 1803 accorde à la Diète fédérale le droit de conclure des contrats commerciaux avec d’autres pays. En décembre 1813, la Suisse se dote de son premier tarif douanier, essentiellement pour percevoir quelques taxes. Mais face aux contestations d’un mouvement populaire dirigé par le Directoire commercial de Saint-Gall, il ne dure que huit mois. Ce dernier refuse tout droit de douane sur le coton brut et se sent même assez fort pour affronter la concurrence des fabricants anglais. Lorsqu’à l’occasion du Congrès de Vienne en 1815, sa souveraineté est une nouvelle fois confirmée par les grandes puissances européennes, la Suisse constitue un îlot de libre-échange, de surcroît le plus moderne d’Europe. La Diète prélève, sur les fils de coton filés à la machine et les tissus uniquement, un batz douanier fixé si bas qu’il n’exerce pas d’effet de verrouillage.
Sur le long terme, le Blocus continental pose cependant des jalons importants pour l’économie suisse. Bon an mal an, les commerçants suisses conquièrent de nouveaux débouchés hors d’Europe, à commencer par les États-Unis encore jeunes. Forte de l’orientation mondiale de son commerce extérieur, la Suisse est pendant deux siècles le pays aux plus fortes exportations par habitant en Europe et aux plus gros investissements directs hors d’Europe, en particulier aussi dans les pays du Sud. Par ailleurs, la guerre économique du Blocus donne de nouvelles impulsions à l’économie domestique et à l’industrie textile suisse. L’absence de concurrence britannique sur le marché continental favorise le développement des filatures mécaniques de coton. Entre 1808 et 1814, une vague de création d’entreprises porte leur nombre à 60 dans le canton de Zurich, 17 dans celui de Saint-Gall et 7 en Appenzell. Des entrepreneurs comme Johann Caspar Zellweger à Trogen (Appenzell) ou Hans Caspar Escher à Zurich, proches du modèle anglais, trouvent des débouchés en Allemagne, malgré les entraves au commerce imposées par la France, et réalisent des bénéfices importants dans la conjoncture de la guerre. Dans le même temps, le Blocus retarde la disparition du filage à la main.
Après la chute de Napoléon et la levée du Blocus, des cotonnades anglaises à bas prix inondent le continent. Cela provoque en 1816/1817 une grave crise économique au sein de la Confédération qui n’est protégée par aucun droit de douane. Les guerres napoléoniennes sont terminées, mais le protectionnisme des États européens, lui, continue sans relâche, même après le Congrès de Vienne en 1815. Dans les années 1820, l’économie suisse est en piteux état. L’Allemagne, la Scandinavie et l’Italie centrale et méridionale sont les seuls pays ouverts aux exportations suisses. La disponibilité de mercenaires n’a plus guère d’importance et rend toute possibilité de pression à cet égard insignifiante. En outre, la solde relève de la compétence des cantons et les accords commerciaux de celle de la Diète fédérale.

Construite en 1801/02, la filature du Hard est la première en Suisse à être entièrement mécanisée, Winterthour, vers 1820.
Le mercantilisme a certes été banni sous Napoléon, mais les puissances européennes mènent désormais des politiques protectionnistes plus modernes. Une fois de plus, elles en paient le prix sur le plan économique. En termes de volume d’échanges, la Suisse dépasse dès 1820 l’Espagne, la grande puissance coloniale du début des temps modernes, tout comme la Belgique et l’Autriche. Et elle est, après l’Angleterre, leader de la filature mécanique du coton. En 1827, le canton de Zurich compte à lui seul plus d’une centaine de filatures employant quelque 5000 ouvriers. L’expérience du Blocus continental marque l’économie suisse qui s’affirme comme un acteur planétaire et se forge un esprit politique empreint de scepticisme à l’égard des grandes puissances européennes. Par ailleurs, pays d’accueil des penseurs français en exil, la Suisse devient un creuset des idées libérales. Le concept du citoyen libre et de ses vertus est inextricablement lié à celui de l’entrepreneur et de l’économie de marché. Après les années 1830, l’industrie suisse d’exportation se trouve pourtant confrontée à un renouveau du protectionnisme. Venant de l’Union douanière allemande (Zollverein), celui-ci s’étend rapidement et inclut bientôt les royaumes et principautés du sud de l’Allemagne. La Suisse septentrionale notamment perd ainsi un débouché essentiel. L’existence même de son économie est menacée. Mais au lieu d’adhérer à la « Zollverein », les forces libérales exigent la création d’un espace économique fédéral pour compenser les désavantages causés.