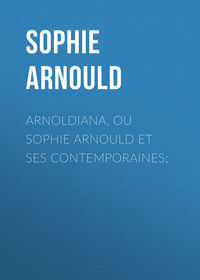Kitap dosya olarak indirilemez ancak uygulamamız üzerinden veya online olarak web sitemizden okunabilir.
Kitabı oku: «Arnoldiana, ou Sophie Arnould et ses contemporaines;», sayfa 3
Quelques années avant la révolution Sophie Arnould habitait à Clichy-la-Garenne une maison de campagne où, partagée entre les souvenirs et les jouissances que lui assurait son amour pour les arts, elle se livrait presque entièrement à l'agriculture et aux douceurs d'une vie paisible et retirée.
Elle vendit cette propriété, et acheta à Luzarches, en 1790, la maison des pénitens du tiers-ordre de Saint-François, et sur la porte elle fit graver cette inscription:
ITE MISSA EST.
(Allez vous-en; la messe est dite.)
Elle avait choisi au fond du cloître un endroit qu'elle destinait pour son tombeau, et elle y fit inscrire ce verset de l'Ecriture:
Multa remittuntur ei peccata quia dilexit multum.
Beaucoup de péchés lui seront remis, parce qu'elle a beaucoup aimé.
Des agens du comité révolutionnaire de Luzarches vinrent un jour chez elle faire une visite domicilière; quelques frères la traitant de suspecte: «Mes amis, leur dit-elle, j'ai toujours été une citoyenne très-active, et je connais par cœur les droits de l'homme.» Un des membres aperçut alors sur une console un buste de marbre qui la représentait dans le rôle d'Iphigénie; il crut que c'était le buste de Marat, et, prenant l'écharpe de la prêtresse pour celle de leur patron, ils se retirèrent très édifiés du patriotisme de l'actrice.
La révolution, qui a rompu tant de liens, dispersa tous les amis de Sophie; elle perdit alors une grande partie de sa fortune, qui se montait à près de trente mille livres de rente, tant en pensions qu'en contrats; néanmoins elle eût pu s'assurer un sort indépendant si elle n'eût pas mis toute sa confiance dans un homme d'affaires dont les malversations achevèrent de la ruiner.
On a vu dans ces temps de confusion cette femme, célèbre par son esprit et par ses conquêtes, cette femme, qui pouvait le mieux rappeler l'image d'une courtisane grecque, implorer vainement des secours auprès du Gouvernement; on a entendu mêler aux concerts mystiques des obscurs théophilantropes cette voix qui tonnait dans Armide, qui soupirait dans Psyché, et on a gémi en pensant à l'incertitude des événemens et aux mystères de la fatalité.
Sophie végétait dans un dénuement presque absolu lorsqu'elle apprit, en 1797, que M. F. venait d'être nommé l'un des premiers magistrats de l'état; son cœur tressaillit et s'abandonna facilement à la douce espérance que son ancien ami, élevé au faîte des grandeurs, viendrait bientôt à son secours; elle lui fit part de sa position pénible, et il l'invita à dîner pour le lendemain.
Mme D., présente à cette réunion, fut enchantée de rencontrer Sophie Arnould, qu'elle ne connaissait que de réputation; elle alla lui faire une visite, et, la voyant misérablement logée chez un perruquier de la rue du Petit-Lion, elle lui proposa un appartement dans sa maison. Sophie accepta avec la plus vive reconnaissance une offre aussi généreuse, et trouva bientôt près de sa nouvelle amie tous les charmes que les bons cœurs répandent autour d'eux.
M. F., redevenu ministre en 1798, fit obtenir à Sophie une pension de 2,400 fr. et un logement à l'hôtel d'Angivilliers, près le Louvre. Alors quelques amis se rapprochèrent d'elle; des gens de lettres et des artistes lui formèrent encore une société agréable.
Sophie Arnould conserva jusqu'au dernier instant tout l'enjouement de son esprit; les grâces semblaient avoir effacé la date de son âge, et la vivacité de ses saillies faisait oublier les ravages que le temps avait fait à ses charmes. Elle était attaquée d'un squirrhe au rectum, qui lui était survenu à la suite d'une chute: un jour, qu'elle avait rassemblé plusieurs docteurs pour examiner le siége secret de ce mal douloureux, elle dit: «Faut-il que je paie maintenant pour faire voir cette chose-là, tandis qu'autrefois…»
Elle mourut à l'hôtel d'Angivilliers sur la fin de 1802; sa dépouille mortelle fut portée dans le champ du repos de Montmartre; aucune pompe funèbre ne l'accompagna, aucun marbre ne lui servit de tombe: un de ses amis, témoin de cette modeste sépulture, s'écria douloureusement:
Ainsi tout passe sur la terre,
Esprit, beauté, grâces, talens,
Et, comme une fleur éphémère,
Tout ne brille que peu d'instans!
ARNOLDIANA
Sophie Arnould avait dix-huit ans moins deux mois lorsqu'elle parut pour la première fois à l'Académie royale de Musique; elle débuta dans le divertissement du ballet des Amours des Dieux, par un air détaché qui commence ainsi: Charmant Amour6. On lui a souvent entendu dire que cette invocation lui avait porté bonheur.
Dorat entra dans les mousquetaires à l'époque où Sophie Arnould fut reçue à l'Opéra; mais il quitta bientôt l'état militaire pour se livrer entièrement à la littérature. Ce poëte avait la prétention de passer pour homme à bonnes fortunes; Sophie, qui connaissait la faiblesse de ses moyens, lui dit un jour: «Mon cher Dorat, vous voulez jouer le berger Tircis; mais vous n'êtes pas fait pour ce rôle-là.»
Dans une promenade au bois de Romainville elle rencontra Gentil-Bernard, qui, rêvant à l'Art d'Aimer, était assis comme Tityre à l'ombre d'un hêtre: – Que faites-vous donc dans cette solitude? lui demanda Sophie. – Je m'entretiens avec moi-même, répondit le poëte: «Prenez-y garde, reprit-elle; vous causez avec un flatteur.»
On a vu rarement le double talent de la déclamation et du chant réunis dans le même sujet: Chassé posséda ce rare mérite; sa voix et son jeu l'élevèrent au rang des plus grands acteurs lyriques. Cet artiste se retira en 1757. Un musicien s'étant présenté pour lui succéder, Sophie lui dit: «Monsieur, si vous voulez être des nôtres, tâchez de vous faire Chassé.»
Mlle Clairon7 naquit en 1723 à Condé, petite ville du département du Nord, pendant le carnaval. Là tout le monde aimait le plaisir: le curé et son vicaire étaient masqués, l'un en Arlequin et l'autre en Gilles. On apporta l'enfant, qui avait l'air mourant, et le curé l'ondoya sans changer d'habit. Cette célèbre actrice qui occupa la scène avec tant d'éclat, débuta à l'Opéra-Comique à peine âgée de douze ans; elle passa de là aux Italiens, au grand Opéra, enfin aux Français, où la gloire l'attendait. Elle était galante, voluptueuse et peu intéressée. Quelque temps avant sa retraite, qui eut lieu en 1766, on parlait sourdement de son mariage avec M. de Valbelle, son amant intime, et en attendant elle vivait avec un Russe d'une réputation singulière. On disait à Mlle Arnould que ce sigisbée se contentait de lui baiser la main: «C'est tout ce qu'il peut faire de mieux,» répondit-elle.
Albaneze, sopraniste du Conservatoire de Naples, et l'un des plus fameux castrats8 que nous ayons eus, vint à Paris à l'âge de dix-huit ans. Une dame, l'ayant entendu chanter, en devint amoureuse, et parlait avec enthousiasme du charme de sa voix: «Il est vrai, dit Sophie, que son organe est ravissant; mais ne sentez-vous pas qu'il y manque quelque chose?»
Mlle Beaumenard, actrice de la Comédie française, avait joué en 1743 à l'Opéra-Comique, où elle était connue sous le nom de Gogo. Aucune actrice n'a demeuré si longtemps au théâtre. Le fermier général d'Ogny lui ayant donné une superbe rivière de diamans, une de ses camarades en admirait l'éclat, mais trouvait que cette rivière descendait bien bas: «C'est qu'elle retourne vers sa source, observa Sophie.»
Chévrier a présenté dans son Colporteur une satire affreuse des mœurs du siècle; les principales actrices de Paris y sont passées en revue, et chacune a son paquet. Cet écrivain virulent, poursuivi par la police, alla mourir en Hollande en 1762. Le bruit ayant couru qu'il s'était empoisonné: «Juste ciel! dit Mlle Arnould, il aura sucé sa plume.»
Poinsinet a fait imaginer le mot mystification pour exprimer l'art de tirer parti d'un homme simple en s'amusant de sa crédulité. Cet être singulier ne manquait pas de cette vivacité d'esprit naturel qui s'exhale quelquefois en saillies piquantes; mais il était absolument dénué de jugement. Un de ses prôneurs vantait un jour les nombreux ouvrages de Poinsinet en disant que peu d'auteurs avaient son esprit: «Je pense comme vous, reprit Mlle Arnould; Poinsinet a tant d'esprit dans sa tête que le bon sens n'a jamais pu s'y loger.»
Le lord Craffort, grand adorateur des vierges de l'Opéra, faisait le dévot et se ruinait au jeu. Sophie lui dit un jour: «Milord, vous ressemblez aux BONS CHRÉTIENS d'hiver; vous mûrirez sur la paille.»
J. – P. – N. Ducommun est auteur de l'Eloge du sein des Femmes. Un amateur, citant cet ouvrage à Sophie, disait qu'une belle gorge était ce qu'il prisait davantage chez les dames, mais que depuis longtemps il n'en trouvait pas: «Vraiment! répondit-elle; vous ne savez donc plus à quel SEIN vous vouer?»
Ce fut au danseur Léger que Mlle G. dut son premier pas et un enfant, dont elle accoucha dans un grenier9, au milieu de l'hiver, sans feu et sans linge. Depuis cette époque elle gagna un hôtel, un suisse, six chevaux, autant de domestiques, et une fois autant d'amans. On assure qu'elle a dû ses vertus et son humanité à l'état de dénuement où elle se trouva au commencement de sa carrière. Cette danseuse était fort maigre, et quoique sa danse fût maniérée et pleine d'afféteries, on l'avait surnommée le squelette des grâces. Un jour qu'elle dansait avec Gardel, son soupirant, et Dauberval, son favori, Sophie dit: «Je crois voir deux chiens qui se disputent un os.»
Un petit-maître, beau comme Adonis et pauvre comme Job, épousa la veuve d'un riche marchand de bois qui fournissait l'Opéra; un ami de la dame s'étonnait qu'à son âge elle eût fait choix d'un tel étourdi: «Mais cette femme entend très-bien le ménage, dit Mlle Arnould; pour que le feu s'éprenne ne faut-il pas que le bois sec soit sous le bois vert.»
Mlle Defresne, fille d'une blanchisseuse de Paris, était citée en 1735 comme une des plus jolies personnes qu'on pût voir; sa beauté fit sa fortune, et après avoir longtemps circulé dans le monde elle épousa le marquis de Fleury, qui lui vendit son nom et ses titres moyennant une pension viagère. Depuis cette mutation Mme la marquise de Fleury eut des armoiries, des gens qui portaient la queue de sa robe, et un carreau à l'église. Un jour qu'elle étalait à Saint-Roch son faste et son hypocrisie, Sophie dit à quelqu'un: «Examinez donc cette nouvelle marquise; elle devient dévote à vue d'œil; elle prie Dieu quand on la regarde.»
Une actrice de l'Opéra vivait avec un joueur qui lui mangeait tout ce qu'elle gagnait. Sophie, la voyant recourir souvent aux emprunts, lui dit: – Ton amant te ruine; comment peux-tu rester avec lui? – Cela est vrai; mais c'est un si bon diable! «Je ne m'étonne plus, reprit sa camarade, si tu t'amuses à tirer le diable par la queue.»
M. de Sennecterre, devenu aveugle, donna en 1762 une pastorale intitulée Hylas et Zélie; les paroles en sont plates, la musique pauvre, et les ballets insignifians. Mlle Arnould dit que ce spectacle était un opéra d'aveugle fait pour être entendu par des sourds.
Il est des femmes chez lesquelles règne une bonté d'âme incompatible avec des rigueurs constantes; elles n'ont pas la force de résister ni le courage de refuser. La tendre Gaussin10 était de ce caractère; jamais un refus n'est sorti de sa bouche. On disait que Chévrier avait recueilli les noms de mille trois cent soixante-douze soupirans auxquels cette actrice généreuse avait rendu service: «Cela prouve un grand cœur, observa Sophie; mais qui sert tout le monde n'oblige personne.»
Un Anglais qui faisait la cour à Mlle Beaumenard vint prier Sophie de le raccommoder avec cette actrice. – Qui vous a donc brouillé? – Vous savez bien qu'elle avait un épagneul; ce petit animal venait toujours me mordre les jambes; je lui ai donné un coup de pied, et il en est mort. – Ah, milord, quel coup de pied! – Cela est vrai; mais, voulant réparer le mal, je lui ai porté un joli petit chien anglais. – Hé bien? – Hé bien, elle a pris la petite bête, l'a jetée par la fenêtre, et il est resté mort sur le pavé. —Encore! répartit Sophie; «mais c'est le massacre des innocens que cette histoire-là.»
Il se trouvait à Paris en 1763 un arrière petit-fils de Racine par les femmes. Comme il ne restait aucun mâle, et que le dernier mort et son fils avaient très-peu joui de leurs entrées au théâtre Français, ce jeune homme crut pouvoir recueillir cette espèce de succession littéraire, et attendre cette grâce du respect et de la reconnaissance des comédiens pour leur bienfaiteur; mais ces messieurs, sous prétexte qu'une telle faveur nuirait à leurs intérêts, refusèrent tout net les entrées au descendant de Racine. Mlle Arnould dit en apprenant cette lésinerie: «Qu'est-ce qu'une ENTRÉE de plus ou de moins pour des gens qui vivent de Racine.»
Un jeune homme lisait des vers faits contre une femme dont il avait à se plaindre; un ami de la belle prit l'épigramme et la déchira. Il s'en suivit une dispute fort vive qui les conduisit au bois de Boulogne, où l'agresseur reçut un violent coup d'épée. Celui-ci, quelque temps après, étant au foyer, racontait sa triste aventure: «Voilà ce qui arrive, dit Sophie; qui casse les VERS les paie.»
Mlle Dubois débuta au théâtre Français en 1759, et par l'effet de la jalousie et des cabales elle resta douze ans à l'essai. Cette actrice, voulant courir plusieurs carrières à la fois, se fit recevoir au Concert spirituel en 1763; mais quoiqu'elle eût du talent et une figure intéressante, on lui trouvait de grands bras, des gestes monotones et une âme froide. Quelque temps avant son début quelqu'un ayant demandé à Sophie ce qu'elle pensait de cette chanteuse, elle répondit: «C'est une VOIX DE BOIS que nous essaierons cet hiver.»
Peu d'hommes ont été traités de la nature aussi bien que le philosophe Helvétius; elle lui avait accordé la beauté, la santé et le génie. Dans sa jeunesse il était bon danseur et fréquentait souvent l'Opéra; aimable, beau, riche et généreux, il dut faire beaucoup de conquêtes, et Sophie devint une des siennes. Il lui avait envoyé le jour de sa fête, un riche cadeau, et il resta quelque temps sans lui parler. Sophie, ennuyée de ce retard, lui dit naïvement: «Est-ce que vous voulez perdre ce que vous m'avez donné?»
Mlle Durancy11 fut consacrée au théâtre dès sa plus tendre enfance. Douée d'une intelligence supérieure, et encouragée par ses premiers essais en province, elle débuta à la Comédie française en 1759, dans l'emploi des soubrettes, à peine âgée de treize ans; elle passa ensuite à l'Opéra en 1762, et s'éleva aux rôles de reines. Cette actrice avait la voix rauque et le cri un peu poissard; un jour qu'elle chantait le rôle de Clytemnestre dans Iphigénie, elle fut sifflée: «Cela est étonnant, dit Sophie, car Durancy a la voix du peuple.»
Le docteur Bartès disait un soir au foyer de l'Opéra que la goutte est la seule maladie qui donne de la considération dans le monde: «Je le crois bien, reprit Mlle Arnould; c'est la croix de Saint-Louis de la galanterie.»
En 1763 plusieurs amateurs reçurent pour étrennes un petit almanach contenant vingt-six couplets sur vingt-six danseuses de l'Opéra et leurs entreteneurs. Mlle Lany, qui à cette époque était la première danseuse de l'Europe, se trouvait à la tête de cette satire, et en paraissait désolée: «De quoi te plains-tu, ma chère Lany! lui dit Sophie; on a rendu justice à tes talens, puisqu'on t'a choisie pour ouvrir le bal.»
Laharpe12 dans sa jeunesse fut mis au Fort-l'Evêque pour avoir fait une satire contre ses professeurs. A cette époque il arriva au concert spirituel un accident qui mit ce spectacle en désordre; une harpe fut brisée au milieu d'une symphonie par la chute d'une personne. Comme on cherchait à remplacer cet instrument, Mlle Arnould s'écria: «Si vous voulez être d'accord, n'allez pas chercher Laharpe du Fort-l'Evêque.»
Clairval débuta à l'Opéra-Comique en 1756. Aucun acteur n'a joué avec plus de noblesse le Magnifique et l'Amant jaloux. Il était très bel homme; ses manières étaient séduisantes; il n'en fallait pas davantage pour qu'il devînt la coqueluche de toutes les femmes. Sa passion pour le jeu lui fit perdre 30,000 l. au jeu de la Belle. Sophie dit en apprenant cette mésaventure: «Il n'y a pas de mal qu'une BELLE lui soit cruelle.»
Deux jeunes danseurs s'amusaient à lutter en attendant une répétition. Une figurante, qui prenait intérêt à ces athlètes, s'approcha d'eux pour mieux juger de leur adresse; lorsqu'elle revint à sa place Sophie lui dit en riant: «Hé bien, ma chère, tu connais maintenant le fort et le faible de cette affaire-là?»
M. Bertin avait fait une telle dépense pour Mlle Hus, que le mobilier de cette actrice était estimé plus de 500,000 liv. Tant de bienfaits ne purent fixer le cœur de cette volage, et M. Bertin la trouva, un beau matin, couchée dans sa maison de campagne avec le fils de l'entrepreneur des eaux de Passy. Quelques jours après Sophie dit à M. Bertin: «J'ai des obstructions; dites-moi donc comment Mlle Hus se trouve des eaux de Passy?»
Le 6 avril 1763, entre onze heures et midi, le feu se déclara, on ne sait comment, dans la salle de l'Opéra: en peu de temps l'incendie dévora tout. Quelques heures après ce funeste événement, une grande dame rencontra Sophie, et lui dit d'un air effrayé: – Mademoiselle, racontez-moi ce qui s'est passé à cette terrible incendie? «Madame, répondit-elle, tout ce que je puis vous dire c'est qu'incendie est du masculin.»
Mlle Miré13, plus célèbre courtisane que bonne danseuse, était fort exigeante en amour; il lui fallait preuve sur preuve, et plus d'un brave y succomba. L'un d'eux étant mort au champ d'honneur, Sophie dit à ce sujet: «Ordinairement la lame use le fourreau; mais ici c'est le fourreau qui a usé la lame.»
Le pauvre défunt avait été musicien. Un de ses camarades voulant lui faire une épitaphe, Sophie proposa le rébus suivant:
La mi ré la mi la.
La Miré l'a mis là.
Un cri général s'éleva contre la nouvelle édition des Œuvres de Corneille publiée par Voltaire; on fut indigné non seulement de la critique amère et dure que le commentateur faisait de Pierre Corneille, mais de ce qu'il y enveloppait les deux pièces de Thomas restées au théâtre. Sophie, entendant analiser cette espèce de satire, se mit à dire: «Voltaire eût mieux fait de bâiller (BAYER) aux corneilles que de songer à leur couper les ailes.»
Mlle Maisonneuve, petite-fille de la femme de chambre de Mlle Gaussin, débuta en 1763: elle jouait dans la Gouvernante; et comme elle était en tête à tête avec son amant on vint l'avertir de se retirer. En fuyant elle tomba dans la coulisse et laissa voir son derrière. Le public fêta beaucoup ce nouveau visage, et Sophie s'écria: «Quel heureux début! jamais actrice ne mérita mieux d'être claquée.»
Un danseur, rentrant tout essoufflé dans la coulisse, dit en se jetant sur un siége: – Je n'en puis plus! N'est-il pas un autre emploi qui m'enrichisse sans tant me fatiguer? «Hé bien! répondit Sophie, il faut prendre l'emploi de cocu; c'est la femme qui en fait tout l'exercice.»
Mlle Dumesnil, actrice de la Comédie française, buvait comme une éponge14. Son laquais, lorsqu'elle jouait, était toujours dans la coulisse pour l'abreuver, et ce vice la mettait souvent dans le cas de substituer sur la scène les écarts de sa raison aux désordres des grandes passions qu'elle devait peindre. Un jour qu'elle remplissait le rôle de Médée quelqu'un dit en l'applaudissant: – Ne semble-t-il pas que ses yeux distillent le poison? «Dites plutôt, reprit Sophie, que le vin lui sort par les yeux.»
En 1763 on entendit au concert spirituel un cor de chasse qui étonna tout Paris; c'était le seigneur Rhodolphe. Jusque-là cet instrument n'avait point été porté à un tel degré de perfection; il imitait tour à tour la flûte la plus douce et la trompette la plus éclatante. Un musicien, jaloux de ces succès, prétendit qu'un cor de chasse ne pouvait exciter aucun sentiment tendre. «A vous entendre, dit Mlle Arnould, on croirait que Rhodolphe est un COR sans âme.»
Une Mme Lecoq, attachée à l'administration de l'Opéra, fréquentait souvent ce spectacle; elle avait la voix fausse, et cependant elle aimait beaucoup à fredonner. Un jour elle se plaignait de ce que son mari la faisait toujours taire quand elle répétait des airs nouveaux. «Madame, lui dit Sophie, c'est que la poule ne doit jamais chanter devant le coq.»
Le sieur Guignon, reçu à la musique du roi en 1733, devint l'émule du fameux Leclair pour le violon. Son talent supérieur pour le jeu de cet instrument lui avait mérité l'office de roi et maître des ménétriers du royaume. Mlle Arnould se trouvant en soirée avec la femme de ce musicien, on lui proposa de faire avec elle une partie de wisk. «Je ne veux point d'une telle partner, dit Sophie; cette dame porte guignon.»
Mlle Fel a été l'une des meilleures actrices de l'Opéra pour les rôles tendres, et la plus agréable cantatrice du concert spirituel. C'est, disait-on, un rossignol qui chante, un ruisseau qui murmure un zéphir qui folâtre. Elle quitta le théâtre en 1758, et afficha pendant quelque temps une sorte de sagesse. Quelqu'un citant la vie retirée de Mlle Fel, Sophie répliqua: «Ne vous y fiez pas; cette fille ressemble à Pénélope; elle défait la nuit ce qu'elle a fait le jour.»
Après l'incendie de l'Opéra en 1763 on éleva sur le même terrain une nouvelle salle qui s'ouvrit le 24 janvier 176415; elle était richement décorée, mais la construction du parterre et des loges fut généralement critiquée. Le paradis en était si reculé et si exhaussé qu'on y était comme dans un autre monde. Mlle Arnould dit à l'architecte Soufflot: «Ah, monsieur! que deviendrons-nous s'il faut crier comme des DIABLES pour être entendus du PARADIS?»
Champfort avait vingt-un ans lorsqu'il donna sa comédie de la Jeune Indienne. Cette pièce, dont le sujet est tiré du Spectateur Anglais, n'eut pas de succès, ce qui fit dire à Sophie que l'Indienne avait fait baisser la TOILE.
Mlle Duprat de l'Opéra perdit le procès qu'elle avait intenté à Poinsinet pour cause d'escroquerie, malgré le mémoire que fit pour elle M. Coqueley de Chaussepierre, avocat au parlement et chef du conseil des comédiens. – Quel désagrément! disait Mlle Durancy; cela me fait encore détester davantage les procès. «Je le crois, reprit Sophie; tu ne chicanes point, toi; tu accordes tout.»
Mlle Robbe débuta à l'Opéra en 1765. Cette jolie danseuse inspira de l'amour au comte de L., qui fit part à Sophie de l'impression que la nouvelle fée avait faite sur son cœur. Celle-ci reçut la confidence avec philosophie; elle prit sur elle de suivre le nouveau goût de son infidèle, et d'en apprendre des nouvelles de sa propre bouche. Un jour qu'elle lui demandait où il en était, il ne put s'empêcher de lui témoigner qu'il était désolé de rencontrer toujours chez sa divinité un certain chevalier de Malte qui l'offusquait fort. «Hé bien, répartit Sophie, ce rival accomplit son vœu de chevalier de Malte; il fait la guerre aux infidèles.»
De tous les auteurs dramatiques Lemierre est celui dont le style âpre et rude rappelle davantage celui de la fameuse Pucelle de Chapelain. Parmi les vers tudesques dont ce poëte a parsemé sa tragédie de Guillaume Tell, on remarque ce passage rocailleux:
Je pars, j'erre en ces rocs dont partout se hérisse
Cette chaîne de monts qui couronne la Suisse.
La Veuve du Malabar offre celui-ci:
Toi prêtre! toi bramine! et tu n'es pas même homme.
Mlle Arnould avait surnommé Lemierre le chapelain de Saint-Roch16.
Le duc de *** était bossu, et avait, comme beaucoup de grands, la manie d'afficher des goûts qu'il n'éprouvait pas; il possédait surtout une riche collection de livres qu'il citait souvent. Sophie disait de ce seigneur: «Sa bibliothèque a le sort de sa bosse; elle est à lui, il s'en fait honneur, et jamais il ne la regarde.»
Le célèbre musicien Rameau17 mourut en 1764. L'Académie royale de musique fit célébrer pour lui, dans l'église de l'Oratoire, un service solennel. Plusieurs beaux morceaux des opéras de Castor et de Dardanus furent adaptés aux prières qu'il est d'usage de chanter dans cette cérémonie. Mlle Arnould, rappelant le nom et les talens de l'homme illustre que la France venait de perdre, s'écria: «Nos lauriers ont perdu leur plus beau Rameau!»
Vestris père, surnommé le diou de la danse, ayant appelé Mlle Heynel catin18, le public, à qui elle appartenait, le força de lui faire des excuses en plein théâtre. La veille de cette réparation Mlle Heynel se plaignait du propos indécent de Vestris. «Que veux-tu, ma chère, répondit Sophie, il faut se consoler de tout; les gens aujourd'hui sont si grossiers qu'ils appellent les choses par leur nom.»
La fille d'un premier président de la Chambre des Comptes de Dôle, à la veille d'être forcée à un mariage qui lui répugnait, introduisit secrètement son amant dans sa chambre, et rendit ses père et mère témoins malgré eux de son mariage physique. Cet événement singulier fit beaucoup de bruit, et il s'en suivit un long procès: «Voilà où conduit la tyrannie des parens, dit Mlle Arnould; quand une fille est condamnée à l'hymen elle en appelle à l'amour.»
Mlle Gaussin, cette héroïne du théâtre français, dont les talens et les grâces ont été si chantés, épousa en 1758 un danseur italien, nommé Toalaigo, qui la rendit fort malheureuse; cinq ans après elle quitta le théâtre et se fit dévote: «Tel est le sort des femmes galantes, dit Sophie; elles se donnent à Dieu quand le diable n'en veut plus.»
Le Siége de Calais, tragédie de Dubelloy, jouée en 176519, obtint un succès prodigieux, grâces au sujet national que l'auteur avait choisi, et au jeu brillant de Molé. Dans le même temps les comédiens italiens annoncèrent Tom Jones, comédie de Poinsinet. Sophie dit: «Je ne crois pas que Poinsinet fasse lever le siége de Calais.»
Le Concert spirituel était un spectacle public dans lequel on exécutait, les jours où les théâtres étaient fermés, des motets et des symphonies; il avait été établi en 1725 dans la salle des suisses des Tuileries, et on le rétablit en 1763, après l'incendie de l'Opéra, afin de dédommager le public de la privation de ce spectacle, en attendant que la nouvelle salle fût construite. Mlle Arnould disait que ces concerts étaient de l'onguent pour la brûlure.
La comédie du Cercle est la seule pièce de Poinsinet qui soit restée au théâtre. Cet ouvrage est un mélange de plusieurs scènes pillées dans une comédie de Palissot, jouée à Nancy en 1756, sous le même titre. Lorsque cette pièce en mosaïque parut, Sophie qui connaissait la source où Poinsinet avait puisé, lui dit un jour qu'il se targuait de cette composition: «Mon cher Poinsinet, il ne faut pas juger le vin au CERCLE.»
Lorsqu'elle mit au monde son premier né tous ses amis allèrent chez elle entretenir les caquets de l'accouchée – Bon dieu, dit-elle, que l'on souffre pour des jeux d'enfant! – Il est un remède qui prévient ces douleurs-là, observa gravement un médecin. – Quel est-il? – La continence. —Que me proposez-vous là, s'écria-t-elle; le remède est pire que le mal.
Mlle Clairon fut la première qui osa paraître sur la scène sans paniers, et son exemple fut imité par toutes ses compagnes. Cette actrice, ayant refusé de jouer dans le Siége de Calais avec un nommé Dubois, accusé d'une bassesse, excita parmi ses camarades, quoique la pièce fût affichée, une telle insurrection, que la plupart furent mis au Fort-l'Evêque; la reine du théâtre y alla comme les autres; le public s'amusa beaucoup des débats du tripot comique, et Mlle Arnould s'écria: «Cette conduite est impardonnable; jamais on n'a vu une troupe bien disciplinée manquer un jour de SIÉGE.»
Favart a fait le portrait de Mlle Beaumenard dans son opéra de la Coquette sans le savoir. Cette actrice sur la fin de son été s'éprit de belle passion pour son camarade Belcourt, et l'épousa en lui offrant les dépouilles d'une multitude d'amans ruinés en son honneur. Quelqu'un, citant l'inconstance et la légèreté de Mme Belcourt, comparait les coquettes aux girouettes: «Ce sont bien de vraies girouettes, reprit Sophie; car elles ne se fixent que quand elles sont rouillées.»
Les Italiens donnèrent en 1766 le Braconnier et le Garde de Chasse, comédie mêlée d'ariettes. Cette pièce fut trouvée détestable, et on la raya du répertoire. Quelque temps après quelqu'un dit devant Mlle Arnould: – On n'entend plus parler du Braconnier: – «C'est qu'on l'a envoyé aux galères,» répondit-elle.
Un exempt fut chargé de conduire Mlle Clairon au Fort-l'Evêque à cause de son incartade contre l'acteur Dubois. L'héroïne, s'adressant à l'alguazil, lui dit que ses biens, sa personne et sa vie dépendait de S. M., mais qu'elle ne pouvait rien sur son honneur. Ce propos rapporté à Sophie, elle répartit: «C'est juste; partout où il n'y a rien le roi perd ses droits.»
Deux jolies danseuses discutaient la beauté de leurs gorges; elles prirent pour arbitre Mlle Arnould, qui, après avoir examiné les pièces du procès, jugea qu'il serait difficile de décider laquelle des deux méritait le prix: «Au surplus, ajouta-t-elle, il est permis à chacun de prêcher pour son SEIN.»
Mlle Beaumesnil, âgée de dix-sept ans, remplaça en 1766 Mlle Arnould dans le rôle de Sylvie; elle fut la première qui eut assez l'esprit de son art pour se décolorer sur la scène, afin de mieux rendre en plusieurs circonstances la situation de son personnage. Cette actrice avait pour favori un médecin qui lui faisait prendre tous les matins un lavement, afin d'entretenir sa fraîcheur. Sophie se trouvant chez elle au moment de l'opération: – Tu vois, lui dit Beaumesnil, comme mon docteur me prouve sa tendresse. —Cette attention-là, répondit sa camarade, est un vrai remède d'amour.
Louis XV avait un sérail qu'on appelait le Parc aux Cerfs. Les jeunes personnes qu'on y élevait n'en sortaient que pour se marier. Le chevalier de… n'ayant point de fortune, consentit en faveur de la dot à prendre une de ces sultanes validés. Sophie, le voyant quelque temps après dans un brillant équipage, lui dit en riant: «Ah, ah, chevalier! on voit bien que vous êtes entré dans les affaires du roi.»
M. Bouret, ce fameux fermier général qui mangea, dit-on, quarante-deux millions et qui mourut insolvable, affichait un luxe dont on ne peut se faire d'idée; il le poussait au point d'avoir nourri une vache avec des petits pois verts à cent cinquante livres le litron, pour régaler dans la primeur une femme qui ne vivait que de lait. Ce fastueux financier désirait former une liaison avec Mlle Arnould. Il se jeta à ses genoux; elle parut inexorable: il lui jura de l'aimer toute sa vie; elle fut inflexible: il lui présenta un superbe diamant; elle sourit, et lui dit en parodiant le mot de Henri IV à Sully: «Relevez-vous; on croirait que je vous pardonne.»
Un amateur, ravi de ses accens mélodieux, lui adressa cet impromptu:
Que ta voix divine me touche!Et que je serais fortunéSi je pouvais rendre à ta boucheLe plaisir qu'elle m'a donné!
[Закрыть]
Garrick, célèbre acteur anglais, se trouvant à Paris en 1763, mit ce quatrain au bas d'un tableau qui représentait Mlle Clairon couronnée par Melpomène:
J'ai prédit que Clairon illustrerait la scène,Et mon espoir n'a point été déçu:Elle a couronné Melpomène;Melpomène lui rend ce qu'elle en a reçu.
[Закрыть]
Barthe composa en 1767 une pièce de vers intitulée: Statuts pour l'Académie royale de Musique. Voici l'un des vingt-deux articles qui les composent:
Tous remplis du vaste desseinDe perfectionner en France l'harmonie,Voulions au pontife romainDemander une colonieDe ces chantres flûtés qu'admire l'Ausonie;Mais tout notre conseil a jugé qu'un castra,Car c'est ainsi qu'on les appelle,Etait honnête à la chapelle,Mais indécent à l'Opéra.
[Закрыть]
Barthe, dans ses Statuts pour l'Opéra, dit à ce sujet:
Que celles qui, pour prix de leurs heureux travaux,Jouissent à vingt ans d'une honnête opulence,Ont un hôtel et des chevaux,Se rappellent parfois leur première indigence,Et leur petit grenier et leur lit sans rideaux.Leur défendons en conséquenceDe regarder avec pitiéCelle qui s'en retourne à pié;Pauvre enfant dont l'innocenceN'a pas encore réussi,Mais qui, grâces à la danse,Fera son chemin aussi.
[Закрыть]
Gaussin en recevant le jourOffrit l'art d'aimer et de plaire,Et jamais enfant de l'amourNe ressembla mieux à son père.A. D.
[Закрыть]
Cette actrice jouant le rôle d'Ernelinde dans l'opéra de ce nom, Favart lui adressa ces vers:
O Durancy! par quels charmes puissans,Par quel heureux prestige abuses-tu mes sens?C'est l'effet de ton art suprême.Je cours à l'Opéra pour t'entendre et te voir:L'actrice disparaît; tu trompes mon espoir;Je ne vois plus qu'Ernelinde elle-même.
[Закрыть]
M. F. D. N. a fait sur ce littérateur l'énigme suivante:
J'ai sous un même nom trois attributs divers;Je suis un instrument, un poëte, une rue:Rue étroite, je suis des pédans parcourue;Instrument, par mes sons je charme l'univers;Rimeur, je l'endors par mes vers.
[Закрыть]
Dauberval, devenu l'amant de cette nymphe, fit faire un cachet sur lequel il était représenté en chasseur, avec ces mots pour légende:
Quand je n'ai pas Miré je manque mon coup.
[Закрыть]
Malgré ce défaut cette actrice fit l'ornement du théâtre Français dans les rôles de fureur, de reine et de mère.
Quand Dumesnil vient sur la scèneAu gré des connaisseurs parfaits,On croit entendre MelpomèneRéciter les vers qu'elle a faits.N.
[Закрыть]
Cette salle fut restaurée par M. Moreau en 1769; on proposa d'y mettre cette inscription:
Ici les dieux du temps jadisRenouvellent leurs liturgies:Vénus y forme des Laïs;Mercure y dresse des Sosies.
[Закрыть]
Épigramme.
Prenez les vers du rocailleux Lemierre,Dont un moment ici j'emprunte la manière;Lisez, relisez-les souventSi votre langue a de la gêne,Ils feront pour son mouvementL'effet de ces cailloux que mâchait Diogène.N.
[Закрыть]
On fit paraître à cette époque les vers suivans:
Belloy nous donne un siége; il en mérite un autre.Graves académiciens,Faites-lui partager le vôtre,Où tant de bonnes gens sont assis pour des riens.
[Закрыть]