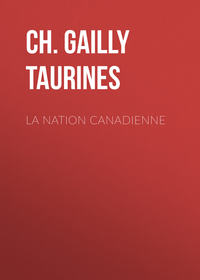Kitap dosya olarak indirilemez ancak uygulamamız üzerinden veya online olarak web sitemizden okunabilir.
Kitabı oku: «La Nation canadienne», sayfa 10
CHAPITRE XVIII
POPULATION FRANÇAISE DU MANITOBA
ET DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST
Vers l'ouest, la province de Manitoba, de création récente, et les territoires non encore organisés d'Assiniboia, de Saskatchewan et d'Alberta, comprennent, eux aussi, des groupes notables de population d'origine française.
Nous sortons là des limites du vieux Canada historique. Les vastes régions qui s'étendent à l'ouest des Grands Lacs étaient inexplorées au dix-septième siècle; elles n'ont été découvertes et parcourues qu'au milieu du dix-huitième siècle par l'infatigable voyageur La Vérandrye.
Comme par son histoire, le pays est ici différent par son sol et par son aspect. Plus de forêts: la prairie; plus de fourrés impénétrables au regard: la plaine nue où l'œil cherche en vain jusqu'à l'horizon quelque objet pour varier l'uniforme monotonie qui l'environne.
Plus de rivières, plus de rapides, plus de cascades: quelques minces cours d'eau qui, s'écoulant dans des terrains meubles formés d'alluvion, s'y sont creusé des lits profonds (des coulées, comme disent les Canadiens), au fond desquels ils glissent silencieusement leurs eaux bourbeuses, sans interrompre au regard la parfaite et fastidieuse horizontalité du pays.
Plus de lacs cernés de collines et réunissant leurs eaux profondes dans le creux des vallées; quelques nappes d'eau n'ayant de lacs que la surface, tantôt démesurément étendues par les pluies, tantôt réduites à rien par la sécheresse, si bien que le voyageur s'étonne quelquefois de marcher à pied sec dans la prairie brûlée de soleil, là où quelques années auparavant il avait navigué sur une mer sans limites.
Ici, la prairie étend au loin ses horizons rectilignes comme des horizons marins; là, elle s'incline en molles ondulations plus fastidieuses encore, car elles leurrent le voyageur de l'espérance d'un aspect nouveau, et lui présentent toujours le même, ainsi que dans un défilé de troupes les bataillons succèdent aux bataillons sans changer de forme, d'aspect ni d'allure. L'immensité de la prairie rappelle l'immensité de la mer, et tous les termes de marine peuvent s'appliquer à elle. Pour les vieux habitants du pays, voyager dans la prairie c'est aller au large, un bosquet est une île, et le coude d'une rivière une baie.
Du lac Winnipeg aux Montagnes Rocheuses, la prairie s'étend sur un espace de plus de 1,000 kilomètres. Elle est aujourd'hui traversée par une voie ferrée, le Canadian Pacific Railway, qui déroule sur cette plaine sans fin la double ligne de ses rails perpendiculaires à l'horizon. Çà et là une station solitaire se dresse sur la voie, et le voyageur venu de quelque ferme nouvellement créée peut, dans les jours clairs, être prévenu de l'approche des trains par la fumée qui point à l'horizon, une heure avant leur passage.
C'est dans ces régions que le gouvernement canadien a créé en 1871 la province de Manitoba et les territoires d'Assiniboia, de Saskatchewan et d'Alberta.
Quand cette réunion fut faite, les territoires annexés n'étaient pas déserts. Il s'y trouvait déjà des groupes de population assez nombreux et, qui plus est, des groupes de population d'origine française. C'étaient les descendants de ces chasseurs de fourrures qui, depuis la fin du dix-huitième siècle, parcouraient cette contrée au service des deux grandes Compagnies de la baie d'Hudson et du Nord-Ouest.
La plus ancienne de ces compagnies, la Compagnie de la baie d'Hudson, avait été fondée par les Anglais en 1669; mais, jusqu'à la paix de 1763, elle ne s'éloigna pas des rives mêmes de la baie, et borna son trafic aux régions immédiatement avoisinantes, séparées de la colonie canadienne par une vaste étendue de déserts glacés. Ce n'est que du jour où le Canada devint possession anglaise que cette compagnie commença à s'étendre vers l'intérieur et à y envoyer ses agents.
En même temps, une compagnie rivale se créait à Montréal en 1783, la Compagnie du Nord-Ouest. Son but était de nouer des affaires avec les Indiens des plaines, à l'ouest des Grands Lacs.
Rivales, ces deux compagnies l'étaient non seulement par la nature de leurs affaires commerciales, mais encore par la nationalité de leurs agents.
Créée à Londres, ayant son siège à Londres, la Compagnie de la baie d'Hudson recrutait la plupart de ses gens en Angleterre; créée à Montréal, la Compagnie du Nord-Ouest (bien que fondée, elle aussi, par des capitalistes anglais) prenait cependant son personnel (ses voyageurs) dans le pays même, parmi les Canadiens, si aptes aux longs et aventureux voyages, si durs à toutes les fatigues du corps, si bien au fait des coutumes et de la langue des Indiens avec lesquels ils avaient à traiter.
L'antagonisme était tel que, pour tous, et dans le langage courant, les gens de la Compagnie de la baie d'Hudson, c'étaient les Anglais; ceux de la Compagnie du Nord-Ouest, les Français!
C'étaient des hommes vigoureusement trempés que ces aventureux voyageurs qui, renonçant à l'attrait d'un tranquille foyer, s'enfonçaient dans les solitudes de la baie d'Hudson et du Nord-Ouest pour s'y créer une vie nouvelle, toute de mouvement, d'aventures et de dangers, si attrayante pourtant que beaucoup ne se décidaient jamais à l'abandonner, conquis pour toujours par le désert sur la société des hommes.
Ceux-là, pour la plupart, s'unissaient à des femmes indiennes; unions légitimes ayant pour résultat la constitution de véritables familles. Ce sont ces familles qui, restées longtemps sans communications avec les régions colonisées du Canada ou des États-Unis, se sont multipliées et ont formé, à côté de la population indienne des territoires de l'Ouest, une sorte de groupe ethnographique tout spécial, ayant ses traditions, sa langue et ses mœurs distincts, assez nombreux de nos jours pour qu'on puisse lui donner le nom de race métisse-canadienne, assez intéressant aussi pour qu'on s'arrête à conter son histoire.
La race métisse n'est pas une; elle se divise en deux groupes provenant chacun des deux éléments divers qui l'ont formée: des gens de la Compagnie de la baie d'Hudson descendent les métis anglais; de ceux de la Compagnie du Nord-Ouest, les métis français tirent leur origine. Le groupe français est le plus nombreux, c'est aussi le plus uni; au point de vue ethnographique et social il forme bien, à proprement parler, une race.
Les métis français doivent seuls nous occuper ici. Leur caractère intrépide et aventureux ne s'est pas démenti. Braves au point que quelques centaines d'entre eux ont pu, il y a quelques années, tenir tête pendant plusieurs mois, comme nous le conterons plus loin, à une armée de 3,000 hommes commandée par un major général anglais, ils ne se montrent pas humiliés, mais fiers du double sang qui coule dans leurs veines, et se désignent eux-mêmes sous le nom de bois brûlés.
Aussi attachés à la langue des Indiens Cris, leurs ancêtres maternels, qu'à celle des Français, leurs ancêtres paternels, les métis parlent l'une et l'autre langue avec une égale facilité. Chatouilleux sur le point d'honneur, ils n'ont pas pardonné à l'un de leurs chefs d'avoir profité de la notoriété qu'il s'était faite dans la révolte de 1885 pour venir s'exhiber en Europe, dans une sorte de cirque, sous les auspices d'un faiseur de réclame américain. Ils ont d'ailleurs de qui tenir à ce point de vue. Plus d'un gentilhomme, dit-on, a, aux dix-septième et dix-huitième siècles, embrassé la vie aventureuse de coureur des bois, et des noms, sinon illustres, du moins honorés en France, se retrouvent encore chez les métis français de l'Ouest canadien.
Fort différents les uns des autres, quant au caractère et à la physionomie, suivant le degré de mélange du sang, les uns se rapprochant davantage du type indien, les autres ne différant en rien des blancs ni par leur aspect, ni par leur éducation, tous demeurent unis et solidaires, ceux qu'aucun signe extérieur ne distingue n'hésitant pas à se classer eux-mêmes parmi les métis. Nul mépris, d'ailleurs, semblable à celui qui frappe les mulâtres des colonies n'atteint les métis dans la société canadienne; des unions se contractent avec eux sans exciter ni la réprobation publique, ni même l'étonnement.
Ce sont ces populations qu'en 1871 le gouvernement canadien fit entrer dans la Confédération par l'acquisition de tous les territoires de l'Ouest, possédés alors par la Compagnie de la baie d'Hudson.
Les luttes des Compagnies de la baie d'Hudson et du Nord-Ouest s'étaient terminées à l'amiable en 1821, par la fusion de leurs intérêts sous une seule dénomination. Leurs territoires de chasse furent alors réunis, et, devenue l'une des plus riches, mais sans contredit la plus puissante des compagnies commerciales de l'univers, la nouvelle Compagnie de la baie d'Hudson occupa sans conteste près du quart du continent américain, depuis les grands lacs jusqu'au Pacifique.
Cet immense domaine, elle le réserva strictement à la chasse des animaux à fourrure, dont elle tirait d'immenses profits, et s'efforça, par tous les moyens, d'en écarter la colonisation. L'arrivée du colon, c'était la fuite du castor, de l'hermine, du vison, du renard argenté, et pour éloigner cet ennemi de sa richesse, la Compagnie cachait comme un secret d'État la fertilité des territoires qu'elle occupait.
Un jour vint pourtant où la vérité se fit jour, et où les intérêts particuliers durent s'effacer devant l'intérêt public. Vers 1850, le gouvernement anglais exigea, moyennant indemnité, la rétrocession de toute la partie du territoire s'étendant à l'ouest des Montagnes Rocheuses jusqu'au Pacifique, et y créa la colonie de la Colombie britannique.
En 1870 enfin, la Confédération canadienne fut autorisée par le même gouvernement à enlever à la Compagnie de la baie d'Hudson la plus grande partie du domaine qui lui restait. Ce à quoi celle-ci dut consentir, moyennant le payement d'une indemnité de 7 millions et demi de francs et l'abandon, en toute propriété, d'une grande étendue de territoire.
La création d'une nouvelle province dans ces terres fertiles fut aussitôt résolue par le gouvernement canadien. Les limites en furent tracées dans les bureaux d'Ottawa, en même temps que sa constitution était décrétée, et que le personnel administratif chargé de la mettre à exécution était lui-même choisi.
Sur le nouveau sort qui leur était préparé, les métis, seuls habitants du pays, n'avaient été ni consultés, ni même pressentis. A cette nouvelle, ils s'indignèrent, eux libres habitants de la prairie, d'être traités comme un bétail humain qu'on livre à son insu, et lorsque, après un long et pénible voyage à travers les rivières et les lacs (car alors les communications étaient peu faciles avec le Nord-Ouest), le gouverneur nommé à Ottawa, M. Mac Dougall, arriva avec ses bagages et ses agents en vue de la Rivière Rouge, il fut fort étonné de voir venir à sa rencontre une troupe de 400 métis armés, n'ayant nullement l'attitude paisible d'administrés qui viennent saluer leur gouverneur.
«Qui vous envoie? leur dit-il. – Le gouvernement. – Quel gouvernement? – Le gouvernement que nous avons fait!» Et, en effet, à la nouvelle qu'un administrateur, d'eux inconnu, était en marche pour venir chez eux prendre la direction du pouvoir, ils s'étaient assemblés, avaient nommé un gouvernement provisoire, et refusaient d'en reconnaître d'autre. M. Mac Dougall n'eut d'autre perspective que de faire demi-tour avec son personnel et ses bagages et de recommencer en sens inverse le long trajet qu'il venait d'accomplir, pour aller rendre compte à Ottawa de ce qui se passait dans l'Ouest.
Le promoteur de la fière détermination des métis, l'âme du «gouvernement provisoire», était Louis Riel, devenu célèbre depuis par sa nouvelle résistance et par sa mort.
Les métis pourtant n'étaient pas intraitables, il était facile de s'entendre avec eux, pourvu qu'on respectât leur dignité et leurs intérêts. Un prélat qu'ils vénéraient, Mgr Taché, évêque de la Rivière Rouge, parvint par ses négociations entre le gouvernement canadien et le gouvernement provisoire à arranger les choses. Grâce à cette intervention, et après l'acceptation de certaines de leurs conditions, les métis consentirent à entrer dans la Confédération canadienne. Celle-ci leur accorda la possession d'une portion considérable de terres, l'usage officiel de la langue française dans les assemblées législatives, leur assura le maintien des écoles catholiques, et la province de Manitoba put être définitivement organisée.
La population du Manitoba était, en 1870, de 10,000 âmes, dont 5,000 métis français. La proportion s'est bien vite modifiée; le fait était absolument inévitable. Des routes de communication ayant été ouvertes avec la nouvelle province, une immigration assez considérable, venue des provinces anglaises d'Amérique et même d'Angleterre, ne tarda pas à s'y diriger. De plus, le gouvernement canadien commença bientôt la construction de la grande ligne transcontinentale du Pacifique qui, traversant dans toute sa largeur la province du Manitoba, y a déversé un flot pressé de colons de toutes races: Anglais, Écossais, Irlandais, Scandinaves et même Russes97.
En 1881, la population s'élevait à 65,000 âmes, sur lesquelles l'élément français représenté, non plus seulement par les métis, mais par un certain nombre de Canadiens venus de Québec, comptait pour 10,000 âmes, formant un peu moins du sixième du nombre total des habitants98.
Bien que la proportion des Français, dans la province du Manitoba, soit en décroissance, il ne faudrait pas croire que cet élément fût noyé, pénétré de toutes parts par des éléments étrangers, et menacé d'être absorbé à brève échéance. Il n'en est nullement ainsi. Les Canadiens demeurent au contraire groupés dans une région qu'ils tiennent fortement et dans laquelle ne pénètrent guère d'étrangers, région précisément la plus fertile et la mieux située de la province; c'est le comté de Provencher, qui occupe les deux rives de la rivière Rouge, depuis la frontière américaine jusqu'à la ville française de Saint-Boniface, en face de la capitale, Winnipeg.
Dans ce comté la population est à peu près uniquement française, et envoie un député français au Parlement fédéral. C'était, en 1890, M. Larivière.
C'est là un noyau assez fort pour pouvoir se maintenir pendant plusieurs générations, et qui sait ce que nous réserve l'avenir? qui sait si alors l'immigration étrangère n'aura pas cessé? qui sait si elle n'aura pas été remplacée par une immigration française venue de Québec, laquelle commence à se produire et qui, jointe au gain annuel résultant de la natalité supérieure des Canadiens, permettrait aux Français du Manitoba de reprendre dans toute la région la prépondérance qu'ils y ont momentanément perdue?
Les deux villes de Winnipeg et de Saint-Boniface, l'une anglaise, l'autre française, placées face à face sur les deux rives opposées de la rivière Rouge, se dressent comme les champions des deux nationalités. L'une, avec ses rues animées, ses riches magasins et ses monuments ambitieux, représente la victoire brillante mais éphémère peut-être des Anglais; l'autre, avec son calme et ses proportions modestes, avec ses institutions de charité, son vaste hôpital, son collège, son église, monuments d'une architecture simple et sévère, montre la patience des Canadiens, leur persévérance et leur confiance dans l'avenir, sous la direction d'un clergé qui jamais ne leur a fait défaut.
Les métis ne sont pas tous demeurés dans la province du Manitoba. Peu à peu beaucoup d'entre eux l'ont abandonnée pour aller s'établir plus au nord, vers les rivages solitaires de la rivière Saskatchewan.
Ce n'est pas qu'ils aient aucune inaptitude à vivre comme les blancs, mais leurs traditions ne les y ont pas préparés et leurs goûts ne les y portent pas.
L'habitude est une seconde nature, dit-on, et ces hommes issus d'aventureux coureurs des bois, n'ayant jamais connu que les libres chevauchées de la chasse au buffle, les grands voyages à travers la plaine à la tête de leurs convois de chariots, se résignent avec peine à la vie calme et rangée du colon. Leur existence et leurs habitudes sociales étaient si différentes des nôtres! Ces «freteurs» (c'est ainsi qu'ils s'appelaient, empruntant encore un terme à la marine), véritables caboteurs de terre, toujours en route, allant de Fort-Garry à Saint-Paul, et de Saint-Paul à la baie d'Hudson, faisant traverser les rivières à la nage à leurs chevaux et flotter leurs chariots, bravant les chaleurs de l'été, les neiges de l'hiver et les attaques des Indiens, pouvaient-ils sans regrets renoncer à cette vie libre et fière?
Les buffles ont fui devant le colon et la culture, la vapeur a tué le fret, la charrue a défoncé les vierges étendues de la prairie, et les métis, sevrés de la libre existence qu'il y a vingt ans à peine ils menaient encore, se retirent tristement vers le Nord.
Les contrées dans lesquelles ils émigrent forment administrativement, dans la Confédération canadienne, les territoires d'Assiniboia, de Saskatchewan et d'Alberta. Ces territoires, bien qu'occupant d'immenses étendues, ont une population minime. Ils sont administrés par un seul gouverneur, et par un conseil élu par les habitants. Le petit bourg de Régina, composé de quelques tristes maisons de bois, en est la bien modeste capitale.
Les métis se sont spécialement portés vers la Saskatchewan, où ils forment quelques agglomérations. C'est là qu'en 1885 de nouvelles difficultés s'élevèrent avec le gouvernement canadien. Les métis prétendaient avoir de graves motifs de plaintes et réclamaient, entre autres choses, un arpentage de leurs terres qui pût les mettre à l'abri de toute éviction future. Comme on tardait à faire droit à ces justes réclamations, l'effervescence s'accrut. Louis Riel, réfugié aux États-Unis depuis les affaires de 1871, fut appelé pour se mettre à la tête des mécontents, et une nouvelle prise d'armes eut lieu. Dans ces régions lointaines, quelques centaines d'hommes, sans organisation et presque sans armes, purent pendant plusieurs mois tenir en échec une armée de 3,000 miliciens d'Ontario commandés par le général Middleton.
Mais cette résistance inégale ne pouvait durer. Malgré des prodiges de valeur, les métis furent écrasés. Riel fut pris, jugé, condamné à mort et exécuté à Winnipeg, à la clameur indignée de tous les Français du Canada. Tous en effet, pendant l'insurrection, n'avaient cessé de témoigner de leur sympathie pour ces hommes de même langue et de même religion, dont les réclamations paraissaient justifiées et la révolte excusable. En France même le soulèvement des métis et la campagne du Nord-Ouest eurent quelque retentissement, le nom de Riel acquit une certaine notoriété, et les journaux contèrent avec émotion les péripéties de la lutte.
Avec les effectifs dont il disposait, la victoire du général Middleton était facile; il ne manqua pas, pourtant, dans ses rapports officiels, de conter, avec une pompeuse emphase, les moindres détails de son expédition. La prise de Batoche, qui termina la campagne par la reddition de Riel, fut racontée comme un véritable fait d'armes, presque comme la prise d'une place importante. Or, Batoche n'est ni une forteresse, ni une ville, ni même un village; c'est une simple et unique maison, celle d'un métis, M. Batoche lui-même!
Depuis 1885, les luttes sanglantes ont cessé, mais l'apaisement n'est pas venu, et partout où il tient la majorité, l'élément anglais n'épargne aux Français-Canadiens ou métis-ni les tracasseries ni les persécutions. C'est ce qu'on peut constater aujourd'hui, et dans les trois territoires de l'Ouest, et dans la province du Manitoba.
Déjà, l'assemblée anglaise des Territoires a supprimé dans ses délibérations l'usage de la langue française.
Au Manitoba, le mauvais vouloir de la majorité revêt un caractère plus grave encore. Elle a, – il y a quelques années, – fait voter par l'assemblée législative de la province, une loi qui ne tend à rien moins qu'à la suppression des écoles françaises. Les Canadiens se défendent avec un acharnement et une énergie remarquables. Tous les recours légaux et constitutionnels auprès du gouvernement fédéral et auprès du gouvernement métropolitain, ils les ont successivement exercés. Actuellement encore, l'affaire n'est pas entièrement terminée; mais quelle qu'en soit la solution définitive, le sentiment national des Canadiens au Manitoba n'en peut être amoindri. La persécution, – car c'en est une véritable à laquelle ils sont en butte, – n'aura pas d'autres résultats que ceux qu'elle a toujours eus, en tout temps et en tout pays. Elle ne fera des Canadiens ni des protestants ni des Anglais, elle les rendra plus Français et plus catholiques. Que les Français du Manitoba tournent seulement leurs regards vers leurs compatriotes de la province de Québec, ils trouveront en eux de vaillants défenseurs, et ils comprendront par leur exemple comment de la persécution courageusement affrontée on sort plus robuste et plus fort.