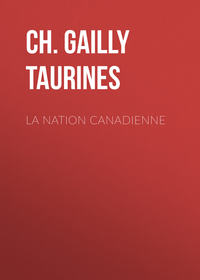Kitap dosya olarak indirilemez ancak uygulamamız üzerinden veya online olarak web sitemizden okunabilir.
Kitabı oku: «La Nation canadienne», sayfa 15
D'IBERVILLE,
Aux marins de l'Aréthuse et du Hussard.
Flamme à la drisse, vent arrière
A demi couché sur bâbord,
Le Pélican cingle en croisière,
A travers les glaces du Nord,
Malgré la neige et la rafale,
Il file grand'erre. A l'avant,
Tout à coup un gabier s'affale
Criant: «Trois voiles sous le vent!»
Sournoisement, parmi les ombres
D'un ciel bas, au loin, sur les eaux,
Balançant leurs antennes sombres,
Montent les mâts des trois vaisseaux;
On dirait ces oiseaux du pôle
Qui s'enlèvent avec efforts,
Et dont le vol lourd et lent, frôle
La nuit de ces mers aux flots morts.
Un contre trois! Parbleu, qu'importe!
Le Pélican n'eut jamais peur.
Il vole, et le nordet l'emporte
Dans un large souffle vainqueur.
Le pavillon de la victoire,
C'est celui des marins français.
…
Puis après une longue et vivante description du combat et de la victoire, le poète termine par cet envoi aux marins de l'Aréthuse et du Hussard:
Chers marins, chers Français de France,
D'Iberville est votre parent.
Par mainte fière remembrance,
Le cœur des fils du Saint-Laurent,
Malgré la cruelle secousse,
A la France tient ferme encor.
Ce nœud n'est pas un nœud de mousse,
C'est un bon nœud franc, dur et fort.
La poésie des poètes n'est pas la seule. Au Canada comme ailleurs, le peuple a la sienne, et ce n'est pas la moins propre à indiquer ses tendances, ses goûts, ses aspirations et ses enthousiasmes.
Parmi les chansons populaires du Canada, pas une qui ne vienne de France et qui, surtout, ne parle de la France; on y voit défiler comme dans un panorama toutes les vieilles provinces, toutes les vieilles villes françaises d'où sont sortis les Canadiens et d'où ils ont apporté avec eux ces antiques et naïfs refrains.
Un patriote, M. Gagnon, a pris soin de les recueillir et d'en noter la musique. Ce n'est pas que ces vieilles chansons aient rien de remarquable ni comme œuvre littéraire, ni comme œuvre musicale, mais ce qu'elles ont de tout particulièrement intéressant, c'est que les Canadiens y sont attachés comme à des souvenirs presque sacrés et qu'ils les ont adoptées pour ainsi dire comme des chants nationaux. S'ils ne les entonnent pas sans émotion, c'est que ces simples chansons réveillent dans leur cœur tous les souvenirs d'enfance, tous les souvenirs du foyer et du pays natal et y font surgir l'image sacrée de la patrie.
Ne sourions pas aux vieilles chansons canadiennes, si naïves et si simples qu'elles nous paraissent; avec les Canadiens, respectons-les, découvrons-nous à leurs accents, elles sont les chants patriotiques d'un peuple qui se souvient qu'il est Français et qui veut rester Français.
Faut-il l'avouer en terminant, la littérature canadienne a quelquefois trouvé, parmi les Français, des juges peu bienveillants et n'a reçu de leur part que des appréciations un peu sévères, on pourrait presque dire injustes. Certes, si l'on juge des lettres françaises au Canada par la lecture des textes de lois et même d'une partie des journaux, on s'en fera une idée peu avantageuse. Nous avons montré plus haut quels étaient les motifs de cette infériorité forcée d'une partie de la presse, obligée de traduire et de puiser dans les journaux anglais.
Mais ouvrez les œuvres des vrais écrivains canadiens, et vous y trouverez des pages qu'on pourrait donner, en France même, comme des modèles d'élégance, de finesse et de recherche d'expression.
La littérature canadienne, on peut l'affirmer hautement, doit prendre une place honorable dans la littérature française; cette place a déjà été consacrée par les plus hauts juges des arts et de la pensée: plusieurs auteurs canadiens, poètes et prosateurs, ont été couronnés par l'Académie française.
La modestie de certains critiques canadiens est certes beaucoup trop grande; M. Buies est de ceux qui méritent le plus ce reproche: «C'est un lot peu enviable, dit-il, dans notre pays, que celui qui est dévolu aux ouvriers de la pensée. Il n'y a pas place pour eux. Ce pays, encore dans l'enfance de toutes choses, où tout est à créer pour qu'il atteigne au rang qu'il occupera un jour dans la civilisation, a besoin avant tout, à l'heure actuelle, de bûcherons, de laboureurs, d'artisans et de mécaniciens qui lui fassent une charpente et un corps avant qu'il songe à meubler et à garnir son cerveau. Aux littérateurs, il ne faut pas songer encore.»
Je crois avoir suffisamment montré, au contraire, que le cerveau de la nation canadienne se développe conjointement à sa charpente et à son corps, et qu'elle peut désormais, à la fois, marcher, agir et penser.
CHAPITRE XXV
MISSION PROVIDENTIELLE
L'impression qui se dégage de la lecture des historiens, des romanciers et des poètes, c'est que le peuple canadien est un peuple élu, désigné par le doigt de Dieu pour agir d'une façon notable sur les destinées de l'Amérique.
L'action de la Providence, les historiens canadiens nous la montrent partout. C'est elle, nous l'avons déjà dit, d'après eux, qui dirige Cartier sur les rives du Saint-Laurent, c'est elle qui y fixe Champlain, c'est elle qui donne comme fondateurs à la nation canadienne de pieux héros et de sublimes martyrs. C'est elle encore qui dirige, à travers les impénétrables fourrés de la forêt, le bras des défricheurs, et c'est elle enfin qui tous, héros, martyrs et colons, les conduit de son doigt puissant vers leur mystérieux avenir.
La plante qui va naître étonnera le monde,
Car, ne l'oubliez pas, nous sommes en ce lieu
Les instruments choisis du grand œuvre de Dieu159.
Quel est ce grand œuvre dont le peuple canadien sera l'instrument, et quelle providentielle mission va-t-il accomplir? La voix des Canadiens sera unanime encore à nous répondre, et du haut de la chaire sacrée comme de la tribune politique, nous entendrons toujours retentir ces mots: «Notre mission, c'est de remplir en Amérique, nous, peuple de sang français, le rôle que la France elle-même a rempli en Europe.»
C'est là, chez tout Canadien, non pas seulement une idée, mais une foi. Nul n'est leur ami s'il ne la partage, et nul, il faut le dire, ne peut demeurer au milieu d'eux sans la partager; elle a gagné jusqu'à leurs gouverneurs anglais eux-mêmes, et lord Dufferin disait, en 1878, dans un discours officiel:
«Effacez de l'histoire de l'Europe les grandes actions accomplies par la France, retranchez de la civilisation européenne ce que la France y a fourni, et vous verrez quel vide immense il en résulterait. Mon aspiration la plus chaleureuse pour cette province a toujours été de voir les habitants français remplir pour le Canada les fonctions que la France elle-même a si admirablement remplies pour l'Europe.»
Cette mission civilisatrice, les Canadiens l'aperçoivent sous une double face: ils doivent répandre en Amérique, au milieu de ce peuple «voué tout entier aux intérêts matériels160», le culte de l'idéal et de l'art dont la race française semble la propagatrice et l'apôtre; mais leur mission s'étend plus loin encore et s'élève plus haut. Au delà de toute préoccupation terrestre, c'est une mission divine qu'ils ont à remplir. Ils doivent, eux catholiques, eux l'un des peuples restés le plus strictement dévoués à l'Église, conquérir au catholicisme l'Amérique du Nord tout entière.
Nul ne niera qu'au point de vue de l'idéal et de l'art les Américains n'aient besoin d'une initiation, et ne doivent accueillir avec reconnaissance ceux qui seraient leurs éducateurs. Le sens artistique de l'Américain, demeuré assez obtus, aurait besoin d'être affiné. Je ne parle pas de la classe, très peu nombreuse, de l'aristocratie, qui, autant que chez nous, est instruite, lettrée, délicate de goûts et d'instincts, mais de la masse du peuple.
En France, un paysan, d'une façon si obscure que ce soit, a pourtant un certain sens du beau: voyez les costumes de nos vieilles provinces dont nos peintres se plaisent à reproduire la pittoresque variété! voyez les vieux meubles de nos campagnes que se disputent les amateurs161!
Les Américains, eux, ne discernent la beauté des choses qu'à travers leur valeur. Un chiffre de dollars est une explication dont ils ont besoin pour comprendre, et ils n'admirent que lorsqu'il est gros. L'argent, chez eux, est en grande partie la mesure de la beauté.
Cette tendance d'esprit se manifeste de toute façon et dans les sujets les plus disparates. On voit les théâtres de féeries annoncer sur les programmes, à côté de l'énumération des tableaux, le prix qu'a coûté chaque décor. Dans le splendide jardin zoologique de Cincinnati, sur la cage d'un majestueux lion d'Afrique et sur celle d'un ours gris des mers Glaciales, avec leur nom, est indiquée leur valeur.
Le fameux tableau de Millet, l'Angelus, n'a pas été exhibé dans toutes les villes de l'Amérique par un entrepreneur adroit, sans que le public fût informé et du prix qu'il avait été payé, et des 150,000 francs de droits de douane qu'il avait dû acquitter pour franchir la frontière. Sans cet avertissement, personne peut-être ne se fût inquiété ni de l'objet d'art, ni de son mérite; mais ces chiffres étaient connus, tout le monde courait le voir.
Cette absence de sentiment artistique se manifeste partout aux États-Unis. L'œil cherche en vain des monuments dans leurs grandes villes. Les Américains conçoivent le grand, mais non pas le grandiose.
L'Auditorium, que les habitants de Chicago ont la prétention de faire admirer aux étrangers, est une lourde carrière de moellons et de pierres de taille dans laquelle on n'entre qu'en baissant les épaules, de peur d'être écrasé sous sa masse.
Le «monument», élevé dans la capitale même, en l'honneur de Washington, est l'édifice en pierre le plus élevé de l'univers entier. C'est son principal mérite, et c'est le seul sans doute qu'aient ambitionné les Américains. La hauteur des flèches de Cologne les rendait jaloux. Ils ont voulu avoir plus haut; ils l'ont. C'est une sorte de paratonnerre en pierre de la forme de l'obélisque de la place de la Concorde, mais de 80 mètres de haut.
Le seul vrai monument de l'Amérique est le Capitole de Washington162, mais celui-là est splendide et capable de faire envie à la vieille Europe tout entière.
Posez sur une colline plusieurs Panthéons de marbre, d'une blancheur immaculée, accompagnez-les de colonnades, d'escaliers monumentaux, de rampes, de terrasses couvertes de fleurs et de verdure, et vous n'aurez qu'une faible idée de la beauté du Capitole.
Mais si, gravissant ces rampes, ces terrasses et ces escaliers, vous pénétrez à l'intérieur, quelle pauvreté! Des couloirs sombres, des escaliers dénudés, voilà l'impression avec laquelle vous quittez cet admirable monument.
Oui, certes, les Américains ont une éducation artistique à recevoir; et de qui la recevront-ils? Est-ce des émigrants qui leur arrivent d'Europe? Mais la masse des émigrants ne se recrute guère dans des classes capables de fournir un enseignement artistique.
Voisine de la république américaine, la nation canadienne, seule, possède une unité d'action assez forte pour remplir envers elle ce rôle d'éducatrice. Et pourquoi ne le remplirait-elle pas d'une façon efficace? Cet instinct des beaux-arts qui fait briller entre toutes les nations la France, sa mère, elle le possède, elle aussi; elle a des monuments, et sans être obligée de faire parade ni de leur hauteur, ni de leur prix, elle peut être fière de leur beauté.
Le palais du Parlement, à Québec, se dresse fièrement sur le large plateau d'où il domine le Saint-Laurent; son emplacement même dénote le sens artistique de ceux qui l'ont choisi. Pénétrez-y sans hésitation; derrière son élégante façade ne vous attend pas une déception. Un spacieux escalier aux boiseries couvertes de cartouches sculptés, rappelant par des devises ou des armoiries toute l'histoire du Canada français, vous conduit aux étages supérieurs. Nul détail ne choque, tout est fini, soigné, et vous ne trouvez nulle part ce je ne sais quoi d'inachevé et de provisoire, cet air de chantier en construction qui étonne quelquefois l'œil français dans les monuments américains.
Cette supériorité artistique des Canadiens, les Américains la reconnaissent eux-mêmes; c'est avec une sorte de respect qu'ils viennent visiter Québec comme la ville par excellence des traditions des arts et de la littérature.
La mission de propager en Amérique le culte des arts est grande et belle; mais combien est plus élevée encore celle de propagande religieuse que se donne non seulement le clergé, mais la société civile elle-même! «Après avoir médité l'histoire du peuple canadien, dit l'abbé Casgrain, il est impossible de méconnaître les grandes vues providentielles qui ont présidé à sa formation; il est impossible de ne pas entrevoir que, s'il ne trahit pas sa vocation, de grandes destinées lui sont réservées dans cette partie du monde. La mission de la France américaine est la même sur ce continent que celle de la France européenne sur l'autre hémisphère. Pionnière de la vérité comme elle, longtemps elle a été l'unique apôtre de la vraie foi dans l'Amérique du Nord. Depuis son origine elle n'a cessé de poursuivre fidèlement cette mission, et aujourd'hui elle envoie ses missionnaires et ses évêques jusqu'aux extrémités de ce continent. C'est de son sein, nous n'en doutons pas, que doivent sortir les conquérants pacifiques qui ramèneront sous l'égide du catholicisme les peuples égarés du nouveau monde163.»
Les progrès du catholicisme aux États-Unis sont indéniables. De toutes les Églises si nombreuses qui s'y disputent la prépondérance, l'Église catholique est aujourd'hui celle qui compte le plus de fidèles: près de 10 millions, tandis que la secte protestante la plus forte, celle des méthodistes, n'en compte pas la moitié.
C'est à l'immigration des Irlandais, des Allemands et des Canadiens qu'est due cette augmentation du nombre des catholiques; ajoutez à cela que chez eux la natalité est fort élevée, tandis qu'elle est infime chez les protestants, si bien qu'un écrivain américain a pu calculer que dans un siècle l'Église catholique comptera 70 millions de fidèles en Amérique164.
Ce mouvement n'est pas sans avoir, depuis longtemps, attiré l'attention des plus hautes autorités de l'Église catholique. Une nouvelle Église s'élevait en Amérique qui allait changer peut-être l'équilibre du catholicisme. Rome, désormais, devait s'appuyer sur elle en même temps que sur les vieilles Églises d'Europe. Ce nouvel arbre, jeune et plein de sève, n'était-il pas un point d'appui autrement ferme que ceux du vieux monde affaibli, et la sollicitude principale ne devait-elle pas se tourner vers l'avenir plutôt que vers le passé?
M. de Vôgüé, à l'occasion du voyage à Rome en 1886 du cardinal Gibbons, venant plaider la cause de l'Association ouvrière des Chevaliers du travail, a conté d'une façon vivante «cette irruption du Nouveau Monde dans le milieu de la prélature romaine, peu préoccupée jusqu'ici des questions sociales», et, par ce seul fait, a pressenti que notre génération allait voir peut-être de grands changements et inaugurer une nouvelle période dans l'histoire du monde.
Au mouvement de catholicisation de l'Amérique, les Canadiens ont eu une grande part. Ils comptent pour un million parmi les catholiques des États-Unis. Mais s'ils sont, par le nombre, un élément important de la nouvelle Église, ils le sont encore plus par l'esprit de cohésion et de solidarité qu'ils mettent au service de leur foi. On ne voit pas chez eux de ces relâchements du lien religieux qui ont conduit tant d'autres émigrants catholiques à l'indifférence ou au protestantisme, et cela parce que leur clergé canadien, toujours si dévoué et si patriote, les suit et les dirige. Que d'Allemands, que d'Italiens, privés d'un clergé national et entraînés par le milieu, ont été perdus pour l'Église!
Et cependant, chose étrange, le clergé catholique irlandais d'Amérique combat à outrance l'idée des clergés nationaux. Il ne veut plus ni de Canadiens, ni d'Italiens, ni d'Allemands; il prétend tout unifier sous le joug de la langue anglaise. Quel est son but? Ne voit-il pas qu'il risque ainsi de faire perdre à l'Église des éléments qui, une fois perdus, ne se retrouveront plus? N'a-t-il pas l'exemple même des millions d'Irlandais passés au protestantisme? Ce qu'il n'a pu empêcher chez les siens, ne doit-il pas craindre de le provoquer chez les autres? Il invoque la nécessité de favoriser l'unité nationale américaine. L'unité nationale consiste-t-elle donc seulement dans la langue anglaise, et, d'ailleurs, le clergé peut-il faire passer l'intérêt américain avant l'intérêt catholique?
Depuis son origine, et par la force même de l'histoire, l'Église catholique est une puissance latine. Quelle serait sa destinée si toute une portion nouvelle de cette Église, qui bientôt peut-être sera la plus puissante, était absorbée par le monde anglo-saxon?
L'idée anglaise est aussi inséparable de l'idée protestante que l'idée française de l'idée catholique. La France aurait beau s'en défendre, il lui est impossible de ne pas être une nation catholique. Son histoire tout entière l'y force; y renoncer, serait amoindrir volontairement sa puissance et briser elle-même une arme qui combat pour sa grandeur. Comptez l'influence que vaut à la France dans le monde l'œuvre admirable de ces légions de missionnaires qu'elle sème sur les deux hémisphères, et vous verrez, si elle peut, de gaieté de cœur, y renoncer sans regrets!
L'Angleterre et la civilisation anglaise sont aussi irrémédiablement liées au protestantisme que la France au catholicisme. La langue anglaise est le véhicule du protestantisme à travers le monde; et c'est à elle qu'on voudrait confier la garde des intérêts catholiques en Amérique?
Des rapprochements trop intimes avec les éléments de langue anglaise, et même avec les éléments protestants, – car le clergé irlandais a voulu conclure une sorte de trêve avec les autorités protestantes, – ne seraient-ils pas une capitulation bien plus qu'une victoire?
Ceux qui tiennent haut et ferme le drapeau de l'Église latine, ceux qui peuvent remplir là, sur ce jeune hémisphère, le rôle historique rempli par la France dans le vieux monde, ce sont les Canadiens. Puissent-ils recevoir dans cette grande tâche les encouragements et les secours que méritent et leur persévérance et leur foi. Avec un but aussi noble, ils peuvent marcher la tête haute vers l'avenir.
TROISIÈME PARTIE
AVENIR DE LA NATION CANADIENNE
CHAPITRE XXVI
DESTINÉE POLITIQUE ET SOCIALE
Nous avons suivi l'évolution historique des Canadiens; nous avons exposé leur état présent au point de vue matériel et moral, montré la richesse de leur territoire et le merveilleux accroissement de leur population; nous avons aussi analysé leur sentiment national et montré que, par la réunion même de tous ces éléments divers, ils constituent dès aujourd'hui une véritable nation.
Cette nation naissante, tout fait prévoir qu'elle doit s'accroître et occuper une place honorable parmi les nations d'Amérique. Trop jeune encore pour se suffire à elle-même, elle doit, pour le moment, demeurer sous la protection d'une nation plus puissante. C'est aujourd'hui l'Angleterre, mais les Anglais eux-mêmes ne pensent pas que ce protectorat puisse être de longue durée. Tous, les uns avec regret, les autres avec joie, prévoient que dans un avenir plus ou moins long il devra cesser; en ce cas, quels changements de souveraineté pourront advenir et quelle influence ces changements auront-ils sur la situation et le progrès des Canadiens?
Quelques Anglais patriotes, inquiets de voir s'accentuer de plus en plus le mouvement d'émancipation de leurs colonies, ont émis le vœu de voir resserrer les liens qui les unissent à la métropole. Ils ont mis en avant le fameux projet de la Fédération impériale, qui n'est pas sans avoir acquis une certaine célébrité, et dont les revues et les journaux britanniques entretiennent leurs lecteurs.
C'est là, il faut bien l'avouer, une idée qui semble irréalisable. Beaucoup d'hommes éminents ont trouvé pour la combattre les arguments les plus sérieux. La Fédération impériale, disent-ils, avec un Parlement impérial siégeant à Londres et délibérant sur les affaires de tout l'Empire anglais, quelle chimère, bien mieux, quelle calamité! Dans un tel Parlement, les représentants des possessions d'outre-mer dépasseraient de beaucoup en nombre ceux de l'Angleterre britannique; ce serait l'asservissement de l'Angleterre à ses colonies, et de chacune des colonies à l'ensemble des autres. Possédant toutes aujourd'hui leur autonomie particulière, consentiront-elles à une pareille capitulation? Une alliance, d'ordinaire, se contracte, une fédération s'organise par suite de la réunion d'intérêts communs; mais quelle force serait capable de former et de maintenir une alliance contraire à la fois aux intérêts de tous les contractants?
Les promoteurs eux-mêmes de la Fédération impériale se rendent parfaitement compte de ce que leurs désirs ont de pratiquement irréalisable, et leurs plans ne vont guère au delà du vœu de réunir périodiquement de grandes conférences coloniales, «composées des hommes les plus compétents des colonies et de la mère patrie», dont la tâche serait «l'élaboration, non de lois, mais de recommandations ou vœux165», et dont les délibérations porteraient sur «la défense impériale, les arrangements postaux et télégraphiques, les problèmes sociaux, dans la discussion desquels la mère patrie peut apprendre des colonies, et les colonies de la mère patrie».
Un congrès d'hommes éminents qui ne fait pas de lois, mais émet des vœux, dont les sujets de délibération se renferment dans l'étude des arrangements postaux et télégraphiques et dans celle des problèmes sociaux, cela se voit tous les jours, en Angleterre, en France et ailleurs; des représentants de la Russie, de l'Autriche, de l'Allemagne, et même des États de l'Extrême-Orient, se rassemblent pour discuter en commun sur les grandes questions d'intérêt général, et ces congrès internationaux ne constituent pas une «Fédération impériale».
Entendue de cette façon, la fédération des colonies anglaises est donc fort praticable; mais c'est la seule. Toute autre interprétation du projet n'obtient, dans les grandes colonies, et spécialement au Canada, qu'un succès de silence et de dédain. Tout au plus sort-elle quelquefois de l'oubli aux jours d'élections, pour servir d'épouvantail auprès du peuple, auquel on montre la Fédération impériale comme un monstre affamé, prêt à le dévorer.
En Angleterre même, le mouvement fédéraliste, malgré sa ligue, ses comités, ses présidents et ses séances, n'a qu'une importance factice, et les organes les plus autorisés de l'opinion tendent à réagir contre «les aspirations vagues et trompeuses qui se glissent sous cette rubrique166».
L'indépendance des colonies est une hypothèse bien plus probable que la réalisation du rêve des fédéralistes.
Et pourquoi ne pas parler ouvertement de la rupture du lien colonial entre le Canada et l'Angleterre, quand tous les hommes d'État anglais eux-mêmes en parlent, quand les organisateurs de la Confédération canadienne, en 1867, ne se sont pas fait illusion sur la durée probable de leur œuvre, en tant que soumise à l'hégémonie anglaise!
Dans la discussion du projet, un des orateurs, M. Bright, déclara qu'il serait peut-être préférable d'ériger tout de suite les colonies américaines en État indépendant; un autre, M. Fortescue, émit l'espoir que la nouvelle Confédération donnerait naissance «à un grand royaume, transatlantique, sur lequel l'Angleterre serait toujours heureuse et fière de compte167».
Dans combien de réunions, dans combien de discours, a-t-on, depuis, entendu des déclarations semblables! Tout récemment, M. Blake disait encore: «Si le Canada se décide à se séparer de nous, nous pouvons faire acte de résignation, lui serrer cordialement la main et lui dire adieu168.»
Les organes les plus autorisés de la presse vont répétant sans cesse aux colonies qu'elles sont libres de se séparer à l'heure où elles le voudront, que l'Angleterre n'y mettra pas obstacle, laissant presque entendre qu'elle le verrait avec plaisir. Le Times écrit: «Les colonies nous jettent sans cesse dans des querelles qui ne nous regardent pas… Combien de temps cela doit-il durer? Quelques autres différends comme celui de la mer de Behring nous forceront à regarder en face le problème et à nous demander sérieusement si les relations actuelles entre la mère patrie et les colonies sont bien équitables pour les contribuables anglais169.» La presse libérale canadienne prend acte d'une telle déclaration pour railler l'indiscrète et tenace loyauté des conservateurs envers une si indifférente métropole. Ne veulent-ils donc pas comprendre à demi-mot et s'obstineront-ils, dit le journal la Patrie, «à abuser de l'hospitalité que l'Angleterre continue, un peu malgré elle, à nous accorder? Comprendront-ils enfin une bonne fois toute l'inconvenance de notre position, et faudra-t-il la force pour nous faire déguerpir170?»
Les conservateurs canadiens eux-mêmes, qui désirent maintenir le plus longtemps possible le lien colonial avec l'Angleterre, reconnaissent cependant qu'un jour il sera fatalement rompu. Le lieutenant gouverneur actuel de la province de Québec, M. Chapleau, l'un des représentants les plus autorisés du parti conservateur, déclarait à un journaliste français, durant un séjour fait récemment en France, que, «quant à l'indépendance du Canada, tout le monde est persuadé qu'elle arrivera à être proclamée du consentement même de l'Angleterre, mais qu'il faut attendre encore, et retarder la demande de l'indépendance jusqu'au jour où la population sera plus dense et où le pays sera plus puissamment organisé171 ».
Et pourquoi les Anglais redouteraient-ils cette séparation? Lequel de leurs intérêts est engagé au maintien du lien colonial? L'intérêt commercial? Mais ils ne jouissent à ce point de vue d'aucun privilège particulier, et le tarif douanier canadien frappe les produits anglais à l'égal des produits étrangers. Regretteront-ils un débouché pour les fonctionnaires métropolitains, une mine à places lucratives? De toutes les fonctions, il n'en est qu'une qui demeure à la nomination de l'Angleterre, celle du gouverneur général; toutes les autres appartiennent au gouvernement canadien et sont réservées à des Canadiens.
Les plus intéressés, en somme, au maintien de l'allégeance anglaise, ce ne sont pas les Anglais, ce sont les Canadiens eux-mêmes, qui, sans en supporter aucun frais, ont droit à la protection diplomatique et militaire d'une grande nation.
Le lien colonial rompu, – le plus tard possible, suivant le vœu des conservateurs, – le plus tôt qu'il se pourra, suivant le désir des libéraux, – qu'adviendrait-il du Canada? Est-il mûr pour l'indépendance? Beaucoup de bons esprits en doutent et se demandent quelles garanties elle offrirait à un État, jeune encore, placé seul en face d'un voisin tel que les États-Unis.
La Confédération canadienne possède bien un territoire égal, supérieur même, à celui de l'Union, mais sa population n'est que de 5 millions d'âmes, en regard de 60 millions d'Américains. On cite l'exemple de l'Europe, où des États minuscules subsistent côte à côte avec des États puissants. Mais dans notre vieux monde lui-même, l'existence de ces petits États serait-elle possible s'ils ne s'équilibraient par leur nombre, et si la rivalité des forts n'était une garantie de la durée des faibles?
La rupture par le Canada de son union avec l'Angleterre serait probablement le prélude de son annexion aux États-Unis. C'est à cette annexion que pousse, ouvertement ou d'une façon indirecte, le parti libéral canadien. Cette campagne a pris depuis quelque temps une certaine ampleur, mais il ne s'ensuit pas que nous soyons tout près d'en voir les résultats. Depuis longtemps qu'elle est commencée172, elle n'a pas abouti, et cela peut durer longtemps encore.
A quel mobile obéissent les libéraux canadiens en souhaitant cette union? Beaucoup d'entre eux se laissent éblouir par le mot même de République, qui désigne le gouvernement de leurs voisins. Pure question de mots, car la république que leur a octroyée la reine d'Angleterre sous le protectorat de sa couronne-c'est la meilleure définition qu'on puisse donner du gouvernement canadien-est dotée d'institutions tout aussi libérales que la République américaine elle-même.
Les hommes éclairés, les chefs du parti, obéissent à des considérations d'une nature plus élevée et plus sérieuse. Ils considèrent le Dominion comme un théâtre trop restreint pour le développement de leur activité et de leurs talents. Cette confédération de sept provinces, égrenées de l'est à l'ouest, presque sans intérêts communs entre elles, sans lien géographique ni économique, ne formera jamais, pensent-ils, qu'un État désuni, sans cohésion et sans puissance. Toutes les carrières ouvertes à une ambition légitime: armée, marine, diplomatie, commerce, politique, l'Union, les leur ouvrirait bien plus larges et plus grandes que ne peut le faire le Dominion.
Les conservateurs, de leur côté, combattent l'idée d'annexion au nom de la liberté même. Ils ne pensent pas que les institutions américaines soient supérieures à celles dont ils jouissent, et ne peuvent admettre, par exemple, que l'élection des juges, adoptée par presque tous les États américains, soit une garantie de la dignité et de l'indépendance de la magistrature.
L'intérêt national canadien-français est enfin invoqué à la fois par les deux partis, pour soutenir-chose curieuse-les deux thèses opposées. Nous devons, disent les libéraux, donner la main, par delà la frontière, à nos compatriotes des États-Unis. Déjà ils exercent une influence politique dans la grande République. Leur vote est recherché dans les élections présidentielles; à quoi ne pourrons-nous pas aspirer quand nous compterons, par l'annexion, trois millions d'électeurs français? N'aurons-nous pas le droit d'exiger au moins un ministre français? Les Irlandais, vivant en fait dans une situation inférieure et manquant d'hommes d'État et de chefs, les nôtres, – comme catholiques, – prennent tout naturellement leur direction. Soit douze millions d'électeurs en plus. Quelle puissance alors, quelle influence exercée dans la grande République par la race canadienne-française!
«Toujours la même différence entre les deux races. Le Français goûte et découvre d'instinct l'agrément et l'élégance; il en a besoin. Un quincaillier de Paris me disait qu'après le traité de commerce, quantité d'outils anglais, limes, poinçons, rabots, avaient été importés chez nous; bons outils, manches solides, laines excellentes, le tout à bon marché. Cependant on n'en avait guère vendu. L'ouvrier parisien regardait, touchait et finissait par dire: «Cela n'a pas d'œil», et il n'achetait pas.» (Taine, Notes sur l'Angleterre, p. 305.)