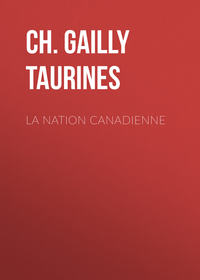Kitap dosya olarak indirilemez ancak uygulamamız üzerinden veya online olarak web sitemizden okunabilir.
Kitabı oku: «La Nation canadienne», sayfa 3
CHAPITRE IV
L'ANGLETERRE S'ATTACHE LES CANADIENS.
LA FRANCE LES OUBLIE (1763-1778)
«Enfin, le Roi dormira tranquille!» s'écria, dit-on, Mme de Pompadour en apprenant la signature du désastreux traité!
Le traité de Paris était pourtant l'échec le plus grave qu'eût, depuis quatre siècles, subi la monarchie française. Depuis le traité de Bretigny, aucune convention aussi humiliante n'avait été signée. Et comme alors; c'était le même ennemi que nous trouvions devant nous. Mais dans quelles différentes conditions!
Au quatorzième siècle, la lutte entre les rois de France et d'Angleterre était une lutte dynastique bien plus qu'une lutte de race; la guerre était une guerre civile entre deux nations de même origine. Les rois anglais, les barons et chevaliers qui les suivaient, les hommes d'armes qui composaient leur armée, étaient des Normands, tous de même sang, de même langue31, de même religion que les sujets des rois de France et que les rois de France eux-mêmes; ceux-ci eussent-ils succombé dans la lutte engagée entre ces deux fractions d'un même peuple, la dynastie française eût été changée peut-être, mais non la nationalité des Français.
Il en était bien autrement de l'échec infligé par l'Angleterre à la France au dix-septième siècle. La communauté d'origine était oubliée depuis longtemps. L'ancienne noblesse normande avait disparu, absorbée dans la nation anglo-saxonne. La langue française était remplacée par un langage nouveau. La religion elle-même-un des liens les plus forts entre les hommes quand elle les unit, mais aussi une des plus violentes causes de haine et de guerres quand elle les divise-était devenue une barrière de plus entre les deux peuples.
La dynastie d'Angleterre n'était plus de souche française. Une maison allemande occupait le trône de Guillaume le Conquérant et de Henri Plantagenet. Rien de commun ne subsistait entre les deux peuples. La lutte qui venait de se terminer n'était plus une lutte de frères ennemis, c'était bien le combat acharné entre deux races qui se disputent l'empire du monde; et dans cette lutte, la France venait d'avoir le dessous!
On est écœuré et triste à la fois de voir avec quelle indifférence cette honteuse paix fut acceptée en France. Pas un cri d'indignation; pas un regret pour un monde perdu! Devant un tel aveuglement, devant un tel abaissement des caractères, on ne peut que regarder d'un œil de douloureuse pitié cette malheureuse époque de notre histoire, et partager l'opinion que le marquis de Mirabeau, père du célèbre tribun, exprimait sur ses contemporains: «Ce royaume est bien mal, disait-il un jour, il n'y a plus de sentiments énergiques, ni d'argent pour les suppléer.»32
Le traité de Paris consacrait la prépondérance écrasante des Anglais en Amérique. Qu'allaient devenir ces 70,00 °Canadiens-Français que nous y abandonnions avec si peu de regrets? Leur nationalité, leur langue, leur religion, allaient subir de terribles assauts; sauraient-ils les défendre?
Tout paraissait conspirer contre ce petit peuple; aucun obstacle ne semblait s'opposer aux projets de ses ennemis. Pauvre, peu nombreux, sans direction, que pourrait-il donc contre une nation puissante, hardie, riche, nombreuse, et chez qui le prestige de la victoire sur une rivale, jusqu'alors considérée comme la première puissance de l'Europe, justifiait un incommensurable orgueil?
Tous les chefs naturels des Canadiens semblaient les avoir abandonnés; tous avaient regagné la France. Il n'en restait qu'un, mais c'était le plus puissant, le clergé!
Les services que, depuis les débuts de la colonie, le clergé rendait au peuple, avaient mérité sa confiance: explorations, découvertes, missions, enseignement, hôpitaux, colonisation, il avait tout entrepris, tout dirigé. Des plus illustres familles françaises étaient sortis ses prélats; des Montmorency, des Saint-Vallier, des Mornay avaient occupé le siège épiscopal de Québec. Il avait fourni de hardis voyageurs: Marquette et Hennepin au Mississipi; Druillettes et d'Ablon au lac Saint-Jean; Albanel à la baie d'Hudson.
Il avait eu ses colonisateurs: les Sulpiciens avaient défriché et mis en culture l'île de Montréal.
Il avait eu ses martyrs, les Pères Jogues, Daniel, de Brébeuf, Lallemand, torturés par les cruels ennemis des Français, les sauvages Iroquois.
Le clergé avait eu tant de part à la création de la colonie, qu'en parcourant les premières annales canadiennes, il semble qu'on lise une page de l'histoire de l'Église plutôt qu'une page de l'histoire de France. C'est avec la force d'influence qui lui était due pour tant de services que le clergé prit en 1763 la direction de la petite nation que nous venions d'abandonner. C'est lui qui mena, avec une vigueur dont nous devons lui savoir gré, la lutte nationale. Pour lui, la nationalité et la langue anglaises ne faisaient qu'un avec le protestantisme; il travailla avec acharnement à conserver les Canadiens à la nationalité française et au catholicisme, et c'est à ce puissant adversaire que vint, avec étonnement, se heurter la volonté du vainqueur.
C'est presque comme un crime que la loi anglaise, au dix-huitième siècle, considérait l'exercice du catholicisme. Au Canada, malgré les stipulations du traité de cession, la tolérance religieuse ne fut pas plus grande que dans la métropole. Le clergé fut en butte, sinon à toutes les persécutions, du moins à toutes les vexations, et des adresses venues de Londres sollicitaient les gouverneurs «d'ensevelir le papisme sous ses propres ruines». L'une d'elles, entre autres, élaborée par une Université anglaise, proposait, pour y arriver, les étranges moyens que voici: «Ne parler jamais contre le papisme en public, mais le miner sourdement; engager les jeunes filles à épouser des protestants; ne point discuter avec les gens d'Église, et se défier des Jésuites et des Sulpiciens; ne pas exiger actuellement le serment d'allégeance; réduire l'évêque à l'indigence; fomenter la division entre lui et ses prêtres; exclure les Européens de l'épiscopat, ainsi que les habitants du pays qui ont du mérite et qui peuvent maintenir les anciennes idées. Si l'on conserve un collège, en exclure les Jésuites et les Sulpiciens, les Européens et ceux qui ont étudié sous eux, afin que, privé de tout secours étranger, le papisme s'ensevelisse sous ses propres ruines. Rendre ridicules les cérémonies religieuses qui frappent les imaginations; empêcher les catéchismes; paraître faire grand cas de ceux qui ne donneront aucune instruction au peuple; les entraîner au plaisir, les dégoûter d'entendre les confessions, louer les curés luxueux, leur table, leurs équipages, leurs divertissements, excuser leur intempérance; les porter à violer le célibat qui en impose aux simples, etc.33.»
Au point de vue civil les Canadiens n'étaient pas mieux traités qu'au point de vue religieux. Toute fonction publique leur était fermée, d'une façon absolue, par la nécessité du fameux serment du test exigé par la loi, et que leur foi leur interdisait de prêter comme impliquant une apostasie des plus sacrées de leurs croyances. Dans ce pays qui, au moment de la conquête, était exclusivement français, pas un fonctionnaire petit ou grand, pas un juge n'était Français! Où donc les prenait-on puisque les Français formaient toute la population? Il fallait, au regret et à la honte des gouverneurs eux-mêmes, «prendre les magistrats et les jurés parmi quatre cent cinquante Anglais immigrés, commerçants, artisans et fermiers, méprisables principalement par leur ignorance34».
Telle est l'humiliante domination à laquelle étaient soumis les Canadiens. Elle aurait pu durer longtemps encore, mais heureusement pour eux, un grand événement se préparait en Amérique qui allait changer leur sort.
Un vent de révolte soufflait sur les colonies anglaises. Le gouvernement de Londres voyait l'orage qui s'amoncelait à l'horizon, l'inquiétude le gagnait, partout il cherchait un appui contre le danger. Il espéra le trouver dans les Canadiens eux-mêmes, et depuis longtemps des hommes éclairés lui conseillaient cette sage politique: «S'il est un moyen, disait un mémoire resté aux archives anglaises, d'empêcher, ou du moins d'éloigner la révolution des colonies d'Amérique, ce ne peut être que de favoriser tout ce qui peut entretenir une diversité d'opinions, de langue, de mœurs et d'intérêts, entre le Canada et la Nouvelle-Angleterre35.»
Cédant à ces habiles conseils, l'Angleterre, contre ses anciens sujets prêts à prendre les armes, voulut, par d'habiles concessions, s'assurer la fidélité des nouveaux. L'acte de Québec, voté par le parlement britannique en 1774, rendit aux Canadiens l'usage des lois françaises, et leur ouvrit l'accès des fonctions publiques en les dispensant du serment du test; il les fit sortir en un mot de cette triste situation de vaincus dans laquelle ils avaient été tenus jusque-là, et leur fit acquérir véritablement le titre et les droits de citoyens anglais.
Ces sages concessions arrivaient à point nommé. Le 26 octobre de cette même année, les treize colonies anglaises se réunissaient en congrès à Philadelphie, et l'année suivante la guerre éclatait, bientôt suivie de la déclaration d'indépendance.
Le Congrès des colonies révoltées eut beau, dès lors, s'efforcer d'entraîner les Canadiens dans sa rébellion, il eut beau leur faire parvenir les proclamations les plus pathétiques, l'éloquence de ses manifestes demeura sans effet; «l'acte de Québec» avait gagné les Canadiens à la cause anglaise.
Ces prétendus alliés offrant si bruyamment leur amitié, qu'étaient-ils d'ailleurs? Les Canadiens ne reconnaissaient-ils pas en eux ces mêmes Bostonais, leurs pires ennemis depuis deux siècles? Parmi ces émissaires de paix, ne voyaient-ils pas venir à eux, la bouche pleine de paroles de sympathie, ce même Franklin qui, lors de la guerre de Sept ans, avait multiplié ses efforts pour engager l'Angleterre à porter la guerre dans leur pays et à l'enlever à la France?
Une seule considération, peut-être, aurait pu entraîner leurs sympathies en faveur de la nouvelle république, c'est l'alliance que la France fit avec elle en 1778 en lui accordant l'appui de ses armes.
On s'étonne quelquefois que les Canadiens qui, vingt ans auparavant, avaient combattu avec tant d'énergie pour demeurer Français, n'aient rien fait alors pour le redevenir. Eh bien, c'est encore à notre honte qu'il faut l'avouer, la faute n'en est pas à eux, mais à nous.
En déclarant la guerre à l'Angleterre, le désir des hommes d'État français les plus éclairés était de recouvrer le Canada; c'était l'idée du ministre des affaires étrangères, M. de Vergennes. Un des anciens héros de la campagne canadienne, le chevalier, devenu le maréchal de Lévis, offrait ses services pour concourir à l'exécution du projet. Les Anglais eux-mêmes ne pouvaient croire que la France considérât le Canada comme définitivement perdu. Au lendemain même de la paix de 1763, ils prévoyaient, dans un avenir plus ou moins long, l'éventualité d'une nouvelle guerre, s'imaginant que le premier souci de la France serait de reconquérir son ancienne colonie: «Lorsque je considère, écrivait, en 1768, le gouverneur sir Guy Carleton, que la domination du Roi n'est maintenue qu'à l'aide de troupes peu nombreuses, et cela parmi une population militaire nombreuse, dont les gentilshommes sont tous des officiers d'expérience, pauvres, sans espoir qu'eux ou leurs descendants seront admis au service de leur présent souverain, je ne puis avoir de doute que la France, dès qu'elle sera décidée à recommencer la guerre, cherchera à reprendre le Canada… Mais si la France commence une guerre dans l'espérance que les colonies britanniques pousseront les choses aux extrémités, et qu'elle adopte le projet de les soutenir dans leurs idées d'indépendance, le Canada deviendra probablement la principale scène sur laquelle se jouera le sort de l'Amérique36.»
Quel ne dut pas être l'étonnement des Anglais en voyant les événements tourner d'une façon si étrangère à leurs prévisions, et si contraires à la vraisemblance! Pouvaient-ils s'imaginer que la France, trouvant l'occasion de prendre sur une orgueilleuse rivale une éclatante revanche, et de recouvrer en même temps son empire colonial perdu, renonçât à tout cela, pour embrasser une cause qui n'était pas la sienne? Pouvaient-ils croire, qu'oubliant l'intérêt national pour obéir à une opinion publique faussée par des sophismes, elle négligeât la défense de ses propres enfants, pour aller batailler, au nom des grandes idées de liberté, d'indépendance et d'émancipation, en faveur d'hommes qui, dans le même temps, consacraient l'esclavage, et, dans le nôtre, se sont battus pour le conserver?
Le comte de Ségur, un de ces jeunes militaires que l'enthousiasme guerrier porta à demander la faveur d'un emploi dans la guerre d'Amérique, et qui prit part à la campagne comme colonel en second du régiment de Soissonnais, nous donne, dans ses Mémoires, une vivante peinture de l'étrange engouement de la nation française en faveur de ses ennemis d'hier et des ingrats de demain: «Ce qu'il y a de plus singulier et de plus remarquable à l'époque dont je parle, dit-il, c'est que, à la cour comme à la ville, chez les grands comme chez les bourgeois, parmi les militaires comme parmi les financiers, au sein d'une vaste monarchie, sanctuaire antique des privilèges nobiliaires, parlementaires, ecclésiastiques, malgré l'habitude d'une longue obéissance au pouvoir arbitraire, la cause des Américains insurgés fixait toutes les attentions et excitait un intérêt général. De toutes parts, l'opinion pressait le gouvernement royal de se déclarer pour la liberté républicaine, et semblait lui reprocher sa lenteur et sa timidité.»
La cause des Américains insurgés, voilà donc ce qui excitait l'enthousiasme des Français! Des intérêts de la France elle-même il n'était pas question37.
Saisis par cet entraînement fatal, les ministres, en signant le traité d'alliance avec la république américaine, osèrent accéder à cette étrange clause réclamée par nos nouveaux amis, que la France renoncerait à reprendre le Canada!
Ainsi, les Canadiens n'avaient pas oublié leur patrie; c'était elle qui les oubliait!
CHAPITRE V
DES RIVAUX AUX CANADIENS: LES LOYALISTES (1778-1791)
Si la révolution américaine eut pour les Canadiens d'heureuses conséquences, si elle leur fit accorder par l'Angleterre un traitement plus juste et une situation plus favorable, elle eut, d'autre part, cet effet funeste d'amener, sur leur propre sol, des voisins qui devaient fatalement devenir pour eux des rivaux et même des ennemis.
Jusqu'à la révolution d'Amérique, pas un Anglais ne s'était établi parmi eux. Seuls, quelques négociants avaient, à la suite des vainqueurs, envahi les villes, y avaient formé cette petite oligarchie arrogante que les gouverneurs militaires traitaient avec tant de mépris, et dans laquelle ils rougissaient d'avoir à choisir des fonctionnaires et des magistrats.
Les campagnes étaient demeurées entièrement aux Canadiens. Mais la révolution refoula sur leur territoire tous ceux des habitants de l'Amérique anglaise qui voulurent continuer à vivre sous le drapeau anglais plutôt que d'adopter celui de la nouvelle république.
Les «loyalistes» (c'est le nom qu'on donnait à ces sujets fidèles, presque tous des fonctionnaires ou des officiers) arrivaient en foule. On estimait leur nombre à 10,000 en 178338. Il fallut leur donner des terres. On les établit sur plusieurs points encore inoccupés, les uns à l'extrémité de la presqu'île de Gaspé, d'autres sur le lac Champlain, d'autres enfin, et de beaucoup les plus nombreux, dans la grande presqu'île intérieure formée par les lacs Érié et Ontario. Ce sont ces derniers qui ont créé là une grande province anglaise, nommée d'abord le Haut-Canada, à cause de sa situation en amont sur le fleuve Saint-Laurent et sur les lacs d'où il sort, province connue aujourd'hui sous le nom de province d'Ontario.
Les deux nationalités étaient désormais en présence sur deux territoires voisins; la lutte allait commencer entre elles. Jusque-là les Canadiens n'avaient eu affaire qu'au gouvernement et à l'administration anglaise; ils allaient se trouver face à face avec la population et la race anglaise elle-même. L'hostilité du gouvernement n'avait été ni bien terrible, ni bien prolongée. Le conflit de nationalité entre les peuples fut long, acharné, sanglant même.
C'est en vain que l'administration essaya de séparer les adversaires, de poser entre eux une sorte de barrière; le conflit devait éclater un jour.
Dès 1783, le Haut-Canada reçut une organisation à part. Son territoire fut divisé en quatre départements qui, par une idée étrange, reçurent les noms allemands de Lunebourg, Mecklembourg, Hesse et Nassau.
Séparés ainsi territorialement et administrativement de leurs voisins, les Anglais le furent encore au point de vue judiciaire. Une ordonnance de 1787 les mit en dehors de la juridiction française, établie par l'acte de 1774 pour tout le pays39.
C'étaient là des mesures insuffisantes pour satisfaire une population que son loyalisme et son accroissement numérique lui-même rendaient exigeante. Dès la fin du dix-huitième siècle, elle s'élevait à 30,000 âmes, et ce n'étaient plus seulement des concessions et des droits qu'elle réclamait, mais-comme race conquérante-des privilèges, des faveurs et la domination de la population française.
La situation des gouverneurs était assez délicate, obligés qu'ils étaient de favoriser ces sujets-loyaux au point d'avoir abandonné leurs foyers pour demeurer fidèles à la couronne-et de ménager ces Canadiens dont la conduite venait de conserver à l'Angleterre une grande partie du continent.
Le gouvernement anglais sentait parfaitement que le concours de chacune de ces populations lui était également nécessaire, et dans l'impossibilité de les concilier, il essaya de les séparer tout à fait.
Le grand ministre, William Pitt, prit l'initiative d'un projet consistant à diviser le territoire canadien en deux provinces, ayant chacune son gouvernement et son administration distincts. Le 4 mars 1791, il présentait ce plan à la Chambre des communes et en démontrait les avantages: «La division en deux gouvernements, disait-il, mettra un terme à cette rivalité entre les émigrants anglais et les anciens habitants français, qui occasionne tant d'incertitude dans les lois et tant de dissensions. J'espère qu'elle pourra se faire de façon à assurer à chaque peuple une grande majorité dans la partie du pays qu'il occupe, car il n'est pas possible de tirer une ligne de séparation parfaite40.»
Le projet de Pitt comportait non seulement la séparation des provinces, mais-très libéral encore en ce point-il accordait à chacune d'elles ce gouvernement représentatif cher à tout citoyen anglais, en quelque partie du monde qu'il se trouve jeté par le destin.
C'était une faveur qu'il eût été difficile de refuser aux Anglais du Haut-Canada. Ces libres institutions, ne voyaient-ils pas les Américains, leurs concitoyens d'hier, en jouir? était-il juste que leur loyauté les privât de privilèges que leur eût assurés une conduite moins fidèle?
Sans réclamer d'une façon aussi pressante des institutions contre lesquelles ils avaient même un peu la méfiance de l'inconnu, – car le régime français ne les leur avait guère enseignées, – les Canadiens tenaient à ne pas être traités d'une façon différente; ils voulaient recevoir en même temps que leurs voisins tout ce que ceux-ci recevraient. C'est ainsi qu'ils furent, eux aussi, dotés d'un gouvernement représentatif.
La constitution préparée par Pitt fut votée sans difficulté par le Parlement. Dans la province française, elle confiait le pouvoir législatif à deux Chambres, l'une composée de cinquante membres et élective, l'Assemblée législative, l'autre composée de quinze membres choisis par le gouverneur, la Chambre haute ou Conseil législatif.
Cette constitution de 1791 donna aux Canadiens une autonomie et une liberté qu'ils n'auraient jamais obtenues s'ils étaient demeurés sous la domination de leur ancienne patrie: par intérêt, l'Angleterre agissait envers eux d'une façon plus libérale que la France ne l'eût jamais fait par amitié.
Son habile politique lui valut de précieux dévouements, et le clergé, entièrement rallié, n'eut plus que des éloges pour un gouvernement si libéral et si bienveillant: «Nos conquérants, disait, en 1794, dans une oraison funèbre M. Plessis, plus tard évêque de Québec, nos conquérants, regardés d'un œil ombrageux et jaloux, n'inspiraient que de l'horreur; on ne pouvait se persuader que des hommes étrangers à notre sol, à notre langue, à nos lois, à nos usages et à notre culte, fussent jamais capables de rendre au Canada ce qu'il venait de perdre en changeant de maîtres. Nation généreuse qui nous avez fait voir avec tant d'évidence combien nos préjugés étaient faux; nation industrieuse qui avez fait germer les richesses que cette terre renfermait dans son sein; nation exemplaire qui, dans ce moment de crise, enseignez à l'univers attentif en quoi consiste cette liberté après laquelle tous les hommes soupirent, et dont si peu connaissent les justes bornes; nation compatissante qui venez de recueillir avec tant d'humanité les sujets les plus fidèles et les plus maltraités de ce royaume auquel nous appartînmes autrefois; nation bienfaisante qui donnez chaque jour au Canada de nouvelles preuves de votre libéralité; – non, non, vous n'êtes pas nos ennemis, ni ceux de nos propriétés que vos lois protègent, ni ceux de notre sainte religion que vous respectez! Pardonnez donc ces premières défiances à un peuple qui n'avait pas encore le bonheur de vous connaîtr41.»
Ces éloges, tout exagérées dans leur forme lyrique qu'ils puissent nous paraître aujourd'hui, le gouvernement anglais les méritait véritablement. Par la séparation des deux provinces, par l'octroi de la constitution de 1791, il venait, pour ainsi dire, de prendre lui-même la défense de la nationalité canadienne contre les attaques des populations anglaises. Les précautions prises pour séparer les rivaux étaient conformes à tout ce que pouvait prévoir la prudence humaine; elles furent cependant encore insuffisantes à contenir la haine atroce dont les Anglais du Canada poursuivirent les Canadiens, et dont nous allons voir bientôt les sanglants résultats.