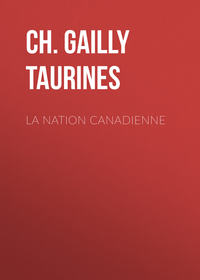Kitap dosya olarak indirilemez ancak uygulamamız üzerinden veya online olarak web sitemizden okunabilir.
Kitabı oku: «La Nation canadienne», sayfa 5
CHAPITRE VIII
L'AUTONOMIE DES CANADIENS.
LE DOMINION (1867)
Toute grande œuvre politique a son grand homme. Sans Cavour, pas de royaume d'Italie; sans Bismarck, pas d'empire d'Allemagne. La Confédération canadienne-toutes proportions gardées-a, elle aussi, son fondateur.
Ministre presque sans interruption pendant plus de trente ans, sir John A. Macdonald est un type curieux et tient de beaucoup la première place parmi les hommes d'État anglais du Canada.
Ayant dans la conscience la souplesse qui tourne les obstacles, et dans la volonté la fermeté d'acier qui les brise; voyant clairement le but à atteindre, y marchant droit ou par un détour, suivant la nature des difficultés qui se présentaient sur sa route; assez habile et insinuant pour réunir sous sa bannière les ennemis les plus irréconciliables et les faire combattre côte à côte pour sa propre cause; idole du parti antifrançais et anticatholique des Orangistes, auxquels il accorda toujours une protection efficace, suivi aussi par les catholiques, auxquels il ne ménagea jamais les paroles ni les promesses; cachant une volonté de fer sous une physionomie souriante et simple, sir John avait l'étoffe d'un véritable politique.
Son œuvre fut digne de son talent: un État grand comme l'Europe entière, baigné par deux océans, et traversé par la voie ferrée la plus étendue de l'univers, certes, c'est là une création dont plus d'un serait fier.
De sang écossais, il naquit à Glasgow en 1815. Il était fils d'un yeoman (petit propriétaire) du Sutherlandshire, qui émigra au Canada vers 1820, et se fixa avec sa famille à Kingston (Ontario). Élevé au collège de cette ville, le jeune Macdonald fit ses études de droit et entra au barreau en 1836. Dès 1839, à l'âge de vingt-quatre ans, il se faisait connaître comme avocat par la défense, restée célèbre, d'un aventurier allemand, von Schultz, qui pendant trois ans avait terrorisé le pays à la tête d'une bande de maraudeurs. Enfin, en 1844, il débutait dans la vie politique comme représentant de la ville de Kingston à l'Assemblée législative du Canada. Il s'imposa dès lors comme un des chefs du parti conservateur, et figura, à partir de 1847, dans plusieurs ministères. En 1864 enfin, il prit la présidence du cabinet qui élabora et fit réussir le projet de Confédération canadienne.
Aux quatre provinces entrées tout d'abord dans la confédération: Ontario, Québec, Nouveau-Brunswick et Nouvelle-Écosse, il réussit bientôt à en ajouter d'autres. En ouvrant, le 7 novembre 1867, la première session du Parlement canadien, le gouverneur général, lord Monck, avait tracé, pour ainsi dire, un programme et marqué un but à la nouvelle nation: «J'espère et je crois, avait-il dit, qu'elle étendra ses frontières de l'Atlantique au Pacifique54.» Sir John Macdonald ne tarda pas à réaliser ce programme et à atteindre ce but.
Avec la puissante compagnie de la Baie d'Hudson, il négocie dès 1869 l'achat des vastes territoires de l'Ouest, et y organise en 1870 la nouvelle province de Manitoba. C'était un pas immense fait par le nouvel État vers le Pacifique; mais les Montagnes Rocheuses l'en séparaient encore. L'année suivante, sir John les lui fait franchir, en obtenant l'adhésion de la Colombie britannique à la Confédération. En 1873 enfin, il y ajoute l'île du prince Édouard, qui porte à sept le nombre des provinces, et complète un territoire s'étendant sans interruption des bords de l'Atlantique à ceux du Pacifique, de l'embouchure du Saint-Laurent à l'île de Vancouver!
Restreint autrefois aux contrées limitrophes du Saint-Laurent, le nom de Canada embrasse aujourd'hui la moitié du continent américain, et le titre même de Dominion, imposé par ses fondateurs au nouvel État, montre bien quelles brillantes destinées ils espéraient pour lui.
La vie entière de sir John a été, depuis 1867, consacrée à la consolidation de son œuvre. Maintenu constamment aux affaires par une imposante majorité dans les Chambres, – sauf une courte période, de 1872 à 1878, durant laquelle le parti libéral s'éleva et se maintint au pouvoir, – il eut le temps de développer toute son énergie et tous ses talents. Sa persévérante volonté réussit à mener à bien la grande et difficile entreprise du chemin de fer Transcontinental. C'est grâce à lui qu'en 1886, le Canadian Pacific Railway, le C. P. R. comme on dit au Canada, faisait franchir à ses locomotives les cols abrupts perdus dans les glaciers des Montagnes Rocheuses, reliant par une ligne de quatre mille kilomètres la ville de Québec à celle de Vancouver!
En même temps qu'il ouvrait de grandes voies au commerce, sir John, par une politique étroitement protectionniste, – que tous n'admirent pas, mais dont tous reconnaissent l'énergie, – s'efforçait de développer les ressources industrielles du pays. Il n'a cessé de déployer en toute matière une infatigable activité, et sa mort, arrivée à Ottawa le 6 juin 1891, a été accueillie comme un deuil national par le parti conservateur tout entier. En mémoire de ses services, la reine Victoria a conféré à sa veuve le titre de comtesse de Earncliffe55.
La Confédération, cet édifice tout neuf, composé d'éléments un peu hétérogènes laborieusement réunis, survivra-t-il au puissant architecte qui l'avait construit? Ce qui pourrait inspirer des craintes à cet égard, c'est que les élections fédérales, surtout depuis la mort de sir John, semblent indiquer une diminution constante dans la majorité conservatrice, seul soutien de la Constitution, que le parti libéral s'efforce au contraire de battre en brèche.
Quoi qu'il en soit, et quel que doive être le destin du Dominion, il est intéressant d'en connaître la Constitution et de savoir quel degré d'autonomie lui est laissé dans ses rapports avec l'Angleterre; quelle autonomie il laisse lui-même aux provinces, et spécialement à la province française de Québec.
La Constitution canadienne de 1867 est à la fois une imitation de la constitution anglaise et de celle des États-Unis. A l'Angleterre elle a emprunté son système de responsabilité ministérielle, aux États-Unis leur organisation fédérale.
Le pouvoir exécutif est exercé par le gouverneur général. Il représente la Reine; en cette qualité il agit comme un souverain constitutionnel et garde une rigoureuse impartialité entre les partis, prenant invariablement ses ministres dans la majorité des Chambres. Toujours choisis parmi les hommes d'État les plus en vue, et parmi les plus grands noms de la pairie anglaise, les gouverneurs qui se sont succédé depuis 1867 ont été, après lord Monck, le marquis de Lansdowne, le marquis de Lorne, lord Dufferin, lord Stanley et aujourd'hui enfin lord Aberdeen.
Dans les provinces, les lieutenants gouverneurs, nommés par le gouverneur général, sont eux aussi les représentants du pouvoir exécutif, et agissent de la même façon quant au choix des ministres et à l'exercice de la responsabilité ministérielle.
Ainsi, deux hiérarchies de gouvernements: le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux, l'un à peu près indépendant en fait du gouvernement anglais, les autres jouissant, vis-à-vis du gouvernement fédéral, d'une large autonomie.
Sur le Dominion, l'Angleterre ne fait guère sentir sa suprématie que par la nomination du gouverneur; tous ses droits souverains, elle les a abandonnés à sa colonie. Elle n'en a retenu qu'un seul, celui de présider à ses relations extérieures; encore l'exerce-t-elle avec une remarquable modération, et, bien que les agents diplomatiques et consulaires anglais soient seuls chargés, d'une façon officielle, de la représentation des intérêts coloniaux à l'étranger, le gouvernement canadien entretient cependant à Paris et à Londres deux agents, qui, avec le titre de Commissaires généraux, sont chargés de veiller, d'une façon plus directe, aux intérêts de leurs compatriotes56.
Bien mieux encore: dans toute affaire diplomatique où les intérêts canadiens peuvent être en jeu, l'Angleterre a depuis longtemps reconnu en pratique le droit, pour sa colonie, d'être consultée et de participer aux négociations. Dans les négociations des traités de Washington en 1871 et en 1888, relativement aux pêcheries de Behring (et dont les clauses, restées sans exécution de la part des États-Unis, ont été remplacées par celles de la sentence internationale récemment rendue à Paris), – le Canada avait chaque fois été représenté par un de ses hommes d'État les plus habiles: par sir John A. Macdonald en 1871, par sir Charles Tupper en 1888.
Tous les traités intéressant le Canada doivent être ratifiés par son Parlement aussi bien que par le Parlement impérial, et dans les traités eux-mêmes présentant un intérêt général pour l'empire britannique, l'Angleterre a soin, la plupart du temps, de stipuler qu'ils ne seront appliquables à ses colonies qu'autant que leurs clauses ne seraient pas en opposition avec la législation de ces colonies au moment de la signature57.
Non contents d'avoir, à Paris et à Londres, des représentants officieux, les Canadiens aspirent à en avoir dans tous les pays étrangers, et voudraient faire reconnaître par la métropole elle-même leur caractère diplomatique. Durant la session de 1892, le Parlement canadien a adopté une résolution tendant à ce que «des négociations soient entamées avec le gouvernement de Sa Majesté afin de procurer au Canada une représentation plus complète de ses intérêts à Washington et dans les capitales des autres pays où cette représentation pourrait être avantageuse. En tant-ajoute la motion-que cela pourra être compatible avec le maintien des relations qui doivent exister entre la Grande-Bretagne et le Canada58.»
Depuis longtemps le Canada n'a plus de garnison anglaise, sauf dans la seule forteresse d'Halifax, où se trouve encore un régiment. Toutes les autres villes, même fortifiées, et Québec entre autres, n'ont plus dans leurs murs que les milices du pays.
Bien plus encore qu'au point de vue diplomatique et militaire, c'est dans ses relations économiques avec la métropole que se manifeste d'une façon claire l'indépendance du Canada. Lorsqu'on 1879 sir John A. Macdonald inaugura sa politique protectionniste, et fit voter un tarif douanier assez élevé, l'Angleterre s'en trouva frappée à l'égal des nations étrangères; nulle exception ne fut faite en sa faveur, et elle dut subir la loi commune.
Certes, cette politique n'a pas été sans causer en Angleterre quelque dépit; mais quand, à la Chambre des communes, un député s'adressa au gouvernement pour lui demander de désapprouver la loi et de mettre obstacle à son application, le ministre des colonies fut forcé de répondre que la mesure en question ne sortait pas de la limite des droits garantis au Canada par sa constitution, et il ajouta que, quelque regret qu'on pût ressentir de lui voir adopter un système économique si contraire à celui de la métropole et à ses intérêts, toute opposition et toute entrave seraient impossibles et injustifiables59.
Si libre, si indépendant en tout de la métropole, le Dominion est en somme aujourd'hui une véritable république, presque autonome, sous le protectorat bienveillant et peu onéreux de la couronne d'Angleterre. C'est là la meilleure et la plus exacte définition qu'on en puisse donner.
CHAPITRE IX
L'AUTONOMIE DES CANADIENS-FRANÇAIS.
LA PROVINCE DE QUÉBEC
Dans l'État, presque indépendant, que nous venons de décrire, quelle place tiennent les Canadiens-Français? Leur autonomie dans la province de Québec est aussi grande que celle du Dominion vis-à-vis du gouvernement anglais; elle leur permet de conserver intactes leurs traditions, leurs mœurs, leurs institutions et leurs lois.
Formant les quatre cinquièmes de la population de Québec, ils y sont, dans les limites de la Constitution, à peu près tout-puissants, et cette constitution est fort large. Tous les intérêts locaux sont laissés à la province. Le gouvernement fédéral ne fait sentir son autorité que dans les affaires d'intérêt général, telles que le régime douanier, les postes et télégraphes, la milice, la navigation, les monnaies et les lois criminelles.
Quant à la législation civile, à l'administration de la justice, aux institutions municipales, aux travaux publics provinciaux, au domaine public (les terres de la couronne, suivant l'expression officielle), à l'instruction publique, et à la constitution provinciale elle-même, tout cela reste dans la compétence de la province.
La province de Québec, en somme, est dès aujourd'hui, et non seulement au point de vue des mœurs et de la langue, mais même au point de vue politique, un petit État français.
Elle s'est donné une législation civile toute française par ses sources, puisqu'elle a été tirée en grande partie de la Coutume de Paris en usage dans l'ancien Canada, mais remaniée et modernisée dans les données de notre Code civil.
Son Parlement, aussi bien la Chambre haute (ou Conseil législatif), nommée par le lieutenant gouverneur, que la Chambre basse (ou Assemblée législative), nommée au suffrage universel, se compose à peu près exclusivement de Canadiens-Français; sur les soixante-cinq membres de l'Assemblée législative, on ne compte guère qu'une dizaine d'Anglais.
En somme, ce Parlement est un petit parlement français, toutes les discussions à peu près s'y font en français et, ajoutons-le, à la française, avec cette pointe de vivacité qui caractérise les nôtres. L'étiquette et la procédure parlementaires ont beau être empruntées à l'Angleterre, le président a beau s'appeler M. l'Orateur, un huissier de la Verge noire sorte de personnage sacramentel, la Masse d'arme elle-même qui, soi-disant, représente l'autorité de la Reine, ont beau donner aux apparences comme une sorte de vernis britannique, les hommes et leurs actes sont bien français.
La rapidité même avec laquelle se succèdent les ministères ne suffirait-elle pas à montrer que nos frères d'Amérique n'ont rien perdu de la promptitude de notre caractère? Dans l'exercice du gouvernement parlementaire, les Canadiens n'ont pu apporter cette patience et ce calme propres aux Anglo-Saxons; ils y mettent un peu de cette ardeur française, dont leurs concitoyens anglais leur font un reproche, mais qui, après tout, n'est peut-être pas un défaut.
Libéraux et conservateurs se disputent le pouvoir avec acharnement, et l'occupent tour à tour avec une remarquable périodicité. Bien mieux que des changements de ministères, les Canadiens ont eu, eux aussi, leurs coups d'État, – sans effusion de sang, grâce à Dieu! Déjà deux fois depuis 1867, les lieutenants gouverneurs ont, de leur propre autorité, renvoyé des ministres possédant la confiance du Parlement, et dissous le Parlement lui-même pour procéder à de nouvelles élections. C'est ce que fit en 1878, en faveur du parti libéral, M. Letellier de Saint-Just, et en 1892, M. Angers, en faveur du parti conservateur.
Mais ces luttes de parti n'altèrent en rien l'union nationale. Libéraux et conservateurs, divisés sur des détails de politique et d'intérêt, demeurent unis sur les points essentiels. Les uns et les autres sont également d'ardents défenseurs de l'idée catholique et de la nationalité française.
Cette unanimité s'est manifestée, il y a quelques années, lorsqu'on 1885, à la suite de la rébellion des métis français du Nord-Ouest, le gouvernement fédéral sévit contre les révoltés avec une sévérité qui put faire supposer qu'il poursuivait en eux les représentants de la race française plus que les rebelles. A la nouvelle du supplice de Louis Riel, la province de Québec tout entière fut unanime; libéraux et conservateurs oublièrent leurs querelles et, sous la direction d'un homme politique habile qui prit la tête du mouvement, s'unirent en un seul parti sous le nom de Parti national. Grâce à l'influence de l'auteur de cette fusion (M. Mercier, qui devint premier ministre de la province), la concorde dura quelques années. Mais la question Riel finit par tomber dans l'oubli, les luttes de parti reprirent, et ont eu dernièrement leur conclusion par la chute du cabinet Mercier, remplacé par M. de Boucherville.
Querelles de famille que ces luttes; arrive de nouveau un danger, ou même l'apparence d'un danger national, tous les partis s'uniraient de nouveau.
Cette suprématie de l'élément français, les Anglais de la province sont bien obligés de la subir; ils le font sans récriminations et, sauf quelques rares exceptions, se montrent satisfaits de la liberté absolue de conscience qui leur est laissée comme protestants, et de la part équitable, généreuse même, qui leur est faite dans la répartition des fonctions publiques. Un député anglais a beau s'écrier parfois dans l'Assemblée législative «que ce n'est pas par tolérance que la population anglaise se trouve dans la province de Québec et qu'elle y restera en dépit de tous60»; ce sont là des fanfaronnades que personne ne relève parce qu'elles n'ont aucune portée. Personne, en effet, parmi les Canadiens-Français, ne conteste à la population anglaise le droit de demeurer dans la province, et ce n'est pas leur faute si, de l'aveu de tous, elle y est en voie de décroissance constante. De ce fait avéré et avoué par eux, les Anglais ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Il est pourtant quelques rares fanatiques qui ne craignent pas d'attribuer à l'action du clergé français la décadence de la population anglaise: «Est-il nécessaire de dire, écrit l'un d'eux, – un journaliste, – que l'introduction du système paroissial dans les cantons anglais de Québec y a apporté la décadence? Un grand nombre d'établissements anglais ont disparu et partout le nombre des Français augmente, au point que les Anglais qui pouvaient commander vingt collèges électoraux il y a vingt-cinq ans, s'y trouvent maintenant en minorité à l'exception de quatre comtés61.»
La plupart des Anglais de Québec montrent un plus équitable esprit, et reconnaissent que le mouvement de diminution de leur population est un mouvement inévitable contre lequel il n'y a pas à récriminer: «Les Anglais partent, les Français arrivent, dit un Anglais, le Dr Dawson… Si les cultivateurs anglais peuvent améliorer leur sort en vendant leurs fermes, il est certainement préférable qu'ils puissent trouver des acquéreurs62.»
Les Anglais de Québec se résignent, on le voit, de bonne grâce à la situation un peu effacée qu'ils occupent. Mais l'attitude des Anglais d'Ontario est tout autre en présence des progrès des Canadiens. Le dépit non dissimulé de ceux-là égale la sage résignation des premiers.
Il existe, dans la province anglaise, une coterie faisant profession d'un protestantisme intransigeant et haineux, et qui, réunie en une sorte de société secrète sous le nom de Loges orangistes, se plaît à accabler les Canadiens de tous les outrages et de toutes les injustices. Les Orangistes voilent leur fanatisme sous un prétendu dévouement dynastique à la couronne anglaise et sous un patriotisme d'ostentation; mais leur zèle est tenu en haut lieu pour ce qu'il vaut, et leur a plusieurs fois attiré des humiliations officielles.
Lorsqu'on 1860 le prince de Galles fit un voyage au Canada, ayant été averti que les Orangistes de la province d'Ontario préparaient en son honneur des manifestations quelque peu hostiles à l'élément catholique et français, il fit savoir aux autorités, par l'intermédiaire du duc de Newcastle, secrétaire d'État des colonies, qui l'accompagnait, qu'il n'accepterait aucune fête d'un caractère exclusif, et ne mettrait le pied dans aucune ville où les dispositions prises pour le recevoir seraient de nature à blesser les opinions ou les croyances d'une portion quelconque des sujets de la Reine. Dans plusieurs villes, on ne tint aucun compte de cet avertissement. Le prince, qui voyageait en bateau à vapeur, modifia son itinéraire, et passa sans s'y arrêter devant les villes de Kingston et de Bonneville, et les Loges orangistes, rangées sur le quai en grand costume et bannières déployées, autour des arcs de triomphe emblématiques qu'elles avaient préparés, ne purent que poursuivre de leurs murmures le bateau à vapeur qui emportait le prince, sans avoir reçu de lui ni une parole, ni un regard.
Cette coterie orangiste s'émeut quelquefois de la politique suivie par la province de Québec. Le vote en 1888 par le Parlement de la province française, sur l'initiative de M. Mercier, d'une loi restituant aux Jésuites une partie des biens qui leur avaient été confisqués par le gouvernement anglais, a suscité dans ce milieu protestant les plus violentes tempêtes. Les protestants d'Ontario demandèrent au gouvernement fédéral le désaveu de la loi. Dans le cours de la discussion, les Canadiens furent accusés de vouloir arrêter le cours du progrès et remonter aux temps les plus ténébreux d'oppression et d'ignorance; des orateurs, sans doute peu au fait de l'histoire, confondirent dans une réprobation commune les Jésuites, le moyen âge, la tyrannie et le papisme! Bref, comme le dit sir John A. Macdonald, qui, pour cette fois, soutint les Canadiens d'une façon effective, «on eût pu croire, à lire les articles publiés par certains journaux, et à entendre les discours prononcés par certains orateurs, qu'on se trouvait en face d'une invasion des Jésuites comme d'une nouvelle invasion des Huns et des Vandales, qui allait balayer la civilisation du pays63»
Si quelques centaines de mille francs restituées aux Jésuites64, – car les biens eux-mêmes ne leur avaient pas été rendus, mais seulement leur valeur, – soulevaient de pareilles tempêtes, c'est que cette somme minime et qui ne regardait, après tout, que les contribuables de Québec, non pas ceux d'Ontario, c'est que les Jésuites eux-mêmes n'étaient, au fond, que l'accessoire de la question, et que le conflit, bien plus qu'une polémique religieuse, était une lutte nationale entre les deux populations rivales.
«La question qui agite l'esprit du peuple, s'écriait un député anglais, M. Charlton, qui crée l'intérêt causé par ce débat, c'est de savoir si la Confédération canadienne sera saxonne ou française… C'est une question d'une grande portée, une question dont nous ne pouvons exagérer l'importance… La tendance à développer en ce pays un sentiment intense de nationalité française, tendance qui s'accentue encore de ce que cette nationalité possède une Église nationale qui, dans son propre intérêt, travaille au développement de ce sentiment national, est une tendance que nous devons tous déplorer, une tendance que nous désirons ne pas voir s'accentuer, une tendance que ceux qui ont à cœur le bien du pays désireraient plutôt voir s'amoindrir et disparaître65.»
Les Orangistes d'Ontario ont beau le déplorer, cette tendance s'accentue et s'accentuera. La nation canadienne-française n'est pas en voie de s'éteindre; elle est, au contraire, tant au point de vue matériel qu'au point de vue moral, en pleine voie d'accroissement et de progrès.