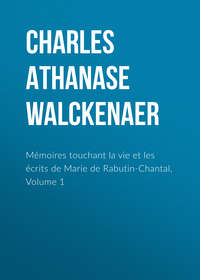Kitabı oku: «Mémoires touchant la vie et les écrits de Marie de Rabutin-Chantal, Volume 1», sayfa 11
CHAPITRE XIII.
1648-1649
Madame de Sévigné accouche d'une fille.—Conjectures sur le lieu de sa naissance.—Date du séjour de madame de Sévigné au château de Ferrières; son retour à Paris.—Elle y trouve Marigny.—Impromptu qu'il fait pour elle.—Brusqueries et mauvais procédés du marquis de Sévigné envers sa femme.—Bussy devient le confident des deux époux.—Sentiments de madame de Sévigné pour son cousin.—Il conçoit l'espérance de la séduire.—Fuite de la cour à Saint-Germain.—Bussy est obligé de la suivre.—Commencement de la première guerre de Paris.—Le marquis de Sévigné se rend en Normandie.—Rôle qu'il joue dans cette guerre.—Le chevalier Renaud de Sévigné est employé par le coadjuteur.—Bussy réclame auprès du ministre l'argent qui lui est dû.—Il sert avec zèle le parti du roi.—Il envoie à Paris pour ramener ses chevaux.—Il écrit à sa cousine.—Lettre de Bussy à madame de Sévigné.—Bussy se trouve à l'attaque du pont de Charenton.—Il envoie réclamer les chevaux qu'on lui avait pris.—Madame de Sévigné s'emploie pour lui, et lui répond.—Autre lettre de Bussy à madame de Sévigné.—Paix conclue entre la cour et le parlement.—Bussy veut rentrer dans Paris, et manque d'être assommé à la barrière.—Il repart de Paris.—Condé, mécontent, lui donne des ordres, qu'il fait exécuter par son maréchal des logis.—Bussy se rend en Bourgogne; il y trouve Condé, qui l'oblige à partir pour l'armée.—Bussy insatiable d'intrigues galantes.—Pendant son séjour au Temple, Bussy fait sa cour à une jeune personne, et s'en fait aimer.—Forcé de la quitter, il lui écrit de l'armée.
Pendant toute cette orageuse année de 1648, qui vit commencer les troubles précurseurs de la guerre civile, madame de Sévigné avait été retenue par son mari loin de la capitale; elle était accouchée d'une fille, celle-là même qui devait remplir une si grande place dans son existence, et devenir pour elle la source de tant de tendresse, d'inquiétudes, de plaisirs et de tourments. Les noms de baptême donnés à cette enfant, devenue, sous le nom de Grignan, plus célèbre par les lettres de sa mère que par l'antique noblesse de celui qu'elle épousa, furent Françoise-Marguerite. Le jour précis et le lieu de sa naissance ne sont pas connus avec certitude. Tout porte à croire cependant que mademoiselle de Sévigné est née à la terre des Rochers. Nous avons vu que madame de Sévigné se trouvait encore à l'abbaye de Ferrières le 15 novembre. Elle revint à Paris à la fin de ce même mois: elle y trouva toute la cour. La reine régente, accompagnée du roi son fils, avait fait son entrée dans la capitale, la veille de la Toussaint, au bruit des acclamations de joie de tout le peuple251.
Madame de Sévigné retrouva encore à Paris son cousin Bussy et le gai et spirituel Marigny. Il revenait de Suède252. Aussitôt après son retour, le coadjuteur s'était empressé de se l'attacher; il employait utilement sa muse joviale, burlesque et populaire, à ridiculiser tous ceux qui se montraient contraires à ses projets253. Marigny, le 1er janvier 1649, envoya, sous le titre d'étrennes à la marquise de Sévigné, pour lui souhaiter la bonne année, les vers suivants, écrits dans ce mauvais style grotesque si fort à la mode alors:
Adorable et belle marquise,
Plus belle mille fois qu'un satin blanc tout neuf;
Au premier jour de l'an mil sept cent quarante-neuf,
Je vous présenterais de bon cœur ma franchise;
Mais les charmes que vous avez
Depuis quelque temps me l'ont prise.
Je ne sais si vous le savez254.
Bussy, de plus en plus amoureux de sa cousine, continuait à se montrer très-assidu auprès d'elle. Il s'était habilement insinué dans la confiance de son mari. Admis comme parent dans la familiarité la plus intime des deux époux, il était souvent témoin des brusqueries de Sévigné envers sa femme; il écoutait avec une apparente sympathie les plaintes de celle-ci sur les infidélités répétées du marquis et sur les peines qu'elle en éprouvait. Abusant de l'inexpérience de sa jeune cousine, il acceptait le rôle de conciliateur, dont elle le chargeait, avec une feinte répugnance, mais avec une joie secrète. Elle croyait qu'il employait dans l'intérêt de son bonheur conjugal l'ascendant que lui donnaient sur le marquis de Sévigné la supériorité de son esprit et l'amitié qu'il paraissait avoir pour lui. Peut-être aussi, sans qu'elle s'en doutât, madame de Sévigné aimait-elle à trouver dans les soins, les flatteries et la conversation d'un homme aussi aimable et aussi spirituel que Bussy, un dédommagement aux délaissements d'un époux dont les manières à son égard faisaient un si grand contraste avec celles de son cousin; et le besoin d'être consolée n'était pas le seul motif qui lui faisait prolonger ses entretiens avec le consolateur. Les lettres qui nous restent d'elle et les ménagements qu'elle eut toujours pour Bussy, même après les torts les plus grands qu'un homme puisse avoir envers une femme, donnent lieu de le croire255. Quoi qu'il en soit, Bussy n'en doutait pas, et un caractère moins présomptueux que le sien en eût été également persuadé. Aussi écrivait-il et agissait-il en conséquence: quoiqu'il n'ignorât pas tous les scrupules qu'il avait à vaincre, il était plein d'espoir, et de jour en jour moins réservé dans son langage. A mesure que les torts du mari se multipliaient, et qu'ils froissaient et humiliaient le cœur d'une épouse dont la tendresse, l'esprit et les attraits devaient la garantir de tout outrage, Bussy devenait plus entreprenant. Il se croyait près du but qu'il avait tant désiré atteindre, lorsque, par une fatalité qui semblait lui être particulière dans ses amours avec sa cousine, il se vit subitement séparé d'elle par un événement qui non-seulement compromettait le succès de sa longue attente, mais les destinées de la France entière.
Le lendemain du jour des Rois, le 7 janvier, on apprit que la reine régente, qui avait reçu la veille et tenu son cercle comme à l'ordinaire, était partie dans la nuit avec le roi et toute sa cour, et qu'elle s'était retirée à Saint-Germain. Elle fut suivie par le duc d'Orléans et le prince de Condé. La première guerre civile, ou la première guerre de Paris, commença aussitôt256.
Le duc de Longueville se rendit en Normandie. Il était le gouverneur de cette province, et il voulait la faire déclarer contre la cour et pour la Fronde. Il emmena avec lui un grand nombre de gentils-hommes, et entre autres le marquis de Sévigné, dont les hauts faits les plus remarquables dans cette guerre furent, si l'on en croit le spirituel Saint-Évremond, d'avoir su en mainte occasion faire rire son altesse le gouverneur par ses quolibets et son esprit goguenard257. Son oncle Renaud de Sévigné joua un rôle plus important. Le coadjuteur lui donna le commandement du régiment qu'il fit lever à ses frais pour la défense de Paris; et comme Gondi avait aussi le titre d'archevêque de Corinthe, on nomma le régiment que commandait Renaud de Sévigné, le régiment de Corinthe. Quand ce corps eut été battu dans une sortie, les royalistes appelèrent cette déroute la première aux Corinthiens, plaisanterie qui fit rire les frondeurs eux-mêmes258. Renaud de Sévigné fut encore employé par le coadjuteur dans quelques-unes des nombreuses négociations qu'on pouvait dire être continuelles en ces temps de trouble, où l'on ne se déclarait presque jamais pour un parti sans offrir en même temps des conditions, pour prix de sa défection, au parti contraire. Renaud de Sévigné fut pendant la Fronde considéré comme un personnage assez notable pour que le cardinal de Retz, dans une de ses conférences avec la reine et Mazarin, ne voulût point faire sa paix avec la cour sans le comprendre au nombre de ceux pour lesquels il réclamait des indemnités pécuniaires259. Il demandait pour lui 22,000 livres, ou 44,000 fr. de notre monnaie actuelle. Aucune mention ne fut faite alors du marquis de Sévigné. L'expédition où il avait été employé n'eut aucun succès. Plusieurs nobles, et entre autres Saint-Évremond, refusèrent de se joindre au duc de Longueville; et le projet qu'il avait de faire révolter la Normandie échoua par l'arrivée du comte d'Harcourt, que la reine se hâta d'envoyer dans cette province260.
La duchesse de Longueville n'alla point rejoindre la cour ni son mari; elle se déclara pour la Fronde, et resta dans Paris. Toutes les femmes des seigneurs qui avaient embrassé le même parti imitèrent son exemple. Madame de Sévigné fut de ce nombre: elle n'accompagna point son mari en Normandie, et resta dans la capitale. Les courageuses résolutions de tant de beautés d'un haut rang, qui avaient dans l'armée des assiégeants leurs frères, leurs parents, leurs amis, excitèrent parmi les bourgeois et le peuple un enthousiasme extraordinaire, et accrurent encore le feu de la sédition.
Bussy, que la reine n'avait pas mis dans le secret de son évasion, s'échappa avec peine de Paris, maudissant Mazarin, la guerre, et sa position, qui le forçaient de se séparer de sa cousine, de servir le prince de Condé, dont il était mécontent, et de suivre la cour, qui ne lui payait point les deux années d'appointements dus pour sa lieutenance de Nivernais261. Cependant il obéit avec zèle aux ordres qui lui furent donnés. Il tira du Nivernais les régiments qui y étaient en quartier, et d'Autun les chevau-légers du prince de Condé; il conduisit toutes ces troupes à Saint-Denis, où il fut placé sous les ordres du maréchal Duplessis-Praslin262. Bussy envoya un de ses laquais à Paris, pour lui ramener ses chevaux de carrosse; et pour qu'on les laissât sortir de la ville, il les fit passer pour être ceux de son oncle le grand prieur du Temple. Il ne négligea pas en cette occasion d'écrire à sa cousine, et lui envoya la lettre suivante263:
LETTRE DE BUSSY A MADAME DE SÉVIGNÉ
«A Saint-Denis, 5 février 1649.
«J'ai longtemps balancé à vous écrire, ne sachant si vous étiez devenue mon ennemie ou si vous étiez toujours ma bonne cousine, et si je devais vous envoyer un laquais ou un trompette. Enfin, me ressouvenant de vous avoir ouïe blâmer la brutalité d'Horace pour avoir dit à son beau-frère qu'il ne le connaissait plus depuis la guerre déclarée entre leurs républiques, j'ai cru que l'intérêt de votre parti ne vous empêcherait pas de lire mes lettres; et pour moi, je vous assure que, hors le service du roi mon maître, je suis votre très-humble serviteur.
«Ne croyez pas, ma chère cousine, que ce soit ici la fin de ma lettre: je vous veux dire encore deux mots de notre guerre. Je trouve qu'il fait bien froid pour faire garde. Il est vrai que le bois ne nous coûte rien ici, et que nous y faisons grande chère à bon marché. Avec tout cela il m'y ennuie fort; et sans l'espérance de vous faire quelque plaisir au sac de Paris, et que vous ne passerez que par mes mains, je crois que je déserterais. Mais cette vue me fait prendre patience.
«J'envoie ce laquais pour me rapporter de vos nouvelles, et pour me faire venir mes chevaux de carrosse, sous le nom de notre oncle le grand prieur. Adieu, ma chère cousine.»
Le lendemain du jour qui suivit le départ de cette lettre, Bussy partit de Saint-Denis dans la nuit, aux flambeaux, par un froid excessif; et au lever de l'aurore sa cavalerie se trouva rangée entre le parc de Vincennes et Conflans. Condé attaqua Charenton et s'en empara, mais seulement après trois combats meurtriers. Le marquis de Chaulieu du côté des frondeurs, et Gaspard de Coligny, duc de Châtillon, du côté des royalistes, y furent tués264. Les frondeurs s'étaient emparés de Brie-Comte-Robert. On forma le projet de reprendre cette place, dans le dessein où l'on était d'affamer Paris. Le maréchal de Grancey eut cette commission, et le maréchal Duplessis-Praslin fut chargé de protéger ses opérations avec un corps de troupes. Les chevau-légers de Bussy en faisaient partie. Il marcha donc pour cette expédition, qui ne dura que huit jours265. Revenu dans son cantonnement de Saint-Denis, Bussy apprit que les gens du maréchal la Mothe-Houdancourt avaient rencontré sur la route ses chevaux que son cocher lui amenait, et qu'ils s'en étaient emparés. Bussy se décida à envoyer un trompette au maréchal pour les réclamer, et en même temps il chargea le trompette de la lettre suivante pour madame de Sévigné266:
LETTRE DE BUSSY A MADAME DE SÉVIGNÉ
«Saint-Denis, le 5 mars 1649.
«C'est à ce coup que je vous traite en ennemie, Madame, en vous écrivant par mon trompette. La vérité est que c'est au maréchal de la Mothe que je l'envoie, pour le prier de me renvoyer les chevaux du carrosse du grand prieur notre oncle, que ses domestiques ont pris comme on me les amenait. Je ne vous prie pas de vous y employer, car c'est votre affaire aussi bien que la mienne; mais nous jugerons, par le succès de votre entremise, quelle considération on a pour vous dans votre parti; c'est-à-dire que nous avons bonne opinion de vos généraux, s'ils font le cas qu'ils doivent de vos recommandations.
«J'arrive présentement de notre expédition de Brie-Comte-Robert, las comme un chien. Il y a huit jours que je ne me suis déshabillé: nous sommes vos maîtres, mais il faut avouer que ce n'est pas sans peine. La guerre de Paris commence fort à m'ennuyer. Si vous ne mourez bientôt de faim, nous mourrons de fatigue; rendez-vous, ou nous allons nous rendre. Pour moi, avec tous mes autres maux, j'ai encore une extrême impatience de vous voir. Si M. le cardinal (Mazarin) avait à Paris une cousine faite comme vous, je me trompe fort, ou la paix se ferait à quelque prix que ce fût; tant y a que je la ferais, moi, si j'étais à sa place, car, sur ma foi, je vous aime fort.»
Madame de Sévigné s'employa d'une manière active pour faire rendre à son cousin ses chevaux; mais le maréchal de la Mothe s'y refusa. Elle répondit à la lettre de Bussy, et lui apprit le mauvais succès de sa négociation. On voit, par la réponse qu'il lui adressa le même jour, l'empressement qu'il mettait à saisir toutes les occasions de correspondre avec elle, et le plaisir qu'il avait à la railler sur les défaites de son parti267.
LETTRE DE BUSSY A MADAME DE SÉVIGNÉ
«Saint-Denis, le 6 mars 1649.
«Tant pis pour ceux qui vous ont refusé mes chevaux, ma belle cousine; je ne sais pas si cela leur fera grand profit, mais je sais bien que cela ne leur fait pas grand honneur. Pour moi, je suis tout consolé de cette perte, par les marques d'amitié que j'ai reçues de vous en cette rencontre. Pour M. de la Mothe, maréchal de la Ligue, si jamais il avait besoin de moi, il trouverait un chevalier peu courtois.
«Mais parlons un peu de la paix: qu'en croit-on à Paris? L'on en a ici fort méchante opinion: cela est étrange que les deux partis la souhaitent, et qu'on n'en puisse venir à bout.
«Vous m'appelez insolent, de vous avoir mandé que nous avions pris Brie. Est-ce que l'on dit à Paris que cela n'est pas vrai? Si nous en avions levé le siége, nous aurions été bien inquiets; car pour vos généraux, ils ont eu toute la patience imaginable: nous aurions tort de nous en plaindre.
«Voulez-vous que je vous parle franchement, ma belle cousine? Comme il n'y a point de péril pour nous à courre avec vos gens, il n'y a point aussi d'honneur à gagner: ils ne disputent pas assez la partie, nous n'y avons point de plaisir; qu'ils se rendent, ou qu'ils se battent bien. Il n'y a, je crois, jamais eu que cette guerre où la fortune n'ait point eu de part: quand nous pouvons tant faire que de vous trouver, c'est un coup sûr à nous que de vous battre, et le nombre ni l'avantage du lieu ne peuvent pas seulement faire balancer la victoire.
«Ah! que vous m'allez haïr, ma belle cousine! toutes les fleurettes du monde ne pourront pas vous apaiser.»
Cette paix que Bussy désirait tant fut conclue six jours après la lettre que nous venons de citer. Elle fut consentie le 11 mars entre la reine et les commissaires du parlement; mais on ne le sut à Paris que le 13, et la déclaration royale qui en réglait les dispositions ne fut approuvée par le parlement que le 1er avril. On convint d'une trêve de trois jours entre les parties belligérantes, à partir du jour où les commissaires du parlement étaient tombés d'accord des conditions de la paix avec la reine. On renouvelait cette trêve tous les trois jours avant qu'elle fût expirée, afin de procurer au parlement le temps de délibérer et de donner son approbation. Bussy, dans cet intervalle, entreprit de se rendre à Paris, afin de voir sa cousine. Arrivé à la porte Saint-Martin, où il se présenta accompagné de son frère et de deux autres personnes, l'officier du poste, à moitié ivre, voulut l'empêcher de passer outre, et lui demanda s'il avait un billet du maréchal Duplessis. Bussy lui répondit que la trêve était publiée, et qu'il n'avait pas besoin de billet pour entrer. L'officier lui dit qu'il n'entrerait pas sans billet. Bussy, contrarié de ce refus, déclara qu'il s'en allait aussi de son côté empêcher les gens de Paris d'entrer à Saint-Denis. Alors l'officier se mit à crier «au Mazarin!» Aussitôt Bussy fut enveloppé par une foule de gens qui sortirent des maisons environnantes: on l'assaillit lui et ses compagnons. Bussy reçut un coup de bâton sur la tête, qui lui fit une large blessure, et ce fut avec peine qu'on parvint à le faire entrer, ainsi que sa suite, dans un corps de garde voisin. On s'occupa à panser sa blessure; mais la multitude augmentait autour de lui et de ceux qui l'accompagnaient. On se pressait pour les voir comme des bêtes curieuses; on vociférait, on menaçait de les massacrer. Bussy, dans cette situation critique (il dit dans ses Mémoires qu'il n'a jamais vu la mort de si près), osa prendre à partie un homme qui s'emportait en injures contre le roi; mais comme en même temps Bussy, en défendant le roi, se mit à maudire Mazarin, il fut applaudi par le peuple et ne courut plus de danger: on lui permit d'écrire, et il en profita pour donner avis de son aventure au chevalier Dufresnoy, qui vint six heures après, muni d'un ordre du prévôt des marchands, délivrer les malheureux captifs. Le chevalier Dufresnoy prit Bussy dans son carrosse, et le conduisit au Temple, chez son oncle le grand prieur.
Bussy ne put jouir longtemps du bonheur de se trouver à Paris avec sa cousine. Le prince de Condé, qui avait contre lui des sujets de mécontentement graves, ou à qui son esprit caustique et son caractère présomptueux et moqueur avaient déplu, cherchait à lui occasionner des dégoûts; il voulait que Bussy vendît à Guitaut sa charge de capitaine-lieutenant des chevau-légers. Le comte de Guitaut était cornette dans cette compagnie, et il avait toute la confiance du prince268. Bussy résista; alors Condé donna l'ordre à sa compagnie de chevau-légers de marcher en Flandre. La guerre s'y continuait. Les Espagnols, profitant des troubles civils, avaient repris Ypres et Saint-Venant. Bussy évita cette fois l'obligation de se rendre à l'armée, en chargeant son maréchal des logis de l'exécution des ordres qu'il avait reçus, et en prétextant des affaires de famille qui exigeaient sa présence en Bourgogne, où en effet il eut soin de se rendre. Malheureusement pour lui, le prince de Condé y vint aussi, et Bussy se trouva dans la nécessité d'aller lui rendre ses devoirs à Dijon. Là, le prince lui réitéra l'ordre d'aller à l'armée; il fallait nécessairement ou vendre sa charge, ou faire la campagne: Bussy préféra ce dernier parti269.
Ni les projets de mariage que Bussy formait à cette époque270, ni la mort du seul frère qui lui restait, et dont il avait reçu des marques de dévouement et d'amitié271, ni l'amour qu'il avait pour sa cousine, ne pouvaient arrêter ce besoin d'intrigues galantes qui le dominait. Pendant son séjour à Paris, il eut occasion de voir dans le Temple, où il demeurait, deux demoiselles272. Elles étaient sœurs, «aussi jolies femmes, dit-il, qu'il y en eût en France, et jusque alors en fort bonne réputation». Elles demeuraient avec leur mère. De concert avec un autre gentil-homme, qui devait l'accompagner à l'armée comme volontaire, Bussy s'introduisit chez elles, et se fit aimer de la cadette, tandis que son compagnon adressait ses hommages à l'aînée. Tous deux se montraient fort assidus dans cette maison, et n'en sortaient le soir que fort tard. D'après une lettre de Bussy, datée de Clermont en Beauvoisis le 15 septembre 1649, il paraît même que les deux galants passèrent avec les deux sœurs la nuit entière du jour qui précéda leur départ pour l'armée; mais cette lettre même prouve qu'ils ne purent parvenir à exécuter leurs coupables projets de séduction.