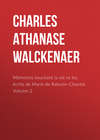Kitabı oku: «Mémoires touchant la vie et les écrits de Marie de Rabutin-Chantal, Volume 2», sayfa 5
Bautru, retenu par la goutte sur son fauteuil, ne pouvait se contenir; il faisait des efforts pour se lever, et allait répliquer, quand le prélat, charmé de trouver une si belle occasion de faire briller son savoir et sa belle élocution, étendit les bras entre les deux interlocuteurs, trois fois toussa avec méthode, trois fois sourit agréablement à l'apologiste de l'ignorance; puis, lorsqu'il crut avoir suffisamment composé sa physionomie, il dit qu'il allait concilier les deux opinions; et il prononça un discours gonflé de fleurs de rhétorique, chamarré de comparaisons subtiles, embarrassé de distinctions frivoles, obscurci par d'inutiles définitions; ne cessant, pendant qu'il parlait, d'accompagner sa voix de gestes méthodiques, marquant du doigt indicateur le commencement, le milieu et la fin de chacune de ses longues périodes. Le commandeur ne put y tenir. «Il faut finir la conversation, reprit-il brusquement; j'aime encore mieux sa science et son latin que le grand discours que vous faites.» Bautru, de son côté, avoua qu'il préférait l'agréable ignorance du commandeur aux paroles magnifiques du prélat.
Ainsi finit cet entretien. L'évêque se retira en montrant une grande satisfaction de lui-même, et en paraissant avoir pitié de ces deux gentils-hommes, si peu en état d'apprécier la véritable éloquence et les savants artifices de l'argumentation, l'un parce qu'il n'avait aucune étude, l'autre à cause de la fausse direction des siennes148.
Le parti de ceux qui prônaient la doctrine du commandeur de Jars était partout le plus faible; le goût de l'instruction était général dans les hautes classes de la société; l'ascendant des femmes et leur influence sur le bon ton, le savoir-vivre et la politesse des manières, s'accroissaient encore par les inclinations naissantes du jeune monarque, par les ballets, les réunions, les divertissements, devenus de plus en plus fréquents. Plusieurs cercles s'étaient établis à l'imitation de celui de l'hôtel de Rambouillet; et quelques-uns offraient dans l'exagération de leur modèle des côtés ridicules, qui furent aussitôt saisis par les bons esprits, et que Saint-Évremond fit ressortir dans une satire intitulée le Cercle149. Cette pièce, faiblement versifiée, offre des tableaux moins comiques, mais peut-être plus exacts, que ceux de la comédie de Molière sur les précieuses, qui ne fut écrite que trois ans après.
Saint-Évremond, dans sa satire, nous présente d'abord le portrait d'un habitué
De certaine ruelle
Où la laide se rend aussi bien que la belle,
Où tout âge, où tout sexe, où la ville et la cour
Viennent prendre séance en l'école d'amour.
D'abord il peint la prude
qui partage son âme
Entre les feux humains et la divine flamme;
la coquette surannée, et la jeune coquette, qui n'a que la vanité en tête,
Contente de l'éclat que fait la renommée;
et la coquette solide, qui,
opposée à tous ces vains dehors,
Se veut instruire à fond des intérêts du corps.
Puis
L'intrigueuse vient là, par un esprit d'affaire;
Écoute avec dessein, propose avec mystère;
Et, tandis qu'on s'amuse à discourir d'amour,
Ramasse quelque chose à porter à la cour.
Mais le portrait de la vraie précieuse, de la précieuse sentimentale, platonique, de la précieuse subtile et doctrinaire, est celui qui est tracé avec le plus de bonheur et de vérité:
Dans un lieu plus secret, on tient la précieuse
Occupée aux leçons de morale amoureuse.
Là se font distinguer les fiertés des rigueurs,
Les dédains des mépris, les tourments des langueurs.
On y sait démêler la crainte et les alarmes;
Discerner les attraits, les appas, et les charmes:
On y parle du temps que forme le désir
(Mouvement incertain de peine et de plaisir).
Des premiers maux d'amour on connaît la naissance;
On a de leurs progrès une entière science;
Et toujours on ajuste à l'ordre des douleurs
Et le temps de la plainte et la saison des pleurs.
On sait que la reine Christine ayant demandé qu'on lui donnât une définition des précieuses, Ninon lui répondit que «c'étaient les jansénistes de l'amour».
Les jansénistes faisaient alors encore plus de bruit dans le monde que les précieuses; mais s'ils condamnaient les faiblesses en religion comme les précieuses en amour, ils ne réduisaient pas le culte au sentiment, ils mettaient en pratique ses préceptes. Le nombre des solitaires de Port-Royal s'était accru: cependant il n'allait pas au delà de vingt-sept; mais ces vingt-sept personnes, par leur conviction profonde, par leur zèle ardent, leurs vertus, leur abnégation pour le monde, leur savoir, leur indépendance, le génie supérieur de quelques-uns d'entre eux, leurs amis et leurs nombreux sectateurs, partout répandus, formaient une association qui luttait avec l'ordre puissant des jésuites, avec les abus de la cour de Rome, et la molle complaisance des ecclésiastiques envers les puissants.
La publication du livre d'Arnauld sur la fréquente communion avait réveillé la haine des jésuites contre la secte qui s'était attachée à l'Augustinus de Jansénius, contenant, selon eux, la véritable exposition de la foi catholique. A l'occasion de ce livre de Jansenius, on fit rédiger cinq propositions, qu'on prétendit être le résumé de sa doctrine, et on les déféra au pape, qui les condamna. Les jansénistes souscrivirent à cette condamnation des cinq propositions, mais ils soutinrent qu'elles n'étaient point dans Jansenius. Une assemblée d'évêques, suscitée par Mazarin et les jésuites, sur le rapport des commissaires qu'elle avait nommés, décida que les cinq propositions étaient dans Jansenius. Le livre d'Arnauld sur la fréquente communion fut en même temps déféré à la Sorbonne, où les docteurs se divisèrent. La dispute s'échauffa: soixante-dix docteurs furent expulsés. Le livre d'Arnauld fut censuré. Une nouvelle bulle du pape reconnut que les propositions étaient dans Jansenius: on rédigea un acte ou formulaire, que tous les prêtres, les religieux et les religieuses devaient souscrire, en signe de leur orthodoxie et de leur entière union avec le saint-siége. On avait à combattre une opinion évidemment contraire aux dogmes de l'Église comme à une saine philosophie; une opinion qui introduisait dans la religion la doctrine du fatalisme, et enlevait à l'homme son libre arbitre. Au lieu de recourir aux moyens de douceur et de persuasion, les seuls permis aux défenseurs de la foi, on employa la rigueur et la persécution; et en intéressant ainsi toutes les âmes généreuses au sort de ceux que l'erreur avait égarée, on fit son succès, on contribua à la propager.
Les jansénistes voulaient à la fois résister aux décisions du pape et se considérer comme des fidèles qui lui étaient soumis comme au chef de l'Église: c'est alors que, pour justifier leur résistance et tranquilliser leurs consciences, ils imaginèrent la subtile distinction du fait et du droit. Ils reconnaissaient que pour être sauvé on devait une soumission entière, une foi divine au pape et à l'Église, dans tout ce qui concernait le dogme, parce que le pape et l'Église avaient dans ces matières une autorité divine; mais que quand il s'agissait d'un fait, le pape et l'Église ne pouvaient réclamer des fidèles qu'une foi humaine, c'est-à-dire que chacun était libre de décider selon sa conscience. On devait donc condamner les cinq propositions, d'après la décision du pape; mais on n'était pas forcé de croire d'après la seule assertion du pape et des évêques, que ces cinq propositions fussent dans Jansenius.
Il y a trois principes de nos connaissances, de nos convictions: les sens, la raison, et la foi. Tout ce qui est surnaturel et touche à la révélation se juge par l'Écriture et les décisions de l'Église, et est du ressort de la foi; tout ce qui est naturel, et n'est pas relatif à la révélation, se décide par la raison naturelle. Quant aux faits, on n'est tenu qu'à en croire ses sens. Les propositions qui ne reposent que sur des faits, c'est aux sens seuls qu'il appartient d'en connaître. Dieu n'a pas voulu que jamais la foi pût anéantir la conviction qui résulte du témoignage des sens, ni que cette conviction pût être soumise en nous à aucune autorité; car c'eût été vouloir l'impossible, et anéantir notre propre nature. Les décisions du pape et de l'Église ne peuvent donc enchaîner la conscience en ce qui concerne les faits non révélés.
Ainsi raisonnaient les jansénistes; et comme ils soutenaient que les propositions condamnées n'étaient pas dans Jansenius, ils refusaient de se soumettre à la bulle du pape qui déclarait qu'elles y étaient; ils prétendaient que le pape avait été surpris et trompé. Toute cette contestation reposait sur une subtilité qui semble presque puérile. Il était bien constant qu'on ne pouvait trouver textuellement les cinq propositions dans le livre de l'évêque d'Ypres; mais, selon les juges les plus impartiaux sur ces matières, ces cinq propositions résultaient des doctrines exposées dans ce livre, et en étaient la substance. Il fallait bien cependant que les jansénistes ne pensassent point ainsi, puisqu'ils donnaient leur consentement à la bulle qui les condamnait.
Quoi qu'il en soit, le refus de reconnaître que ces cinq propositions fussent dans le livre de Jansenius devint le prétexte d'une persécution contre les vingt-sept solitaires de Port-Royal. On les expulsa de leur champêtre asile, et on les força de se disperser. Seulement Arnault d'Andilly, qui avait rendu de grands services à l'État dans les hauts emplois de la diplomatie, dont l'attachement au gouvernement était connu, qui inspirait la plus entière confiance à la reine et à Mazarin, et était aimé d'eux, obtint qu'aucune violence ne serait exercée contre les paisibles habitants de la vallée. On se contenta de leur intimer les ordres du roi; et la promesse qu'Arnauld avait faite en leur nom, qu'ils y obéiraient sur-le-champ, fut exécutée. «Je ne dirai point à votre éminence, écrivait Arnauld au cardinal, que j'obéirai; mais je lui dirai que j'ai commencé à obéir en quittant la sainte maison où Dieu, par sa miséricorde, m'a donné le dessein de finir mes jours; et je continuerai d'obéir en allant demain à Pomponne, que je ne regarde plus comme ma maison, quoique je l'aie fort aimée, mais comme le lieu de mon exil, et d'un exil si douloureux, que rien ne m'y peut faire vivre que ma confiance en la bonté dont la reine et votre éminence m'honorent. Ainsi mon prompt retour dans mon heureuse retraite n'étant pas une simple grâce que je demande à votre éminence, mais une grâce qui m'importe de tout, je la supplie de considérer les jours de mon bannissement comme elle ferait les années pour d'autres150.»
C'est dans ces circonstances, c'est lorsque la violation de tous les droits, des actes d'une tyrannie arbitraire, avaient rendu les jansénistes l'objet de l'intérêt général, que parurent les lettres intitulées les Provinciales151: la première est datée du 23 janvier 1656, et la dernière du 24 mars 1657.
Jamais pamphlets ne produisirent un effet plus puissant; jamais une cause ne fut défendue avec plus de talent; jamais une attaque ne fut dirigée avec une si terrible énergie, ni combinée et graduée avec un art plus subtil. Pour concevoir le succès que durent avoir ces écrits, qui paraissaient de mois en mois, il faut se rappeler ce que nous avons déjà dit, qu'à cette époque, où l'on remarquait tant d'ardeur pour le plaisir, tant d'intrigues immorales, tant d'aventures scandaleuses, le sentiment religieux était fortement empreint dans les esprits: ceux qui étaient le plus plongés dans les délices du monde les interrompaient souvent pour satisfaire ce besoin de l'âme; et même quelquefois ils les quittaient pour toujours, afin de s'occuper uniquement de Dieu et de leur salut. Leurs compagnons de plaisirs admiraient et enviaient leurs résolutions; et, dans le vide et l'ennui que laissent toujours après elles les passions satisfaites, ils regrettaient fréquemment de n'avoir pas le courage de les imiter.
Avec une telle disposition des esprits, comment pouvait-on ne pas être charmé d'un écrivain qui donnait aux raisonnements les mieux enchaînés, aux discussions les plus savantes, la forme d'un dialogue animé, la gaieté d'une scène comique, le sel mordant d'une satire enjouée, l'autorité d'une doctrine irréfragable, l'entraînement de la plus sublime éloquence? L'intérêt qu'inspiraient de tels écrits s'augmentait encore quand on savait qu'ils étaient composés pour venger des solitaires vertueux et inoffensifs, de saintes et faibles religieuses, des hommes admirés de l'Europe entière par le noble usage qu'ils faisaient de leur génie et de leurs loisirs, des femmes d'un mérite supérieur, gloire et modèle de leur sexe; quand on songeait qu'ils étaient opprimés au nom de la religion par un ministre qui, après avoir enlevé à tous la liberté politique avec une armée de soldats, voulait avec une armée de religieux ravir aussi à tous la liberté de conscience, et anéantir toute discussion sur les intérêts spirituels, comme il l'avait déjà fait sur les intérêts temporels.
Qu'on ne s'étonne pas qu'un livre composé pour une lutte qui n'existe plus, et pour un temps si différent du nôtre, ait survécu à l'époque qui le vit naître, aux motifs qui le firent écrire, et qu'il captive encore tellement notre attention, qu'on ne peut en quitter la lecture, lorsqu'une fois on l'a commencée. Ceux-là même qui l'ont le plus loué n'y ont vu qu'un livre de controverse religieuse, qu'un ouvrage de circonstance, et n'ont pas su apercevoir, sous la forme spéciale et théologique qui la déguise, toute la grandeur des questions qui y sont traitées. Les vérités qu'on y agite ne sont ni fugitives ni périssables; ce sont celles qui intéressent le plus l'homme sociable et l'homme religieux. Le système des opinions probables et de la direction d'intention, qu'est-ce autre chose que la vieille dispute des stoïciens et des sceptiques? Quel est celui qui ne fait pas un retour plein d'effroi sur lui-même, alors que l'auteur des Provinciales prouve, avec une évidence qui s'accroît à chaque page, que les principes de la morale ne peuvent se modifier ni se laisser fléchir; et que si par la faiblesse de notre nature on est amené à se permettre la moindre déviation, le premier pas nous conduit, par une route de plus en plus divergente, jusque dans l'abîme du crime et de la folie? Ne sentons-nous pas que nos passions, nos vices et notre égoïsme sont des casuistes toujours prêts à égarer notre conscience, et l'obligent à des capitulations qui tendent à altérer sa pureté, et même à la pervertir entièrement? Ces disputes, qui paraissent toutes théologiques, sur la grâce suffisante et insuffisante, diffèrent-elles en rien des doutes et des croyances sur l'absence ou l'existence de l'intervention céleste dans les choses terrestres, et sur la liberté de l'homme dans ses rapports avec Dieu? A quelle époque et chez quel peuple civilisé les philosophes ont-ils cessé de se partager sur ces questions, ou se sont-ils abstenus de les discuter? En est-il en effet de plus hautes? en est-il qui intéressent plus l'homme en général? En est-il qui embrassent d'une manière plus complète toute sa destinée dans sa vie présente et mortelle et dans son immortel avenir?
Le voile dont se couvrait l'auteur de ces lettres, et qui fut quelque temps avant de pouvoir être soulevé, contribua encore à leur réputation. Quand on sut quel était le nom célèbre que cachait le nom obscur de Montalte, et que Blaise Pascal, connu par ses sublimes découvertes en physique et en mathématiques, était celui que l'on cherchait, la surprise se mêla à l'admiration. Tout le monde voulut lire ces écrits théologiques du jeune et savant géomètre. Madame de Sévigné, qui avait parmi les solitaires de Port-Royal des amis dévoués, lut donc aussi les Petites Lettres (c'est ainsi qu'on les appelait alors); elle les lut avec l'intérêt puissant qu'excitaient en elle le sujet et les personnages; elle se pénétra des doctrines qu'elles contenaient. Nous nous en apercevons souvent en lisant ce qu'elle a écrit, et par cette raison nous avons dû signaler l'époque de leur apparition comme une circonstance essentielle dans sa vie.
L'effet des Provinciales ne se borna pas à exciter une stérile admiration. L'opinion publique fut tellement émue par elles, elles excitèrent une telle clameur, qu'elles forcèrent en quelque sorte l'autorité à permettre que les solitaires de Port-Royal reprissent possession de leur vallée chérie, et rouvrissent leur savante école: le gouvernement permit encore aux saintes vierges du couvent de les encourager par leurs prières, tandis qu'eux-mêmes les instruisaient par leurs discours et les édifiaient par leurs exemples152.
CHAPITRE VIII.
1657-1658
Soins que madame de Sévigné donne à l'éducation de ses deux enfants.—Leur amitié prouve qu'ils ont été élevés ensemble.—Services rendus par les jésuites à l'éducation publique.—Révolution dans la philosophie, produite par Descartes. Elle donne l'impulsion aux écrivains de Port-Royal.—Bossuet paraît.—Sa doctrine, fondée sur les saintes Écritures, ne s'appuie ni sur Jansenius ni sur les jésuites.—Madame de Sévigné fait l'éducation de ses enfants sous l'influence de ces divers systèmes.—Elle les résume tous en elle.—Sa fille s'instruit dans la philosophie de Descartes, et est moins religieuse que sa mère.—Son fils est conduit par l'influence du jansénisme aux pratiques de la plus haute dévotion.—La vie de l'une comme celle de l'autre prouvent combien leur éducation fut soignée.—Caractère de madame de Grignan.—Caractère du marquis de Sévigné.—Différence d'opinion entre la mère, la fille, et le fils, en matière de littérature.—De l'abbé Arnauld, et de l'origine de sa liaison avec madame de Sévigné.—Ce qu'il dit d'elle lorsqu'il la rencontra pour la première fois avec ses enfants.
Les deux enfants de madame de Sévigné étaient tous deux parvenus à cet âge qui tient le milieu entre l'enfance et l'adolescence, et que les anciens exprimaient par un mot qui manque à notre langue. Les soins qu'elle donnait à leur éducation devenaient de jour en jour plus importants et plus nécessaires; et sans doute une partie du temps qu'elle était habituée à sacrifier aux amusements du monde fut consacrée aux deux êtres qui lui étaient les plus chers, et vers lesquels se dirigeaient ses principales pensées.
Ce n'était pas à cause de ce titre d'excellente mère qu'elle s'était attiré les prévenances et les assiduités d'un si grand nombre de ses contemporains et qu'elle était recherchée par les femmes les plus aimables de son temps; les intérêts de la société, dont elle faisait le charme, se trouvaient, au contraire, en opposition avec ses devoirs maternels. Aussi les mémoires et les correspondances de ces temps ne nous donnent aucun détail sur la manière dont madame de Sévigné dirigea l'éducation de ses enfants. Mais l'amitié vive et sincère qui s'établit entre le frère et la sœur semble démontrer qu'ils ont été élevés ensemble et sous les yeux de leur mère.
On a souvent discuté les avantages et les désavantages de l'éducation publique et de l'éducation particulière, et cherché à déterminer quelle est celle des deux qui doit obtenir la préférence sur l'autre. Montaigne et Pascal n'eurent point d'autres précepteurs que leurs pères; et nous savons que ceux-ci firent de l'éducation de leurs enfants l'œuvre principale de leur vie. Cependant ces exemples et plusieurs autres semblables ne décident point cette question, qui, comme beaucoup d'autres, n'est pas susceptible d'une solution absolue. Il en est des divers modes d'éducation comme des différentes formes de gouvernement, dont les perfections et les vices dépendent de ceux qui les dirigent. A l'époque dont nous parlons il régnait une grande émulation pour le perfectionnement de l'éducation publique. L'université de Paris, après avoir rendu d'immenses services pour la renaissance des lettres en Europe, était, comme toutes les corporations privilégiées ou sans rivales, restée stationnaire au milieu du mouvement progressif de la société et des esprits. Retranchée derrière ses vieux usages et ses antiques préjugés, elle serait devenue tout à fait impropre à remplir les fins de sa création, si les jésuites, en élevant partout des colléges qui ne ressortissaient pas à sa juridiction, et en admettant dans leur plan d'éducation tout ce que les mœurs et les progrès de la société rendaient nécessaire, n'avaient pas produit une heureuse émulation, et forcé l'université, au commencement du dix-septième siècle, à introduire quelques innovations dans ses statuts. Ces innovations furent en petit nombre et insuffisantes; cependant l'université ne put se décider à les faire sans jeter de hauts cris contre ceux qui l'y contraignaient, et sans demander aux parlements que les écoles de ceux-ci fussent fermées. A la suite de ces nouveaux statuts, imprimés en 1601, elle compare l'ordre des jésuites à une nouvelle Carthage qui était venue établir son camp sur le territoire de Rome elle-même, et à un astre contagieux qui produit la flétrissure et la décadence des études à Paris et dans toutes les académies du royaume153. Mais, heureusement pour les progrès de l'enseignement en France et pour l'université elle-même, ses plaintes ne furent point écoutées. Les jésuites, protégés par le pape et les souverains, enlevèrent à l'université son monopole, et la forcèrent à faire de nouvelles altérations dans le plan des études, sous peine de voir déserter ses bancs.
Cette révolution dans l'instruction n'était que le prélude d'une plus grande. La philosophie d'Aristote était alors exclusivement enseignée par l'université comme par les jésuites; et l'admiration pour le génie de cet ancien philosophe était telle, que ses axiomes de physique et de métaphysique semblaient être les dernières limites de la raison et celles dans lesquelles elle devait se renfermer. On les regardait comme des principes aussi incontestables, aussi hors de toute discussion que les articles de foi, que la religion nous ordonne de croire. Les nier eût été une sorte de sacrilége ou une preuve de la plus grossière ignorance.
Un génie puissant, élevé chez les jésuites, venait, à l'époque dont nous nous occupons, de briser les entraves dans lesquelles la routine avait si longtemps enchaîné l'esprit humain, et de mettre en crédit une nouvelle philosophie: c'était Descartes. Toutes les intelligences vigoureuses s'empressèrent de se mettre à la suite de ce hardi novateur, de s'enrôler sous les drapeaux de ce nouveau chef, qui les appelait à une entière liberté, et les délivrait des chaînes qui jusque alors avaient arrêté leur essor. Les écrivains de Port-Royal durent au doute universel de Descartes et à ses écrits, au vaste horizon tracé par sa profonde métaphysique, cette méthode lumineuse de discussion, cette hauteur de vues, cette déduction sévère dans les raisonnements, cette lucidité d'expression, cette énergie de style qu'ils portèrent jusque dans les régions, auparavant si obscures, de la théologie. Par leur école, mais plus encore par leurs excellents livres élémentaires, ils opérèrent dans l'enseignement une réforme complète. Ils introduisirent surtout dans toutes les classes éclairées le goût des discussions en matière religieuse, et par là ils contribuèrent à accroître la ferveur de ceux dont la foi était ferme et sincère. Rien n'est plus propre à raffermir une croyance dont les semences, implantées dès l'enfance, ont jeté en nous de fortes et profondes racines, que les efforts qu'il nous faut faire pour repousser une autre croyance, que nous regardons comme fausse, et qu'on voudrait nous imposer. Ce qu'il y a de plus mortel pour l'esprit comme pour le cœur, c'est l'indifférence. Ce vers de la comédie de Gresset,
.... Rien n'est vrai sur rien; qu'importe ce qu'on dit?
est le résumé de la doctrine du type brillant et corrompu d'une société usée, qui n'a plus ni principe, ni croyance, ni morale, et où tout tend à se dissoudre.
Tandis que Descartes démontrait l'existence de Dieu et l'immortalité de l'âme par les seuls secours de la raison; que les jansénistes semblaient concentrer tous les principes de la religion et de la morale dans leur doctrine sur la grâce; que les jésuites plaçaient tout espoir de salut dans une soumission aveugle à l'autorité du pape, un jeune homme parut tout à coup, comme un soleil d'été, qui en se levant darde aussitôt sur l'horizon la lumière et la chaleur. Survenu au milieu de ces opinions opposées, mais qui toutes se proposaient le même but, il s'appuya sur ce que chacune d'elles lui offrait de conforme aux Écritures et aux décisions de l'Église. Par son génie, par sa vaste érudition, par son saint enthousiasme, par sa haute éloquence, il se créa un nouvel apostolat, qui ne se fondait ni sur une servile obéissance à Rome, ni sur les subtiles doctrines de Jansenius, ni sur les concessions jésuitiques. Ce jeune homme, tous nos lecteurs l'ont nommé, c'était Bossuet.
Ce fut en 1657 qu'il parut à Paris pour la première fois dans la chaire évangélique. Il prêcha le 10 mars à Saint-Thomas d'Aquin, et le 24 du même mois aux Feuillants, en présence de vingt-deux évêques; puis le 27 octobre suivant il prononça le panégyrique de sainte Thérèse, en présence de la reine mère et de toute sa cour. Dès ces premiers débuts il laissa bien loin derrière lui les Boux, les Camus, les Lingende, et les Testu, qui à cette époque n'avaient point de rivaux dans la prédication.
Loret, qui l'entendit alors, et qui ne pouvait prévoir la réputation que ce jeune docteur, comme il l'appelle, devait acquérir un jour, qui ne vécut même point assez pour la connaître, atteste que jamais orateur chrétien n'a prêché avec un tel succès; et il résume, avec une précision qui certes ne lui est pas ordinaire, tout ce qu'il a dit sur l'effet que produisait le nouveau prédicateur:
Telles étaient les diverses sortes d'influences sous lesquelles se trouvait placée madame de Sévigné lorsqu'elle s'occupait de l'éducation de ses enfants. Elle était liée particulièrement avec madame Duplessis-Guénégaud, une des amies intimes du jeune Bossuet, et elle dut le rencontrer fréquemment chez elle155. Par l'oncle de son mari et par le cardinal de Retz, elle avait toujours eu des communications fréquentes avec les plus célèbres solitaires de Port-Royal. Les écrits de Descartes sur la philosophie, dont plusieurs étaient adressés à des femmes, à la reine Christine ou à la princesse Élisabeth, se trouvaient, comme les Lettres provinciales, entre les mains de toutes les personnes dont l'éducation était cultivée. Enfin les plus savants, les plus illustres dans l'ordre des jésuites étaient admis à la cour et dans les maisons des grands; ils se répandaient partout dans le monde, et ne pouvaient être évités. Aussi madame de Sévigné était liée avec quelques-uns d'entre eux, remarquables par leur esprit et leur savoir-vivre.
C'est par de bien justes motifs que nous détaillons ici les influences morales et religieuses qui agissaient alors sur la société en France; car toutes se sont réalisées sur madame de Sévigné et sur ses enfants. Ceux-ci ne subirent que l'effet de quelques-unes; mais pour elle, il semble qu'elle conserva des empreintes de toutes. Ses désirs de religion étaient tempérés par son goût pour les plaisirs; la sévérité de ses principes, modifiée par une imagination éprise des charmes de la belle littérature; la roideur et la subtilité des doctrines de son jansénisme, rectifiées par un jugement naturellement ennemi de tout ce qui l'éloignait du bon sens général et de la raison commune. Elle résumait en elle l'élégance galante et polie de l'hôtel de Rambouillet, le spiritualisme de Port-Royal, l'indulgence mondaine des disciples de Loyola, les vives résolutions d'un Bossuet, et quelque chose de la sensibilité pieuse et de l'amour mystique d'une sœur de Sainte-Thérèse. Sa fille, avec plus de beauté, eut moins d'esprit naturel, un savoir aussi varié et plus étendu, une tête plus forte et plus calme. Moins aimable, elle fut moins aimée, moins flattée par ses contemporains, qui l'ont jugée avec trop de sévérité, peut-être parce que, comme nous, ils la comparaient sans cesse à sa mère. Eh! quelle est la femme qui sortirait avec avantage d'une telle comparaison? Madame de Grignan avait étudié les œuvres de Descartes et les parties les plus abstruses de sa métaphysique; elle croyait avoir saisi l'ensemble du système de ce grand homme, et triomphé des difficultés qu'il offrait aux intelligences vulgaires. Devenue le disciple de cet apôtre du doute, elle se soumettait avec moins d'abandon que sa mère à ce que la foi commandait de croire; elle cherchait plus souvent ses points d'appui dans la philosophie cartésienne que dans les lumières de la révélation. Son frère, né et élevé au milieu des doctrines de Port-Royal, y fut toute sa vie fidèle; mais l'heureuse flexibilité du caractère de sa mère s'était chez lui convertie en une incurable légèreté: incapable d'éprouver aucune impression profonde et durable, il effleura tout, même le désordre. La femme qu'il épousa, et dont il n'eut point d'enfants, le ploya, dans sa vieillesse, aux habitudes de la plus haute dévotion.
L'éducation ne peut tout faire; elle ne donne ni le génie, ni la force de réflexion, ni l'énergie de caractère, ni la constance des résolutions, ni la sensibilité de cœur. Nous pouvons perfectionner ou détériorer la nature, mais nous ne pouvons suppléer à ce qu'elle n'a pas, ni lui ôter ce qu'elle possède. Celui qui a eu occasion de remarquer combien différemment la même culture et la même instruction profite à des esprits différents, est d'avance convaincu de l'absurdité du système d'Helvétius, qui soutient que toutes les intelligences sont égales, et proclame la toute-puissance de l'éducation. Non, il n'est pas vrai que l'influence des objets extérieurs soit la seule cause des modifications que nous éprouvons. Les impressions reçues produisent des résultats divers, selon le sujet qui les reçoit. L'homme n'est point une matière inerte, qu'on puisse façonner à volonté. Le principe vital, selon le plus ou moins de chaleur du sang, décompose et recompose différemment, dans chaque être vivant, les substances qu'il s'assimile; de même il y a en nous une âme qui élabore les sensations, les pensées, et qui fonctionne différemment dans chaque individu. Dans la multitude innombrable de créatures humaines répandues sur la surface de la terre, il n'y en a pas deux qui aient des visages semblables, des sens pareils, des facultés égales, des volontés identiques, ni les mêmes désirs, ni les mêmes passions, ni le même caractère. La lumière, telle qu'elle semble émaner du soleil, est pure de toute couleur, toujours semblable, toujours la même; mais, selon les corps qui la divisent, la modifient, l'absorbent ou la réfléchissent, elle donne le rouge, le bleu, le jaune, le vert, le violet, l'orange, le noir, le blanc, toutes les teintes, toutes les nuances. Voilà l'image de la même éducation, de la même instruction agissant sur les individus qui diffèrent par leur tempérament et leur organisation.