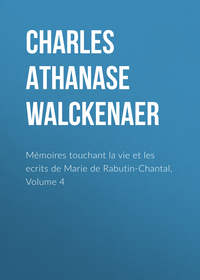Kitap dosya olarak indirilemez ancak uygulamamız üzerinden veya online olarak web sitemizden okunabilir.
Kitabı oku: «Mémoires touchant la vie et les ecrits de Marie de Rabutin-Chantal, Volume 4», sayfa 10
CHAPITRE VII.
1672
Mort de la tante de madame de Sévigné.—Préparatifs de départ pour la Provence.—Madame de Sévigné fait ses adieux à ses amies.—Ramène sa petite-fille Blanche de Livry à Paris.—Part ensuite pour se rendre à Grignan.—Détails sur sa manière de voyager.—Elle couche à Melun, arrive à Auxerre, s'arrête à Montjeu trois jours.—Détails sur ce lieu et sur Jeannin de Castille.—Souvenirs que le séjour à Montjeu rappelle à madame de Sévigné.—Elle y avait été en 1656.—Madame de Toulongeon sa tante, madame de Toulongeon la jeune, madame de Senneterre viennent voir madame de Sévigné à Montjeu.—Détails sur ces personnes.—Réconciliation de Jeannin de Castille et de Bussy.—Correspondance entre Bussy et la jeune comtesse de Toulongeon.—Madame de Sévigné va coucher à Châlon.—Arrive à Lyon.—Soins et attentions dont elle est l'objet de la part de l'intendant et de madame de Coulanges.—Pourquoi madame de Coulanges et son mari s'étaient rendus à Lyon.—Date du mariage du fils de M. du Gué-Bagnols avec mademoiselle de Bagnols, sa cousine.—Madame de Sévigné loge chez un beau-frère de M. de Grignan.—Elle fait connaissance avec la comtesse de Rochebonne.—Voit madame de Senneterre.—Détails sur le deuil de celle-ci et sur la fin tragique de son mari.—Madame de Sévigné part de Lyon, et va coucher à Valence.—Elle arrive à Montélimart.—Madame de Grignan vient la chercher dans ce lieu, et la conduit à Grignan.—Calculs sur la durée du voyage de madame de Sévigné et sur le temps de sa séparation d'avec madame de Grignan.
Qu'on ne s'y trompe pas, toute cette jeune noblesse, qui paraissait si fort occupée de ses plaisirs, de ses intrigues amoureuses, était prodigue de ses veilles et de son sang quand il s'agissait des intérêts et de la gloire du monarque et de celle de la France. En cela comme en toutes choses, dans ce qui était digne de louange comme dans ce que réprouvait une morale sévère, elle suivait l'exemple de son roi. A l'époque où l'on jugeait à la Tournelle le procès de Sidonia de Lenoncourt, le marquis de Courcelles son mari, Colbert de Maulevrier qu'on avait voulu lui faire épouser, Louvois et Villeroi, Cavoye son amant, Castelnau, Lavardin, d'Uxelles, la Rochefoucauld, prince de Marsillac, Choiseul-Pradelle, du Plessis-Praslin, du Lude et tant d'autres connus de madame de Sévigné donnaient des preuves de leur valeur, et secondaient Louis XIV dans la conquête de la Hollande469. Madame de Sévigné, tranquille sur son fils, qui lui avait écrit que la campagne était terminée, que toute la Hollande se rendait sans résistance, annonçait à madame de Grignan470 qu'elle faisait ses préparatifs pour ce voyage de Provence projeté depuis si longtemps, depuis si longtemps différé, et dont elle n'osait plus parler: «car, dit-elle, les longues espérances usent la joie, comme les longues maladies usent la douleur471.»
Rien ne la retenait. Sa tante la Trousse, qu'elle n'avait pas quittée durant sa maladie, était morte le 30 juin. Après avoir donné à mademoiselle de la Trousse et à toute la famille les consolations d'usage; après avoir écrit à la comtesse de Bussy pour s'excuser de ne pas céder à son invitation d'aller la voir, madame de Sévigné fixa enfin le jour de son départ, et fit ses adieux à d'Andilly, à madame de la Fayette et à M. de la Rochefoucauld, alors au château de Saint-Maur, dont Gourville472 avait acheté l'usufruit au prince de Condé. Madame de Sévigné y fut retenue à souper, et y coucha. Elle avait ramené de Livry ses petites entrailles473, Blanche sa petite-fille, parce qu'elle craignait que la nourrice ne s'ennuyât à la campagne. Madame du Puy du Fou, madame de Sanzei474, madame de Coulanges et le petit Pecquet, son médecin, devaient donner des soins à l'enfant, et lui en répondre475.
Tous ses préparatifs achevés le mercredi 13 juillet, elle se mit en route dans un carrosse de campagne acheté pour ce voyage et attelé de six chevaux476. Elle avait avec elle deux femmes de chambre, l'abbé de Coulanges, qui malgré son âge ne voulait pas la quitter, et l'abbé de la Mousse, qui hésita à se mettre en route parce qu'il redoutait les fatigues d'un si long voyage, et craignait les scorpions, les puces et les punaises477. Cependant, si l'on en croit les révélateurs indiscrets des secrètes généalogies de ces temps, l'abbé de la Mousse avait un intérêt tout particulier pour désirer faire ce voyage, puisqu'il devait retrouver à Lyon, dans M. du Gué l'intendant et dans madame de Coulanges, un père et une sœur478.
Madame de Sévigné avait emporté pour tout livre un Virgile: «non pas travesti, dit-elle, mais dans toute la majesté du latin et de l'italien.» Elle dut coucher le premier jour à Essonne ou à Melun. Le samedi 16, elle arriva à Auxerre479. Elle parcourut donc en quatre jours 166 kilomètres (41 lieues et demie), ou 11 à 12 lieues de poste par jour. Le voyage fut sérieux; elle regretta la compagnie de son cousin de Coulanges: «Pour avoir de la joie, écrit-elle, il faut être avec des gens réjouis. Vous savez que je suis comme on veut; mais je n'invente rien.»
Six jours après, nous la trouvons, non pas à Autun, mais à deux lieues au delà, hors de la route qui conduit à Lyon, où elle tendait, dans le beau château de Montjeu, sur le sommet de ce mons Jovis qui domine la ville moderne d'Autun et les ruines de l'antique Bibracte. De là elle écrit à Bussy une lettre datée du 22 juillet, c'est-à-dire six jours après son départ d'Auxerre; mais comme sa lettre nous prouve qu'elle était déjà depuis cinq jours installée dans ce château480, il en résulte qu'elle a mis trois jours à faire ce trajet, qui est de 128 kilomètres (32 lieues). Ainsi, quoique cette route soit même encore aujourd'hui montueuse et difficile en approchant d'Autun, madame de Sévigné fit par jour dix à onze lieues, comme dans son voyage en Bretagne. Mais quel motif, dira-t-on, madame de Sévigné, désireuse d'arriver à Grignan et de revoir sa fille, avait-elle pour se détourner de sa route et s'arrêter quatre jours à Montjeu? Nous allons l'expliquer.
Elle dit à Bussy: «M. Jeannin m'a priée si instamment de venir ici que je n'ai pu lui refuser. Il me fait gagner le jour que je lui donne par un relais qui me mènera demain coucher à Châlon, comme je l'avais résolu.»
D'après le calcul que nous venons de faire, on s'aperçoit que ce qu'elle dit n'était pas tout à fait exact, et qu'elle perdait plus d'un jour; mais il fallait qu'elle s'excusât auprès de son cousin, alors à Dijon pour affaires et non encore réconcilié avec le seigneur de Montjeu481. Si elle avait dirigé sa route par la capitale de la Bourgogne, elle eût pu voir en passant son cousin, avec lequel sa correspondance était redevenue fort active et fort aimable482. Si Bussy avait été à Chaseu lors de son passage par Autun, nul doute qu'elle ne se fût arrêtée chez lui; mais comme il était absent, il en résulta que dans cette Bourgogne, dans cette patrie de ses aïeux, où elle avait ses biens, ses parents, ses alliés, elle céda plutôt aux prières d'un étranger qu'aux instances de famille qui lui étaient faites de toutes parts. C'est que cet étranger était un ami, un ami de sa jeunesse, un ami que l'adversité avait frappé; et nul n'avait plus qu'elle la mémoire du cœur, nul n'avait un sentiment plus vif des preuves de tendresse et d'attachement qu'a droit de réclamer la constance en amitié. Le seigneur de Montjeu était ce Jeannin de Castille, trésorier des ordres du roi et un des trésoriers de l'épargne sous l'administration de Fouquet. Jeannin, ainsi que Duplessis Guénégaud, cet autre ami de madame de Sévigné, avait été une de ces grandes existences financières que Colbert avait brisées en parvenant au pouvoir. Entraîné dans la disgrâce et le procès du surintendant483, Jeannin paya, par la perte de ses places et d'une partie de sa fortune, son trop complaisant concours aux immenses opérations financières de Fouquet. Comme celui-ci, dans son temps de prospérité il avait profité du crédit et de la puissance dont il jouissait pour obtenir les faveurs de belles femmes de la cour, connues par la facilité de leurs mœurs; mais il avait sur Fouquet l'avantage d'une très-belle figure. Il ne fut pas épargné par l'esprit satirique de Bussy-Rabutin, qui, dans ses Amours des Gaules, en parle comme d'un des rivaux heureux du duc de Candale auprès de la comtesse d'Olonne484. Il avait aussi, par ses fêtes, ses magnificences, contribué aux plaisirs des belles années de madame de Sévigné, alors que, jeune veuve et n'ayant pas encore à s'occuper de l'éducation de ses enfants, elle s'abandonnait à la gaieté de son caractère, lorsqu'elle aimait à s'entourer de courtisans et d'admirateurs, et qu'elle présentait ce singulier contraste d'une piété sincère, d'une invincible vertu unies à un grand penchant à la coquetterie, à une extrême indulgence pour les faiblesses où l'amour précipite les personnes de son sexe, et au libre langage d'une imagination peu chaste et peu scrupuleuse.
Si le nom de Jeannin de Castille n'a pas encore paru dans ces Mémoires, c'est que nous n'avons pu faire mention d'un voyage que madame de Sévigné fit en Bourgogne, parce que nous en ignorions l'époque. La lettre que madame de Sévigné écrit de Montjeu à son cousin nous donne la date de ce voyage. Ce fut en 1656, année où Bussy quitta l'armée pour se rendre aussi en Bourgogne485, la même année où Jeannin de Castille eut assez de crédit pour faire ériger en marquisat la baronnie de Montjeu, qu'il avait héritée de son père486. Madame de Sévigné s'y rendit alors. Ce ne fut donc pas pour la première fois qu'en allant en Provence elle admira ce château, ces eaux limpides jaillissant de terre à une grande hauteur, alimentant toutes les fontaines et les usines de la ville d'Autun; qu'elle parcourut ces belles allées, ces bosquets, ces vergers, ces parterres de fleurs placés au milieu d'un parc de quatre à cinq lieues de tour, fermé de murailles et peuplé de cerfs, de daims, de biches et de toutes sortes de gibier487. Jeannin, qui faisait de ce lieu sa principale résidence, y avait ajouté de nouveaux embellissements. «J'ai trouvé, dit madame de Sévigné en écrivant à Bussy, cette maison embellie de la moitié depuis seize ans que j'y étais venue; mais je ne suis pas de même, et le temps, qui a donné de grandes beautés à ces jardins, m'a ôté un air de jeunesse que je ne pense pas que je recouvre jamais [elle avait quarante-six ans]. Vous m'en eussiez rendu plus que personne par la joie que j'aurais eue de vous voir, et par les épanouissements de la rate, à quoi nous sommes fort sujets quand nous sommes ensemble. Mais Dieu ne l'a pas voulu, ou le grand Jupiter, qui s'est contenté de me mettre sur sa montagne, sans vouloir me faire voir ma famille entière488.»
Cependant une grande partie de cette famille, prévenue de son arrivée, s'empressa de lui rendre visite à Montjeu. La première qui y vint fut Françoise de Rabutin, veuve du comte Antoine de Toulongeon, sœur du baron de Chantal, père de madame de Sévigné, et belle-mère de Bussy par sa fille Gabrielle, qu'elle avait perdue en 1646. Quoique alliée à leur famille par tant de titres, cette comtesse de Toulongeon n'était point aimée de madame de Sévigné ni de Bussy. Elle était fort avare, mais cependant charitable envers les pauvres489. Madame de Sévigné avait considéré comme un devoir indispensable de s'arrêter chez elle quelques jours490. Pour éviter la dépense que lui aurait occasionnée une telle réception, elle se hâta de prévenir madame de Sévigné. Cette tante de Toulongeon résidait à Autun. Son fils possédait la terre d'Alonne, du bailliage de Montcenis; il la fit par la suite ériger en comté de son nom, et, par ordre du roi, Alonne se nomma Toulongeon. Ce lieu, voisin d'Autun, devint, par les embellissements qu'y fit le comte de Toulongeon, un des plus agréables séjours de la Bourgogne491. Chazeu, dont madame de Sévigné admirait tant la pureté de l'air, la belle situation et la vue riante, était aussi du bailliage d'Autun, dans la paroisse de Laizy, et très-rapproché de Toulongeon, de Montjeu, aussi bien que d'Autun; de sorte que lorsque Bussy allait se fixer dans cette demeure favorite, il ne manquait pas de société492.
Madame de Toulongeon s'empressa d'aller à Montjeu rendre visite à sa cousine; madame de Sévigné, qui la voyait pour la première fois, fut charmée de la trouver si jolie et si aimable. Bussy, dont elle était la belle-sœur, regrettait auprès d'elle tout ce que l'âge lui avait fait perdre493. Il disait qu'il lui avait donné de l'esprit, mais qu'elle le lui avait rendu avec usure: et, en effet, les vers les plus agréables qu'il ait faits sont ceux qu'elle lui a inspirés494. Elle était un des ornements de la société qui se réunissait à Montjeu, et il est probable qu'elle contribua beaucoup, ainsi que madame de Sévigné, à la réconciliation de Bussy avec Jeannin de Castille, qui eut lieu l'année suivante495. Cette réconciliation fut sincère; et le nom du seigneur de Montjeu revient assez fréquemment dans les lettres de madame de Sévigné et dans celles de Bussy496. Jeannin de Castille, plus heureux que Bussy, obtint plus tôt que lui la permission de se présenter devant Louis XIV, et termina heureusement ses affaires497. Si son fils, qui mourut avant lui, ne répondit pas à ses espérances, il eut la consolation de voir sa petite-fille épouser un prince d'Harcourt. Cette princesse d'Harcourt donna le jour à deux filles, qui furent la duchesse de Bouillon et la duchesse de Richelieu.
Madame de Sévigné s'arrêta cinq jours à Autun, et n'en partit que le samedi 23 juillet. Après un trajet de 51 kilomètres ou 12 lieues depuis Autun, madame de Sévigné arriva à Châlon-sur-Saône, où elle coucha. Elle s'embarqua le lendemain, dimanche 24, pour Lyon; et quoiqu'elle n'eût que 125 kilomètres ou 32 lieues à parcourir, elle n'arriva le jour suivant qu'à six heures du soir498. «M. l'intendant de Lyon (du Gué-Bagnols), sa femme et madame de Coulanges vinrent me prendre au sortir du bateau de midi (25 juillet). Je soupai chez eux; j'y dînai hier.»
Madame de Coulanges s'était rendue avec son mari à Lyon, immédiatement après Pâques499, pour le mariage de sa sœur, mademoiselle du Gué, avec Bagnols, cousin issu de germain500, riche de 45,000 livres de rente. Bagnols devint depuis intendant de Flandre; et le jeune baron de Sévigné nous forcera bientôt d'occuper nos lecteurs de sa femme. Elle ne plut guère à madame de Sévigné, qui fut bien aise que les nouveaux mariés se proposassent d'aller à Paris, plutôt que de céder aux invitations plus polies que sincères qu'elle était obligée de leur faire. Madame de Coulanges, bien autrement engagée aussi à faire ce voyage, promit de l'accompagner à Grignan, à condition que madame de Sévigné ne se hâterait pas trop de quitter Lyon. Le plaisir que toute cette famille de Bagnols eut à jouir pendant quelques jours de la société de madame de Sévigné fit qu'on ne crut jamais lui prodiguer assez de soins, assez d'attentions. «On me promène, on me montre, je reçois mille civilités. J'en suis honteuse; je ne sais ce qu'on a à me tant estimer501.»
Elle alla dans une des deux bastilles de Lyon, celle de Pierre-Encise, rendre visite à un ami prisonnier, dont il est difficile de deviner le nom par la seule lettre initiale F. Il n'en est pas de même d'un monsieur M., chez lequel elle dit qu'on doit la mener pour voir «son cabinet et ses antiquailles.» Nul doute qu'il ne soit ici question de M. Mey, riche amateur des beaux-arts, Italien d'origine, dont les étrangers qui passaient à Lyon allaient visiter la maison, située à la montée des Capucins, célèbre par sa belle vue, la magnifique collection de tableaux et les beaux objets d'antiquité qu'elle renfermait. On y admirait surtout alors ce beau disque antique en argent connu sous le nom de bouclier de Scipion, qui fut acheté par Louis XIV après la mort de M. Mey et qui est aujourd'hui un des ornements du cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale502.
Cependant ce ne fut pas chez l'intendant que logea madame de Sévigné, mais chez un beau-frère de M. de Grignan, Charles de Châteauneuf, chanoine-comte et chamarier de l'église de Saint-Jean de Lyon: «C'est, dit-elle, un homme qui emporte le cœur, une facilité et une liberté d'esprit qui me convient et qui me charme.» Elle fut aussi très-satisfaite de faire connaissance avec la sœur de M. de Grignan, la comtesse de Rochebonne, qui ressemblait à son frère d'une manière étonnante. Elle était veuve du comte de Rochebonne, commandant du Lyonnais. Madame de Sévigné reçut la visite d'une autre veuve parente de Bussy-Rabutin, Anne de Longueval, veuve de Henri de Senneterre, marquis de Châteauneuf, que sa mère fut accusée d'avoir fait assassiner503. La marquise de Senneterre porta longtemps le deuil, et sembla regretter son mari, mais elle trouvait peu de personnes disposées à sympathiser aux marques de sa douleur, et même à croire à leur sincérité504.
Après les trois jours donnés à madame de Coulanges, madame de Sévigné partit de Lyon, s'embarqua le vendredi 29 juillet au matin, et alla coucher à Valence. Puis elle fut confiée aux soins des patrons de barque choisis par l'intendant. «J'ai de bons patrons, dit-elle dans sa lettre à madame de Grignan; surtout j'ai prié qu'on ne me donnât pas les vôtres, qui sont de francs coquins: on me recommande comme une princesse.» Le trajet qu'elle avait parcouru dans cette journée était de 99 kilomètres, ou 24 lieues trois quarts. Le lendemain, samedi 30 juillet, elle était, à une heure après midi, à Robinet sur le Robion, lieu où l'on débarque pour se rendre à Montélimart. Madame de Grignan vint la prendre dans sa voiture; et, après avoir franchi les quatre lieues qui séparent le château de Grignan de Montélimart, la mère et la fille se trouvèrent enfin réunies sous le même toit. Leur séparation avait duré un an et sept mois505. La distance parcourue par madame de Sévigné depuis Paris était de 620 kilomètres ou 150 lieues de poste. Dix-sept jours avaient été employés pour faire ce trajet; mais on doit en retrancher huit pour les séjours à Montjeu et à Lyon; il en résulte que la journée moyenne était de 67 kilomètres ou de 16 lieues par jour. La durée de ce trajet eût été plus longue si une partie n'en avait pas été faite par eau. Rendue à Grignan sans autre accident que la perte d'un de ses chevaux qui se noya, madame de Sévigné, ainsi que son oncle, ses femmes de chambre et son abbé de la Mousse, arrivèrent en parfaite santé, quoiqu'elle annonce malignement que ce dernier, dès son entrée à Lyon, était tout étonné de se trouver encore en vie après un si grand et si périlleux voyage.
CHAPITRE VIII.
1672
Le court séjour de madame de Sévigné à Lyon accroît son intimité avec madame de Coulanges.—Dans les lettres que celle-ci lui écrit à Grignan, elle lui annonce l'arrivée de Villeroi à Lyon.—Cet exil est la cause du rappel du chevalier de Lorraine.—Fâcheux effets de ce rappel.—Débauche chez M. le duc d'Enghien.—Le chevalier de Lorraine habile à séduire les femmes.—Le marquis de Villeroi plus séduisant encore.—Il est nommé le charmant.—Aveu singulier de madame de Sévigné.—Son explication.—Conjectures sur la cause de l'exil de Villeroi.—Il se rend à l'armée de l'électeur de Cologne.—Le roi le force de retourner à Lyon.—Ses intrigues d'amour à Lyon.—Il se retire à sa terre de Neufville, désespéré de l'infidélité d'une maîtresse de la cour, désignée dans les lettres sous le nom d'Alcine.—Les indiscrétions de Villeroi sur cette liaison ont été la cause de son exil.—Alcine n'est point la comtesse de Soissons.—Détails sur cette comtesse et sur sa liaison avec Villeroi.—Le gros cousin de madame de Coulanges n'est point Louvois, mais son frère l'archevêque de Reims.—Portrait de cet archevêque et détails sur ses liaisons avec la duchesse d'Aumont.—Il suit le roi à l'armée, et inaugure, dans la cathédrale de Reims, des drapeaux pris sur les Hollandais.—Alcine est la duchesse d'Aumont.—Détails sur cette duchesse.—Son caractère, sa vie décente.—Ses liaisons amoureuses.—Dévote dans l'âge avancé.—Son genre de dévotion.—Contraste entre certaines dévotes.—Liaisons amoureuses de la duchesse d'Aumont, avant sa conversion, avec Caderousse, le marquis de Biran et le marquis de Villeroi.—Le mystère de sa liaison avec l'archevêque de Reims est dévoilé par le beau-fils de la duchesse d'Aumont, le marquis de Villequier.—On n'ajoute pas foi à ses révélations.—La comtesse de Soissons reprend son ascendant sur le marquis de Villeroi.—On s'intéressait aux intrigues amoureuses des hommes renommés par leurs séductions.—Cause de l'indulgence générale pour les fautes que l'amour fait commettre.—Vardes séduit mademoiselle de Toiras.—Scène de désespoir entre ces deux amants, jouée par madame de Coulanges et par Barillon.—Madame de Sévigné redoute la visite de Villeroi à Grignan.—Bruit qui court à Paris sur Vardes et Villeroi.—Madame de Coulanges part pour Lyon, et se rend à Paris.
Le court séjour de madame de Sévigné à Lyon et le peu de temps passé dans la société de madame de Coulanges accrurent encore leur attachement mutuel. Ces deux amies ne pouvaient se passer l'une de l'autre; toutes deux, connaissant parfaitement le monde et la cour, s'intéressaient plus vivement à tout ce qui s'y passait; toutes deux aimaient à railler et à médire506, non par haine, non par malice, non par envie, mais pour exercer leur esprit, pour s'amuser et s'instruire mutuellement de ce qui se passait autour d'elles. Quand elles ne pouvaient converser ensemble, elles s'écrivaient. Madame de Sévigné, le jour même de son départ de Lyon, écrivit à madame de Coulanges, et puis encore le lendemain en arrivant à Grignan507.
Une des réponses de madame de Coulanges roule presque en entier sur le marquis de Villeroi, gouverneur de Lyon, et qui venait d'y arriver; il regrettait beaucoup de n'y plus retrouver madame de Sévigné. Celle-ci, avant son départ de Paris, avait su que le marquis de Villeroi était exilé à Lyon, et elle avait mandé cette nouvelle à sa fille. Le motif de cette sévérité de Louis XIV envers un de ses courtisans qu'il aimait le mieux, et qui avait été le compagnon de son enfance, était inconnu. On savait seulement qu'il était le résultat d'une indiscrétion et de paroles imprudentes prononcées chez la comtesse de Soissons508. C'est cet exil qui donna occasion à MONSIEUR de demander au roi le rappel du chevalier de Lorraine. Ce rappel ne surprit pas moins que la défense faite à Villeroi d'accompagner Louis XIV à l'armée et l'ordre qu'il reçut de se rendre à Lyon. Au milieu des grands événements de la guerre, on s'en préoccupa à la cour. Les détails de l'entretien des deux frères au sujet de ce rappel nous prouvent combien était grand l'effet du despotisme de Louis XIV sur sa famille, la crainte qu'il inspirait à tout ce qui l'entourait et la profonde humiliation de MONSIEUR. Il faut que les singulières particularités de cet entretien aient été racontées par le roi lui-même ou par Monsieur, pour que madame de Sévigné, en les transmettant à sa fille, puisse lui écrire: «Vous pouvez vous assurer que tout ceci est vrai: c'est mon aversion que les faux détails, mais j'aime les vrais. Si vous n'êtes de mon goût, vous êtes perdue, car en voici d'infinis509.» Il est difficile d'admettre qu'il y ait eu un seul témoin de cette étrange scène.
Ce retour du chevalier de Lorraine produisit, parmi les courtisans de MONSIEUR, un redoublement de débauche qui scandalisait cette cour galante et si peu scrupuleuse. C'est alors que les lettres de madame de Sévigné et les libelles du temps nous signalent un honteux libertinage, des fêtes, des parties de chasse et des repas splendides faits à Saint-Maur au milieu de la nuit, sans aucun égard pour les prescriptions du carême ou plutôt avec la coupable intention d'assaisonner la débauche par l'impiété. Le duc d'Enghien, fils du prince de Condé, était un des grands promoteurs de ces orgies; et madame de Sévigné figura dans une de ces parties, où se trouvaient les deux filles de la maréchale de Grancey, qu'on appelait les anges (l'une, mademoiselle de Grancey, avait le titre de madame, parce qu'elle était chanoinesse; l'autre était madame de Marey), et avec elles mesdames de Coëtquen et de Bordeaux, et la comtesse de Soissons510. La présence à la cour du chevalier de Lorraine, qui était l'indispensable acteur dans toutes ces parties, fournit aussi à madame de Sévigné511 l'occasion d'entretenir madame de Grignan d'une des filles d'honneur de la reine, mademoiselle de Fiennes. Elle avait été enlevée par le chevalier de Lorraine avant qu'il fût exilé; il la délaissa, quoiqu'il en eût eu un fils qui fut élevé avec les enfants de la comtesse d'Armagnac, à la vue du public, dit madame de Sévigné. Après son retour, il reconnut cet enfant.
Le chevalier de Lorraine, profondément dissimulé, avait cependant une physionomie ouverte et enjouée, qui convenait à madame de Sévigné; il déplaisait à sa fille, probablement meilleure physionomiste. Lui, Vardes et Villeroi étaient considérés comme les plus dangereux séducteurs; mais Villeroi l'emportait alors sur ses deux rivaux par sa jeunesse, par les agréments de sa personne, par la magnificence et le goût de sa parure, la grâce de ses belles manières, son habileté et son adresse dans tous les exercices du corps, sa force et sa belle santé, qui le rendaient en tout infatigable512.
Madame de Coulanges ne tarit pas dans ses lettres sur les louanges qu'elle donne au charmant. Madame de Sévigné témoigne pour son amie, sur l'effet de cet engouement, des craintes qui paraissent sérieuses; et, à ce sujet, elle fait un aveu trop important pour que son biographe le laisse passer inaperçu.
Elle était à Livry, où son cousin Coulanges vint la voir; et elle écrivit à sa fille le 2 juin, alors qu'elle se disposait à se rendre à Lyon et en Provence: «M. de Coulanges, dit-elle, est charmé du marquis de Villeroi. Il (Coulanges) arriva hier au soir. Sa femme, comme vous dites, a donné tout au travers des louanges et des approbations de ce marquis. Cela est naturel; il faut avoir trop d'application pour s'en garantir. Je me suis mirée dans sa lettre, mais je l'excuse mieux qu'on ne m'excusait513.» Le marquis de Villeroi n'était alors âgé que de vingt-neuf ans, et madame de Sévigné en avait quarante-six. Dans ce retour qu'elle fait sur elle-même, elle ne pouvait penser au temps présent; elle fait allusion à l'époque de sa jeunesse, alors que, compromise par la publication du perfide ouvrage de Bussy, elle ne trouva personne qui voulût l'excuser de s'être trop complue aux louanges que lui donnait son cousin, et de ne s'être pas assez refusée au plaisir que lui faisaient éprouver ses spirituelles saillies et sa réjouissante conversation514.
Le marquis de Villeroi alla d'abord à Lyon, pour obéir aux ordres du roi; mais il s'en écarta presque aussitôt, et partit pour se rendre près de l'électeur de Cologne, voulant servir Louis XIV au moins dans l'armée de ses alliés515. Ce zèle ne réussit pas, et le roi lui ordonna de retourner à Lyon516.
A cette époque, le marquis de Villeroi était réellement amoureux d'une femme de la cour. Il avait retrouvé à Lyon une madame Salus, femme d'un financier, qu'il avait séduite. Quand il la revit après un assez long intervalle, il trouva chez elle une madame Carles, qui lui parut plus belle, et les attentions qu'il eut pour celle-ci divisèrent les deux amies517; mais ni l'une ni l'autre ne purent le distraire d'une passion où, contre son ordinaire, son cœur était engagé. Nous avons vu, par l'exemple de Sidonia, que, bien différent de Vardes, le marquis de Villeroi, quand il était véritablement épris d'une femme, ne gardait plus ni discrétion ni mesure. Il est probable que les paroles qu'il prononça chez la comtesse de Soissons et qui furent la cause de son exil avaient trait à cette passion. L'inconduite fut le seul motif qu'allégua Louis XIV pour justifier sa rigueur envers le jeune Villeroi; et le vieux maréchal duc, son père, reçut de la bouche royale l'assurance que la pénitence ne serait pas de longue durée518. Mais Villeroi, à la fois dévoré par l'amour et par l'ambition, était désespéré de se voir condamné à un honteux repos quand il aurait pu se distinguer à la conquête de la Hollande par des actions d'éclat, et gagner des grades à l'armée. Il était désolé surtout que son exil à Lyon l'éloignât d'une maîtresse adorée. Très-peu disposé à se prévaloir des liaisons qu'il avait formées ou à en chercher de nouvelles, il se retira dans sa terre de Neufville, à quatre lieues de Lyon, n'y recevant personne. Madame de Coulanges écrit à madame de Sévigné: «Écoutez, madame, le procédé du charmant. Il y a un mois que je ne l'ai vu; il est à Neufville, outré de tristesse; et quand on prend la liberté de lui en parler, il dit que son exil est long; et voilà les seules paroles qu'il ait proférées depuis l'infidélité de son Alcine519. Il hait mortellement la chasse, et il ne fait que chasser; il ne lit plus, ou du moins il ne sait ce qu'il lit; plus de Salus, plus d'amusement: il a un mépris pour les femmes qui empêche de croire qu'il méprise celle qui outrage son amour et sa gloire..... Je suis de votre avis, madame, je ne comprends pas qu'un amant ait tort, parce qu'il est absent; mais qu'il ait tort étant présent, je le comprends mieux. Il me paraît plus aisé de conserver son idée sans défauts pendant l'absence; Alcine n'est pas de ce goût; le charmant l'aime de bien bonne foi: c'est la seule personne qui m'ait fait croire à l'inclination naturelle; j'ai été surprise de ce que je lui ai entendu dire là-dessus..... Le bruit de la reconnaissance que l'on a pour l'amour de mon gros cousin se confirme. Je ne crois que médiocrement aux méchantes langues; mais mon cousin, tout gros qu'il est, a été préféré à des tailles plus fines; et puis, après un petit un grand. Pourquoi ne voulez-vous pas qu'un gros trouve sa place520?»
Et quatre mois après, de retour à Paris ainsi que Villeroi521, madame de Coulanges écrit encore à son amie: «Le marquis de Villeroi est si amoureux qu'on lui fait voir ce que l'on veut. Jamais aveuglement ne fut pareil au sien; tout le monde le trouve digne de pitié, et il me paraît digne d'envie: il est plus charmé qu'il n'est charmant; il ne compte pour rien sa fortune, mais la belle compte Caderousse pour quelque chose, et puis un autre pour quelque chose encore: un, deux, trois, c'est la pure vérité! Fi! je hais les médisances.»