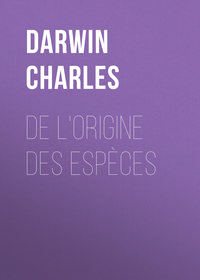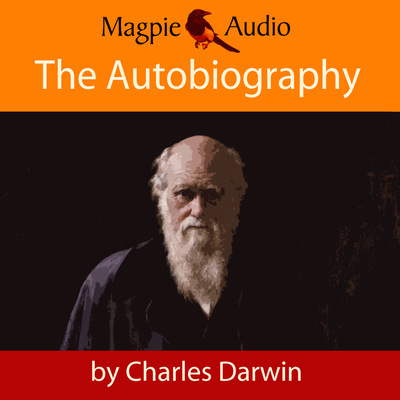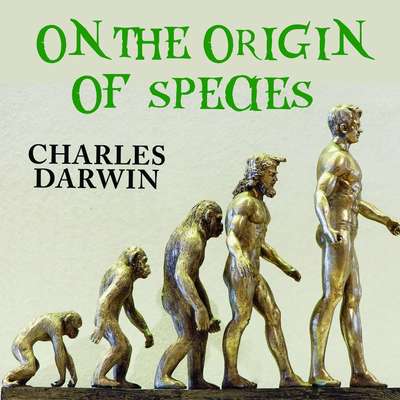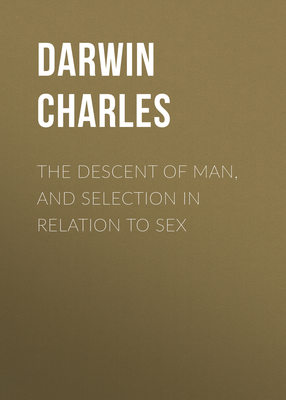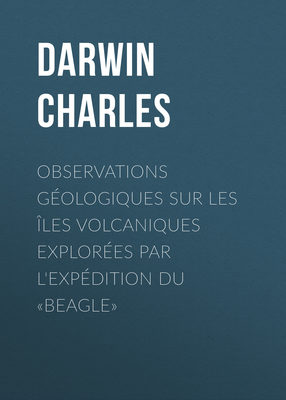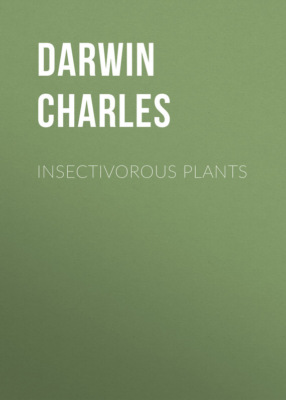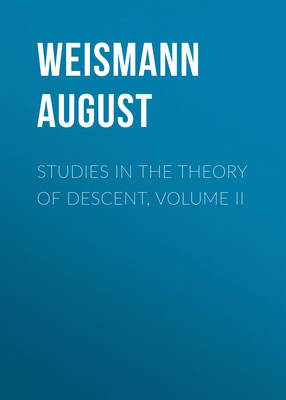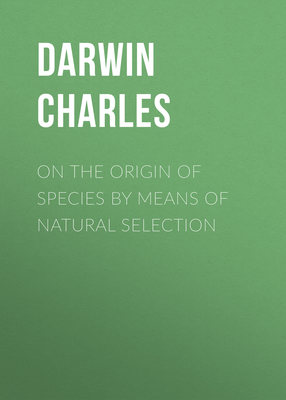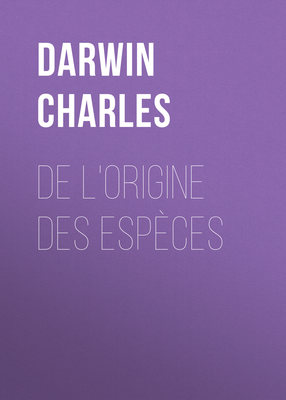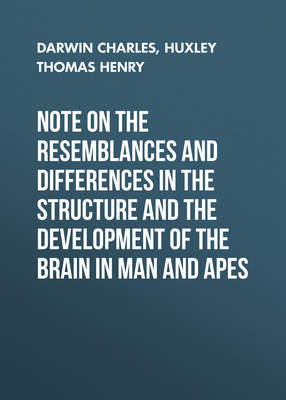Kitabı oku: «De l'origine des espèces», sayfa 2
INTRODUCTION
Les rapports géologiques qui existent entre la faune actuelle et la faune éteinte de l'Amérique méridionale, ainsi que certains faits relatifs à la distribution des êtres organisés qui peuplent ce continent, m'ont profondément frappé lors mon voyage à bord du navire le Beagle [La relation du voyage de M. Darwin a été récemment publiée en français sous le titre de: Voyage d'un naturaliste autour du monde, 1 vol, in-8°, Paris, Reinwald], en qualité de naturaliste. Ces faits, comme on le verra dans les chapitres subséquents de ce volume, semblent jeter quelque lumière sur l'origine des espèces – ce mystère des mystères – pour employer l'expression de l'un de nos plus grands philosophes. À mon retour en Angleterre, en 1837, je pensai qu'en accumulant patiemment tous les faits relatifs à ce sujet, qu'en les examinant sous toutes les faces, je pourrais peut-être arriver à élucider cette question. Après cinq années d'un travail opiniâtre, je rédigeai quelques notes; puis, en 1844, je résumai ces notes sous forme d'un mémoire, où j'indiquais les résultats qui me semblaient offrir quelque degré de probabilité; depuis cette époque, j'ai constamment poursuivi le même but. On m'excusera, je l'espère, d'entrer dans ces détails personnels; si je le fais, c'est pour prouver que je n'ai pris aucune décision à la légère.
Mon oeuvre est actuellement (1859) presque complète. Il me faudra, cependant, bien des années encore pour l'achever, et, comme ma santé est loin d'être bonne, mes amis m'ont conseillé de publier le résumé qui fait l'objet de ce volume. Une autre raison m'a complètement décidé: M. Wallace, qui étudie actuellement l'histoire naturelle dans l'archipel Malais, en est arrivé à des conclusions presque identiques aux miennes sur l'origine des espèces. En 1858, ce savant naturaliste m'envoya un mémoire à ce sujet, avec prière de le communiquer à Sir Charles Lyell, qui le remit à la Société Linnéenne; le mémoire de M. Wallace a paru dans le troisième volume du journal de cette société. Sir Charles Lyell et le docteur Hooker, qui tous deux étaient au courant de mes travaux – le docteur Hooker avait lu l'extrait de mon manuscrit écrit en 1844 – me conseillèrent de publier, en même temps que le mémoire de M. Wallace, quelques extraits de mes notes manuscrites.
Le mémoire qui fait l'objet du présent volume est nécessairement imparfait. Il me sera impossible de renvoyer à toutes les autorités auxquelles j'emprunte certains faits, mais j'espère que le lecteur voudra bien se fier à mon exactitude. Quelques erreurs ont pu, sans doute, se glisser dans mon travail, bien que j'aie toujours eu grand soin de m'appuyer seulement sur des travaux de premier ordre. En outre, je devrai me borner à indiquer les conclusions générales auxquelles j'en suis arrivé, tout en citant quelques exemples, qui, je pense, suffiront dans la plupart des cas. Personne, plus que moi, ne comprend la nécessité de publier plus tard, en détail, tous les faits sur lesquels reposent mes conclusions; ce sera l'objet d'un autre ouvrage. Cela est d'autant plus nécessaire que, sur presque tous les points abordés dans ce volume, on peut invoquer des faits qui, au premier abord, semblent tendre à des conclusions absolument contraires à celles que j'indique. Or, on ne peut arriver à un résultat satisfaisant qu'en examinant les deux côtés de la question et en discutant les faits et les arguments; c'est là chose impossible dans cet ouvrage.
Je regrette beaucoup que le défaut d'espace m'empêche de reconnaître l'assistance généreuse que m'ont prêtée beaucoup de naturalistes, dont quelques-uns me sont personnellement inconnus. Je ne puis, cependant, laisser passer cette occasion sans exprimer ma profonde gratitude à M. le docteur Hooker, qui, pendant ces quinze dernières années, a mis à mon entière disposition ses trésors de science et son excellent jugement.
On comprend facilement qu'un naturaliste qui aborde l'étude de l'origine des espèces et qui observe les affinités mutuelles des êtres organisés, leurs rapports embryologiques, leur distribution géographique, leur succession géologique et d'autres faits analogues, en arrive à la conclusion que les espèces n'ont pas été créées indépendamment les unes des autres, mais que, comme les variétés, elles descendent d'autres espèces. Toutefois, en admettant même que cette conclusion soit bien établie, elle serait peu satisfaisante jusqu'à ce qu'on ait pu prouver comment les innombrables espèces, habitant la terre, se sont modifiées de façon à acquérir cette perfection de forme et de coadaptation qui excite à si juste titre notre admiration. Les naturalistes assignent, comme seules causes possibles aux variations, les conditions extérieures, telles que le climat, l'alimentation, etc. Cela peut être vrai dans un sens très limité, comme nous le verrons plus tard; mais il serait absurde d'attribuer aux seules conditions extérieures la conformation du pic, par exemple, dont les pattes, la queue, le bec et la langue sont si admirablement adaptés pour aller saisir les insectes sous l'écorce des arbres. Il serait également absurde d'expliquer la conformation du gui et ses rapports avec plusieurs êtres organisés distincts, par les seuls effets des conditions extérieures, de l'habitude, ou de la volonté de la plante elle-même, quand on pense que ce parasite tire sa nourriture de certains arbres, qu'il produit des graines que doivent transporter certains oiseaux, et qu'il porte des fleurs unisexuées, ce qui nécessite l'intervention de certains insectes pour porter le pollen d'une fleur à une autre.
Il est donc de la plus haute importance d'élucider quels sont les moyens de modification et de coadaptalion. Tout d'abord, il m'a semblé probable que l'étude attentive des animaux domestiques et des plantes cultivées devait offrir le meilleur champ de recherches pour expliquer cet obscur problème. Je n'ai pas été désappointé; j'ai bientôt reconnu, en effet, que nos connaissances, quelque imparfaites qu'elles soient, sur les variations à l'état domestique, nous fournissent toujours l'explication la plus simple et la moins sujette à erreur. Qu'il me soit donc permis d'ajouter que, dans ma conviction, ces études ont la plus grande importance et qu'elles sont ordinairement beaucoup trop négligées par les naturalistes.
Ces considérations m'engagent à consacrer le premier chapitre de cet ouvrage à l'étude des variations à l'état domestique. Nous y verrons que beaucoup de modifications héréditaires sont tout au moins possibles; et, ce qui est également important, ou même plus important encore, nous verrons quelle influence exerce l'homme en accumulant, par la sélection, de légères variations successives. J'étudierai ensuite la variabilité des espèces à l'état de nature, mais je me verrai naturellement forcé de traiter ce sujet beaucoup trop brièvement; on ne pourrait, en effet, le traiter complètement qu'à condition de citer une longue série de faits. En tout cas, nous serons à même de discuter quelles sont les circonstances les plus favorables à la variation. Dans le chapitre suivant, nous considérerons la lutte pour l'existence parmi les êtres organisés dans le monde entier, lutte qui doit inévitablement découler de la progression géométrique de leur augmentation en nombre. C'est la doctrine de Malthus appliquée à tout le règne animal et à tout le règne végétal. Comme il naît beaucoup plus d'individus de chaque espèce qu'il n'en peut survivre; comme, en conséquence, la lutte pour l'existence se renouvelle à chaque instant, il s'ensuit que tout être qui varie quelque peu que ce soit de façon qui lui est profitable a une plus grande chance de survivre; cet être est ainsi l'objet d'une sélection naturelle. En vertu du principe si puissant de l'hérédité, toute variété objet de la sélection tendra à propager sa nouvelle forme modifiée.
Je traiterai assez longuement, dans le quatrième chapitre, ce point fondamental de la sélection naturelle. Nous verrons alors que la sélection naturelle cause presque inévitablement une extinction considérable des formes moins bien organisées et amène ce que j'ai appelé la divergence des caractères. Dans le chapitre suivant, j'indiquerai les lois complexes et peu connues de la variation. Dans les cinq chapitres subséquents, je discuterai les difficultés les plus sérieuses qui semblent s'opposer à l'adoption de cette théorie; c'est-à-dire, premièrement, les difficultés de transition, ou, en d'autres termes, comment un être simple, ou un simple organisme, peut se modifier, se perfectionner, pour devenir un être hautement développé, ou un organisme admirablement construit; secondement, l'instinct, ou la puissance intellectuelle des animaux; troisièmement, l'hybridité, ou la stérilité des espèces et la fécondité des variétés quand on les croise; et, quatrièmement, l'imperfection des documents géologiques. Dans le chapitre suivant, j'examinerai la succession géologique des êtres à travers le temps; dans le douzième et dans le treizième chapitre, leur distribution géographique à travers l'espace; dans le quatorzième, leur classification ou leurs affinités mutuelles, soit à leur état de complet développement, soit à leur état embryonnaire. Je consacrerai le dernier chapitre à une brève récapitulation de l'ouvrage entier et à quelques remarques finales.
On ne peut s'étonner qu'il y ait encore tant de points obscurs relativement à l'origine des espèces et des variétés, si l'on tient compte de notre profonde ignorance pour tout ce qui concerne les rapports réciproques des êtres innombrables qui vivent autour de nous. Qui peut dire pourquoi telle espèce est très nombreuse et très répandue, alors que telle autre espèce voisine est très rare et a un habitat fort restreint? Ces rapports ont, cependant, la plus haute importance, car c'est d'eux que dépendent la prospérité actuelle et, je le crois fermement, les futurs progrès et la modification de tous les habitants de ce monde. Nous connaissons encore bien moins les rapports réciproques des innombrables habitants du monde pendant les longues périodes géologiques écoulées. Or, bien que beaucoup de points soient encore très obscurs, bien qu'ils doivent rester, sans doute, inexpliqués longtemps encore, je me vois cependant, après les études les plus approfondies, après une appréciation froide et impartiale, forcé de soutenir que l'opinion défendue jusque tout récemment par la plupart des naturalistes, opinion que je partageais moi-même autrefois, c'est-à-dire que chaque espèce a été l'objet d'une création indépendante, est absolument erronée. Je suis pleinement convaincu que les espèces ne sont pas immuables; je suis convaincu que les espèces qui appartiennent à ce que nous appelons le même genre descendent directement de quelque autre espèce ordinairement éteinte, de même que les variétés reconnues d'une espèce quelle qu'elle soit descendent directement de cette espèce; je suis convaincu, enfin, que la sélection naturelle a joué le rôle principal dans la modification des espèces, bien que d'autres agents y aient aussi participé.
CHAPITRE I DE LA VARIATION DES ESPÈCES À L'ÉTAT DOMESTIQUE
Causes de la variabilité. – Effets des habitudes. – Effets de l'usage ou du non-usage des parties. – Variation par corrélation. – Hérédité. – Caractères des variétés domestiques. – Difficulté de distinguer entre les variétés et les espèces. – Nos variétés domestiques descendent d'une ou de plusieurs espèces. – Pigeons domestiques. Leurs différences et leur origine. – La sélection appliquée depuis longtemps, ses effets. – Sélection méthodique et inconsciente. – Origine inconnue de nos animaux domestiques. – Circonstances favorables à l'exercice de la sélection par l'homme.
CAUSES DE LA VARIABILITÉ
Quand on compare les individus appartenant à une même variété ou à une même sous-variété de nos plantes cultivées depuis le plus longtemps et de nos animaux domestiques les plus anciens, on remarque tout d'abord qu'ils diffèrent ordinairement plus les uns des autres que les individus appartenant à une espèce ou à une variété quelconque à l'état de nature. Or, si l'on pense à l'immense diversité de nos plantes cultivées et de nos animaux domestiques, qui ont varié à toutes les époques, exposés qu'ils étaient aux climats et aux traitements les plus divers, on est amené à conclure que cette grande variabilité provient de ce que nos productions domestiques ont été élevées dans des conditions de vie moins uniformes, ou même quelque peu différentes de celles auxquelles l'espèce mère a été soumise à l'état de nature. Il y a peut-être aussi quelque chose de fondé dans l'opinion soutenue par Andrew Knight, c'est-à-dire que la variabilité peut provenir en partie de l'excès de nourriture. Il semble évident que les êtres organisés doivent être exposés, pendant plusieurs générations, à de nouvelles conditions d'existence, pour qu'il se produise chez eux une quantité appréciable de variation; mais il est tout aussi évident que, dès qu'un organisme a commencé à varier, il continue ordinairement à le faire pendant de nombreuses générations. On ne pourrait citer aucun exemple d'un organisme variable qui ait cessé de varier à l'état domestique. Nos plantes les plus anciennement cultivées, telles que le froment, produisent encore de nouvelles variétés; nos animaux réduits depuis le plus longtemps à l'état domestique sont encore susceptibles de modifications ou d'améliorations très rapides.
Autant que je puis en juger, après avoir longuement étudié ce sujet, les conditions de la vie paraissent agir de deux façons distinctes: directement sur l'organisation entière ou sur certaines parties seulement, et indirectement en affectant le système reproducteur. Quant à l'action directe, nous devons nous rappeler que, dans tous les cas, comme l'a fait dernièrement remarquer le professeur Weismann, et comme je l'ai incidemment démontré dans mon ouvrage sur la Variation à l'état domestique [De_ la Variation des Animaux et des Plantes à l'état domestique_, Paris, Reinwald], nous devons nous rappeler, dis-je, que cette action comporte deux facteurs: la nature de l'organisme et la nature des conditions. Le premier de ces facteurs semble être de beaucoup le plus important; car, autant toutefois que nous en pouvons juger, des variations presque semblables se produisent quelquefois dans des conditions différentes, et, d'autre part, des variations différentes se produisent dans des conditions qui paraissent presque uniformes. Les effets sur la descendance sont définis ou indéfinis. On peut les considérer comme définis quand tous, ou presque tous les descendants d'individus soumis à certaines conditions d'existence pendant plusieurs générations, se modifient de la même manière. Il est extrêmement difficile de spécifier L'étendue des changements qui ont été définitivement produits de cette façon. Toutefois, on ne peut guère avoir de doute relativement à de nombreuses modifications très légères, telles que: modifications de la taille provenant de la quantité de nourriture; modifications de la couleur provenant de la nature de l'alimentation; modifications dans l'épaisseur de la peau et de la fourrure provenant de la nature du climat, etc. Chacune des variations infinies que nous remarquons dans le plumage de nos oiseaux de basse-cour doit être le résultat d'une cause efficace; or, si la même cause agissait uniformément, pendant une longue série de générations, sur un grand nombre d'individus, ils se modifieraient probablement tous de la même manière. Des faits tels que les excroissances extraordinaires et compliquées, conséquence invariable du dépôt d'une goutte microscopique de poison fournie par un gall-insecte, nous prouvent quelles modifications singulières peuvent, chez les plantes, résulter d'un changement chimique dans la nature de la sève.
Le changement des conditions produit beaucoup plus souvent une variabilité indéfinie qu'une variabilité définie, et la première a probablement joué un rôle beaucoup plus important que la seconde dans la formation de nos races domestiques. Cette variabilité indéfinie se traduit par les innombrables petites particularités qui distinguent les individus d'une même espèce, particularités que l'on ne peut attribuer, en vertu de l'hérédité, ni au père, ni à la mère, ni à un ancêtre plus éloigné. Des différences considérables apparaissent même parfois chez les jeunes d'une même portée, ou chez les plantes nées de graines provenant d'une même capsule. À de longs intervalles, on voit surgir des déviations de conformation assez fortement prononcées pour mériter la qualification de monstruosités; ces déviations affectent quelques individus, au milieu de millions d'autres élevés dans le même pays et nourris presque de la même manière; toutefois, on ne peut établir une ligne absolue de démarcation entre les monstruosités et les simples variations. On peut considérer comme les effets indéfinis des conditions d'existence, sur chaque organisme individuel, tous ces changements de conformation, qu'ils soient peu prononcés ou qu'ils le soient beaucoup, qui se manifestent chez un grand nombre d'individus vivant ensemble. On pourrait comparer ces effets indéfinis aux effets d'un refroidissement, lequel affecte différentes personnes de façon indéfinie, selon leur état de santé ou leur constitution, se traduisant chez les unes par un rhume de poitrine, chez les autres par un rhume de cerveau, chez celle-ci par un rhumatisme, chez celle-là par une inflammation de divers organes.
Passons à ce que j'ai appelé l'action indirecte du changement des conditions d'existence, c'est-à-dire les changements provenant de modifications affectant le système reproducteur. Deux causes principales nous autorisent à admettre l'existence de ces variations: l'extrême sensibilité du système reproducteur pour tout changement dans les conditions extérieures; la grande analogie, constatée par Kölreuter et par d'autres naturalistes, entre la variabilité résultant du croisement d'espèces distinctes et celle que l'on peut observer chez les plantes et chez les animaux élevés dans des conditions nouvelles ou artificielles. Un grand nombre de faits témoignent de l'excessive sensibilité du système reproducteur pour tout changement, même insignifiant, dans les conditions ambiantes. Rien n'est plus facile que d'apprivoiser un animal, mais rien n'est plus difficile que de l'amener à reproduire en captivité, alors même que l'union des deux sexes s'opère facilement. Combien d'animaux qui ne se reproduisent pas, bien qu'on les laisse presque en liberté dans leur pays natal! On attribue ordinairement ce fait, mais bien à tort, à une corruption des instincts. Beaucoup de plantes cultivées poussent avec la plus grande vigueur, et cependant elles ne produisent que fort rarement des graines ou n'en produisent même pas du tout. On a découvert, dans quelques cas, qu'un changement insignifiant, un peu plus ou un peu moins d'eau par exemple, à une époque particulière de la croissance, amène ou non chez la plante la production des graines. Je ne puis entrer ici dans les détails des faits que j'ai recueillis et publiés ailleurs sur ce curieux sujet; toutefois, pour démontrer combien sont singulières les lois qui régissent la reproduction des animaux en captivité, je puis constater que les animaux carnivores, même ceux provenant des pays tropicaux, reproduisent assez facilement dans nos pays, sauf toutefois les animaux appartenant à la famille des plantigrades, alors que les oiseaux carnivores ne pondent presque jamais d'oeufs féconds. Bien des plantes exotiques ne produisent qu'un pollen sans valeur comme celui des hybrides les plus stériles. Nous voyons donc, d'une part, des animaux et des plantes réduits à l'état domestique se reproduire facilement en captivité, bien qu'ils soient souvent faibles et maladifs; nous voyons, d'autre part, des individus, enlevés tout jeunes à leurs forêts, supportant très bien la captivité, admirablement apprivoisés, dans la force de l'âge, sains (je pourrais citer bien des exemples) dont le système reproducteur a été cependant si sérieusement affecté par des causes inconnues, qu'il cesse de fonctionner. En présence de ces deux ordres de faits, faut-il s'étonner que le système reproducteur agisse si irrégulièrement quand il fonctionne en captivité, et que les descendants soient un peu différents de leurs parents? Je puis ajouter que, de même que certains animaux reproduisent facilement dans les conditions les moins naturelles (par exemple, les lapins et les furets enfermés dans des cages), ce qui prouve que le système reproducteur de ces animaux n'est pas affecté par la captivité; de même aussi, certains animaux et certaines plantes supportent la domesticité ou la culture sans varier beaucoup, à peine plus peut-être qu'à l'état de nature.
Quelques naturalistes soutiennent que toutes les variations sont liées à l'acte de la reproduction sexuelle; c'est là certainement une erreur. J'ai cité, en effet, dans un autre ouvrage, une longue liste de plantes que les jardiniers appellent des plantes folles, c'est-à-dire des plantes chez lesquelles on voit surgir tout à coup un bourgeon présentant quelque caractère nouveaux et parfois tout différent des autres bourgeons de la même plante. Ces variations de bourgeons, si on peut employer cette expression, peuvent se propager à leur tour par greffes ou par marcottes, etc., ou quelquefois même par semis. Ces variations se produisent rarement à l'état sauvage, mais elles sont assez fréquentes chez les plantes soumises à la culture. Nous pouvons conclure, d'ailleurs, que la nature de l'organisme joue le rôle principal dans la production de la forme particulière de chaque variation, et que la nature des conditions lui est subordonnée; en effet, nous voyons souvent sur un même arbre soumis à des conditions uniformes, un seul bourgeon, au milieu de milliers d'autres produits annuellement, présenter soudain des caractères nouveaux; nous voyons, d'autre part, des bourgeons appartenant à des arbres distincts, placés dans des conditions différentes, produire quelquefois à peu près la même variété – des bourgeons de pêchers, par exemple, produire des brugnons et des bourgeons de rosier commun produire des roses moussues. La nature des conditions n'a donc peut-être pas plus d'importance dans ce cas que n'en a la nature de l'étincelle, communiquant le feu à une masse de combustible, pour déterminer la nature de la flamme