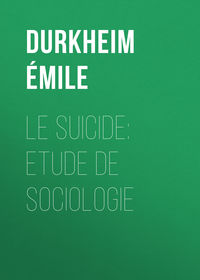Kitap dosya olarak indirilemez ancak uygulamamız üzerinden veya online olarak web sitemizden okunabilir.
Kitabı oku: «Le Suicide: Etude de Sociologie», sayfa 13
II
L'immunité dont jouissent les gens mariés ne peut être attribuée qu'à l'une des deux causes suivantes:
Ou bien elle est due à l'influence du milieu domestique. Ce serait alors la famille qui, par son action, neutraliserait le penchant au suicide ou l'empêcherait d'éclore.
Ou bien elle est due à ce qu'on peut appeler la sélection matrimoniale. Le mariage, en effet, opère mécaniquement dans l'ensemble de la population une sorte de triage. Ne se marie pas qui veut; on a peu de chances de réussir à fonder une famille si l'on ne réunit certaines qualités de santé, de fortune et de moralité. Ceux qui ne les ont pas, à moins d'un concours exceptionnel de circonstances favorables, sont donc, bon gré mal gré, rejetés dans la classe des célibataires qui se trouve ainsi comprendre tout le déchet humain du pays. C'est là que se rencontrent les infirmes, les incurables, les gens trop pauvres ou notoirement tarés. Dès lors, si cette partie de la population est à ce point inférieure à l'autre, il est naturel qu'elle témoigne de son infériorité par une mortalité plus élevée, par une criminalité plus considérable, enfin par une plus grande aptitude au suicide. Dans cette hypothèse, ce ne serait donc pas la famille qui préserverait du suicide, du crime ou de la maladie; le privilège des époux leur viendrait simplement de ce que ceux-là seuls sont admis à la vie de famille qui offrent déjà de sérieuses garanties de santé physique et morale.
Bertillon paraît avoir hésité entre ces deux explications et les avoir admises concurremment. Depuis, M. Letourneau, dans son Évolution du mariage et de la famille[169], a catégoriquement opté pour la seconde. Il se refuse à voir dans la supériorité incontestable de la population mariée une conséquence et une preuve de la supériorité de l'état de mariage. Il aurait moins précipité son jugement s'il n'avait pas aussi sommairement observé les faits.
Sans doute, il est assez vraisemblable que les gens mariés ont, en général, une constitution physique et morale plutôt meilleure que les célibataires. Il s'en faut, cependant, que la sélection matrimoniale ne laisse arriver au mariage que l'élite de la population. Il est surtout douteux que les gens sans fortune et sans position se marient sensiblement moins que les autres. Ainsi qu'on l'a fait remarquer[170], ils ont généralement plus d'enfants qu'on n'en a dans les classes aisées. Si donc l'esprit de prévoyance ne met pas obstacle à ce qu'ils accroissent leur famille au delà de toute prudence, pourquoi les empêcherait-il d'en fonder une? D'ailleurs, des faits répétés prouveront dans la suite que la misère n'est pas un des facteurs dont dépend le taux social des suicides. Pour ce qui concerne les infirmes, outre que bien des raisons font souvent passer sur leurs infirmités, il n'est pas du tout prouvé que ce soit dans leurs rangs que se recrutent de préférence les suicidés. Le tempérament organico-psychique qui prédispose le plus l'homme à se tuer est la neurasthénie sous toutes ses formes. Or, aujourd'hui, la neurasthénie passe plutôt pour une marque de distinction que pour une tare. Dans nos sociétés raffinées, éprises des choses de l'intelligence, les nerveux constituent presque une noblesse. Seuls, les fous caractérisés sont exposés à se voir refuser l'accès du mariage. Cette élimination restreinte ne suffit pas à expliquer l'importante immunité des gens mariés[171].
En dehors de ces considérations un peu a priori, des faits nombreux démontrent que la situation respective des mariés et des célibataires est due à de tout autres causes.
Si elle était un effet de la sélection matrimoniale, on devrait la voir s'accuser dès que cette sélection commence à opérer, c'est-à-dire à partir de l'âge où garçons et filles commencent à se marier. À ce moment, on devrait constater un premier écart, qui irait ensuite en croissant peu à peu à mesure que le triage s'effectue, c'est-à-dire à mesure que les gens mariables se marient et cessent ainsi d'être confondus avec cette tourbe qui est prédestinée par sa nature à former la classe des célibataires irréductibles. Enfin, le maximum devrait être atteint à l'âge où le bon grain est complètement séparé de l'ivraie, où toute la population admissible au mariage y a été réellement admise, où il n'y a plus parmi les célibataires que ceux qui sont irrémédiablement voués à cette condition par leur infériorité physique ou morale. C'est entre 30 et 40 ans que ce moment doit être placé; au delà on ne se marie plus guère.
Or, en fait, le coefficient de préservation évolue selon une tout autre loi. Au point de départ, il est très souvent remplacé par un coefficient d'aggravation. Les tout jeunes époux sont plus enclins au suicide que les célibataires; il n'en serait pas ainsi s'ils portaient en eux-mêmes et de naissance leur immunité. En second lieu, le maximum est réalisé presque d'emblée. Dès le premier âge où la condition privilégiée des gens mariés commence à s'affirmer (entre 20 et 25 ans), le coefficient atteint un chiffre qu'il ne dépasse plus guère dans la suite. Or, à cette période, il n'y a[172] que 148.000 époux contre 1.430.000 garçons, et 626.000 épouses contre 1.049.000 filles (nombres ronds). Les célibataires comprennent donc alors au milieu d'eux la majeure partie de cette élite que l'on dit être appelée par ses qualités congénitales à former plus tard l'aristocratie des époux; l'écart entre les deux classes au point de vue du suicide devrait par conséquent être faible, alors qu'il est déjà considérable. De même, à l'âge suivant (entre 25 et 30 ans), sur les 2 millions d'époux qui doivent apparaître entre 30 et 40 ans, il y en a plus d'un million qui ne sont pas encore mariés; et pourtant, bien loin que le célibat bénéficie de leur présence dans ses rangs, c'est alors qu'il fait la plus mauvaise figure. Jamais, pour ce qui est du suicide, ces deux parties de la population ne sont aussi distantes l'une de l'autre. Au contraire, entre 30 et 40 ans, alors que la séparation est achevée, que la classe des époux a ses cadres à peu près complets, le coefficient de préservation, au lieu d'arriver à son apogée et d'exprimer ainsi que la sélection conjugale est elle-même parvenue à son terme, subit une chute brusque et importante. Il passe, pour les hommes, de 3,20 à 2,77; pour les femmes, la régression est encore plus accentuée, 4,53 au lieu de 2,22, soit une diminution de 32 %.
D'autre part, ce triage, de quelque façon qu'il s'effectue, doit se faire également pour les filles et pour les garçons; car les épouses ne se recrutent pas d'une autre manière que les époux. Si donc la supériorité morale des gens mariés est simplement un produit de la sélection, elle doit être égale pour les deux sexes et, par suite, il en doit être de même de l'immunité contre le suicide. Or, en réalité, les époux sont en France sensiblement plus protégés que les épouses. Pour les premiers, le coefficient de préservation s'élève jusqu'à 3,20, ne descend qu'une seule fois au-dessous de 2,04 et oscille généralement autour de 2,80, tandis que, pour les secondes, le maximum ne dépasse pas 2,22 (ou, au plus, 2,39[173]) et que le minimum est inférieur à l'unité (0,98). Aussi est-ce à l'état de mariage que, chez nous, la femme se rapproche le plus de l'homme pour le suicide. Voici, en effet, quelle était, pendant les années 1887-91, la part de chaque sexe aux suicides de chaque catégorie d'état civil:

Ainsi, à chaque âge[174] la part des épouses aux suicides des mariés est de beaucoup supérieure à la part des filles aux suicides des célibataires. Ce n'est pas, assurément, que l'épouse soit plus exposée que la fille; les tableaux XX et XXI prouvent le contraire. Seulement, si elle ne perd pas à se marier, elle y gagne moins que l'époux. Mais alors, si l'immunité est à ce point inégale, c'est que la vie de famille affecte différemment la constitution morale des deux sexes. Ce qui prouve même péremptoirement que cette inégalité n'a pas d'autre origine, c'est qu'on la voit naître et grandir sous l'action du milieu domestique. Le tableau XXI montre, en effet, qu'au point de départ le coefficient de préservation est à peine différent pour les deux sexes (2,93 ou 2 d'un côté, 2,40 de l'autre). Puis, peu à peu, la différence s'accentue, d'abord parce que le coefficient des épouses croît moins que celui des époux jusqu'à l'âge du maximum, et ensuite parce que la décroissance en est plus rapide et plus importante[175]. Si donc il évolue ainsi à mesure que l'influence de la famille se prolonge, c'est qu'il en dépend.
Ce qui est plus démonstratif encore, c'est que la situation relative des sexes quant au degré de préservation dont jouissent les gens mariés n'est pas la même dans tous les pays. Dans le grand-duché d'Oldenbourg, ce sont les femmes qui sont favorisées et nous trouverons plus loin un autre cas de la même inversion. Cependant, en gros, la sélection conjugale se fait partout de la même manière. Il est donc impossible qu'elle soit le facteur essentiel de l'immunité matrimoniale; car alors comment produirait-elle des résultats opposés dans les différents pays? Au contraire, il est très possible que la famille soit, dans deux sociétés différentes, constituée de manière à agir différemment sur les sexes. C'est donc dans la constitution du groupe familial que doit se trouver la cause principale du phénomène que nous étudions.
Mais, si intéressant que soit ce résultat, il a besoin d'être précisé; car le milieu domestique est formé d'éléments différents. Pour chaque époux, la famille comprend: 1° l'autre époux; 2° les enfants. Est-ce au premier ou aux seconds qu'est due l'action salutaire qu'elle exerce sur le penchant au suicide? En d'autres termes, elle est composée de deux associations différentes: il y a le groupe conjugal d'une part, de l'autre, le groupe familial proprement dit. Ces deux sociétés n'ont ni les mêmes origines, ni la même nature, ni, par conséquent, selon toute vraisemblance, les mêmes effets. L'une dérive d'un contrat et d'affinités électives, l'autre d'un phénomène naturel, la consanguinité; la première lie entre eux deux membres d'une même génération, la seconde, une génération à la suivante; celle-ci est aussi vieille que l'humanité, celle-là ne s'est organisée qu'à une époque relativement tardive. Puisqu'elles diffèrent à ce point, il n'est pas certain a priori qu'elles concourent toutes deux à produire le fait que nous cherchons à comprendre. En tout cas, si l'une et l'autre y contribuent, ce ne saurait être ni de la même manière ni, probablement, dans la même mesure. Il importe donc de chercher si l'une et l'autre y ont part et, en cas d'affirmative, quelle est la part de chacune.
On a déjà une preuve de la médiocre efficacité du mariage dans ce fait que la nuptialité a peu changé depuis le commencement du siècle, alors que le suicide a triplé. De 1821 à 1830, il y avait 7,8 mariages annuels par 1.000 habitants, 8 de 1831 à 1850, 7,9 en 1851-60, 7,8 de 1861 à 1870, 8 de 1871 à 1880. Pendant ce temps, le taux des suicides par million d'habitants passait de 54 à 180. De 1880 à 1888, la nuptialité a légèrement fléchi (7,4 au lieu de 8), mais cette décroissance est sans rapport avec l'énorme accroissement des suicides qui, de 1880 à 1887, ont augmenté de plus de 16 %[176]. D'ailleurs, pendant la période 1865-88, la nuptialité moyenne de la France (7,7) est presque égale à celle du Danemark (7,8) et de l'Italie (7,6); pourtant ces pays sont aussi dissemblables que possible sous le rapport du suicide[177].
Mais nous avons un moyen beaucoup plus décisif de mesurer exactement l'influence propre de l'association conjugale sur le suicide; c'est de l'observer là où elle est réduite à ses seules forces, c'est-à-dire, dans les ménages sans enfants.
Pendant les années 1887-1891, un million d'époux sans enfants a donné annuellement 644 suicides[178]. Pour savoir dans quelle mesure l'état de mariage, à lui seul et abstraction faite de la famille, préserve du suicide, il n'y a qu'à comparer ce chiffre à celui que donnent les célibataires du même âge moyen. C'est cette comparaison que notre tableau XXI va nous permettre de faire, et ce n'est pas un des moindres services qu'il nous rendra. L'âge moyen des hommes mariés était alors, comme aujourd'hui, de 46 ans 8 mois 1/3. Un million de célibataires de cet âge produit environ 975 suicides. Or, 644 est à 975 comme 100 est à 150, c'est-à-dire que les époux stériles ont un coefficient de préservation de 1,5 seulement; ils ne se tuent qu'un tiers de fois moins que les célibataires du même âge. Il en est tout autrement quand il existe des enfants. Un million d'époux avec enfants produisait annuellement pendant cette même période 336 suicides seulement. Ce nombre est à 975 comme 100 est à 290; c'est-à-dire que, quand le mariage est fécond, le coefficient de préservation est presque doublé (2,90 au lieu de 1,5).
La société conjugale n'est donc que pour une faible part dans l'immunité des hommes mariés. Encore, dans le calcul précédent, avons-nous fait cette part un peu plus grande qu'elle n'est en réalité. Nous avons supposé, en effet, que les époux sans enfants ont le même âge moyen que les époux en général, alors qu'ils sont certainement moins âgés. Car ils comptent dans leurs rangs tous les époux les plus jeunes, qui n'ont pas d'enfants, non parce qu'ils sont irrémédiablement stériles, mais parce que, mariés trop récemment, ils n'ont pas encore eu le temps d'en avoir. En moyenne, c'est seulement à 34 ans que l'homme a son premier enfant[179], et pourtant c'est vers 28 ou 29 ans qu'il se marie, La partie de la population mariée qui a de 28 à 34 ans se trouve donc presque tout entière comprise dans la catégorie des époux sans enfants, ce qui abaisse l'âge moyen de ces derniers; par suite, en l'estimant à 46 ans, nous l'avons certainement exagéré. Mais alors, les célibataires auxquels il eût fallu les comparer ne sont pas ceux de 46 ans, mais de plus jeunes qui, par conséquent, se tuent moins que les précédents. Le coefficient de 1,5 doit donc être un peu trop élevé; si nous connaissions exactement l'âge moyen des maris sans enfants, on verrait que leur aptitude au suicide se rapproche de celle des célibataires plus encore que ne l'indiquent les chiffres précédents.
Ce qui montre bien, d'ailleurs, l'influence restreinte du mariage, c'est que les veufs avec enfants sont encore dans une meilleure situation que les époux sans enfants. Les premiers, en effet, donnent 937 suicides par million. Or ils ont un âge moyen de 61 ans 8 mois et 1/3. Le taux des célibataires du même âge (V. tableau XXI) est compris entre 1.434 et 1.768, soit environ 1.504. Ce nombre est à 937, comme 160 est à 100. Les veufs, quand ils ont des enfants, ont donc un coefficient de préservation d'au moins 1,6, supérieur par conséquent à celui des époux sans enfants. Et encore, en le calculant ainsi, l'avons-nous plutôt atténué qu'exagéré. Car les veufs qui ont de la famille ont certainement un âge plus élevé que les veufs en général. En effet, parmi ces derniers, sont compris tous ceux dont le mariage n'est resté stérile que pour avoir été prématurément rompu, c'est-à-dire les plus jeunes. C'est donc à des célibataires au-dessus de 62 ans (qui, en vertu de leur âge, ont une plus forte tendance au suicide), que les veufs avec enfants devraient être comparés. Il est clair que, de cette comparaison, leur immunité ne pourrait ressortir que renforcée[180].
Il est vrai que ce coefficient de 1,6 est sensiblement inférieur à celui des époux avec enfants, 2,9; la différence en moins est de 45 %. On pourrait donc croire que, à elle seule, la société matrimoniale a plus d'action que nous ne lui en avons reconnue, puisque, quand elle prend fin, l'immunité de l'époux survivant est à ce point diminuée. Mais cette perte n'est imputable que pour une faible part à la dissolution du mariage. La preuve en est que, là où il n'y a pas d'enfants, le veuvage produit de bien moindres effets. Un million de veufs sans enfants donne 1.258 suicides, nombre qui est à 1.504, contingent des célibataires de 62 ans, comme 100 est à 119. Le coefficient de préservation est donc encore de 1,2 environ, peu au-dessous par conséquent de celui des époux également sans enfants 1,5. Le premier de ces nombres n'est inférieur au second que de 20 %. Ainsi, quand la mort d'un époux n'a d'autre résultat que de rompre le lien conjugal, elle n'a pas sur la tendance au suicide du veuf de bien fortes répercussions. Il faut donc que le mariage, tant qu'il existe, ne contribue que faiblement à contenir cette tendance, puisqu'elle ne s'accroît pas davantage quand il cesse d'être.
Quant à la cause qui rend le veuvage relativement plus malfaisant quand le ménage a été fécond, c'est dans la présence des enfants qu'il faut aller la chercher. Sans doute, en un sens, les enfants rattachent le veuf à la vie, mais, en même temps, ils rendent plus aiguë la crise qu'il traverse. Car les relations conjugales ne sont plus seules atteintes; mais, précisément parce qu'il existe cette fois une société domestique, le fonctionnement en est entravé. Un rouage essentiel fait défaut et tout le mécanisme en est déconcerté. Pour rétablir l'équilibre troublé, il faudrait que l'homme remplît une double tâche et s'acquittât de fonctions pour lesquelles il n'est pas fait. Voilà pourquoi il perd tant des avantages dont il jouissait pendant la durée du mariage. Ce n'est pas parce qu'il n'est plus marié, c'est parce que la famille dont il est le chef est désorganisée. Ce n'est pas la disparition de l'épouse, mais de la mère qui cause ce désarroi.
Mais c'est surtout à propos de la femme que se manifeste avec éclat la faible efficacité du mariage, quand il ne trouve pas dans les enfants son complément naturel. Un million d'épouses sans enfants donne 221 suicides; un million de filles du même âge (entre 42 et 43 ans) 150 seulement. Le premier de ces nombres est au second comme 100 est à 67; le coefficient de préservation tombe donc au-dessous de l'unité, il est égal à 0,67, c'est-à-dire qu'il y a, en réalité, aggravation. Ainsi, en France, les femmes mariées sans enfants se tuent moitié plus que les célibataires du même sexe et du même âge. Déjà, nous avions constaté que, d'une manière générale, l'épouse profite moins de la vie de famille que l'époux. Nous voyons maintenant quelle en est la cause; c'est que, par elle-même, la société conjugale nuit à la femme et aggrave sa tendance au suicide.
Si, néanmoins, la généralité des épouses nous a paru jouir d'un coefficient de préservation, c'est que les ménages stériles sont l'exception et que, par conséquent, dans la majorité des cas, la présence des enfants corrige et atténue la mauvaise action du mariage. Encore celle-ci n'est-elle qu'atténuée. Un million de femmes avec enfants donne 79 suicides; si l'on rapproche ce chiffre de celui qui exprime le taux des filles de 42 ans, soit 150, on trouve que l'épouse, alors même qu'elle est aussi mère, ne bénéficie que d'un coefficient de préservation de 1,89, inférieur par conséquent de 35 % à celui des époux qui sont dans la même condition[181]. On ne saurait donc, pour ce qui est du suicide, souscrire à cette proposition de Bertillon: «Quand la femme entre sous la raison conjugale, elle gagne plus que l'homme à cette association; mais elle déchoit nécessairement plus que l'homme quand elle en sort[182]».
III
Ainsi l'immunité que présentent les gens mariés en général est due, tout entière pour un sexe et en majeure partie pour l'autre, à l'action, non de la société conjugale, mais de la société familiale. Cependant, nous avons vu que, même s'il n'y a pas d'enfants, les hommes tout au moins sont protégés dans le rapport de 1 à 1,5. Une économie de 50 suicides sur 150 ou de 33 %, si elle est bien au-dessous de celle qui se produit quand la famille est complète, n'est cependant pas une quantité négligeable et il importe de comprendre quelle en est la cause. Est-elle due aux bienfaits spéciaux que le mariage rendrait au sexe masculin, ou bien n'est-elle pas plutôt un effet de la sélection matrimoniale? Car si nous avons pu démontrer que cette dernière ne joue pas le rôle capital qu'on lui a attribué, il n'est pas prouvé qu'elle soit sans aucune influence.
Un fait paraît même, au premier abord, devoir imposer cette hypothèse. Nous savons que le coefficient de préservation des époux sans enfants survit en partie au mariage; il tombe seulement de 1,5 à 1,2. Or, cette immunité des veufs sans enfants ne saurait évidemment être attribuée au veuvage qui, par lui-même, n'est pas de nature à diminuer le penchant au suicide, mais ne peut, au contraire, que le renforcer. Elle résulte donc d'une cause antérieure et qui, pourtant, ne paraît pas devoir être le mariage puisqu'elle continue à agir alors même qu'il est dissous par la mort de la femme. Mais alors, ne consisterait-elle pas dans quelque qualité native des époux que la sélection conjugale ferait apparaître, mais ne créerait pas? Comme elle existerait avant le mariage et en serait indépendante, il serait tout naturel qu'elle durât plus que lui. Si la population des mariés est une élite, il en est nécessairement de même de celle des veufs. Il est vrai que cette supériorité congénitale a de moindres effets chez ces derniers puisqu'ils sont protégés contre le suicide à un moindre degré. Mais on conçoit que la secousse produite par le veuvage puisse neutraliser en partie cette influence préventive et l'empêcher de produire tous ses résultats.
Mais, pour que cette explication pût être acceptée, il faudrait qu'elle fût applicable aux deux sexes. On devrait donc trouver aussi chez les femmes mariées quelques traces au moins de cette prédisposition naturelle qui, toutes choses égales, les préserverait du suicide plus que les célibataires. Or déjà, le fait que, en l'absence d'enfants, elles se tuent plus que les filles du même âge, est assez peu conciliable avec l'hypothèse qui les suppose dotées, dès la naissance, d'un coefficient personnel de préservation. Cependant, on pourrait encore admettre que ce coefficient existe pour la femme comme pour l'homme, mais qu'il est totalement annulé pendant la durée du mariage par l'action funeste que ce dernier exerce sur la constitution morale de l'épouse. Mais, si les effets n'en étaient que contenus et masqués par l'espèce de déchéance morale que subit la femme en entrant dans la société conjugale, ils devraient réapparaître quand cette société se dissout, c'est-à-dire au veuvage. On devrait voir alors la femme, débarrassée du joug matrimonial qui la déprimait, ressaisir tous ses avantages et affirmer enfin sa supériorité native sur celles de ses congénères qui n'ont pu se faire admettre au mariage. En d'autres termes, la veuve sans enfants devrait avoir, par rapport aux célibataires, un coefficient de préservation qui se rapproche tout au moins de celui dont jouit le veuf sans enfants. Or il n'en est rien. Un million de veuves sans enfants fournit annuellement 322 suicides; un million de filles de 60 ans (âge moyen des veuves) en produit un nombre compris entre 189 et 204, soit environ 196. Le premier de ces nombres est au second comme 100 est à 60. Les veuves sans enfants ont donc un coefficient au-dessous de l'unité, c'est-à-dire un coefficient d'aggravation; il est égal à 0,60, inférieur même légèrement à celui des épouses sans enfants (0,67). Par conséquent, ce n'est pas le mariage qui empêche ces dernières de manifester pour le suicide l'éloignement naturel qu'on leur attribue.
On répondra peut-être que ce qui empêche le complet rétablissement de ces heureuses qualités dont le mariage aurait suspendu les manifestations, c'est que le veuvage est pour la femme un état pire encore. C'est, en effet, une idée très répandue que la veuve est dans une situation plus critique que le veuf. On insiste sur les difficultés économiques et morales contre lesquelles il lui faut lutter quand elle est obligée de subvenir elle-même à son existence et, surtout, aux besoins de toute une famille. On a même cru que cette opinion était démontrée par les faits. Suivant Morselli[183], la statistique établirait que la femme dans le veuvage serait moins éloignée de l'homme pour l'aptitude au suicide que pendant le mariage; et comme, mariée, elle est déjà plus rapprochée à cet égard du sexe masculin que quand elle est célibataire, il en résulterait qu'il n'y a pas pour elle de plus détestable condition. À l'appui de cette thèse, Morselli cite les chiffres suivants qui ne se rapportent qu'à la France, mais qui, avec de légères variantes, peuvent s'observer chez tous les peuples d'Europe:

La part de la femme dans les suicides commis par les deux sexes à l'état de veuvage semble être, en effet, beaucoup plus considérable que dans les suicides de mariés. N'est-ce pas la preuve que le veuvage lui est beaucoup plus pénible que ne lui était le mariage? S'il en est ainsi, il n'y a rien d'étonnant à ce que, même une fois veuve, les bons effets de son naturel soient, encore plus qu'avant, empêchés de se manifester.
Malheureusement, cette prétendue loi repose sur une erreur de fait. Morselli a oublié qu'il y avait partout deux fois plus de veuves que de veufs. En France, en nombres ronds, il y a deux millions des premières pour un million seulement des seconds. En Prusse, d'après le recensement de 1890, on trouve 450.000 pour les uns et 1.319.000 pour les autres; en Italie, 571.000 d'une part et 1.322.000 de l'autre. Dans ces conditions, il est tout naturel que la contribution des veuves soit plus élevée que celle des épouses qui, elles, sont évidemment en nombre égal aux époux. Si l'on veut que la comparaison comporte quelque enseignement, il faut ramener à l'égalité les deux populations. Mais si l'on prend cette précaution, on obtient des résultats contraires à ceux qu'a trouvés Morselli. À l'âge moyen des veufs, c'est-à-dire à 60 ans, un million d'épouses donne 154 suicides et un million d'époux 577. La part des femmes est donc de 21 %. Elle diminue sensiblement dans le veuvage. En effet, un million de veuves donne 210 cas, un million de veufs 1.017; d'où il suit que, sur 100 suicides de veufs des deux sexes, les femmes n'en comptent que 17. Au contraire, la part des hommes s'élève de 79 à 83 %. Ainsi, en passant du mariage au veuvage, l'homme perd plus que la femme, puisqu'il ne conserve pas certains des avantages qu'il devait à l'état conjugal. Il n'y a donc aucune raison de supposer que ce changement de situation soit moins laborieux et moins troublant pour lui que pour elle; c'est l'inverse qui est la vérité. On sait, d'ailleurs, que la mortalité des veufs dépasse de beaucoup celle des veuves; il en est de même de leur nuptialité. Celle des premiers est, à chaque âge, trois ou quatre fois plus forte que celle des garçons, tandis que celle des secondes n'est que légèrement supérieure à celle des filles. La femme met donc autant de froideur à convoler en secondes noces que l'homme y met d'ardeur[184]. Il en serait autrement si sa condition de veuf lui était à ce point légère et si la femme, au contraire, avait à la supporter autant de mal qu'on a dit[185].
Mais s'il n'y a rien dans le veuvage qui paralyse spécialement les dons naturels qu'aurait la femme par cela seul qu'elle est une élue du mariage, et s'ils ne témoignent alors de leur présence par aucun signe appréciable, tout motif manque pour supposer qu'ils existent. L'hypothèse de la sélection matrimoniale ne s'applique donc pas du tout au sexe féminin. Rien n'autorise à penser que la femme appelée au mariage possède une constitution privilégiée qui la prémunisse dans une certaine mesure, contre le suicide. Par conséquent, la même supposition est tout aussi peu fondée en ce qui concerne l'homme. Ce coefficient de 1,5 dont jouissent les époux sans enfants ne vient pas de ce qu'ils sont recrutés dans les parties les plus saines de la population; ce ne peut donc être qu'un effet du mariage. Il faut admettre que la société conjugale, si désastreuse pour la femme, est, au contraire, même en l'absence d'enfants, bienfaisante à l'homme. Ceux qui y entrent ne constituent pas une aristocratie de naissance; ils n'apportent pas tout fait, dans le mariage, un tempérament qui les détourne du suicide, mais ils acquièrent ce tempérament en vivant de la vie conjugale. Du moins, s'ils ont quelques prérogatives naturelles, elles ne peuvent être que très vagues et indéterminées; car elles restent sans effet, jusqu'à ce que certaines autres conditions soient données. Tant il est vrai que le suicide dépend principalement, non des qualités congénitales des individus, mais de causes qui leur sont extérieures et qui les dominent!
Cependant, une dernière difficulté reste à résoudre. Si ce coefficient de 1,5, indépendant de la famille, est dû au mariage, d'où vient qu'il lui survit et se retrouve au moins sous une forme atténuée (1,2) chez le veuf sans enfants? Si l'on rejette la théorie de la sélection matrimoniale qui rendait compte de cette survivance, comment la remplacer?
Il suffit de supposer que les habitudes, les goûts, les tendances contractées pendant le mariage ne disparaissent pas une fois qu'il est dissous et rien n'est plus naturel que cette hypothèse. Si donc l'homme marié, alors même qu'il n'a pas d'enfants, éprouve pour le suicide un éloignement relatif, il est inévitable qu'il garde quelque chose de ce sentiment quand il se trouve veuf. Seulement, comme le veuvage ne va pas sans un certain ébranlement moral et que, comme nous le montrerons plus loin, toute rupture d'équilibre pousse au suicide, ces dispositions ne se maintiennent qu'affaiblies. Inversement, mais pour la même raison, puisque l'épouse stérile se tue plus que si elle était restée fille, elle conserve, une fois veuve, cette plus forte inclination, même un peu renforcée à cause du trouble et de la désadaptation qu'apporte toujours avec lui le veuvage. Seulement, comme les mauvais effets que le mariage avait pour elle lui rendent ce changement d'état plus facile, cette aggravation est très légère. Le coefficient s'abaisse seulement de quelques centièmes (0,60 au lieu de 0,67)[186].