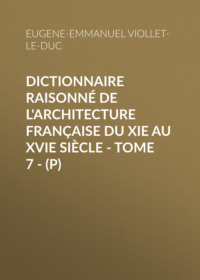Kitap dosya olarak indirilemez ancak uygulamamız üzerinden veya online olarak web sitemizden okunabilir.
Kitabı oku: «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 7 - (P)», sayfa 30
Voyons comme au même moment, dans une province où le système de la structure dite gothique arrivait à l'état d'importation, procédaient les architectes. Le choeur de l'église abbatiale de Vézelay est bâti peu après celui de Notre-Dame de Paris, c'est-à-dire vers 1190: là, dans le tracé des arcs des voûtes, les tâtonnements sont encore sensibles; les méthodes ne sont pas franches et sûres comme à Paris.

Il suffit, pour s'en convaincre, de jeter les yeux sur la figure 17, qui donne en A deux arcs doubleaux des chapelles du choeur, et en B un arc ogive de ces mêmes chapelles 358.
Ces tracés indiquent un sentiment fin de l'effet (et ces arcs en produisent beaucoup); mais la méthode est absente. Les deux arcs ogives et doubleaux provenant des voûtes hautes du choeur (car, ainsi que dans beaucoup de grandes voûtes de la fin du XIIe siècle, les arcs ogives et doubleaux donnent la même section), tracés en D, accusent une étude plus complète de l'architecture de l'Île-de-France, et reproduisent à peu près les profils des voûtes de Notre-Dame de Paris. Mais ces voûtes étaient élevées en effet quelques années après celles des chapelles, et les tâtonnements ont à peu près disparu. Il se manifeste dans ces derniers profils une tendance qui appartient à l'école bourguignonne gothique: c'est la prédominance des courbes sur les lignes droites dans le tracé des moulures. La nature des matériaux employés était bien pour quelque chose dans cette prédominance des courbes, mais aussi le goût de cette école pour la largeur des formes. Pendant que les architectes romans de l'Île-de-France, du Berry, du Poitou, de la Saintonge et de la Provence taillaient des profils fins et détaillés jusqu'à l'excès, ceux de Bourgogne traçaient déjà des profils d'une ampleur et d'une hardiesse de galbe extraordinaires. En adoptant le système de la structure gothique, les architectes de l'école bourguignonne conservèrent cette qualité de terroir; nous aurons tout à l'heure l'occasion de le reconnaître.
Nous ne saurions trop le répéter, on ne peut pas plus étudier l'architecture française en s'en tenant à une seule province, qu'on ne saurait étudier la langue, si l'on ne tenait compte des diverses formes du langage qui sont devenues des patois de nos jours, mais qui étaient bien réellement, au XIIe siècle, des dialectes ayant des grammaires, des syntaxes et des tournures variées. Aucune partie de l'architecture n'est plus propre à faire saisir ces différences d'écoles que les profils, qui sont l'expression la plus sensible du génie appartenant à chacune de ces écoles, si bien que certains monuments bâtis dans une province par un architecte étranger, tout en adoptant les méthodes de bâtir et les dispositions générales admises dans la localité, manifestent clairement l'origine de l'artiste par les profils, qui sont en réalité le langage usuel de l'architecte. On peut faire l'observation contraire. Il est, par exemple, des monuments gothiques bâtis en Auvergne (province dans laquelle l'architecture gothique n'a jamais pu être qu'à l'état d'importation), dont les profils sont auvergnats. L'architecte a voulu parler un langage qu'il ne comprenait pas. Il est d'autres édifices, comme la salle synodale de Sens, bâtie dans une province subissant l'influence champenoise, où la disposition générale, le système de structure est local, et où les profils appartiennent, la plupart, à l'Île-de-France. Comme le choeur de l'église Saint-Nazaire de Carcassonne, où le plan, les données, les formes des piliers, l'apparence extérieure, sont tout méridionaux, et où les profils dénotent la présence d'un artiste du domaine royal. Cet artiste a exprimé les idées admises dans la localité au moyen de son langage à lui. Cette partie de notre architecture nationale mérite donc une étude attentive, délicate, car elle donne le moyen, non-seulement de fixer des dates positives, mais aussi d'indiquer les écoles. Cette étude doit être faite dans chaque province, car tel profil que l'on voit adopter en 1200, à Paris, n'apparaîtra en Poitou qu'en 1230, avec quelques modifications apportées par le génie provincial. Nous pourrions citer des monuments de Champagne de 1250, qui, dans l'Île-de-France, seraient classés à l'aide des profils, par des yeux peu exercés, au commencement du XIVe siècle. Aussi doit-on étudier les profils dans les seuls édifices vraiment originaux et dus à des artistes du premier ordre, et ne pas tenir plus de compte de certaines bizarreries ou exceptions qu'on ne tient compte, pour avoir la connaissance parfaite d'un dialecte, de manuscrits mal copiés ou d'oeuvres grossières. Toutes les époques, même la nôtre, ont produit des oeuvres barbares; ce n'est pas sur celles-là qu'il faut juger un art, ni à plus forte raison l'étudier. Cette étude, faite avec les yeux du critique, nous démontre encore que dans cet art, si longtemps et injustement dédaigné, il existe des lois aussi bien établies que dans les arts de l'architecture grecque et romaine; que ces lois s'appuient sur des principes non moins impérieux: car, s'il en était autrement, comment expliquer certaines similitudes; ou des dissemblances ne s'écartant jamais du principe dominant?

Voici maintenant des profils d'arcs des voûtes du tour du choeur de la cathédrale d'Amiens, qui date de 1240 environ (fig. 18). A est le profil des arcs-doubleaux, B celui des arcs ogives, au dixième de l'exécution. À dater de cette époque, les méthodes employées pour tracer les profils sont de plus en plus soumises à des lois géométriques et à des mesures régulières. Ainsi, dans le profil A d'arc-doubleau, le boudin inférieur a 0m,215 de diamètre (8 pouces). Du centre de ce boudin, tirant une ligne à 45º ab, la rencontre de cette ligne avec la verticale cb donne en b l'arête du cavet supérieur. Le boudin est engagé au douzième de son diamètre par l'horizontale ef. La ligne gh à 45º, tangente au boudin inférieur, est également tangente au boudin supérieur l, dont le diamètre a 0m,108 (4 pouces). Ce boudin est également tangent à la verticale cb prolongée. Le rayon du cavet supérieur est égal au rayon du boudin l, son centre étant en i. Le centre m du cavet inférieur est placé à la rencontre de la ligne ef avec une verticale tangente au boudin supérieur, et le rayon de ce cavet est de 2 pouces-1/2. Le listel bc a 0m,162 (6 pouces). Le filet saillant p se marie avec le gros boudin au moyen de deux contre-courbes dont les centres sont placés en r. On conçoit combien ces méthodes de tracés facilitaient l'épannelage. La verticale co a un pied juste. Cette base prise et la ligne og étant tirée à 45º, on inscrivait ainsi tous les membre du profil dans un épannelage très-simple. Quant au profil B de l'arc ogive, sa largeur est d'un pied. La face st a 10 pouces, et la ligne w est tirée à 45º. Le diamètre du boudin inférieur de ce profil a 5 pouces-1/2. Du point x, élevant une ligne xy à 60º, on obtient le point y, arête du cavet supérieur. Le boudin supérieur a 2 pouces-1/2 de diamètre. Il est facile de reconnaître que ces tracés sont faits en vue de donner aux profils l'aspect léger qui convient à des arcs de voûtes, en laissant à la pierre le plus de résistance possible. L'arête inférieure ménagée dans l'axe, sous les gros boudins, dessine nettement la courbe, ce que ne pouvait faire un cylindre, car les architectes, dès le commencement du XIIIe siècle, ainsi que nous l'avons vu dans les exemples précédents, avaient senti la nécessité, lorsqu'ils terminaient l'arc par un boudin, d'arrêter la lumière (diffuse dans un intérieur) sur ce boudin par un nerf saillant, d'abord composé de deux lignes droites, puis bientôt de courbes avec filet plat. En effet, pour qui a observé les effets de la lumière sur des cylindres courbés, sans nerfs, il se fait un passage de demi-teintes, de clairs et d'ombres formant une spirale très-allongée, détruisant la forme cylindrique et laissant des surfaces indécises; de sorte que les moulures secondaires, avec leurs cavets, prenaient plus d'importance à l'oeil que le membre principal. Il fallait nerver celui-ci pour lui donner toute sa valeur et le faire paraître résistant, saillant et léger en même temps. Ainsi pouvait-on dorénavant renoncer aux profils d'arcs avec boudins latéraux et large listel plat entre eux, comme ceux donnés figure 16, qui avaient l'inconvénient de laisser au milieu même du profil un membre en apparence faible, parce qu'il restait dans la demi-teinte et n'accrochait jamais vivement la lumière. C'était donc une étude profonde des effets qui conduisait ainsi peu à peu à modifier les profils si importants des arcs de voûtes, non point une mode ou un désir capricieux de changement.
Les architectes de l'Île-de-France, toutefois, semblent avoir répugné à adopter les nerfs saillants sous les boudins principaux des arcs des voûtes, jusque vers le milieu du XIIIe siècle. Ils essayèrent de donner à ces arcs une apparence de fermeté par d'autres moyens.

Les parties de l'église abbatiale de Saint-Denis, qui datent de 1240 environ, nous fournissent un exemple de ces tentatives (fig. 19). En A est tracé le profil des archivoltes des bas côtés; en B, celui des arcs-doubleaux; en C et D, ceux des arcs ogives. Les profils d'archivoltes A, dont nous ne donnons ici qu'une moitié, participent encore, à cause de leur épaisseur, des tracés antérieurs, avec boudins sur les arêtes et méplat intermédiaire. En a, nous indiquons une variante, c'est-à-dire le cavet dont le centre est en c avec une partie droite, et le cavet dont le centre est en b. Le profil d'arc-doubleau B présente un tracé très-étudié; la ligne ab est inclinée à 60º. Ainsi que le montre notre figure, c'est sur cette ligne que sont posés les centres du boudin supérieur c et du cavet intermédiaire e. Du centre c une ligne à 45º ayant été tirée, c'est sur cette ligne que se trouvent placés les centres du boudin inférieur g et des baguettes h et i. De plus, le boudin g est tangent à la ligne inclinée à 60º ab. Or, ce gros boudin a 4 pouces de diamètre et le boudin C 3 pouces.
Le tracé est devenu plus méthodique que dans l'exemple précédent, et le traceur a donné au boudin inférieur de la fermeté en le flanquant des deux baguettes qui le redessinent vivement au moyen des noirs k. Le centre du cavet supérieur est en l, c'est-à-dire au point de rencontre de la verticale bl avec l'horizontale tirée du centre c. Pour les profils des arcs ogives C et D, le système de tracé n'est pas moins géométrique. Ici la ligne ab inclinée à 60º donne le centre b du boudin inférieur, dont le diamètre est égal à celui des arcs-doubleaux. De ce centre b, la ligne be tangente au boudin supérieur reçoit le centre de la baguette f et celui g du cavet. Bien que les membres soient de diamètres différents dans les deux exemples C et D, on voit que la méthode de tracé est la même. Sur les détails E et F des boudins principaux, nous avons donné deux des méthodes employées dès cette époque pour nerver ces cylindres. Dans l'exemple E, le tracé donne l'arête vive obtenue au moyen de tangentes à 30º (cette arête étant parfois dégagée, pour plus de netteté, au moyen d'une ligne concave dont le centre est en h sur une perpendiculaire abaissée de la ligne à 30º) 359. Dans l'exemple F, les centres des arcs ik sont pris sur les angles d'un triangle équilatéral, dont le côté est deux fois le rayon du boudin.
Suivant qu'on a voulu obtenir un filet plus ou moins large, on a fait la section o plus haut ou plus bas, sur les arcs de cercle. Les tâtonnements arrivent ici à des formules. Désormais les angles à 30º, 60º et 45º, vont nous servir pour les tracés de ces profils, en employant des méthodes de plus en plus simples. Les architectes bourguignons, qui, ainsi que nous l'avons dit, sont si bons traceurs de profils, nous démontreront comment la méthode peut s'allier avec la liberté de l'artiste, et devient pour lui, s'il sait l'appliquer, non point une gêne, mais au contraire un moyen d'éviter les pertes de temps, les tâtonnements sans fin. Nous arrivons au moment où l'art de l'architecture, désormais affranchi des traditions romanes, livré aux mains laïques, n'en est plus réduit à copier avec plus ou moins de bonheur des formes consacrées, mais s'appuie sur le raisonnement, cherche et trouve des méthodes qui, n'étant point une entrave pour l'artiste de génie, empêchent l'artiste vulgaire de s'égarer.
Les profils, comme le système de construction, de proportion et d'ornementation, procèdent suivant une marche logique favorisant le progrès, la recherche du mieux. C'est qu'en effet, les architectures dignes d'être considérées comme un art, chez les Égyptiens, chez les Grecs, comme chez nous pendant le moyen âge, ont procédé de la même façon: cherchant de sentiment ou d'instinct, si l'on veut, les formes qui semblent le mieux s'approprier aux nécessités; arrivant, par une suite d'expériences, à donner à ces formes une certaine fixité, puis établissant peu à peu des méthodes, et enfin des formules, des lois fondées sur ce sentiment vrai et cette expérience. Alors l'architecte, en prenant son crayon, son compas et ses équerres, ne travaille plus dans le vide à la recherche de formes que sa fantaisie lui suggérera; il part d'un système établi, procède méthodiquement.
Nous savons tout ce qu'on peut dire contre l'adoption des formules; mais nous devons constater qu'il n'y a pas eu d'architecture digne de ce nom qui n'ait fatalement abouti à un formulaire. Plus qu'aucun autre peuple, les Grecs ont eu des méthodes conduisant aux formules, et si quelqu'un en doutait, nous l'engagerions à consulter les travaux si remarquables de M. Aurès sur ce sujet 360. Mais le formulaire architectonique des Grecs ne s'appuie que sur un système harmonique des proportions, développé sous l'influence du sentiment délicat de ce peuple. Ce formulaire, qui commence par une simple méthode empirique, établie par l'expérience, n'est pas une déduction logique d'un raisonnement, c'est un canon, c'est le beau chiffré; aussi ne peut-il se maintenir plus longtemps que ne se maintiendrait une loi établie sous l'empire d'un sentiment; il est renversé, ce formulaire, à chaque génération d'artistes. Il n'en est pas de même, en France, sous l'empire des écoles laïques: la méthode, dès l'abord, s'appuie moins sur un sentiment de la forme que sur le raisonnement; étant logique dans sa marche, elle n'aboutit à une formule que la veille du jour où l'art se perd définitivement. Car, du moment que la méthode atteignait à la formule, toute déduction devenait impossible; dès lors, au sein d'un art dont l'élément était le progrès incessant, la formule était la mort.
Les exemples de profils déjà présentés à nos lecteurs indiquent une tendance, vague d'abord, puis plus accentuée, vers une méthode géométrique, pour le tracé des divers membres qui les composent.
Le sentiment, mais un sentiment raisonné, a évidemment fait trouver les profils donnés dans les figures 15, 16 et 17. Il s'agissait d'allégir, pour l'oeil, des arcs supportant des voûtes élevées, en leur laissant cependant la plus grande résistance possible. Dans les deux figures 16 et 17, il est évident que ces boudins ménagés, comme autant de nerfs, entre des cavets, et ménagés dans les angles saillants, tendent à laisser à la pierre toute résistance en la faisant paraître légère comme le serait un faisceau de baguettes. Le raisonnement est donc intervenu pour beaucoup dans le tracé de ces profils. D'ailleurs, il est non moins évident que l'architecte a soumis son raisonnement à un certain sentiment de la forme, des rapports entre les pleins et les vides, des effets; mais la méthode géométrique pour tracer ces profils est encore incertaine. Dans l'exemple (fig. 18), déjà cette méthode géométrique se développe. On voit que dans cette figure, le tracé A établit la ligne à 45 °, et le tracé B la ligne à 60°, comme limites de la partie résistante de la pierre; les boudins n'étant plus alors qu'un supplément de résistance en même temps qu'une apparence d'allégissement.
Dans la figure 19, la méthode géométrique du tracé se complète, se perfectionne; les lignes à 45° et à 60° reçoivent, sans exception, tous les centres des boudins, et le principe de résistance de l'arc-doubleau comme des arcs ogives est le même cependant que celui admis dans l'exemple (fig. 18). Les évidements, trop prononcés peut-être pour ne pas altérer la force de la pierre dans l'exemple (fig. 18), sont, dans la figure 19, remplis par des baguettes qui, tout en produisant à l'oeil un effet très-vif, laissent à la pierre tout son nerf.

Voyons maintenant comment, vers 1230, les architectes bourguignons procédaient dans le tracé de profils d'arcs de voûtes remplissant le même objet que les précédents; comment la différence de qualité des matériaux employés, le sentiment propre à cette province, faisaient interpréter les méthodes déjà admises dans l'Ile-de-France. Voici (fig. 20), en A, un arc-doubleau de bas côté; en B, une archivolte; en C, un arc-doubleau de grande voûte; en DD', des arcs ogives, et en E, un formeret de l'église de Semur en Auxois 361.
Pour l'arc-doubleau A, la ligne ab est à 45°, la ligne cd à 30°. Tous les centres sont posés sur ces lignes. La ligne de base du profil ef ayant été divisée en cinq parties, une de ces parties a donné le diamètre du cavet inférieur et du boudin inférieur a. Ici, les courbes sont larges, les évidements prononcés, les matériaux très-résistants (pierre de Pouillenay), se prêtant à des tailles profondes et puissantes. Dans l'archivolte B, les centres des cavets et boudins sont posés sur des lignes à 60°. Dans l'arc-doubleau C et les arcs ogives DD', les centres sont posés sur des lignes à 45°. Dans le formeret E, sur une ligne à 60°. La largeur de ces profils contraste avec la délicatesse et la recherche de ceux adoptés dans l'église de Saint-Denis, bien que l'église de Semur en Auxois soit d'une dimension petite, relativement à celle de l'abbaye du domaine royal. La méthode des tracés est encore incertaine quant aux détails, et procède beaucoup du sentiment, quoique, pour la donnée générale, elle se conforme aux éléments établis dans l'Île-de-France; mais dans l'architecture de Bourgogne, soit qu'il s'agisse de la structure, de la composition des masses, des profils ou de l'ornementation, on remarque toujours une certaine liberté, une hardiesse et une part considérable laissée au sentiment, qui donnaient à cette école un caractère particulier.
Les architectes bourguignons reconnaissent les règles et les méthodes de l'école laïque de l'Île-de-France, mais ils les soumettent à leur caractère local. Ils admettent la grammaire et la syntaxe, mais ils conservent des tournures et une prononciation qui leur sont propres.
La grande école clunisienne et la nature des matériaux calcaires du pays laissaient une trace ineffaçable de leur influence sur les formes de l'architecture bourguignonne du XIIIe siècle. Il en est tout autrement en Champagne: dans cette province, les matériaux sont d'une faible résistance, rares sur une grande partie du territoire, et ne pouvant permettre des hardiesses de tracés. Aussi les profils de l'architecture de Champagne, dès l'époque romane et à dater du commencement du XIIIe siècle, sont bas, petits d'échelle, timides, si l'on peut ainsi parler, s'encombrent de membres secondaires et redoutent les évidements. Il est intéressant d'observer comme, dans une partie de cette province qui est située sur les lisières de la Bourgogne et de la Champagne, à Sens, l'architecte de la salle synodale a cherché à concilier les tracés de l'Île-de-France avec ceux de la Champagne. La salle synodale, bâtie vers 1245, par un architecte du domaine royal, emprunte à la Champagne certaines dispositions de structure propres à cette province, à la Bourgogne certaines partie de l'ornementation, à l'Île-de-France les profils, mais en les modifiant cependant quelque peu d'après les données champenoises. Cette tendance vers une fusion le fait hésiter; il prétend continuer les profils français en leur donnant plus de plénitude, suivant la méthode champenoise.

Ainsi (fig. 21) il trace les arcs-doubleaux et les arcs ogives des voûtes de la grande salle du premier étage A, en renforçant le boudin inférieur 362. Ce boudin inférieur est tracé, comme le montre notre figure, au moyen de deux centres aa'. Pour dissimuler la rencontre obtuse des deux cercles, il fait saillir le filet b. Du point a', élevant une ligne a'c à 45º, il pose sur cette ligne le centre c du second boudin. Du centre c, tirant une ligne cd à 30º, et du point e fixé, abaissant une ligne ed à 60º, il obtient le point d, centre du cavet supérieur. Du même centre c, abaissant une ligne cf à 60º, il obtient le filet g, et sur cette ligne le centre f du cavet inférieur, dont la courbe vient mordre celle du gros boudin. Il rachète l'angle h par un arc de cercle dont le centre est posé en i. Ce profil prend un galbe trapu qui n'appartient pas à l'architecture de l'Île-de-France, mais il est d'ailleurs étudié avec soin, et prend, en exécution, un aspect résistant et ferme. Grâce au filet b qui détruit la jonction des deux cercles aa', ces deux courbes ne paraissent être qu'une portion de cercle; mais pour ne pas trop développer à l'oeil ce membre important, le cavet inférieur l'entame et lui enlève sa lourdeur. Le traceur a ainsi obtenu plus de force, sans donner à son profil un aspect moins léger.
Mais tous les traceurs ne procèdent pas avec cette finesse. En Normandie et dans le Maine, les profils, tout en étant tracés suivant les méthodes que nous venons d'indiquer, accusent une tendance vers l'exagération des effets et un défaut dans les rapports de proportion. Un artiste du Maine tracerait ce profil d'arc ainsi qu'il est indiqué en B. Il accuserait l'intersection k; il donnerait une courbe au filet l; il exagérerait la saillie du filet inférieur m, ou bien, comme l'indique le profil C, il flanquerait le gros boudin inférieur d'une baguette n, ou même d'un filet latéral o, et retrouverait des arrêts, des listels et des angles en pq, en diminuant le rayon du second boudin. Cette tendance à l'exagération des cavets, à la multiplicité des membres anguleux, se développe surtout en Angleterre dès le milieu du XIIIe siècle. Les profils de cette contrée et de cette époque se chargent d'une quantité de tores, de listels, d'évidements profonds; mais les méthodes de tracés ne varient guère: ce qui prouve qu'une méthode en architecture est un moyen qui permet à chacun, d'ailleurs, de suivre son goût et son sentiment. Supprimez la méthode dans le tracé des profils de l'architecture dite gothique, et l'on tombe dans un chaos d'incertitudes et de tâtonnements. La fantaisie est maîtresse, et la fantaisie dans un art qui doit tant emprunter à la géométrie ne peut produire que des formes sans nom. N'est-ce pas la méthode qui donne aux profils de l'architecture, à dater du XIIe siècle, en France, une physionomie si saisissante, un style si particulier, qu'on ne saurait prendre un tracé de 1200 pour un tracé de 1220, qu'on ne pourrait confondre une moulure bourguignonne avec une moulure champenoise? Supposons qu'une méthode géométrique n'existe pas, comment tracer un de ces profils, à quel point s'attacher, où commencer, où finir? Comment donner à tous ces membres un rapport, une harmonie? Comment les souder entre eux? et que de temps perdu à tâter le mieux dans le vague! Nous avons vu souvent de nos confrères chercher des tracés de profils à l'aide du sentiment seul, sans, au préalable, s'enquérir d'une méthode; s'ils étaient soigneux, combien ne revenaient-ils pas sur un trait, sans jamais être assuré d'avoir rencontré le bon?
Voyons maintenant comment, en Champagne, les architectes, toujours en suivant la méthode des angles à 45º, à 60º ou 30º, pour le tracé des profils d'arcs, arrivent à donner à ces profils un caractère qui appartient à leur génie et qui s'accorde avec la nature des matériaux employés.
À Troyes, la pierre mise en oeuvre dans l'église de Saint-Urbain, qui date de la fin du XIIIe siècle, est du calcaire de Tonnerre, fin, compacte, résistant, mais fier, comme disent les tailleurs de pierre, c'est-à-dire qui se brise facilement, soit en le travaillant, soit lorsqu'il est posé avec des évidements profonds. L'habile architecte de l'église de Saint-Urbain, si souvent mentionnée dans le Dictionnaire, connaît bien la nature des matériaux qu'il emploie. Il sait qu'il ne faut point trop les évider, s'ils ont une charge à porter; que pour les boudins des arcs, par exemple, il ne faut pas les détacher par des cavets trop creux; cependant il prétend élever un édifice d'un aspect léger, remarquable par la délicatesse de ses membres.

Voici donc comme il tracera en A (fig. 22), les archivoltes de la nef 363. Comme dans l'exemple précédent, il donnera au boudin inférieur deux centres a et a', un nerf b dont les contre-courbes auront leurs centres posés sur les lignes ac, a'c', tracées à 60º; le rayon cb étant égal au rayon ab. De l'un des centres a, il élèvera une ligne ad à 45º. Sur cette ligne, il posera le centre e du deuxième boudin. Mais observons que l'architecte doit bander ces archivoltes au moyen de deux rangs de claveaux, plus un formeret pour la voûte du collatéral. Le deuxième boudin, de 0m,108 de diamètre (4 pouces), est tangent aux lignes d'épannelage du second claveau; sa position est donc fixée. Du centre e, tirant deux lignes à 30º et 60º, la rencontre de ces deux lignes avec celles d'épannelage lui donne les centres des contre-courbes du filet f. L'horizontale tirée de ce centre, et rencontrant la ligne verticale d'épannelage, lui donne en g le centre du cavet h. La verticale fg prolongée lui donne le filet surmontant ce cavet. Il trace alors le cavet supérieur i, dont le centre est sur la verticale dj. Ce centre est au niveau de celui de la baguette k. Sur le claveau inférieur de 0m,31 de largeur, pour obtenir le listel l assez fort pour résister à la pression, il élève du centre a' une ligne à 45º ao. Du point de rencontre de cette ligne avec le cercle du boudin, tirant une horizontale, il pose le centre de la baguette p sur cette horizontale, en prenant la ligne à 45º comme tangente. Cette baguette remplit l'évidement qui serait trop prononcé en q, et même, dans la crainte que l'évidement restant s ne soit trop aigre, il trace la deuxième baguette s, dont le centre est posé sur la ligne à 45º. C'est la même crainte des évidements qui lui fait tracer, sur le deuxième claveau, la baguette t. Les baguettes k, t, p, ont de diamètre 0m,04 (1 pouce 1/2); celle s, 1 pouce. Le tracé du formeret s'explique de lui-même. À l'aide de ces baguettes, le traçeur a supprimé les évidements dangereux, et il a cependant obtenu l'effet désirable en ce que les membres principaux, les boudins, nervés d'ailleurs par les filets saillants, prennent leur saillie et leur importance par la proximité des membres grêles et des lignes noires qui les cernent. Placer une moulure très-fine, une baguette d'un faible diamètre à côté d'un tore ou d'un boudin, c'est donner à celui-ci une valeur qu'il n'aurait pas s'il était isolé. Les Grecs, dans le tracé de leurs profils, avaient bien compris cette règle et l'avaient appliquée. C'est par les contrastes qu'ils donnaient de la valeur aux moulures, bien plus que par leur dimension réelle.
Le tracé des arcs ogives de l'église de Saint-Urbain, donné en B et en C, n'est pas moins remarquable. Celui B devait être résistant, les évidements sont remplacés par des baguettes; celui C, ne recevant aucune charge, pouvait être plus évidé. On voit comme la méthode de tracé de ces deux profils est simple, obtenue entièrement par l'intersection des lignes à 30º, 60º et 45º. Dans l'exemple C, les deux lignes à 60º donnent exactement la résistance de la pierre, les membres laissés tous en dehors. Dans la même église et dans d'autres édifices de la même époque, en Champagne, on voit apparaître le tracé D pour les boudins inférieurs des arcs. Le triangle abc étant équilatéral, et par conséquent les lignes ba, ca, à 60º.
Dans le profil de l'archivolte A, non-seulement le boudin inférieur est nervé, mais les boudins latéraux le sont également. En multipliant les membres, en remplaçant les évidements par des baguettes, on sentait la nécessité de donner plus d'énergie aux membres principaux, et les filets formant nerfs, en arrêtant vivement la lumière, permettent d'obtenir ce résultat.
Les architectes de l'Île-de-France ne se décident pas volontiers à recourir à ces nerfs saillants; s'ils les emploient pour les boudins inférieurs, dès la fin du XIIe siècle, anguleux d'abord, puis à contre-courbes et à filets plus tard, ils ne les adoptent pour les boudins latéraux des arcs que fort rarement avant le milieu du XIVe siècle. Ces architectes semblent prendre à tâche de simplifier les méthodes géométriques qu'ils ont les premiers appliquées. L'église de Saint-Nazaire de Carcassonne nous fournit un exemple bien frappant de ce fait. Cette église, dont la construction est élevée entre les années 1320 et 1325, donne des tracés d'arcs-doubleaux et d'arcs ogives, procédant toujours du système développé plus haut, mais avec des simplifications notables.

Dans le profil A d'arc-doubleau (fig. 23), le boudin inférieur (5 pouces-1/2 de diamètre) étant tracé, de son centre a, la ligne à 45º ab a été élevée jusqu'à sa rencontre avec la verticale cb, limite du profil. L'angle cba a été divisé en deux parties par la ligne be. Tenant compte de la saillie du nerf, sur cette ligne a été posé le centre f du boudin (4 pouces de diamètre); le rayon du cavet est égal à celui du boudin et est placé en g. Le centre h du grand cavet est posé sur la ligne à 45º. Pour tracer les nerfs à contre-courbes, on a tracé les triangles équilatéraux aij; flm. La même méthode, avec des différences sensibles que la figure fait assez comprendre, a été employée pour le tracé des arcs ogives et des arcs-doubleaux B, C, E, F. N'oublions pas que cette église fut construite après que la ville de Carcassonne fut comprise dans le domaine royal, et par un architecte de la province de l'Île-de-France très-certainement, ainsi que tous les détails de l'architecture le prouvent. Ici les nerfs saillants apparaissent sur les boudins latéraux, mais seulement dans les deux exemples A et F.
Tous ces profils sont tracés au dixième de l'exécution.
[Закрыть]
Pour les boudins inférieurs des arcs-doubleaux de la sainte Chapelle de Paris, par exemple.
[Закрыть]
Théorie du module, par M. Aurès, ingénieur en chef des ponts et chaussées.--Études des dimensions de la colonne Trajane, par le même; etc.
[Закрыть]
Ces profils sont, comme les précédents, tracés au dixième de l'exécution.
[Закрыть]
Ce tracé est au cinquième de l'exécution.
[Закрыть]
Au dixième de l'exécution.
[Закрыть]