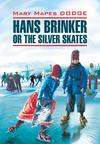Kitabı oku: «Histoire du Canada depuis sa découverte jusqu'à nos jours. Tome II», sayfa 12
Les revers de la guerre de la succession d'Espagne et le traité d'Utrecht, ont précipité la chute de la puissance française en Amérique, quoique cette chute ait été produite par d'autres causes, comme on l'a dit plus d'une fois ailleurs.
Par le traité fameux auquel nous venons de faire allusion, et qui fut signé le 11 avril 1713, Louis XIV céda à l'Angleterre la baie d'Hudson, l'île de Terreneuve et l'Acadie, c'est-à-dire tous les pays situés sur le littoral de la mer Atlantique, sur laquelle il ne resta plus à la France que l'embouchure du St. – Laurent et celle du Mississipi dans la baie du Mexique; elle se réserva seulement le droit de faire sécher le poisson sur une partie de l'île de Terreneuve. On peut juger, dit Raynal, combien ces sacrifices marquaient son abaissement, et combien il en dut coûter à sa fierté de céder trois possessions qui formaient avec le Canada, l'immense pays connu sous le nom glorieux de Nouvelle-France.
Les historiens français nous ont laissé un tableau fidèle de cette époque célèbre, et des causes de la grandeur et des revers de Louis XIV. Pendant près de quarante ans, il avait dominé l'Europe conjurée après l'avoir vaincue dans trois guerres longues et sanglantes. Cette période avait été illustrée par de grands génies en tous genres, et par les plus grands capitaines que les modernes eussent encore vus.
«L'Europe, dit un historien célèbre, s'était armée contre lui, et il avait résisté, il avait grandi encore. Alors il se laissa donner le nom de grand. Le duc de La Feuillade alla plus loin. Il entretint un luminaire devant sa statue, comme devant un autel. On croit lire l'histoire des empereurs romains.
«La brillante littérature de cette époque n'est autre chose qu'un hymne à la royauté. La voix qui couvre les autres est celle de Bossuet. C'est ainsi que Bossuet lui-même, dans son discours sur l'Histoire Universelle, représente les rois d'Egypte loués par le prêtre dans les temples en présence des dieux. La première époque du grand règne, celle de Descartes, de Port-Royal, de Pascal et de Corneille, n'avait pas présenté cette unanimité; la littérature y était animée encore d'une verve plus rude et plus libre. Au moment où nous sommes parvenus, Molière vient de mourir en (1673), Racine a donné Phèdre (1677), La Fontaine publie les six derniers livres de ses Fables (1678), madame de Sévigné écrit ses Lettres, Bossuet médite la connaissance de Dieu et de soi-même, et prépare le discours sur l'Histoire Universelle (1681). L'abbé de Fénélon, jeune encore, simple directeur d'un couvent de filles, vit sous le patronage de Bossuet, qui le croit son disciple. Bossuet mène le choeur triomphal du grand siècle, en pleine sécurité du passé et de l'avenir, entre le jansénisme éclipsé et le quiétisme imminent, entre le sombre Pascal et le mystique Fénélon. Cependant le cartésianisme est poussé à ses conséquences les plus formidables; Mallebranche fait rentrer l'intelligence humaine en Dieu, et tout-à-l'heure dans cette Hollande protestante en lutte avec la France catholique, va s'ouvrir pour l'absorption commun du catholicisme, du protestantisme, de la liberté, de la morale de Dieu et du monde, le gouffre sans fond de Spinosa». La première dans le domaine de l'esprit, la France ouvrit aussi les portes du 18e siècle, comme la première dans celui du courage; elle allait couronner ses triomphes en faisant monter un de ses princes sur le trône d'Espagne. Mais elle n'avait plus pour diriger ses efforts qu'un vieux roi sur son déclin et une femme qu'il avait épousée pour dissiper la tristesse d'une vie dont il avait épuisé toutes les jouissances. Les hommes illustres qui l'avaient couverte de tant de gloire, n'existaient plus. Les esprits perspicaces voyaient avec inquiétude le pays entrer dans une nouvelle guerre. Louis XIV, devenu dévot sur ses vieux jours, vivait retiré, ne connaissait plus si bien les hommes; dans sa solitude les choses ne lui parurent plus sous leur véritable aspect. Madame de Maintenon n'avait point non plus le génie qu'il faut pour manier le sceptre d'un royaume tel que celui de France dans un temps d'orages. Et elle fit la faute de nommer Chamillard, sa créature, pour être premier ministre, homme qui malgré son honnêteté était fort au-dessous de cette vaste tâche 66.
Note 66:(retour) «Chamillard était dirigé par madame de Maintenon, dit quelqu'un, madame de Maintenon par Babbien, sa vieille servante».
Dès lors les généraux furent mal choisis et durent souvent leur nomination à la faveur; la discipline militaire tomba dans un relâchement funeste, et les opérations des armées furent dirigées par le roi et Chamillard du fond du cabinet de madame de Maintenon. Tout se ressentit de ce système malheureux; la France fut ainsi conduite en quelques années du comble de la gloire au bord de l'abîme.
Le traité d'Utrecht qui blessa si profondément l'amour propre des Français, porta le premier coup à leur système colonial. A la fin du ministère de Colbert, leurs possessions en Amérique s'étendaient depuis la baie d'Hudson jusqu'au Mexique, en suivant les vallées du St. – Laurent et du Mississipi, et renfermaient dans leurs limites cinq des plus grands lacs, ou plutôt cinq des plus grandes mers intérieures, et deux des plus grands fleuves du monde.
Par le traité d'Utrecht ils perdirent de vastes territoires, moins précieux encore par leur fertilité que par l'importance de leurs côtes maritimes. Ils se trouvèrent dans le nord du nouveau continent tout à coup éloignés, exclus en quelque sorte de l'Atlantique. Les colonies américaines ont contribué beaucoup à briser le réseau immense que la France avait jeté autour d'elles. On assure que leurs coups ne se dirigeaient pas alors exclusivement contre cette nation, qu'elles confondaient déjà dans le secret de leur pensée la métropole française et la métropole anglaise, et qu'elles les regardaient l'une et l'autre comme deux ennemies naturelles et irréconciliables de la cause américaine. Si c'était là l'objet de leur conduite, on doit avouer que ces colonies montraient à la fois une prévoyance profonde, et une grande puissance de dissimulation 67. Trop faibles pour marcher ouvertement et au grand jour, et pour surmonter de force les entraves qui devaient nécessairement les arrêter, à chaque pas, elles cheminaient vers leur but par des routes cachées; le système colonial de l'Europe mettait un obstacle insurmontable à leur indépendance. «Les colons anglais, dit Bancroft, n'étaient pas simplement les colons de l'Angleterre, ils formaient partie d'un immense système colonial que tous les pays commerciaux de l'Europe avaient contribué à former, et qui enserrait dans ses bras puissans toutes les parties du globe. La question de l'indépendance n'aurait pas été une lutte particulière avec l'Angleterre, mais une révolution dans le commerce et dans la politique du monde, dans les fortunes actuelles et encore plus dans l'avenir des sociétés. Il n'y avait pas encore d'union entre les établissemens qui hérissaient le bord de l'Atlantique, et une seule nation en Europe aurait, à cette époque, toléré, mais pas une n'aurait favorisé, une insurrection. L'Espagne, la Belgique espagnole, la Hollande et l'Autriche étaient alors alliées à l'Angleterre contre la France, qui, par la centralisation de sa puissance et par des plans d'agrandissement territorial habilement conçus, excitaient l'inquiétude de ces nations, qui craignaient de la voir parvenir à la monarchie universelle. Lorsque l'Autriche et la Belgique auraient abandonné leur guerre héréditaire contre la France, lorsque l'Espagne et la Hollande, favorisées par la neutralité armée du Portugal, de la Suède, du Danemark, de la Prusse et de la Russie, se réuniraient à la France pour réprimer l'ambition commerciale de l'Angleterre, alors, mais pas avant, l'indépendance américaine devenait possible.»
Note 67:(retour) Ramsay, auteur d'une Histoire de la révolution américaine, attribue cet événement au changement de politique de la Grande-Bretagne, qui commença à faire peser en 1764, une dure oppression sur ses colonies. Quelques uns pensent, dit-il, que la révolution a été excitée par la France; d'autres que les colons, une fois délivrés du dangereux voisinage de cette nation, ne songèrent plus qu'à obtenir leur indépendance; mais, suivant lui, l'égoïsme du coeur humain est suffisant pour expliquer les motifs de la conduite des colons et de la métropole, sans recourir à ces opinions.
Ces raisons expliqueraient, suivant le même auteur, les motifs de l'ardeur que les colonies anglaises mettaient dans les guerres contre la France; elles voulaient rompre le système qui enchaînaient les colons au joug de l'Europe; et l'Europe, trompée par de faux calculs, aveuglée par des jalousies et des rivalités funestes, travaillait elle-même à l'accomplissement de leur projet. Tels sont les profonds calculs que l'on prête aux pères de l'indépendance américaine. Probablement que l'on a exagéré la clairvoyance des vieilles colonies. Nous ne pensons pas, nous, qu'elles eussent déjà à cette époque pressenti si clairement leur avenir. Une espèce d'heureux instinct, comme une inspiration du génie, éclairait leur politique, à laquelle d'ailleurs la liberté était un sûr flambeau, et les conduisait comme par une pente naturelle là où elles devaient aboutir. Mais l'on doit être très sobre dans les jugemens que l'on porte sur les motifs de conduite des peuples à leur berceau. «Rien n'est plus commun, dit Michaud dans son bel ouvrage de l'Histoire des Croisades, que d'attribuer à des siècles reculés les combinaisons d'une profonde politique. Si l'on en croyait certains écrivains, c'est à l'enfance des sociétés qu'appartiendrait l'expérience 68. Les colonies anglaises étaient dans cette voie où la providence met les peuples auxquels elle prépare une grande destinée. Le traité d'Utrecht, en satisfaisant une partie de leurs désirs, augmentait leurs espérances futures. Aussi jetèrent-elles un cri de triomphe lorsqu'elles virent tomber les trois plus anciennes branches de l'arbre colonial français. Cet arbre resta comme un tronc mutilé par la foudre; mais on verra que ce tronc vigoureux, enfoui dans les neiges du Canada, était encore capable de lutter contre de rudes tempêtes et d'obtenir de belles victoires.
Note 68:(retour) Il rappelle à ce sujet l'opinion de Montesquieu: «Transporter dans les siècles reculés toutes les idées du siècle où l'on vit, c'est des sources de l'erreur celle qui est la plus féconde. A ces gens qui veulent rendre modernes tous les siècles anciens, je dirai ce que les prêtres d'Egypte dirent à Solon: O Athéniens! vous n'êtes que des enfans.»
CHAPITRE III.
COLONISATION DU CAP-BRETON.
1713-1744
Motifs qui engagent le gouvernement à établir le Cap-Breton. – Description de cette île à laquelle on donne le nom d'Ile-Royale. – La nouvelle colonie excite la jalousie des Anglais. – Projet de l'intendant, M. Raudot, et de son fils pour en faire l'entrepôt général de la Nouvelle-France, en 1706. – Fondation de Louisbourg par M. de Costa Bella. – Comment la France se propose de peupler l'île. – La principale industrie des habitans est la pêche. – Commerce qu'ils font. – M. de St. – Ovide remplace M. de Costa Bella. – Les habitans de l'Acadie, maltraités par leurs gouverneurs et travaillés par les intrigues des Français, menacent d'émigrer à l'Ile-Royale. – Le comte de St. – Pierre forme une compagnie à Paris en 1719, pour établir l'île St. – Jean voisine du Cap-Breton; le roi concède en outre à cette compagnie les îles Miscou et de la Magdeleine. L'entreprise échoue par les divisions des associés.
Le traité d'Utrecht arracha des mains débiles et mourantes de Louis XIV les portes du Canada, l'Acadie et l'île de Terreneuve. De ce traité trop fameux date le déclin de la monarchie française, qui marcha dès lors précipitamment vers l'abîme de 1792. La nation humiliée parut cependant vouloir faire un dernier effort, pour reprendre en Amérique la position avantageuse qu'elle venait de perdre, et elle projeta un système colonial plus vaste encore que celui qui existait avant la guerre, et dont l'heureuse terminaison de la découverte du Mississipi, favorisa l'exécution. En cela le peuple français montrait qu'il n'avait rien perdu lui-même de son esprit d'entreprise ni de son énergie; mais le gouvernement n'avait plus la force ni les moyens de le protéger suffisamment dans une pareille oeuvre. D'ailleurs les circonstances étaient telles qu'il fallait tout sacrifier à l'existence du gouvernement et de la dynastie. Louis XIV n'avait-il pas, par le traité d'Utrecht, acheté le trône d'Espagne pour sa famille au prix de plusieurs de ses colonies, c'est-à-dire, en violant l'intégrité du royaume?
La perte des deux provinces du golfe St. – Laurent, laissait le Canada exposé du côté de l'Océan aux attaques de la puissance qui le touchait déjà du côté de la terre; de sorte qu'en cas d'hostilités celle-ci pouvait empêcher tout secours extérieur d'y parvenir, et le séparer ainsi de sa métropole. Il était donc essentiel tant sous le point de vue défensif, que pour conserver nos pêcheries et avoir un lieu de relâche dans ces parages orageux, de changer une situation si compromettante pour la domination française dans cette partie du monde. Il nous restait encore dans ces lieux, entre autres îles, celle du Cap-Breton, située entre l'Acadie et Terreneuve les deux provinces cédées. Cette île qu'on avait méprisée jusqu'alors, et que l'on était bien aise aujourd'hui de trouver, quoiqu'elle fût très exposée, pouvait devenir comme une double épine dans le flanc des nouvelles acquisitions anglaises qu'elle séparait en deux. On planta le drapeau français sur ses rives désertes, on commença à y édifier des fortifications considérables et qui annonçaient la volonté de protéger efficacement l'entrée de la vallée du St. – Laurent. Ces travaux et l'importance que le Cap-Breton prit tout à coup en France, attirèrent l'attention de sa rivale. L'Angleterre qui avait cru, en s'emparant de l'Acadie et de toute l'île de Terreneuve, porter un coup mortel à la Nouvelle-France, vit avec surprise envelopper entièrement ses colonies, et s'élever depuis les côtes du Cap-Breton jusqu'aux sables de Biloxi, une ceinture de forts dont les canons menaçaient tous les points de leurs vastes frontières. Cette attitude inattendue lui inspira un étonnement mêlé de crainte. Maîtresse des deux plus grands fleuves de l'Amérique septentrionale, fleuves qui lui assuraient la plus grande partie de la traite avec les Sauvages, régnant sur deux vallées fertiles de mille à douze cents lieues de développement, dans lesquelles l'on trouve les productions de tous les climats, la France pouvait acquérir en peu d'années assez de force pour y être inexpugnable. La jalousie de la Grande-Bretagne et la politique prévoyante de ses colonies, qui, dans leur anticipation d'indépendance future, ne désiraient que de voir s'affaiblir le lien d'intérêt commun qui unissait les métropoles ensemble lorsqu'il s'agissait de tenir les colons dans la sujétion, se promirent bien chacune avec ses motifs à elle propres, de réunir, à la première rupture, leurs efforts contre le nouveau poste français du Cap-Breton. Ce poste s'était ainsi suscité, par le fait de sa création, dès en naissant, un ennemi redoutable. La cour de Versailles avait prévu cette hostilité, et ses plans pour y faire face étaient excellens; mais la langueur dans laquelle le monarque du Parc aux Cerfs laissait tomber sa puissance au milieu des débauches, ne permit point de les mettre complètement à exécution: la décrépitude fut la cause des désastres dont cette île devint le théâtre avant de passer aux mains de l'étranger.
Le Cap-Breton, situé au midi de l'île de Terreneuve, dont il est séparé par une des bouches du golfe St. – Laurent de 15 à 16 lieues de large, a, au sud, le détroit de Canseau d'une lieue de traverse à la péninsule acadienne; et à l'ouest l'île St. – Jean (ou du Prince-Edouard). Sa longueur n'est pas tout à fait de 50 lieues. Sa figure à peu près triangulaire est fort irrégulière cependant, et le pays est tellement entrecoupé de lacs et de rivières que les deux parties principales ne tiennent ensemble que par un isthme d'environ 800 verges, qui sépare le port de Toulouse où est situé St. – Pierre, de plusieurs lacs assez considérables dont le plus grand s'appelle Le Bras d'Or. Ces lacs se déchargent au nord-est dans la mer.
Le climat y ressemble à celui de Québec, excepté que le froid y est moins vif à cause du voisinage de l'Océan. Quoique les brumes et les brouillards y soient fréquens, l'air n'y est pas malsain. Elle était couverte de chênes, de pins, d'érables, de planes, de cèdres, de trembles, &c., tous bois propres à la construction. Son sol est susceptible de toutes les productions du bas St. – Laurent, et les montagnes y ayant leur pente au sud, peuvent être cultivées jusqu'à leur sommet. La chasse et la pêche y étaient très abondantes. Elle renferme des mines de charbon de terre et de plâtre, dont une partie amoncelée par bancs au-dessus du sol, était en conséquence plus facile à exploiter que celle qu'il faut aller chercher, comme aujourd'hui, dans les entrailles de la terre.
Il y a un grand nombre d'excellens ports, tous situés du côté de la pleine mer. Les plus beaux sont celui de Ste. – Anne, celui de Louisbourg qui a près de quatre lieues de tour, et dans lequel on entre par un passage de moins de quatre cents verges formé par deux petites îles, et indiqué à la navigation par le cap Lorembec, dont on aperçoit la cime à douze lieues de distance; celui de Miray situé au nord de de l'île Scatari et que les gros vaisseaux peuvent remonter six lieues; et enfin celui des Espagnols, aujourd'hui Sidney, qui a une entrée d'environ mille pas de largeur, et qui allant toujours eu s'élargissant se partage, au bout d'une lieue, en deux bras de trois lieues de longueur assez profonds pour faire de très bons havres.
L'île du Cap-Breton n'avait été fréquentée jusque dans les dernières années, l'été, que par quelques pêcheurs qui y faisaient sécher leur poisson, et, l'hiver, que par des habitans de l'Acadie qui y passaient pour faire la traite des pelleteries avec les Indiens. Vers 1706 elle attira l'attention de M. Raudot, intendant de la Nouvelle-France, qui envoya conjointement avec son fils, au ministère un mémoire relatif à son établissement. Ce mémoire fort circonstancié nous donne une opinion très favorable des connaissances de cet administrateur; et il est fâcheux que la direction du commerce canadien n'ait pas toujours été dans des mains aussi expérimentées. Mais il est vrai aurait-il été possible à un seul homme de neutraliser, pour le Canada, les effets de la politique européenne de la France; c'est-à-dire, d'empêcher que celle-ci en voulant maintenir sa supériorité sur terre, ne la perdît sur mer, ce qui entraînait la ruine de ses colonies.
L'intendant avait imaginé un nouveau plan pour le commerce de l'Amérique du Nord, dans lequel le Cap-Breton devait jouer un grand rôle en devenant l'entrepôt général de cette partie du monde. L'idée en était neuve et ingénieuse; mais elle était mise au jour dans le moment le moins favorable pour être bien accueillie. Néanmoins elle ne fut pas entièrement perdue comme on le verra plus tard.
Après s'être étendu sur les motifs qu'on avait eus d'établir le Canada et sur le commerce des pelleteries, le seul dont on se fût sérieusement occupé jusqu'alors, et auquel on avait tout sacrifié, ces deux administrateurs disaient que le temps était arrivé de donner une nouvelle base au négoce de la Nouvelle-France; que la traite des fourrures devenait de jour en jour moins profitable et cesserait tôt ou tard, que d'ailleurs elle répandait des habitudes vicieuses et vagabondes parmi la population, qui négligeait la culture des terres pour un gain trompeur. Ils faisaient ensuite une comparaison à ce sujet entre la conduite des Américains et la nôtre. Ceux-là, répétaient-ils, sans s'amuser à voyager si loin de chez eux comme nous, cultivent leurs terres, établissent des manufactures, des verreries, ouvrent de mines, construisent des navires et n'ont jamais regardé les pelleteries que comme un accessoire. Nous devons les imiter et nous livrer à un commerce plus avantageux et plus durable. Comme eux encourageons l'exportation des viandes salées, des bois de toutes sortes, du goudron, du brai, des huiles, du poisson, du chanvre, du lin, du fer, du cuivre, &c. A mesure que le chiffre des exportations s'élèvera, celui des importations suivra une marche ascendante proportionnelle; tout le monde sera occupé, les denrées et les marchandises seront abondantes, et par conséquent à meilleur marché; cette activité attirera l'émigration, augmentera les défrichemens, développera la pêche et la navigation, et répandra enfin une vie nouvelle dans tous les établissemens de cette contrée aujourd'hui si languissante. Ils démontraient par un raisonnement parfaitement conforme aux meilleurs principes de l'économie politique moderne, les avantages qui résulteraient de cet état de choses pour la France elle-même; car qu'on ne dise pas, ajoutaient-ils, que si le Cap-Breton tire du Canada une partie de ses denrées que la France peut lui fournir, c'est autant de défalqué du commerce du royaume; celui-là achètera d'autant plus de marchandises françaises qu'il vendra de produits, et plus les manufactures de France emploieront de bras, plus sa population augmentera et plus elle consommera de productions agricoles. Ils terminaient ce long document par insister avec force sur la nécessité de coloniser le Cap-Breton, de faire un dépôt général dans cette île qui se trouvait entre la mère-patrie et l'Acadie, Terreneuve et le Canada, et au centre des pêcheries. Cette île pourrait fournir de son cru, à la première, des morues, des huiles, du charbon de terre, du plâtre, des bois de construction, etc.; aux autres, des marchandises entreposées venant de France, qu'elle échangerait contre les denrées de ces diverses provinces. Il y a plus, observaient-ils encore, ce n'est pas seulement en augmentant la consommation des marchandises en Canada que l'établissement projeté serait utile au royaume, on pourrait aussi faire passer des vins, des eaux de vie, des toiles, du ruban, des taffetas, etc., aux colonies anglaises qui sont très peuplées et qui en achèteraient beaucoup, quand même ce négoce ne serait pas permis. En un mot M. Raudot voulait faire du Cap-Breton dans les limites des possessions françaises, ce que la Grande-Bretagne est aujourd'hui pour le monde, le centre du commerce. Si nous établissions maintenant un chemin de fer entre Halifax et l'extrémité supérieure du Canada, le projet de M. Raudot avec la variante cependant d'Halifax au lieu de Louisbourg, serait bien près de sa réalisation puisque la différence entre les deux entreprises ne tiendrait qu'à celle des circonstances diverses du transport entre ces deux époques. En 1706 l'entrepôt avait besoin de voies liquides pour recevoir et expédier dans toutes les directions les productions et les marchandises. Aujourd'hui un entrepôt peut être placé aussi bien au centre d'un continent qu'au sein d'une mer, parce que l'on peut sur terre faire rayonner des chemins de fer tout aussi bien que des vaisseaux sur l'Atlantique, et que la vapeur franchit les espaces même avec plus de rapidité sur le premier que sur le dernier élément. Ce projet, M. Raudot voulait en confier l'exécution, non à une compagnie toujours égoïste et sacrifiant sans cesse l'avenir au présent, mais au gouvernement qu'il priait de s'en charger, entrant dans les détails les plus minutieux pour lui en démontrer les facilités; mais la guerre que la France soutenait alors contre l'Europe entière et qui occupait toute l'énergie et toutes les forces du royaume, absorbant une partie de sa jeunesse et le trop-plein de la population, ne lui laissait ni le temps ni les moyens de penser à une pareille entreprise. Après la guerre cependant, les choses ayant subi des altérations profondes, la réalisation de ce projet devint non seulement utile, mais d'une absolue nécessité.
L'on commença par changer le nom du Cap-Breton pour lui donner celui d'Ile-Royale, qu'il n'a conservé que durant le temps qu'il est resté entre les mains des Français. L'on choisit ensuite pour quartier général le Havre à l'Anglais dont le nom fut aussi remplacé par celui de Louisbourg. Ce port situé au milieu d'un terrain stérile, ne pouvait être fortifié qu'à grands frais, parce qu'il fallait tirer les matériaux de fort loin. Bien des gens auraient préféré le port Ste. – Anne qui est plus spacieux, très facile à rendre presqu'imprenable, et entouré d'un pays abondant en marbre et en bois de commerce. M. de Costa Bella, qui venait de perdre son gouvernement de Plaisance cédé aux Anglais, fut chargé de commencer la nouvelle colonie et de jeter les fondemens de Louisbourg.
La France comptait moins sur l'émigration sortie de son sein pour peupler l'île et la ville qu'elle voulait fonder, que sur ses anciens sujets de l'Acadie et de Terreneuve. Elle crut que leur antipathie pour leurs nouveaux maîtres les engagerait à venir s'y établir; elle les y invita même ainsi que les Abénaquis, comme s'il eût été raisonnable d'espérer que des colons feraient plus de sacrifices pour augmenter la puissance de leur ancienne mère-patrie que cette mère-patrie elle-même. Les gouverneurs anglais, aveuglés par leurs préjugés religieux et nationaux, avaient d'abord mécontenté, par de mauvais traitemens, les Acadiens, qui, dans leur désespoir, menacèrent d'émigrer. Mais lorsque ces gouverneurs virent la France former un nouvel établissement à côté d'eux, ils se hâtèrent de changer de conduite et de rassurer les colons qui allaient les abandonner. C'est ainsi que la Grande-Bretagne se conduisit envers les habitans du Canada en 1774. Voyant ses anciennes colonies prendre les armes contre elle, elle s'empressa de leur assurer l'usage de leur langue et de leurs institutions nationales, pour les empêcher de joindre les rebelles et les engager à défendre sa cause. Plus tard cependant, lorsqu'elle crut n'avoir plus besoin d'eux, elle les sacrifia; et en cela elle ne fit que répéter ce qu'elle avait déjà fait à l'égard des malheureux Acadiens. Telle est la justice de la politique entre les mains de laquelle les colons, plus que tous autres, ne sont que des jouets, une marchandise.
Les Acadiens rassurés, comme on l'a dit, par les paroles des gouverneurs anglais, ne purent se résoudre à abandonner leurs terres sur lesquelles ils jouissaient d'une douce aisance, et se transmettaient depuis longtemps de père en fils les moeurs pures et patriarcales de leurs ancêtres. Il ne s'en trouva qu'un petit nombre qui voulût émigrer, les uns parce qu'ils ne pouvaient s'habituer au nouveau joug, les autres parce qu'ils avaient peu de chose à perdre en s'en allant; ils vinrent de Terreneuve et de l'Acadie s'établir à Louisbourg et en d'autres endroits de l'île, où ils formèrent de petits villages sans ordre et dispersés sur le rivage, chacun choisissant le terrain qui lui convenait pour la culture ou la pêche.
La ville de Louisbourg bâtie en bois sur une langue de terre qui s'avance dans la mer, atteignit une demi-lieue de longueur dans sa plus grande prospérité. Les rares maisons de pierre qu'on y voyait appartenaient au gouvernement. On y construisit des cales, c'est-à-dire des jetées, qui s'étendant au loin dans le port, servaient pour charger et décharger les navires. Comme le principal objet du gouvernement en prenant possession de l'Ile-Royale, était de s'y rendre inexpugnable, il commença à fortifier Louisbourg en 1720; il y dépensa des sommes énormes et qui dépassèrent trente millions. Il pensa que ce n'était pas trop pour protéger les pêcheries, pour assurer la communication de la France avec le Canada, pour ouvrir en temps de guerre un asile aux vaisseaux venant des Indes occidentales.
La principale industrie des habitans consistait dans la pêche. La traite des fourrures qui s'y faisait avec quelques Sauvages Micmacs était de peu de chose. Cependant le grand nombre d'ouvriers employés d'abord par le gouvernement, pour exécuter ses vastes travaux, et ensuite l'activité de la pêche portèrent graduellement la population de cette colonie à 4000 âmes. Cette population était employée sur la fin au commerce de la morue sèche. Les habitans les moins aisés, suivant Raynal, y employaient deux cents chaloupes et les plus riches cinquante goëlettes de trente à cinquante tonneaux. Les chaloupes ne quittaient jamais les côtes de plus de quatre ou cinq lieues; les goëlettes allaient jusque sur le grand banc de Terreneuve et dans l'automne portaient elles-mêmes leurs précieuses cargaisons en France ou dans les îles de l'archipel du Mexique. Dans le fait l'Ile-Royale n'était qu'une grande pêcherie; et sa population, composée en hiver des pêcheurs fixes, faisait plus que doubler en été par l'arrivée de ceux de l'Europe, qui s'éparpillaient sur les grèves pour faire sécher leur poisson. Elle recevait sa subsistance de la France ou des Antilles. Elle tirait de la première des vivres, des boissons, des vêtemens et jusqu'à ses meubles; elle faisait ses retours en envoyant de la morue dans une partie des vaisseaux qui lui apportaient ces marchandises, le reste allant faire la pêche pour se former une cargaison. Elle expédiait pour les Iles vingt ou vingt-cinq bâtimens de 70 à 140 tonneaux chargés de morue, de madriers, de planches, de merrain, de charbon de terre, de saumon, de maquereau salé, et enfin d'huile de poisson; elle en rapportait du sucre, du café, des rums et des sirops. Elle parvint à créer chez elle un petit commerce d'échange, d'importation et d'exportation. Ne pouvant consommer ce qu'elle recevait de France et des Iles, elle en cédait une partie au Canada et une autre plus considérable à la Nouvelle-Angleterre, qui venait les chercher dans ses navires et apportait en paiement des fruits, des légumes, des bois, des briques, des bestiaux, et par contrebande, des farines et même de la morue.