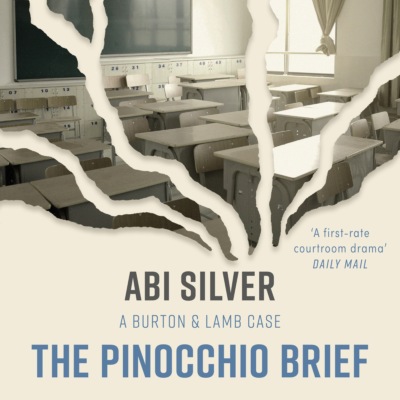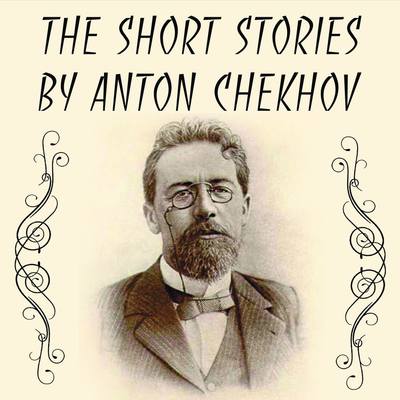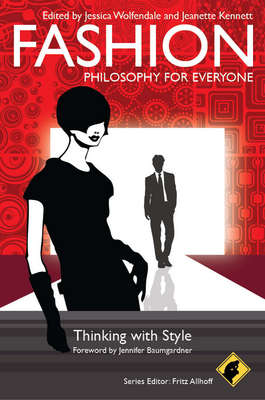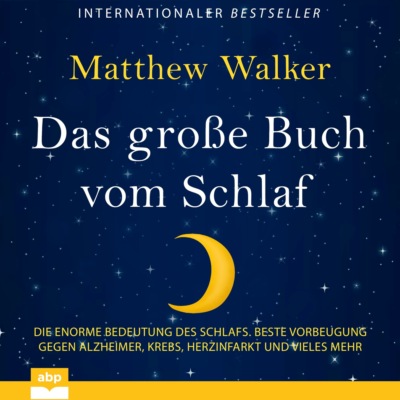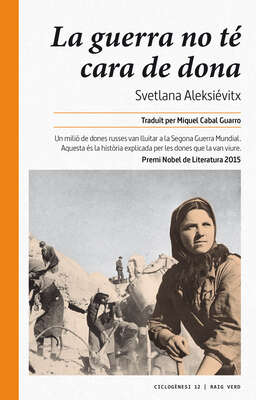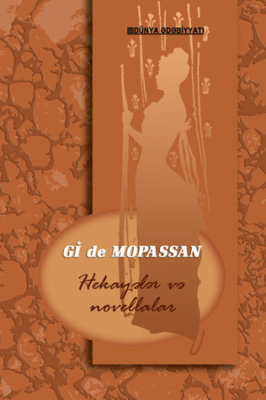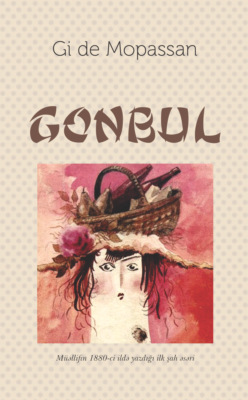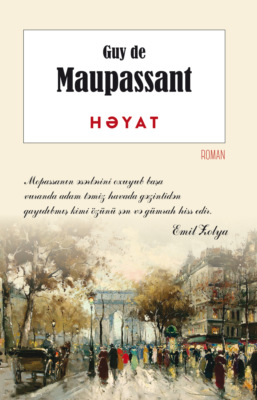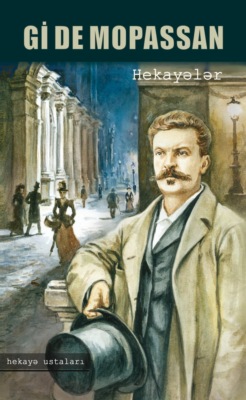Kitabı oku: «Oeuvres complètes de Guy de Maupassant, volume 08», sayfa 10
La nuit était venue, sans lune, toute noire, pleine des rumeurs du vent. Les mains étendues, je marchais en heurtant les grandes pierres dressées; et ce récit, le pays, mes pensées, tout avait pris un ton tellement surnaturel, que je n’aurais point été surpris de sentir tout à coup un korrigan courir entre mes jambes.
Le lendemain je me remis en route, traversant des landes, des villages, des villes, Lorient, Quimperlé, si jolie dans son vallon, Quimper.
La grand’route part de Quimper, monte une côte, coupe des vallées, passe une sorte de lac herbeux et morne, et pénètre enfin dans Pont-l’Abbé, la petite cité la plus bretonne de toute cette Bretagne bretonnante qui va du Morbihan à la pointe du Raz.
A l’entrée, un vieux château flanqué de tours, mouille le pied de ses murs dans un étang triste, triste, avec des vols d’oiseaux sauvages. Une rivière sort de là, que les caboteurs peuvent remonter jusqu’à la ville. Et dans les rues étroites aux maisons séculaires, les hommes portent le chapeau aux bords immenses, le gilet brodé magnifiquement, et les quatre vestes superposées: la première grande comme la main, couvrant au plus les omoplates, et la dernière s’arrêtant juste au-dessus du fond de culotte.
Les filles, grandes, belles, fraîches, ont la poitrine écrasée dans un gilet de drap qui forme cuirasse, les étreint, ne laissant même pas deviner leur gorge puissante et martyrisée. Et elles sont coiffées d’une étrange façon. Sur les tempes, deux plaques brodées en couleur encadrent le visage, serrent les cheveux qui tombent en nappe, puis remontent se tasser au sommet du crâne sous un singulier bonnet, tissu souvent d’or et d’argent.
Et la route sort de nouveau de cette petite cité du moyen âge oubliée là. Elle s’avance à travers la lande piquée d’ajoncs. De temps en temps, trois ou quatre vaches paissent le long du chemin, toujours accompagnées d’un mouton. Pendant plusieurs jours, on se demande pourquoi on ne voit jamais de vaches sans un mouton. Cette question vous tracasse, vous harcèle, devient une obsession. On cherche alors un homme près de qui s’informer. On le trouve, non sans peine, car souvent pendant une semaine entière, en rôdant par les villages, on ne rencontre personne qui sache un mot de français. Enfin quelque curé, qui lit son bréviaire en marchant à pas mesurés, vous apprend avec politesse que ce mouton constitue la part du loup.
Un mouton vaut moins qu’une vache, et, comme sa prise n’offre aucun danger, le loup toujours le préfère. Mais il arrive souvent que les vaillantes petites vaches forment le bataillon carré pour défendre leur innocent camarade, et reçoivent au bout de leurs cornes affilées la bête hurlante en quête de chair vive.
Le loup! Là aussi on le retrouve, ce loup légendaire qui terrifia notre enfance, le loup blanc, le grand loup blanc que tous les chasseurs ont vu et que personne n’a jamais tué.
Jamais on ne l’aperçoit au matin. C’est vers cinq heures en hiver, au moment où le soleil se couche, qu’il apparaît filant sur une cime dénudée, traînant sur le ciel sa longue silhouette qui passe et fuit.
Pourquoi personne ne l’a-t-il tué? Ah! voilà. Une supposition cependant. Les forts déjeuners de chasse commencent toujours vers une heure et finissent à quatre. On a beaucoup bu, et parlé du loup blanc. En sortant de table, on le voit. Quoi d’étonnant aussi à ce qu’on ne le tue pas?
J’allais devant moi, sur la route grise ferrée de granit, et luisante quand brille le soleil. La plaine des deux côtés est plate, semée d’ajoncs. De place en place, une grosse pierre couchée entretient dans la pensée le constant souvenir des druides; et le vent qui souffle au ras de terre, siffle dans les buissons épineux. Parfois, un bruit sourd, comme un coup de canon lointain, fait frémir le sol; car j’approche de Penmarch, où la mer s’enfonce, paraît-il, en des cavernes sonores. Les lames engouffrées en ces trous secouent la côte entière, se font entendre jusqu’à Quimper, par les jours de tempête.
Depuis longtemps déjà on aperçoit la grande ligne des flots gris, qui semblent dominer toute cette campagne nue et basse. Crevant partout la vague, des rochers, des troupeaux d’écueils pointus montrent leurs têtes noires cerclées d’écume comme si elles bavaient; et là-bas, contre l’eau, quelques maisons frileuses cherchent à se cacher derrière des petits tas de pierres pour éviter l’éternel ouragan du large et la pluie salée de l’Océan. Un grand phare, qui tremble sur sa base de rochers, s’avance jusqu’à la vague, et les gardiens racontent que parfois, dans les nuits de tourmente, la longue colonne de granit tangue comme un navire, et que l’horloge s’abat face contre terre, et que les objets accrochés aux murs se détachent, tombent et se brisent.
Depuis ce lieu jusqu’au Conquet, c’est le pays des naufrages. C’est là que semble embusquée la mort, la hideuse mort de la mer, la Noyade. Aucune côte n’est plus dangereuse, plus redoutée, plus mangeuse d’hommes.
Au fond des petites maisons basses des pêcheurs, on voit grouiller, dans la fange, avec les porcs, une femme vieille, de grandes filles aux jambes nues et sales, et les fils, dont le plus âgé marque trente ans. Presque jamais on ne trouve le père, rarement l’aîné. Ne demandez pas où ils sont, car la vieille tendrait la main vers l’horizon bondissant et soulevé, qui semble toujours prêt à se ruer sur ce pays.
Ce n’est pas seulement la mer perfide qui les dévore ainsi, ces hommes. Elle a un allié tout-puissant, plus perfide encore, et qui l’aide, chaque nuit, en ses gloutonneries de chair humaine, l’alcool. Les pêcheurs le savent et l’avouent. «Quand la bouteille est pleine, disent-ils, on voit l’écueil. Mais, quand la bouteille est vide, on ne le voit plus.»
La plage de Penmarch fait peur. C’est bien ici que les naufrageurs devaient attirer les vaisseaux perdus, en attachant aux cornes d’une vache, dont la patte était entravée pour qu’elle boitât, la lanterne trompeuse qui simulait un autre navire.
Voici, un peu à droite, une roche devenue célèbre par un horrible drame. La femme d’un des derniers préfets du Morbihan était assise sur cette pierre, ayant sur ses genoux sa petite fille. La mer, à quelques mètres sous elles, semblait calme, inoffensive, endormie.
Soudain un de ces flots singuliers, qu’on appelle des vagues sourdes, monta, venu sans bruit, le dos gonflé, irrésistible, et, escaladant la roche, comme un malfaiteur furtif, il emporta les deux femmes qu’il engloutit en un moment. Des douaniers, qui passaient au loin, ne virent plus qu’une ombrelle rose, flottant doucement sur la mer recalmée, et la grande roche nue, ruisselante.
Pendant un an, les avocats et les médecins discutèrent, arguèrent, plaidèrent pour savoir laquelle, de la mère ou de l’enfant emportées dans le même flot, était morte la première. On noya des chattes avec leurs petits, des chiennes avec leurs toutous, des lapines avec leurs lapereaux, afin qu’aucun doute ne subsistât, car une grosse question d’héritage en dépendait, la fortune devant aller à l’une ou à l’autre famille suivant que la dernière convulsion avait dû être plus persistante dans le petit corps ou dans le grand.
Presque en face de ce lieu sinistre se dresse un calvaire de granit, comme on en voit partout en ce pays pieux où les croix, si vieilles elles-mêmes, sont aussi nombreuses que les dolmens leurs aînés. Mais ce calvaire s’élève au-dessus d’un bas-relief étrange, représentant d’une façon grossière et comique l’accouchement de la Vierge Marie. Un Anglais, en passant, admira la sculpture naïve, et la fit recouvrir d’un toit afin de la préserver des atteintes de ce climat sauvage.
Et nous suivons la plage, l’interminable plage, tout le long de la baie d’Audierne. Il faut passer à gué ou à la nage deux petites rivières, peiner dans le sable ou sur la poussière de varech, aller toujours entre ces deux solitudes, l’une remuante, l’autre immobile, la mer et la lande.
Voici Audierne, triste petit port, qu’anime seulement l’entrée et la sortie des barques allant pêcher la sardine.
Avant de partir, au matin, on goûte, au lieu du vulgaire café au lait, quelques-uns de ces petits poissons frais, poudrés de sel, savoureux, parfumés, vraies violettes des flots. Et on repart vers la pointe du Raz, cette fin du monde, ce bout de l’Europe.
On monte, on monte toujours, et soudain on aperçoit deux mers, à gauche l’Océan, à droite la Manche.
C’est là qu’elles se rencontrent, qu’elles se battent sans cesse, heurtant leurs courants et leurs vagues toujours furieuses, chavirant les navires et les avalant comme des dragées.
O flots que vous savez de lugubres histoires,
Flots profonds redoutés des mères à genoux.
Plus d’arbres, plus rien que des touffes de gazon sur le grand cap qui s’avance. Tout au bout deux phares, et partout au loin d’autres phares, piqués sur des écueils. Il en est un qu’on essaye en vain de terminer depuis dix ans. La mer, acharnée, détruit, à mesure qu’il s’accomplit, le travail acharné des hommes.
Là-bas, en face, l’île de Sein, l’île sacrée, regarde à l’horizon, derrière la rade de Brest, sa dangereuse commère, l’île d’Ouessant.
Qui voit Ouessant
Voit son sang
disent les matelots. L’île d’Ouessant, la plus inaccessible de toutes, celle que les marins n’abordent qu’en tremblant.
Le haut promontoire se termine soudain, tombe à pic dans cette bataille d’océans. Mais un petit sentier le contourne, rampant sur les granits inclinés, filant sur des crêtes larges comme la main.
Soudain on domine un abîme effrayant dont les murs, noirs comme s’ils avaient été frottés d’encre, vous renvoient le bruit furieux du combat marin qui se livre sous vous, tout au fond de ce trou qu’on a nommé l’Enfer.
Bien qu’à cent mètres au-dessus de la mer, je recevais des crachats d’écume, et, penché sur l’abîme, je contemplais cette fureur de l’eau qui semblait soulevée par une rage inconnue.
C’était bien un enfer qu’aucun poète n’avait décrit. Et une épouvante m’étreignait à la pensée d’hommes précipités là dedans, roulés, tournés, plongeant dans cette tempête entre quatre murailles de pierres, jetés sur les parois de la montagne, repris par le flot, engloutis, reparaissant, bouillonnant pêle-mêle dans les vagues monstrueuses.
Et je me remis en route, hanté de ces images et battu par un grand vent qui fouettait le cap solitaire.
Au bout de vingt minutes, j’atteignis un petit village. Un vieux prêtre, qui lisait son bréviaire à l’abri d’un mur de pierres, me salua. Je lui demandai où je pourrais coucher; il m’offrit l’hospitalité.
Une heure plus tard, assis tous deux devant sa porte, nous parlions de ce pays désolé qui saisit l’âme, quand un petit Breton, un enfant, passa devant nous, nu-pieds, secouant au vent ses longs cheveux blonds.
Le curé l’appela dans sa langue maternelle, et le gamin s’en vint, devenu timide tout à coup, les yeux baissés et les mains inertes.
– Il va vous réciter son cantique, me dit le prêtre; c’est un gaillard doué d’une grande mémoire et dont j’espère tirer quelque chose.
Et l’enfant se mit à bredouiller des paroles inconnues, sur ce ton geignant des petites filles qui répètent leur fable. Il allait sans point ni virgule, déroulant les syllabes comme si le morceau tout entier n’eût formé qu’un mot, s’arrêtant une seconde pour respirer, puis reprenant son chuchotement précipité.
Tout à coup il se tut. C’était fini. Le curé lui caressa la joue d’une petite tape.
– C’est bien, va-t’en.
Et le polisson se sauva. Alors mon hôte ajouta:
– Il vient de vous dire un vieux cantique de ce pays-ci!
Je répondis:
– Un vieux cantique? Est-il connu?
– Oh! pas du tout. Je vais vous le traduire, si vous voulez.
Alors le vieillard, d’une voix forte, s’animant comme s’il eût prêché, levant le bras d’un geste menaçant et enflant les mots, déclama ce naïf et superbe cantique dont j’ai voulu écrire les paroles sous sa dictée.
CANTIQUE BRETON
«L’enfer! l’enfer! Savez-vous ce que c’est, pécheurs?
«C’est une fournaise où rugit la flamme, une fournaise près de laquelle le feu d’une forge refermée, le feu qui a rougi les dalles d’un four, n’est que fumée!
«Là jamais on n’aperçoit de la lumière! Le feu brûle comme la fièvre sans qu’on le voie! Là jamais n’entre l’espérance, car la colère de Dieu a scellé la porte!
«Du feu sur vos têtes, du feu autour de vous! Vous avez faim? – Mangez du feu! – Vous avez soif? buvez à cette rivière de soufre et de fer fondu!
«Vous pleurerez pendant l’éternité; vos pleurs feront une mer; et cette mer ne sera pas une goutte d’eau pour l’enfer! Vos larmes entretiendront les flammes, loin de les éteindre; et vous entendrez la moelle bouillir dans vos os.
«Et puis on coupera vos têtes de dessus vos épaules, et pourtant vous vivrez! Les démons se les jetteront l’un à l’autre, et pourtant vous vivrez! Ils rôtiront votre chair sur les brasiers; vous sentirez votre chair devenir du charbon; et pourtant vous vivrez!
«Et là, il y aura encore d’autres douleurs. Vous entendrez des reproches, des malédictions et des blasphèmes.
«Le père dira à son fils: – Sois maudit, fils de ma chair, car c’est pour toi que j’ai voulu amasser des biens par la rapine!
«Et le fils répondra: – Maudit, maudit sois-tu, mon père, car c’est toi qui m’as donné mon orgueil et qui m’as conduit ici.
«Et la fille dira à sa mère: – Mille malheurs à vous, ma mère, mille malheurs à vous, caverne d’impuretés, car vous m’avez laissée libre, et j’ai quitté Dieu!
«Et la mère ne reconnaîtra plus ses enfants; et elle répondra:
– Malédiction sur mes filles et sur mes fils, malédiction sur les fils de mes filles et sur les filles de mes fils!
«Et ces cris retentiront pendant l’Éternité. Et ces souffrances seront toujours. Et ce feu!.. ce feu!.. c’est la colère de Dieu qui l’a allumé, ce feu!.. il brûlera toujours sans languir, sans fumer, sans pénétrer moins profondément vos os.
«L’Éternité!.. Malheur!.. Ne jamais cesser de mourir, ne jamais cesser de se noyer dans un océan de souffrances!
«O jamais! tu es un mot plus grand que la mer! O jamais! tu es plein de cris, de larmes et de rage. Jamais! Oh! tu es rigoureux. Oh! tu fais peur!»
Et quand le vieux prêtre eut terminé, il me dit:
– N’est-ce pas que c’est terrible?
Là-bas nous entendions la vague infatigable s’acharnant sur la sinistre falaise. Je revoyais ce trou plein d’écume furieuse, lugubre et hurlant, vrai séjour de la mort; et quelque chose de l’effroi mystique qui fait trembler les dévots repentants pesait sur mon cœur.
Je repartis au soleil levant, comptant atteindre Douarnenez avant la nuit.
Un homme qui parlait français, ayant navigué quatorze ans sur les navires de l’Etat, m’aborda, comme je cherchais le sentier douanier, et nous descendîmes ensemble vers la baie des Trépassés, dont la pointe du Raz forme un des bords.
C’est un immense cirque de sable, d’une inoubliable mélancolie, d’une tristesse inquiétante, donnant, au bout de quelque temps, l’envie de partir, d’aller plus loin. Une vallée nue avec un étang lugubre, sans grands ajoncs, un étang, qui paraît mort, aboutit à cette grève effrayante.
Cela semble bien une antichambre du séjour infernal. Le sable jaune, triste et plat, s’étend jusqu’à un énorme cap de granit qui fait face à la pointe du Raz, et où les flots acharnés se brisent.
De loin nous apercevions trois hommes immobiles piqués comme des pieux sur le sable. Mon compagnon parut étonné, car jamais on ne vient dans cette crique désolée. Mais, en approchant, nous aperçûmes quelque chose de long, étendu près d’eux, comme enfoui dans la grève; et parfois ils se penchaient, touchaient cela, se relevaient.
C’était un mort, un noyé, un matelot de Douarnenez perdu la semaine précédente avec ses quatre camarades. Depuis huit jours on les attendait en ce lieu où le courant rejette les cadavres. Il était le premier venu à ce dernier rendez-vous.
Mais autre chose préoccupait mon guide, car les noyés en ce pays ne sont pas rares. Il m’emmena vers le triste étang, et, me faisant pencher sur l’eau, il me montra les murs de la ville d’Ys. C’étaient quelques maçonneries antiques, à peine visibles. Puis j’allai boire à la source, un tout mince filet d’eau, la meilleure de toute la contrée, disait-il. Puis il me conta l’histoire de la cité disparue comme si l’événement était proche encore, accompli tout au plus sous les yeux de son grand-père.
Un roi, faible et bon, avait une fille perverse et belle, si belle que tous les hommes devenaient fous en la voyant, si perverse qu’elle se donnait à tous, puis les faisait tuer, précipiter dans la mer du haut des rochers voisins.
Ses passions débordées étaient plus violentes, disait-on, que les vagues de l’Océan furieux, et surtout plus inapaisables. Son corps semblait un foyer où se brûlaient les âmes que Satan cueillait ensuite.
Dieu se lassa, et il prévint de ses projets un vieux saint qui vivait dans le pays. Le saint avertit le roi, qui n’osa pas punir et enfermer sa fille chérie, mais qui l’informa de l’avertissement de Dieu. Elle n’en tint pas compte, et se livra, au contraire, à de tels débordements que la ville entière l’imita, devenue une cité d’amour, dont toute pudeur et toute vertu disparurent.
Une nuit Dieu réveilla le saint pour lui annoncer l’heure de sa vengeance. Le saint courut chez le roi demeuré seul vertueux en ce pays. Le roi fit seller son cheval, en offrit un autre au saint qui l’accepta; et, un grand bruit les ayant effrayés, ils aperçurent la mer qui s’en venait par la campagne, bondissante et mugissante. Alors la fille du roi parut à sa fenêtre, criant: «Mon père, allez-vous me laisser mourir?» Et le roi la prit en croupe, puis s’enfuit par une des portes de la ville, alors que les flots entraient par l’autre.
Ils galopaient dans la nuit, mais les vagues aussi couraient avec des grondements et des écroulements terribles. Déjà leur écume rampante atteignait les pieds des chevaux, et le vieux saint dit au roi: «Sire, rejetez votre fille de votre cheval, ou sinon vous êtes perdu.» Et la fille criait: «Mon père, mon père, ne m’abandonnez pas!» Mais le saint se dressa sur ses étriers, sa voix devint retentissante comme le tonnerre et il annonça: «C’est la volonté de Dieu.» Alors le roi repoussa sa fille qui se cramponnait à lui, et il la précipita derrière son dos. Les vagues aussitôt la saisirent, puis retournèrent en arrière.
Et le morne étang qui recouvre ces ruines, c’est l’eau restée depuis lors sur la ville impure et détruite.
Cette légende est donc une histoire de Sodome arrangée à l’usage des dames.
Et l’événement qu’on raconte comme s’il était d’hier se passa, paraît-il, au quatrième siècle après la venue du Christ.
Le soir j’atteignis Douarnenez.
C’est une petite ville de pêcheurs, qui serait la plus célèbre station de bains de France si elle était moins isolée.
Ce qui en fait le charme et la grâce, c’est son golfe. Elle est assise tout au fond et semble regarder la douce et longue ligne des côtes, onduleuses, arrondies toujours en des courbes charmantes, et dont les crêtes lointaines sont noyées en ces brumes blanches et bleues, légères et transparentes que dégage la mer.
Je repartis le lendemain pour Quimper; et le soir je couchais à Brest pour reprendre au lever du soleil le chemin de fer de Paris.
En Bretagne a paru dans la Nouvelle Revue du 1er janvier 1884. Maupassant y a utilisé certaines chroniques du Gaulois
LE CREUSOT
Le ciel est bleu, tout bleu, plein de soleil. Le train vient de passer Montchanin. Là-bas, devant nous, un nuage s’élève, tout noir, opaque, qui semble monter de la terre, qui obscurcit l’azur clair du jour, un nuage lourd, immobile. C’est la fumée du Creusot. On approche, on distingue. Cent cheminées géantes vomissent dans l’air des serpents de fumée, d’autres moins hautes et haletantes crachent des haleines de vapeur; tout cela se mêle, s’étend, plane, couvre la ville, emplit les rues, cache le ciel, éteint le soleil. Il fait presque sombre maintenant. Une poussière de charbon voltige, pique les yeux, tache la peau, macule le linge. Les maisons sont noires, comme frottées de suie, les pavés sont noirs, les vitres poudrées de charbon. Une odeur de cheminée, de goudron, de houille flotte, contracte la gorge, oppresse la poitrine, et parfois une âcre saveur de fer, de forge, de métal brûlant, d’enfer ardent, coupe la respiration, vous fait lever les yeux pour chercher l’air pur, l’air libre, l’air sain du grand ciel; mais on voit planer là-haut le nuage épais et sombre, et miroiter près de soi les facettes menues du charbon qui voltige.
C’est le Creusot.
Un bruit sourd et continu fait trembler la terre, un bruit fait de mille bruits, que coupe d’instant en instant un coup formidable, un choc ébranlant la ville entière.
Entrons dans l’usine de MM. Schneider.
Quelle féerie! C’est le royaume du Fer, où règne Sa Majesté le Feu!
Du feu! on en voit partout. Les immenses bâtiments s’alignent à perte de vue, hauts comme des montagnes et pleins jusqu’au faîte de machines qui tournent, tombent, remontent, se croisent, s’agitent, ronflent, sifflent, grincent, crient. Et toutes travaillent du feu.
Ici des brasiers, là des jets de flamme, plus loin des blocs de fer ardent vont, viennent, sortent des fours, entrent dans les engrenages, en ressortent, y rentrent cent fois, changent de forme, toujours rouges. Les machines voraces mangent ce feu, ce fer éclatant, le broient, le coupent, le scient, l’aplatissent, le filent, le tordent, en font des locomotives, des navires, des canons, mille choses diverses, fines comme des ciselures d’artistes, monstrueuses comme des œuvres de géants, et compliquées, délicates, brutales, puissantes.
Essayons de voir, et de comprendre.
Nous entrons, à droite, sous une vaste galerie où fonctionnent quatre énormes machines. Elles vont avec lenteur, remuant leurs roues, leurs pistons, leurs tiges. Que font-elles? Pas autre chose que de souffler de l’air aux hauts fourneaux où bout le métal en fusion. Elles sont les poumons monstrueux des cornues colossales que nous allons voir. Elles respirent, rien de plus; elles font vivre et digérer les monstres.
Et voici les cornues: elles sont deux, aux deux extrémités d’une autre galerie, grosses comme des tours, ventrues, rugissantes et crachant un tel jet de flamme qu’à cent mètres les yeux sont aveuglés, la peau brûlée, et qu’on halète comme dans une étuve.
On dirait un volcan furieux. Le feu qui sort de la bouche est blanc, insoutenable à la vue et projeté avec tant de force et de bruit que rien n’en peut donner l’idée.
Là dedans l’acier bout, l’acier Bessmer dont on fait les rails. Un homme fort, beau, jeune, grave, coiffé d’un grand feutre noir, regarde attentivement l’effroyable souffle. Il est assis devant une roue pareille au gouvernail d’un navire et parfois il la fait tourner à la façon des pilotes. Aussitôt la colère de la cornue augmente; elle crache un ouragan de flammes, c’est que le chef fondeur vient d’augmenter encore le monstrueux courant d’air qui la traverse.
Et, toujours pareil à un capitaine, l’homme, à tout moment, porte à ses yeux une jumelle pour considérer la couleur du feu. Il fait un geste; un wagonnet s’avance et verse d’autres métaux dans le brasier rugissant. Le fondeur encore consulte les nuances des flammes furieuses, cherchant des indications, et, soudain, tournant une autre roue toute petite, il fait basculer la formidable cuve. Elle se retourne lentement, crachant jusqu’au toit de la galerie un terrifiant jet d’étincelles; et elle verse, délicatement, comme un éléphant qui ferait des grâces, quelques gouttes d’un liquide flamboyant dans un vase de fonte qu’on lui tend, puis elle se redresse en rugissant.
Un homme emporte ce feu sorti d’elle. Ce n’est plus maintenant qu’un lingot rouge qu’on dépose sous un marteau mû par la vapeur. Le marteau frappe, écrase, rend mince comme une feuille le métal ardent qu’on refroidit aussitôt dans l’eau. Une pince alors le saisit, le brise; et le contre-maître examine le grain avant de donner l’ordre: «Coulez!»
La cornue aussitôt se renverse de nouveau, et, comme un valet qui emplirait des verres autour d’une table, elle verse le flot flamboyant d’acier qu’elle porte en ses flancs dans une série de récipients de fonte déposés en rond autour d’elle.
Elle semble se déplacer d’une façon naturelle, toute simple, comme si une âme l’animait. Car il suffit, pour remuer ces engins fantastiques, pour leur faire accomplir leur œuvre, les faire aller, venir, tomber, se redresser, tourner, pivoter, il suffit de toucher à des leviers gros comme des cannes, d’appuyer sur des boutons pareils à ceux des sonnettes électriques. Une force, un génie étrange semble planer, qui gouverne les gestes pesants et faciles de ces surprenants appareils.
Nous sortons, le visage rôti, les yeux sanglants.
Voici deux tours de briques, en plein air, trop hautes pour tenir sous un toit. Une chaleur insoutenable s’en dégage. Un homme, armé d’un levier de fer, les frappe au pied, fait tomber une sorte d’enduit, creuse plus profondément. Et bientôt apparaît une lueur, un point clair. Deux coups encore et un ruisseau, un torrent de feu s’élance, suit des canaux creusés dans la terre, va, vient, coule toujours. C’est la fonte, la fonte brute en fusion. On suffoque devant ce fleuve effrayant, on fuit, on entre dans les hauts bâtiments où sont faites les locomotives et les grandes machines des navires de guerre.
On ne distingue plus, on ne sait plus, on perd la tête. C’est un labyrinthe de manivelles, de roues, de courroies, d’engrenages en mouvement. A chaque pas on se trouve en face d’un monstre qui travaille du fer rouge ou sombre. Ici ce sont des scies qui divisent des plaques larges comme le corps; là des pointes pénètrent dans des blocs de fonte et les percent ainsi qu’une aiguille qui entre en du drap; plus loin, un autre appareil coupe des lamelles d’acier comme des ciseaux feraient d’une feuille de papier. Tout cela marche en même temps avec des mouvements différents, peuple fantastique de bêtes méchantes et grondantes. Et toujours on voit du feu sous les marteaux, du feu dans des fours, du feu partout, partout du feu. Et toujours un coup formidable et régulier dominant le tumulte des roues, des chaudières, des enclumes, des mécaniques de toutes sortes, fait trembler le sol. C’est le gros pilon du Creusot qui travaille.
Il est au bout d’un immense bâtiment qui en contient dix ou douze autres. Tous s’abattent de moment en moment sur un bloc incandescent qui lance une pluie d’étincelles et s’aplatit peu à peu, se roule, prend une forme courbe ou droite ou plate, selon la volonté des hommes.
Lui, le gros, il pèse cent mille kilos, et tombe, comme tomberait une montagne, sur un morceau d’acier rouge plus énorme encore que lui. A chaque choc un ouragan de feu jaillit de tous les côtés, et l’on voit diminuer d’épaisseur la masse que travaille le monstre.
Il monte et redescend sans cesse, avec une facilité gracieuse, mû par un homme qui appuie doucement sur un frêle levier; et il fait penser à ces animaux effroyables, domptés jadis par des enfants, à ce que disent les contes.
Et nous entrons dans la galerie des laminoirs. C’est un spectacle plus étrange encore. Des serpents rouges courent par terre, les uns minces comme des ficelles, les autres gros comme des câbles. On dirait ici des vers de terre démesurés, et là-bas des boas effroyables. Car ici on fait des fils de fer et là-bas les rails pour les trains.
Des hommes, les yeux couverts d’une toile métallique, les mains, les bras et les jambes enveloppés de cuir, jettent dans la bouche des machines l’éternel morceau de fer ardent. La machine le saisit, le tire, l’allonge, le tire encore, le rejette, le reprend, l’amincit toujours. Lui, le fer, il se tortille comme un reptile blessé, semble lutter, mais cède, s’allonge encore, s’allonge toujours, toujours repris et toujours rejeté par la mâchoire d’acier.
Voici les rails. Impuissante à résister, la masse rougie, opaque et carrée de Bessmer s’étend sous l’effort des mécaniques et, en quelques secondes, devient un rail. Une scie géante le coupe à sa longueur exacte, et d’autres suivent sans fin, sans que rien arrête ou ralentisse le formidable travail.
Nous sortons enfin, noirs nous-mêmes comme des chauffeurs, épuisés, la vue éteinte. Et sur nos têtes s’étend le nuage épais de charbon et de fumée qui s’élève jusqu’aux hauteurs du ciel.
Oh! quelques fleurs, une prairie, un ruisseau et de l’herbe où se coucher sans pensée et sans autre bruit autour de soi que le glissement de l’eau ou le chant du coq, au loin!