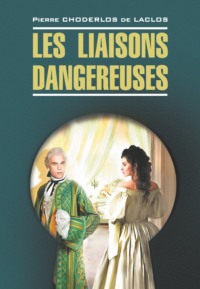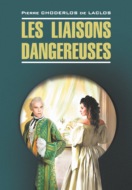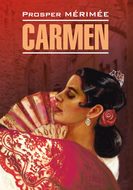Kitabı oku: «Опасные связи / Les liaisons dangereuses. Книга для чтения на французском языке», sayfa 3
Lettre XI. La Présidente de Tourvel à Madame de Volanges
Votre lettre sévère m’aurait effrayée, Madame, si par bonheur, je n’avais trouvé ici plus de motifs de sécurité que vous ne m’en donnez de crainte. Ce redoutable M. de Valmont, qui doit être la terreur de toutes les femmes, paraît avoir déposé ses armes meurtrières avant d’entrer dans ce château. Loin d’y former des projets, il n’y a pas même porté de prétentions, et la qualité d’homme aimable que ses ennemis mêmes lui accordent, disparaît presque ici, pour ne lui laisser que celle de bon enfant. C’est apparemment l’air de la campagne qui a produit ce miracle. Ce que je puis vous assurer, c’est qu’étant sans cesse avec moi, paraissant même s’y plaire, il ne lui est pas échappé un mot qui ressemble à l’amour, pas une de ces phrases que tous les hommes se permettent, sans avoir, comme lui, ce qu’il faut pour les justifier. Jamais il n’oblige à cette réserve, dans laquelle toute femme qui se respecte est forcée de se tenir aujourd’hui, pour contenir les hommes qui l’entourent. Il sait ne point abuser de la gaieté qu’il inspire. Il est peut-être un peu louangeur ; mais c’est avec tant de délicatesse, qu’il accoutumerait la modestie même à l’éloge. Enfin, si j’avais un frère, je désirerais qu’il fût tel que M. de Valmont se montre ici. Peut-être beaucoup de femmes lui désireraient une galanterie plus marquée ; et j’avoue que je lui sais un gré infini d’avoir su me juger assez bien pour ne pas me confondre avec elles.
Ce portrait diffère beaucoup sans doute de celui que vous me faites ; et, malgré cela, tous deux peuvent être ressemblants en fixant les époques. Lui-même convient d’avoir eu beaucoup de torts, et on lui en aura bien aussi prêté quelques-uns. Mais j’ai rencontré peu d’hommes qui parlassent des femmes honnêtes avec plus de respect, je dirais presque d’enthousiasme. Vous m’apprenez qu’au moins sur cet objet il ne trompe pas. Sa conduite avec Madame de Merteuil en est une preuve. Il nous en parle beaucoup ; et c’est toujours avec tant d’éloges et l’air d’un attachement si vrai, que j’ai cru, jusqu’à la réception de votre lettre, que ce qu’il appelait amitié entre eux deux était bien réellement de l’amour. Je m’accuse de ce jugement téméraire, dans lequel j’ai eu d’autant plus de tort, que lui-même a pris souvent le soin de la justifier. J’avoue que je ne regardais que comme finesse, ce qui était de sa part une honnête sincérité. Je ne sais ; mais il me semble que celui qui est capable d’une amitié aussi suivie pour une femme aussi estimable, n’est pas un libertin sans retour. J’ignore au reste si nous devons la conduite sage qu’il tient ici à quelques projets dans les environs, comme vous le supposez. Il y a bien quelques femmes aimables à la ronde ; mais il sort peu, excepté le matin, et alors il dit qu’il va à la chasse. Il est vrai qu’il rapporte rarement du gibier ; mais il assure qu’il est maladroit à cet exercice. D’ailleurs, ce qu’il peut faire au dehors m’inquiète peu, et si je désirais le savoir, ce ne serait que pour avoir une raison de plus de me rapprocher de votre avis ou de vous ramener au mien.
Sur ce que vous me proposez, de travailler à abréger le séjour que M. de Valmont compte faire ici, il me paraît bien difficile d’oser demander à sa tante de ne pas avoir son neveu chez elle, d’autant qu’elle l’aime beaucoup. Je vous promets pourtant, mais seulement par déférence et non pas par besoin, de saisir l’occasion de faire cette demande, soit à elle, soit à lui-même. Quant à moi, M. de Tourvel est instruit de mon projet de rester ici jusqu’à son retour, et il s’étonnerait, avec raison, de la légèreté qui m’en ferait changer.
Voilà, Madame, de bien longs éclaircissements : mais j’ai cru devoir à la vérité, un témoignage avantageux à M. de Valmont, et dont il me paraît avoir grand besoin auprès de vous. Je n’en suis pas moins sensible à l’amitié qui a dicté vos conseils. C’est à elle que je dois aussi ce que vous me dites d’obligeant à l’occasion du retard du mariage de Mademoiselle votre fille. Je vous en remercie bien sincèrement : mais, quelque plaisir que je me promette à passer ces moments avec vous, je les sacrifierais de bien bon cœur au désir de savoir Mademoiselle de Volanges plus tôt heureuse, si pourtant elle peut jamais l’être plus qu’auprès d’une mère aussi digne de toute sa tendresse et de son respect. Je partage avec elle ces deux sentiments qui m’attachent à vous, et je vous prie d’en recevoir l’assurance avec bonté.
J’ai l’honneur d’être, etc.
De…, ce 13 août 17**.
Lettre XII. Cécile Volanges à la Marquise de Merteuil
Maman est incommodée, Madame ; elle ne sortira point, et il faut que je lui tienne compagnie : ainsi je n’aurai pas l’honneur de vous accompagner à l’Opéra. Je vous assure que je regrette bien plus de ne pas être avec vous que le spectacle. Je vous prie d’en être persuadée. Je vous aime tant ! Voudriez-vous bien dire à M. le Chevalier Danceny que je n’ai point le recueil dont il m’a parlé, et que si il veut me l’apporter demain, il me fera grand plaisir. S’il vient aujourd’hui, on lui dira que nous n’y sommes pas ; mais c’est que Maman ne veut recevoir personne. J’espère qu’elle se portera mieux demain.
J’ai l’honneur d’être, etc.
De…, ce 13 août 17**.
Lettre XIII. La Marquise de Merteuil à Cecile Volanges
Je suis très fâchée, ma belle, d’être privée du plaisir de vous voir, et de la cause de cette privation. J’espère que cette occasion se retrouvera. Je m’acquitterai de votre commission auprès du Chevalier Danceny, qui sera sûrement très fâché de savoir votre Maman malade. Si elle veut me recevoir demain, j’irai lui tenir compagnie. Nous attaquerons, elle et moi, le Chevalier de Belleroche10 au piquet ; et, en lui gagnant son argent, nous aurons, pour surcroît de plaisir, celui de vous entendre chanter avec votre aimable maître, à qui je le proposerai. Si cela convient à votre Maman et à vous, je réponds de moi et de mes deux Chevaliers. Adieu, ma belle ; mes compliments à ma chère Mme de Volanges.
Je vous embrasse bien tendrement.
De…, ce 13 août 17**.
Lettre XIV. Cécile Volanges à Sophie Carnay
Je ne t’ai pas écrit hier, ma chère Sophie : mais ce n’est pas le plaisir qui en est cause ; je t’en assure bien. Maman était malade, et je ne l’ai pas quittée de la journée. Le soir, quand je me suis retirée, je n’avais cœur à rien du tout ; et je me suis couchée bien vite, pour m’assurer que le journée fût finie : jamais je n’en avais passé de si longue. Ce n’est pas que je n’aime bien Maman ; mais je ne sais pas ce que c’était. Je devais aller à l’Opéra avec Madame de Merteuil ; le Chevalier Danceny devait y être. Tu sais bien que ce sont les deux personnes que j’aime le mieux. Quand l’heure où j’aurais dû y être aussi est arrivée, mon cœur s’est serré malgré moi. Je me déplaisais à tout, et j’ai pleuré, pleuré, sans pouvoir m’en empêcher. Heureusement, Maman était couchée, et ne pouvait pas me voir. Je suis sûre que le Chevalier Danceny aura été fâché aussi ; mais il aura été distrait par le spectacle et par tout le monde : c’est bien différent.
Par bonheur, Maman va fort bien aujourd’hui, et Mme de Merteuil viendra avec une autre personne et le Chevalier Danceny : mais elle arrive toujours bien tard, Mme de Merteuil ; et quand on est si longtemps toute seule, c’est bien ennuyeux. Il n’est encore qu’onze heures. Il est vrai qu’il faut que je joue de la harpe ; et puis ma toilette me prendra un peu de temps, car je veux être bien coiffée aujourd’hui. Je crois que la mère Perpétue a raison, et qu’on devient coquette dès qu’on est dans le monde. Je n’ai jamais eu tant d’envie d’être jolie que depuis quelques jours, et je trouve que je ne le suis pas autant que je le croyais ; et puis, auprès des femmes qui ont du rouge, on perd beaucoup. Mme de Merteuil, par exemple, je vois bien que tous les hommes la trouvent plus jolie que moi : cela ne me fâche pas beaucoup, parce qu’elle m’aime bien ; et puis elle assure que le Chevalier Danceny me trouve plus jolie qu’elle. C’est bien honnête à elle de me l’avoir dit ! elle avait même l’air d’en être bien aise. Par exemple, je ne conçois pas cela. C’est qu’elle m’aime tant ! et lui ! … oh ! ça m’a fait bien plaisir ! aussi, c’est qu’il me semble que rien que le regarder suffit pour embellir. Je le regarderais toujours, si je ne craignais de rencontrer ses yeux : car toutes les fois que cela m’arrive, cela me décontenance, et me fait comme de la peine ; mais ça ne fait rien.
Adieu, ma chère amie ; je vais me mettre à ma toilette. Je t’aime toujours comme de coutume.
Paris, ce 14 août 17**.
Lettre XV. Le Vicomte de Valmont à la Marquise de Merteuil
Il est bien honnête à vous de ne pas m’abandonner à mon triste sort. La vie que je mène ici est réellement fatigante, par l’excès de son repos et son insipide uniformité. En lisant votre lettre et le détail de votre charmante journée, j’ai été tenté vingt fois de prétexter une affaire, de voler à vos pieds et de vous y demander, en ma faveur, une infidélité à votre Chevalier, qui, après tout, ne mérite pas son bonheur. Savez-vous que vous m’avez rendu jaloux de lui ? Que me parlez-vous d’éternelle rupture ? J’abjure ce serment prononcé dans le délire : nous n’aurions pas été dignes de le faire, si nous eussions dû le garder. Ah ! que je puisse un jour me venger dans vos bras du dépit involontaire que m’a causé le bonheur du Chevalier ! je suis indigné, je l’avoue, quand je songe que cet homme, sans raisonner, sans se donner la moindre peine, en suivant tout bêtement l’instinct de son cœur, trouve une félicité à laquelle je ne puis atteindre. Oh ! je la troublerai… Promettez-moi que je la troublerai. Vous-même n’êtes-vous pas humiliée ? Vous vous donnez la peine de le tromper, et il est plus heureux que vous. Vous le croyez dans vos chaînes ! et c’est bien vous qui êtes dans les siennes. Il dort tranquillement, tandis que vous veillez pour ses plaisirs. Que ferait de plus son esclave ?
Tenez, ma belle amie, tant que vous vous partagez entre plusieurs, je n’ai pas la moindre jalousie : je ne vois alors dans vos amants que les successeurs d’Alexandre, incapables de conserver entre eux tous cet empire où je régnais seul. Mais que vous vous donniez entièrement à un d’eux ! qu’il existe un autre homme aussi heureux que moi ! je ne le souffrirai pas ; n’espérez pas que je le souffre. Ou reprenez-moi, ou au moins prenez-en un autre ; et ne trahissez pas, par un caprice exclusif, l’amitié inviolable que nous nous sommes jurée.
C’est bien assez, sans doute, que j’aie à me plaindre de l’amour. Vous voyez que je me prête à vos idées, et que j’avoue mes torts. En effet, si l’amour est de ne pouvoir vivre sans posséder ce qu’on désire, d’y sacrifier son temps, ses plaisirs, sa vie, je suis bien réellement amoureux. Je n’en suis guère avancé. Je n’aurais même rien du tout à vous apprendre à ce sujet, sans un événement qui me donne beaucoup à réfléchir, et dont je ne sais encore si je dois craindre ou espérer.
Vous connaissez mon chasseur, trésor d’intrigue, et vrai valet de comédie ; vous jugez bien que ses instructions portaient d’être amoureux de la femme de chambre, et d’enivrer les gens. Le coquin est plus heureux que moi ; il a déjà réussi. Il vient de découvrir que Madame de Tourvel a chargé un de ses gens de prendre des informations sur ma conduite, et même de me suivre dans mes courses du matin, autant qu’il le pourrait, sans être aperçu. Que prétend cette femme ? Ainsi donc la plus modeste de toutes ose encore risquer des choses qu’à peine nous oserions nous permettre ! Je jure bien… Mais, avant de songer à me venger de cette ruse féminine, occupons-nous des moyens de la tourner à notre avantage. Jusqu’ici ces courses qu’on suspecte n’avaient aucun objet ; il faut leur en donner un. Cela mérite toute mon attention, et je vous quitte pour y réfléchir. Adieu, ma belle amie.
Toujours du château de…, ce 15 août 17**.
Lettre XVI. Cécile Volanges à Sophie Carnay
Ah ! ma Sophie, voici bien des nouvelles ! je ne devrais peut-être pas te les dire : mais il faut bien que j’en parle à quelqu’un ; c’est plus fort que moi. Ce Chevalier Danceny… Je suis dans un trouble, que je ne peux pas écrire : je ne sais par où commencer. Depuis que je t’avais raconté la jolie soirée11 que j’avais passée chez Maman avec lui et Mme de Merteuil, je ne t’en parlais plus : c’est que je ne voulais plus en parler à personne ; mais j’y pensais pourtant toujours. Depuis il était devenu triste, mais si triste, si triste que ça me faisait de la peine ; et quand je lui demandais pourquoi, il me disait que non ; mais je voyais bien que si. Enfin hier il l’était encore plus que de coutume. Ça n’a pas empêché qu’il n’ait eu la complaisance de chanter avec moi comme à l’ordinaire ; mais, toutes les fois qu’il me regardait cela me serrait le cœur. Après que nous eûmes fini de chanter, il alla renfermer ma harpe dans son étui ; et, en m’en rapportant la clef, il me pria d’en jouer encore le soir, aussitôt que je serais seule. Je ne me défiais de rien du tout ; je ne voulais même pas : mais il m’en pria tant, que je lui dis qu’oui. Il avait bien ses raisons. Effectivement, quand je fus retirée chez moi et que ma femme de chambre fut sortie, j’allai pour prendre ma harpe. Je trouvai dans les cordes une lettre, pliée seulement, et point cachetée, et qui était de lui. Ah ! si tu savais tout ce qu’il me mande ! Depuis que j’ai lu sa lettre, j’ai tant de plaisir, que je ne peux plus songer à autre chose. Je l’ai relue quatre fois tout de suite, et puis je l’ai serrée dans mon secrétaire. Je la savais par cœur ; et, quand j’ai été couchée, je l’ai tant répétée, que je ne songeais pas à dormir. Dès que je fermais les yeux, je le voyais là, qui me disait lui-même tout ce que je venais de lire. Je ne me suis endormie que bien tard ; et aussitôt que je me suis réveillée (il était encore de bien bonne heure), j’ai été reprendre sa lettre pour la relire à mon aise. Je l’ai emportée dans mon lit, et puis je l’ai baisée, comme si… C’est peut-être mal fait de baiser une lettre comme ça ? mais je n’ai pas pu m’en empêcher.
À présent, ma chère amie, si je suis bien aise, je suis aussi bien embarrassée ; car sûrement il ne faut pas que je réponde à cette lettre-là. Je sais bien que ça ne se doit pas, et pourtant il me le demande ; et, si je ne réponds pas, je suis sûre qu’il va encore être triste. C’est pourtant bien malheureux pour lui ! Qu’est-ce que tu me conseilles ? mais tu n’en sais pas plus que moi. J’ai bien envie d’en parler à Mme de Merteuil qui m’aime bien. Je voudrais bien le consoler ; mais je ne voudrais rien faire qui fût mal. On nous recommande tant d’avoir bon cœur ! et puis on nous défend de suivre ce qu’il nous inspire, quand c’est pour un homme. Dame ! Ça n’est pas juste non plus. Est-ce qu’un homme n’est pas notre prochain comme une femme, et plus encore ? car enfin n’a-t-on pas son père comme sa mère, son frère comme sa sœur ? il reste toujours le mari de plus. Cependant, si j’allais faire quelque chose qui ne fût pas bien, peut-être que M. Danceny lui-même n’aurait plus bonne idée de moi ! Oh ! ça, par exemple, j’aime encore mieux qu’il soit triste . Et puis, enfin, je serai toujours à temps. Parce qu’il a écrit hier, je ne suis pas obligée d’écrire aujourd’hui : aussi bien je verrai Mme de Merteuil ce soir, et si j’en ai le courage, je lui conterai tout. En ne faisant que ce qu’elle me dira, je n’aurai rien à me reprocher. Et puis peut-être me dira-t-elle que je peux lui répondre un peu, pour qu’il ne soit plus si triste ! Oh ! je suis bien en peine.
Adieu, ma bonne amie. Dis-moi toujours ce que tu penses.
De…, ce 19 août 17**.
Lettre XVII. Le Chevalier Danceny à Cécile Volanges
Avant de me livrer, Mademoiselle, dirai-je au plaisir ou au besoin de vous écrire ? je commence par vous supplier de m’entendre. Je sens que pour oser vous déclarer mes sentiments, j’ai besoin d’indulgence ; si je ne voulais que les justifier, elle me serait inutile. Que vais-je faire, après tout, que vous montrer votre ouvrage ? Et qu’ai-je à vous dire, que mes regards, mon embarras, ma conduite et même mon silence, ne vous aient dit avant moi ? Eh ! pourquoi vous fâcheriez-vous d’un sentiment que vous avez fait naître ? Emané de vous, sans doute il est digne de vous être offert ; s’il est brûlant comme mon âme, il est pur comme la vôtre. Serait-ce un crime d’avoir su apprécier votre charmante figure, vos talents séducteurs, vos grâces enchanteresses, et cette touchante candeur qui ajoute un prix inestimable à des qualités déjà si précieuses ? non, sans doute ; mais, sans être coupable, on peut être malheureux ; et c’est le sort qui m’attend, si vous refusez d’agréer mon hommage. C’est le premier que mon cœur ait offert. Sans vous je serais encore, non pas heureux, mais tranquille. Je vous ai vue ; le repos a fui loin de moi, et mon bonheur est incertain. Cependant vous vous étonnez de ma tristesse ; vous m’en demandez la cause : quelquefois même j’ai cru voir qu’elle vous affligeait. Ah ! dites un mot, et ma félicité deviendra votre ouvrage. Mais, avant de prononcer, songez qu’un mot peut aussi combler mon malheur. Soyez donc l’arbitre de ma destinée. Par vous je vais être éternellement heureux ou malheureux. En quelles mains plus chères puis-je remettre un intérêt plus grand ?
Je finirai, comme j’ai commencé, par implorer votre indulgence. Je vous ai demandé de m’entendre ; j’oserai plus ; je vous prierai de me répondre. Le refuser, serait me laisser croire que vous vous trouvez offensée, et mon cœur m’est garant que mon respect pour vous égale mon amour.
P. S. Vous pouvez vous servir, pour me répondre, du même moyen dont je me sers pour vous faire parvenir cette lettre ; il me parait également sûr et commode.
De…, ce 18 août 17**.
Lettre XVIII. Cécile Volanges à Sophie Carnay
Quoi ! Sophie, tu blâmes d’avance ce que je vais faire ! J’avais déjà bien assez d’inquiétudes ; voilà que tu les augmentes encore. Il est clair, dis-tu, que je ne dois pas répondre. Tu en parles bien à ton aise ; et d’ailleurs, tu ne sais pas au juste ce qui en est : tu n’es pas là pour voir. Je suis sûre que si tu étais à ma place, tu ferais comme moi. Sûrement en général on ne doit pas répondre et tu as bien vu, par ma lettre d’hier, que je ne le voulais pas non plus : mais c’est que je ne crois pas que personne se soit jamais trouvé dans le cas où je suis.
Et encore être obligée de me décider toute seule ! Mme de Merteuil, que je comptais voir hier au soir, n’est pas venue. Tout s’arrange contre moi : c’est elle qui est cause que je le connais. C’est presque toujours avec elle que je l’ai vu, que je lui ai parlé. Ce n’est pas que je lui en veuille du mal : mais elle me laisse là au moment de l’embarras. Oh ! je suis bien à plaindre !
Figure-toi qu’il est venu hier comme à l’ordinaire. J’étais si troublée, que je n’osais le regarder. Il ne pouvait pas me parler, parce que Maman était là. Je me doutais bien qu’il serait fâché, quand il verrait que je ne lui avais pas écrit. Je ne savais quelle contenance faire. Un petit moment après il me demanda si je voulais qu’il allât chercher ma harpe. Le cœur me battait si fort, que ce fut tout ce que je pus faire que de répondre que oui. Quand il revint, c’était bien pis. Je ne le regardai qu’un petit moment. Il ne me regardait pas, lui : mais il avait un air, qu’on aurait dit qu’il était malade. Ça me faisait bien de la peine. Il se mit à accorder ma harpe, et après, en me l’apportant, il me dit : « Ah ! Mademoiselle ! » … Il ne me dit que ces deux mots-là ; mais c’était d’un ton que j’en fus toute bouleversée. Je préludais sur ma harpe, sans savoir ce que je faisais. Maman demanda si nous ne chanterions pas. Lui s’excusa, en disant qu’il était un peu malade ; et moi, qui n’avais pas d’excuse, il me fallut chanter. J’aurais voulu n’avoir jamais eu de voix. Je choisis exprès un air que je ne savais pas ; car j’étais bien sûre que je ne pourrais en chanter aucun, et on se serait aperçu de quelque chose. Heureusement il vint une visite ; et, dès que j’entendis entrer un carrosse, je cessai, et le priai de rapporter ma harpe. J’avais bien peur qu’il ne s’en allât en même temps ; mais il revint.
Pendant que Maman et cette dame qui était venue causaient ensemble, je voulus le regarder encore un petit moment. Je rencontrai ses yeux, et il me fut impossible de détourner les miens. Un moment après je vis ses larmes couler, et il fut obligé de se retourner pour n’être pas vu. Pour le coup, je ne pus plus y tenir ; je sentis que j’allais pleurer aussi. Je sortis, et tout de suite j’écrivis avec mon crayon, sur un chiffon de papier : « Ne soyez donc pas si triste, je vous en prie ; je promets de vous répondre. » Sûrement tu ne peux pas dire qu’il y ait du mal à cela ; et puis c’était plus fort que moi. Je mis mon papier aux cordes de ma harpe, comme sa lettre était, et je revins dans le salon. Je me sentais plus tranquille. Il me tardait bien que cette dame s’en fût. Heureusement, elle était en visite ; elle s’en alla bientôt après. Aussitôt qu’elle fut sortie, je dis que je voulais reprendre ma leçon de harpe, et je le priai de l’aller chercher. Je vis bien, à son air, qu’il ne se doutait de rien. Mais au retour, oh ! comme il était content ! En posant ma harpe vis-à-vis de moi, il se plaça de façon que Maman ne pouvait voir, et il prit ma main qu’il serra… mais d’une façon ! … ce ne fut qu’un moment : mais je ne saurais te dire le plaisir que cela m’a fait. Je la retirai pourtant ; ainsi je n’ai rien à me reprocher.
À présent, ma bonne amie, tu vois bien que je ne peux pas me dispenser de lui écrire, puisque je le lui ai promis ; et puis, je n’irai pas lui refaire encore du chagrin ; car j’en souffre plus que lui. Si c’était pour quelque chose de mal, sûrement je ne le ferais pas. Mais quel mal peut-il y avoir à écrire, surtout quand c’est pour empêcher quelqu’un d’être malheureux ? Ce qui m’embarrasse, c’est que je ne saurai pas bien faire ma lettre ; mais il sentira bien que ce n’est pas ma faute ; et puis je suis sûre que rien que de ce qu’elle sera de moi, elle lui fera toujours plaisir.
Adieu, ma chère amie. Si tu trouves que j’aie tort, dis-le moi ; mais je ne crois pas. À mesure que le moment de lui écrire approche, mon cœur bat que ça ne se conçoit pas. Il le faut pourtant bien, puisque je l’ai promis. Adieu.
Paris, 21 août 17**.