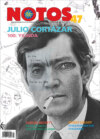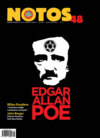Kitabı oku: «Dix contes modernes des meilleurs auteurs du jour», sayfa 2
L'HISTOIRE LA PLUS DROLE
PAR JACQUES NORMAND
L'HISTOIRE la plus drôle de ma vie, m'écrit l'aimable poète? Vous m'embarrassez beaucoup, mon cher confrère. D'abord ai-je eu des histoires vraiment drôles, et parmi ces histoires vraiment drôles quelle est la plus drôle?
Enfin, en remontant le fleuve des souvenirs, j'en retrouve une… que je vous donne telle quelle, sans fioritures, pour ce qu'elle vaut.
C'était en 1872, après la guerre. J'avais pris part au siège de Paris comme simple moblot. J'avais vingt-deux ans à peine, un mètre quatre-vingts de taille, une santé robuste, malgré les fatigues du siège, et une belle barbe qui s'étalait en deux longues pointes sur ma poitrine et dont j'étais très fier. Bref un homme fait et solide. En bon patriote… que je suis toujours (je vous avoue être très vieux jeu!) j'avais souffert profondément des malheurs du pays. J'avais été humilié non seulement de la supériorité militaire, mais… comment dirais-je?.. de la supériorité scolaire de nos ennemis.
Beaucoup d'Allemands parlaient le français, et fort bien, tandis que nous!.. Comme première revanche je voulus apprendre l'allemand. Au collège j'avais pioché l'anglais et après quelques courts séjours en Angleterre je le parlais passablement; mais je ne savais pas un traître mot de la langue de Schiller et de Gœthe. Je me mis courageusement à étudier la méthode Ollendorff qui, soit dit en passant, et sans vouloir faire de réclame à mon ami Ollendorff, est une excellente méthode; je pris des leçons d'un non moins excellent professeur, le Dr Karpelès, recommandé par le même Ollendorff. Au bout de six mois je commençais à me débrouiller. Mais un séjour dans le pays était indispensable. Or, aller en Allemagne aussitôt après la guerre… cela me serrait le cœur. Il le fallait cependant. Je choisis un pays pas trop allemand, récemment annexé: le Hanovre. On y parle d'ailleurs l'allemand le plus pur. L'ami d'un ami de mes parents avait écrit à son correspondant de là-bas pour lui demander l'adresse d'une pension de jeunes gens. On avait indiqué le Dr Davisson dans la ville de Hanovre même. Nourriture excellente; instruction soignée; une vingtaine d'élèves, pas plus… En route pour la pension Davisson!
Par une jolie matinée de juillet, je sonnais à la porte du docteur. Je fus assez étonné, quand, cette porte ouverte, je me trouvai dans une cour où quelques jeunes garçons, dont l'âge pouvait varier entre huit ans au moins et quatorze au plus, jouaient aux billes, à la toupie, au ballon et à d'autres jeux plutôt enfantins.
Le Dr Davisson accourait. C'était un petit vieillard rasé, maigre, pétulant, à lunettes, à favoris gris, à toque de velours, un échappé des contes d'Hoffmann. Je me nommai. Il eut un mouvement de surprise, me regarda de haut en bas, de bas en haut, avec ma haute stature, ma grande barbe, mon aspect de gaillard ayant fait campagne.
– Ah! ah! c'est vous… vous êtes l'élève qui m'a été recommandé par M. X…?
Pendant ce temps les jeunes garçons, intrigués, avaient cessé leurs jeux et m'entouraient curieusement. Je me faisais un peu l'impression de Gulliver à Lilliput.
– Oui, c'est moi, Herr Doctor: mes bagages sont dans la voiture… et…
Le docteur prit courageusement son parti et avec un geste circulaire: "Mais c'est une pension de petits garçons, ici! M. X… en m'écrivant, a négligé de me dire votre âge. Il a dit seulement: un jeune Français… J'ai cru que vous aviez dans les douze ans!"
J'étais fort embarrassé! La perspective de rester au milieu de tous ces gamins me souriait peu, mais, d'un autre côté, l'air brave homme du docteur me séduisait. Et puis, que ferais-je tout seul dans cette ville où je ne connaissais personne; dans ce pays qui était l'ennemi, et plus encore, le vainqueur du mien?
– Voulez-vous tout de même de moi? dis-je au docteur. Et j'ajoutai en riant: "Je vous promets d'être bien sage."
Il dit lui-même en me tendant la main: "Essayons!.."
* * *
Je suis resté deux mois chez le Dr Davisson. J'étais la "grande classe." J'étais admiré et envié par mes jeunes camarades anglais, américains ou allemands. Pendant les études, j'étais seul sur le premier banc, devant le professeur. Ce banc était trop bas pour mes grandes jambes et me les sciait à mi-cuisse. J'étais obligé de me tenir de côté. Un peu trop court le lit que j'occupais dans une chambre à part. (J'avais évité le dortoir.) Mais stoïque, j'avais voulu pour ne pas donner le mauvais exemple, me soumettre autant que possible à la règle de la maison. On m'avait seulement dispensé de jouer aux billes pendant les récréations et aussi de l'"allumage de la pipe."
Cet allumage consistait en ceci. Quand un élève était premier, il avait l'honneur d'allumer la pipe, la grosse pipe en porcelaine, la Pfeife du docteur. J'ai été plusieurs fois premier: mais, en ce cas, c'était le second qui allumait la pipe.
M. Davisson était un brave homme qui demeurait très attaché à la dynastie et détestait les Prussiens. Il m'en disait le plus grand mal. C'était toujours ça! Quant à mes progrès, ils furent considérables. J'étais récompensé de mon courage. Au bout de deux mois, je parlais très convenablement l'allemand. Seulement, il y a vingt-six ans de cela, et je l'ai pas mal oublié. Si je veux retrouver ce que j'ai perdu, il me faudra retourner à Hanovre et me remettre en pension! J'y réfléchirai.
LA CHARGE DES MORTS
PAR HENRY DE FORGE
I
Comme le soir tombait sur la bataille encore indécise laissant l'armée russe en une position vraiment critique, le général prince Rouknine, qui commandait l'aile gauche, se sentant tourné par l'ennemi, donna aux quelques Cosaques qui lui restaient l'ordre de charger.
Il ne s'agissait de rien moins que de déloger deux mille Turcs fortement établis dans le village de Karkow avec des batteries d'artillerie; il fallait absolument que les Russes pussent les chasser de là, s'ils ne voulaient pas se trouver enveloppés…
Cela était nécessaire pour que l'issue du combat changeât et que la marche en avant sur Plewna pût être continuée.
Mais la tentative était d'autant plus difficile que les soldats qui occupaient Karkow faisaient tous partie de la garde particulière du Sultan, et c'étaient de grands diables d'hommes de six pieds de haut, qui ne s'étonnaient de rien, n'avaient peur de rien et avaient pour principe de ne jamais laisser un ennemi à terre sans lui tracer dans le dos, à coups de poignard, le croissant rouge de Mahomet.
Le prince Rouknine savait cela.
Aussi, lorsqu'il se décida à envoyer contre eux ses cinq cents derniers Cosaques, tout ce qui lui restait de son fameux régiment de l'Oural, il comprit qu'il les envoyait à la mort et que pas un ne reviendrait…
Il fit appeler leur capitaine, un beau blond avec des yeux très bleus, qui se nommait Serge Frithiof et qui n'avait pas plus de vingt-cinq ans.
Froidement il lui dit:
– Monsieur, vous allez avoir l'honneur de charger. Vous lancerez vos chevaux à toute vitesse sur le village de Karkow, que l'infanterie ennemie occupe en ce moment. Si vous arrivez à enlever la position, la trouée sera faite et notre armée sera sauvée. Mais vous vous battrez dans la proportion de un contre quatre et c'est pour la plupart d'entre vous la mort certaine. Si Karkow est repris et si le passage est libre grâce à vous, vous ferez résonner la cloche de l'église, et je serai prévenu. Si aucun son ne tinte dans les airs, c'est que l'armée russe doit succomber et que pas un de vous ne sera vivant.
Le capitaine abaissa lentement son sabre en signe d'acquiescement.
C'était un rude soldat que ce Serge Frithiof, malgré son regard doux comme un regard de femme.
Puis, à mi-voix, il murmura ces simples mots:
– La cloche sonnera!
II
Les boulets pleuvaient tout autour des Cosaques, dont les chevaux se cabraient furieux, l'écume aux dents.
Serge Frithiof leva le bras.
Une clameur sauvage retentit, et la masse sombre des cavaliers s'ébranla au grand galop pour traverser le ravin de Karkow.
Ils étaient effrayants, ces géants courbés sur leurs selles, la lance en avant; selon les ordres du capitaine, ils avaient tout de suite cessé leurs cris rauques et l'on n'entendait plus que le bruit sourd et formidable du galop des chevaux.
Quand les soldats de la Garde turque virent arriver cet ouragan, les plus hardis d'entre eux, ceux-là qui ignoraient même qu'on pût trembler, eurent un frisson.
Le choc fut épouvantable. Chaque coup de sabre tranchait une tête, chaque coup de fusil abattait son homme. Et il y avait des ruisseaux de sang le long des maisons.
Mais les Cosaques étaient décimés.
Sentant, néanmoins, ses troupes ébranlées, le général turc leur fit effectuer un mouvement en arrière qui dégageait le village; puis, confiant dans la supériorité du nombre, il leur fit prendre position à un kilomètre de là, près d'une ferme abandonnée, d'où l'artillerie pourrait tirer.
Karkow était pris, mais la trouée n'était pas faite!
Serge Frithiof blêmit de rage: il aurait voulu être tué, vraiment, et voilà que la mort l'épargnait.
– L'armée peut être sauvée par vous! avait dit le général prince Rouknine.
Coûte que coûte, il fallait donc continuer cette charge folle qui venait de faire reculer l'ennemi; mais comment, puisque l'escadron était réduit à quelques cavaliers?..
Le capitaine rassembla ses Cosaques sur la grande place de Karkow et les compta. Ils étaient soixante à peine. Plus de quatre cents cadavres jonchaient les rues du village, à côté des cadavres turcs.
Les chevaux, sans cavaliers, erraient par troupes, docilement. Peu d'entre eux avaient été touchés, car toutes les balles, bien dirigées, avaient frappé les hommes en pleine poitrine. Et il n'y avait que des morts à terre, les soldats du Sultan n'ayant pas oublié le croissant sanglant de Mahomet.
Le soir tombait; des lueurs roses éclairaient doucement l'horrible spectacle, des lueurs qui se mouraient sur le champ de bataille qui allait être un champ de déroute.
Serge restait silencieux, très sombre.
Il avait au cœur une colère folle, un désespoir d'être là, impuissant contre un ennemi qu'il avait vaincu cependant. Soudain, une pensée traversa son cerveau, une pensée fantastique. Il passa la main sur son front, comme s'il voulait en chasser un cauchemar. Ses yeux très bleus avaient un reflet singulier, et tout bas il murmura:
– Nous allons continuer la charge!
Se tournant vers ses hommes, il ajouta:
– Vous irez ramasser tous les morts qui sont tombés dans le village et vous arrêterez les chevaux errants, puis vous remettrez en selle les corps, solidement attachés sur les chevaux avec la courroie des lances.
Un frisson parcourut les rangs.
Que voulait le capitaine? Il devenait fou! Mettre en selle des cadavres, profaner le repos des soldats tués à l'ennemi! Il y eut un moment d'hésitation.
– Faites! répéta l'officier froidement.
Les Cosaques obéirent.
Il leur fut facile de ramener les chevaux qui se groupaient ensemble, par habitude, et d'une main vigoureuse ils soulevèrent les cadavres sanglants pour les dresser sur les étriers.
La scène était terrible, et ces hommes qui, tout à l'heure, avaient montré tant de courage, devenaient blêmes en accomplissant l'affreuse besogne.
– A cheval, vous autres! cria Serge Frithiof, une fois qu'il eut vu reformé son ancien escadron, un escadron de soldats qui ne vivaient plus.
Les soixante Cosaques, les mains rouges de sang, vinrent reprendre leur place, en tête des rangs.
– Nous allons charger une seconde fois! dit le capitaine.
– Y penses-tu, petit père? fit l'un des Cosaques; avec de pareils cavaliers!
Partons en tête, répondit l'officier; leurs chevaux suivront les nôtres!
III
L'escadron s'ébranla, et, sur le chemin en pente qui descendait de Karkow vers la ferme où était l'ennemi, la charge recommença.
Les Turcs, qui avaient vu tomber sous leurs coups la plupart des soldats russes, se croyaient tranquilles maintenant, et ils furent étrangement surpris lorsqu'ils entendirent à nouveau le bruit de cette chevauchée qui approchait.
Au cri d'alarme des sentinelles, ils se déployèrent en bataille et firent feu sur toute la ligne.
Quarante Cosaques roulèrent à terre: c'étaient ceux des premiers rangs, ceux qui vivaient!
Pendant ce temps, les autres continuaient de charger, invulnérables!
Le capitaine Serge brandissait son sabre au-dessus des têtes, et les chevaux, emballés maintenant, galopaient avec une effroyable vitesse.
Les soldats turcs ne concevaient point ce qui se passait. D'où pouvait venir cet escadron? Quels étaient ces démons qui recevaient les balles sans broncher, courbés très bas sur leurs selles, sans une parole, sans un cri?
En cette nuit tombante, cette charge était comme une course des légendes héroïques; on ne distinguait pas le nombre des chevaux, et l'on pouvait croire que c'était toute la cavalerie russe, toute une armée fantôme qui arrivait!
Les premiers rangs d'infanterie fléchirent, les autres ne tardèrent pas à reculer, et, comprenant tout à coup, se rendant compte, les Turcs abandonnèrent leurs armes en s'enfuyant.
Ce fut alors une épouvantable débâcle.
La position était enlevée, et le passage devenait libre enfin.
Serge Frithiof, qui avait été encore épargné par les balles, se retourna et vit que son escadron était là, presque entier, dans son ordre habituel, tant les chevaux étaient dociles; les rudes bêtes s'étaient toutes arrêtées derrière lui, quand il avait crié: "Halte!" et elles restaient maintenant immobiles, tête basse, couvertes d'écume.
La plupart de leurs cavaliers étaient demeurés en selle, car les courroies des lances étaient solides.
Et quelques instants après, dans la nuit, la cloche du village sonna, tintant le glas…
IV
La victoire était possible, certaine même, puisque la trouée avait été faite sous la charge héroïque et que les Turcs abandonnaient leurs positions.
Le général prince Rouknine, en entendant la cloche, se découvrit, comprenant que ses fidèles Cosaques s'étaient bien battus, se sacrifiant pour sauver le reste de l'armée.
Et cet homme qui, dans sa longue vie avait vu tant de combats et d'exploits, pleura.
Avec son état-major, il se porta au galop du côté de Karkow, mais il avait le cœur serré, craignant de voir à terre tous ses beaux Cosaques, – et sa joie de vaincre était mêlée de douleur!
Il déboucha sur la grande place du village.
Quelle ne fut pas sa surprise d'apercevoir soudain, rangées en bataille, comme pour la parade, les lignes noires de l'escadron!
Ils étaient bien trois cents cavaliers environ, le capitaine Serge Frithiof à leur tête.
La nuit était venue; mais il faisait un clair de lune magnifique, un de ces admirables clairs de lune d'Orient qui donnent aux choses des reflets étranges.
Le capitaine Serge s'avança à la rencontre du général.
– Karkow est libre! fit-il en saluant du sabre.
– Vous avez donc pu charger? demanda le prince.
– Deux fois de suite, car il a fallu chasser l'ennemi d'une ferme où il s'était retranché!
– Et vous avez eu beaucoup d'hommes tués, capitaine?
– Tous mes hommes!
En disant ces mots, Serge Frithiof se redressa.
– Mais alors, demanda le prince Rouknine, quels soldats sont donc là, debout sur leurs chevaux?
– Nos braves Cosaques, héroïques jusque dans la mort!
Le prince Rouknine s'approcha et il vit, penchées sur le cou des chevaux, éclairées par la lumière blafarde de la lune, les têtes mortes qui se balançaient aux mouvements des montures.
LE PETIT HOMME ROUGE
PAR FRANÇOIS DE NION
C'EST le soir même des terribles journées d'octobre que la Reine et moi, son humble servante, nous vîmes dans un des couloirs du vieux Louvre cette affreuse figure dont aujourd'hui même encore – à l'heure lointaine où j'écris ces lignes, – je ne puis oublier les traits, ni, malgré tout, méconnaître la réalité.
Je raconterai d'autre part notre voyage de Versailles à Paris dans un torrent de têtes hideuses qui semblaient porter nos carrosses comme l'eau d'un fleuve une barque périlleuse. Têtes sanglantes et têtes sinistres, je vous vois danser autour de nous, les unes au bout d'une pique avec vos prunelles rigides et vos muscles tordus; les autres au niveau de nos visages, les yeux hagards et les bouches hurlant des injures.
L'horrible jour, froid, pluvieux, sombre!
Le soir même il fallut s'occuper de se loger dans les appartements des Tuileries qui n'avaient pas été chauffés depuis l'enfance de Louis XV. Tout y était dans un désordre sinistre. Le pauvre Dauphin, habitué à son palais de Versailles, se pressait contre sa mère, effrayé par ces murs délabrés.
– Tout ici est bien laid, maman, murmurait-il.
Et Marie-Antoinette lui répondait:
– Louis XIV logeait ici, mon fils, nous ne devons pas être plus difficiles que lui.
Dès que ses enfants furent endormis dans des lits préparés à la hâte, la Reine m'appela et me dit:
– Venez avec moi, comtesse; le Roi est couché, mais pour moi je ne saurais dormir sans avoir parcouru ces appartements et m'être assurée que je n'ai pas à redouter le fer d'un assassin veillant dans ces ténèbres contre les jours de Sa Majesté.
* * *
Je pris un bougeoir. C'était le bougeoir du coucher dans la chambre du Roi à Versailles, le long bougeoir de vermeil à deux bougies si ardemment ambitionné par les courtisans, pour qui le tenir était un grand honneur; on l'avait emporté malgré le désarroi. Je pris ce bougeoir et je marchai devant la Reine, éclairant notre ronde nocturne à travers le palais sombre.
Les cent Suisses étaient campés dans la vaste galerie du centre, qui fut depuis la salle des maréchaux; de ce côté il n'y avait rien à craindre. Nous tournâmes dans un appartement qui donnait sur les jardins et sur la Seine. Il faisait clair de lune; certaines fenêtres conservaient encore les petits vitraux plombés du temps des Médicis. Leurs verres grossiers, en culs de bouteilles, laissaient transparaître une lumière verdâtre qui tachait le visage de la Reine et me la montra soudain comme un fantôme en son vêtement blanc. Je me souviens que mes doigts tremblèrent et que les bougies que je tenais pleurèrent sur le parquet.
– Vous avez peur? me dit-elle. Vous étiez plus brave tantôt.
Et elle daigna ajouter:
– J'ai été témoin de votre courage et de votre fidélité; je ne les oublierai jamais… si toutefois j'ai encore longtemps pour me souvenir.
– Oh! madame, m'écriai-je.
Mais d'un geste doux et souverain elle m'indiquait une porte.
– Je ne sais ce qu'il y a de ce côté-ci des appartements. Dans mes rares séjours à Paris je n'ai jamais été si loin.
Je jetai un coup d'œil par un des carreaux de vitre: nous dominions la Seine et le vent faisait trembler, en les balançant, les grands arbres de la grève, mêlant leurs branches noires dans les rayons argentés de l'astre des nuits.
– C'est, me dit la Reine, que nous sommes à la porte qui fait communiquer le château avec la galerie du Louvre.
* * *
Un frisson involontaire me saisit: il me semblait que derrière cette frêle planche aux moulures dorées et peintes par Coypel, tout le vieux mystère du Louvre tragique s'agitait. Je n'étais pas très savante en histoire de France – juste ce qu'on en apprend en même temps que sa généalogie, – mais je me rappelais des récits terribles et des légendes sinistres. Ce palais, disait-on, était parcouru par des spectres étranges. Cependant la Reine me commandait d'ouvrir et d'une main tremblante je tournai le bouton de la serrure.
Un coup de vent me frappa au visage et faillit éteindre mes bougies; je les protégeai de la main en les élevant pour dissiper l'obscurité; leur faible rayonnement faisait remuer des ombres que je jugeais effrayantes; mais la Reine éleva la voix:
– On aurait dû placer ici un factionnaire dont on fût sûr. Dieu sait jusqu'où ce corridor peut conduire!
Car nous distinguions maintenant une longue galerie qui semblait s'étendre à l'infini.
– Allons, dit Marie-Antoinette; il faut voir.
Et comme j'osai représenter à ma souveraine qu'il était nécessaire au moins d'appeler des gardes pour accompagner Sa Majesté, elle me fit signe de la suivre et s'avança la première.
Cette partie du Louvre fut reliée aux Tuileries par les architectes de Louis XIV; elle était alors, par suite de transformations essayées, puis renoncées, un désordre et un chaos. Nous errâmes dans un dédale de corridors coupés de marches et faisant cent détours, rencontrant parfois de brusques escaliers en vis, semblant descendre au centre de la terre, et qui s'arrêtaient devant des baies d'anciennes portes murées. Les voûtes sous lesquelles nous marchions étaient basses, gothiques, supportées par des bustes d'animaux à faces de monstres. La Reine murmura d'une voix basse comme un souffle:
– Nous sommes dans la partie qui n'a pas été touchée; c'est le vieux palais de Charles IX et d'Henri III. Ces pierres ont dû voir bien des événements.
* * *
A ce moment nous entendîmes distinctement un bruit léger à quelques pas de nous. Nous nous trouvions alors au centre d'une sorte d'étoile où venaient aboutir des couloirs obscurs. Le sentiment naturel de ce que je devais à ma souveraine vainquit ma faiblesse et je m'élançai devant Marie-Antoinette en élevant en l'air mon bougeoir de vermeil. Une forme bizarre apparaissait semblant descendre un à un les degrés taillés dans la pierre des murs; c'était une façon de petit homme vêtu de la manière qu'on représente les bourgeois du temps passé, avec des chausses à trousses, une casaque tailladée, et coiffé d'un chaperon à oreillère et à queue pendante. Mes tremblantes mains dirigeaient la lumière de son côté et nous vîmes qu'il était tout habillé de rouge.
Au cri que je ne pus retenir, cet être affreux, qui me parut avoir les traits d'un vieillard et la taille d'un enfant, leva la tête et, remontant brusquement, d'un vif élan, les degrés qu'il était en train de descendre, nous le vîmes s'élever tout d'un coup comme s'il voulait donner de la tête contre la voûte et disparaître.
Marie-Antoinette était immobile et pâle; j'osai saisir sa main glacée.
– Rentrons, me dit-elle; rien d'humain ne nous menace en ces lieux. Sans doute que la Providence a voulu m'attirer jusqu'ici pour m'avertir par un signe des dangers qui menacent la monarchie.
– Votre Majesté pense donc?..
– Que nous venons de voir le petit homme rouge, celui qui erre dans les détours du Louvre quand le roi de France est en péril. Je ne sais si notre croyance catholique nous permet d'ajouter foi à cette superstition; mais comment douter du témoignage de nos yeux?
Nous rentrâmes; elle impassible, moi terrifiée. Tout dormait dans le château. J'aidai la Reine à se dévêtir sans ces étiquettes qui lui avaient tant pesé et je l'entendis murmurer comme à elle-même:
– Je crains tout pour le Roi. Quant à moi je suis étrangère; ils m'assassineront; que deviendront nos pauvres enfants?
La douleur de cette Reine dans ce palais de désastres dépassait tout ce que les tragédies ont pu concevoir de terrible…
* * *
Je suis la dernière servante de la monarchie qui ai vu, de mes yeux vu, le petit homme rouge du Louvre.