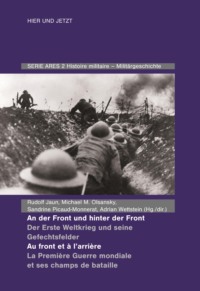Kitabı oku: «An der Front und Hinter der Front - Au front et à l'arrière», sayfa 8
Aspects méthodologiques : état d’esprit, pensée militaire, doctrine, pratiques
Avant la guerre, les processus d’évolution des pratiques et de la doctrine étaient déjà assez complexes2. Pour bien comprendre le phénomène, il faut commencer par distinguer les quatre domaines que sont l’état d’esprit, la pensée militaire, la doctrine et les pratiques ou l’application de la doctrine. Par état d’esprit, il faut entendre « l’ensemble des idées générales, non structurées, souvent vagues et mal définies, qui circulent dans un groupe social spécifique ». De son côté, la pensée militaire « est structurée et vise à appréhender une question dans son ensemble. Elle définit des principes théoriques et des procédés d’application ». Multiple, elle comprend des courants de pensée qui débattent par le biais de publications, de conférences, etc. La doctrine, elle, est codifiée dans des règlements. Elle « représente l’ensemble des méthodes et des idées fondamentales et officielles d’une armée. Elle constitue un ensemble de prescriptions ayant pour but de standardiser les actions des acteurs militaires dans le sens d’une voie unique et bénéfique : défaire l’ennemi dans un combat pouvant présenter une grande variété de conditions différentes3 ». En dépit de son caractère officiel, la doctrine ne représente pas forcément les pratiques effectives de l’armée. Celles-ci correspondent à ce que nous avons nommé l’application de la doctrine.
Les rapports entre ces quatre domaines sont complexes. Diverses questions doivent être étudiées : Comment se forme une doctrine ? Qui la définit ? Comment les idées circulent-elles et parviennent-elles à s’imposer ? Comment la doctrine est-elle diffusée ? En ce qui concerne ce dernier point, soulignons que cette diffusion ne se fait pas de manière automatique. Il faut tenir compte de l’existence de « courroie(s) de transmission » (écoles, structures et méthodes d’instruction). Par ailleurs le schéma de diffusion est soumis à une triple dynamique qui engendre des distorsions. Tout d’abord, les quatre domaines sont en effet influencés par l’étude des conflits contemporains, les changements dans la situation internationale, les développements techniques. En ce qui concerne ces derniers, soulignons qu’il n’existe aucun déterminisme doctrinal. Chaque pays intègre les nouveautés en fonction de divers critères politiques, économiques, sociaux, etc. qui lui sont propres. La deuxième dynamique est celle des acteurs. Les institutions militaires sont en effet soumises à des jeux de pouvoirs, des querelles idéologiques et de personnes. Dès lors, certaines idées peuvent voir leur diffusion accélérée ou bloquée pour des raisons qui n’ont aucun rapport avec leur pertinence. Enfin, les quatre domaines s’influencent mutuellement.
La doctrine de l’armée française à la veille des hostilités
La doctrine de l’« offensive à outrance » a été adoptée par l’armée française quelques mois seulement avant le début des hostilités. Développée à partir des idées du colonel de Grandmaison en 1911 dans le cadre du Centre des hautes études militaires4, elle a été codifiée dans trois règlements s’adressant chacun à un niveau hiérarchique particulier : la Conduite des grandes unités du 28 octobre 19135, le Service des armées en campagne du 2 décembre 19136 et le Règlement d’infanterie du 20 avril 19147. Elle a remplacé la doctrine précédente, la « manœuvre napoléonienne »8. Développée lentement et avec difficultés à l’Ecole supérieure de guerre au lendemain de l’humiliante défaite de 1870, cette dernière était devenue la doctrine officielle de l’armée française en 1895 avec la publication du Service des armées en campagne du 28 mai9.
Même si elle constituait la doctrine officielle de l’armée française, l’« offensive à outrance » était à peu près inconnue des troupes lorsque la guerre éclata10. En effet, les quelques mois d’instruction depuis la fin de l’année 1913 et le printemps 1914 n’avaient pas permis la diffusion du contenu des règlements dans les grandes unités qui n’avaient d’ailleurs jamais eu l’occasion de les appliquer au cours des grandes manœuvres d’automne. Aussi, l’« offensive à outrance » n’est-elle pas responsable des échecs et des pertes des premiers mois de la guerre. Dès lors, la responsabilité doit-elle être imputée à la doctrine précédente, celle de la « manœuvre napoléonienne » ? La réponse est également négative. En effet, celle-ci a été fortement remise en cause à partir du début des années 1900 par une pensée militaire touffue et critique11. De plus, elle a aussi connu de gros problèmes de diffusion auprès des cadres et de la troupe, notamment en raison des problèmes récurrents d’instruction et du fait que, à la même époque, les pères fondateurs de la doctrine quittèrent l’Ecole supérieure de guerre qui ne joua plus désormais son rôle de « courroie de transmission ».
La seule étude de la doctrine ne permet donc pas de savoir comment l’armée française s’est effectivement battue au début de la guerre, quels principes et quels procédés elle a appliqués. Il est d’ailleurs très difficile de déterminer les pratiques réelles en raison de leur diversité. D’une manière générale, celles-ci présentaient cependant trois caractéristiques principales.
Tout d’abord – et cela a été souligné par l’ensemble des historiens –, en 1914, l’armée française est très offensive. Les officiers de tous les niveaux hiérarchiques, tout comme la pensée militaire et les pratiques, sont en effet largement imprégnés de cet état d’esprit. Quant à la doctrine, si elle est aussi très offensive, elle contient, malgré tout, un certain équilibre entre offensive et défensive12.
La deuxième caractéristique de l’armée française est la non-maîtrise de la bataille moderne13. Si les militaires français se passionnent pour certaines innovations techniques, l’aviation et le canon de 75 en particulier, et si la doctrine intègre nombre de nouveautés, comme le montrent notamment la Conduite des grandes unités du 28 octobre 1913 et le Service des armées en campagne du 2 décembre 1913, beaucoup de ces matériels sont largement inconnus des officiers et des troupes ou leur emploi mal maîtrisé en raison des immenses lacunes de l’instruction. Les rapports d’inspections sur les grandes manœuvres montrent en effet que la conduite des formations (donnée d’ordre, rythme des activités, planification …), la collaboration interarmes, les liaisons horizontales et verticales, l’emploi des nouveaux moyens de communication comme le téléphone de campagne, la fortification de campagne ne sont pas maîtrisés. C’est ainsi qu’en 1913, le général de Langle de Carry écrit que l’instruction au combat des 1er et 2e corps d’armée est « presque entièrement à faire14 ».
Enfin, les pratiques de l’armée française se caractérisent par leur grande diversité15. Joffre, en dépit de l’important effort de redressement mené à partir de son accession à la tête de l’Etat-major général en 191116, commente ainsi l’état de l’instruction de l’armée française à la veille de la guerre :
« Ballottée depuis de longues années entre les théories les plus extrêmes, encadrée par des officiers rebelles à toutes les innovations, [les troupes] conservaient néanmoins une apathie et une indolence absolues […] le haut commandement manquait d’unité de vues : à chaque instant on voyait éclore des ‹ instructions › particulières qui commentaient, selon le tempérament du chef qui les rédigeait, les règlements de manœuvre.
En définitive, la masse de l’armée, longtemps maintenue dans un moule défensif, n’avait ni doctrine ni instruction17 ».
Cette diversité s’explique par l’absence d’une doctrine connue et acceptée de tous, la multiplicité des idées, des publications et des prescriptions, la faiblesse intellectuelle des officiers qui n’arrivaient généralement pas à digérer ce flot de nouveautés souvent complexes et fréquemment incohérentes, la grande autonomie des corps d’armée en matière d’instruction … D’une manière synthétique, trois catégories de troupes peuvent être mises en évidence si l’on excepte les forces coloniales18. Les corps d’armée les mieux instruits, les mieux équipés et les mieux commandés étaient les corps de couverture – au nombre de cinq, soit environ un quart de l’armée d’active – qui faisaient face à l’Allemagne et à l’Italie. Les autres corps d’armée d’active étaient « un ton en dessous », avec de grandes variations en fonction des régions et de la personnalité de leur commandant. Enfin, les troupes de réserve, soit 25 divisions, étaient les plus mal formées, notamment en raison de l’absence d’un encadrement instruit aux dernières nouveautés.
Les facteurs de changement des pratiques et de la doctrine
Les batailles des premières semaines montrèrent très vite les insuffisances des pratiques de l’armée française. Les trois offensives lancées en Alsace, en Lorraine et dans les Ardennes se soldèrent rapidement par des échecs, tandis que l’aile gauche du dispositif de l’armée était repoussée après les batailles de Charleroi et de la Sambre19. Très vite cependant aussi, devant l’ampleur des échecs, l’armée française commença à adapter ses pratiques aux réalités de la guerre. Ainsi, par exemple, la 13e Division d’infanterie dans ses combats de Lorraine le 14 août20. Après plusieurs assauts frontaux à la baïonnette, une nouvelle action était menée avec succès à 16 heures, combinant une attaque de fixation et une manœuvre de flanc, le tout appuyé par deux groupes de canons de 75. A la tête du Haut-Commandement, le général Joffre tira également très vite les enseignements des premiers engagements21. Dans sa Directive du 24 août qui devait être diffusée jusqu’aux plus bas échelons, le généralissime insistait sur la coopération entre l’artillerie et l’infanterie, la modération de l’ardeur offensive de l’infanterie, l’organisation défensive du terrain immédiatement après sa conquête … Comme le note Claude Franc, le simple fait de diffuser de telles consignes découlant d’enseignements tirés de combats à peine terminés « est de nature à nuancer tous les procès d’intention portés à l’encontre du GQG en termes d’opacité et de refus de considérer les réalités ».
La volonté d’adapter les pratiques aux réalités de la guerre est donc perceptible dès les premiers combats, et ce à tous les échelons. Au début, il s’agit surtout, pour les niveaux hiérarchiques supérieurs, de rappeler le contenu de la doctrine, preuve qu’elle n’était guère connue des troupes. Cependant, la volonté de modifier celle-ci apparaît aussi rapidement. Ainsi, la Directive du 24 août déjà mentionnée insistait sur la nécessité de préparer les attaques par l’artillerie et pas seulement de les appuyer22. Cette double adaptation des pratiques et de la doctrine dura tout au long du conflit. Au début, les échecs furent le principal moteur. D’autres facteurs contribuèrent cependant également à ce processus de transformation.
Les pertes furent le premier d’entre eux. Phénomène en lien direct avec les échecs, les pertes jouèrent un rôle majeur dans le changement des pratiques et de la doctrine. Aux échelons inférieurs, l’instinct de survie poussa les combattants à adopter des moyens qui leur permettaient de survivre, comme en témoigne la rapide mise en place de la guerre des tranchées par exemple. Aux échelons supérieurs – commandants des grandes unités et Haut-Commandement – la nécessité de conserver des effectifs suffisamment nombreux pour continuer la guerre conduisit également à chercher des moyens pour épargner la vie des hommes. Ceux-ci purent être d’ordre matériel, comme l’adoption d’un casque en acier, ou d’ordre doctrinal, comme les directives n° 1 du 19 mai 1917 et n° 4 du 22 décembre 1917 du général Pétain, relatives respectivement aux offensives à objectif limité et à la défensive du front23.
Les pertes eurent cependant une autre influence dans le domaine qui nous intéresse. Elles entraînèrent d’importants changements de fonctions dans les troupes et les commandements. Les millions de morts, de prisonniers et de blessés24, auxquels il faut ajouter les limogeages pour les officiers généraux25, laissèrent nombre de postes vacants que l’on dut repourvoir en faisant appel aux personnels que l’on jugeait les plus capables. L’arrivée à des postes différents et souvent hiérarchiquement plus élevés de personnes nouvelles et compétentes, dont nombre avaient participé aux débats doctrinaux d’avant guerre, contribua à la réflexion et au développement de solutions nouvelles. Les exemples célèbres sont connus : Foch, Mangin, Nivelle, Fayolle et, le plus significatif, Pétain, colonel proche de la retraite et penseur militaire original par l’équilibre de ses conceptions en 191426, devenu commandant en chef de l’armée au printemps 1917, armée qu’il réorganisa et à laquelle il donna une nouvelle doctrine27.
Dans le même ordre d’idées, l’intégration des réservistes au sein de l’armée d’active dynamisa l’élaboration de solutions nouvelles28. Les militaires issus des milieux civils abordèrent en effet les difficultés sans les a priori des militaires actifs et en employant leurs compétences civiles. Ainsi du lieutenant de réserve Cailloux qui, au début de l’année 1915, fit venir de sa ferme en Tunisie deux tracteurs à chenilles pour assurer les déplacements de l’artillerie lourde de son régiment29.
La nouvelle forme de la guerre, soit la guerre des tranchées, constitua un autre puissant facteur de transformation des pratiques et de la doctrine. A l’origine seule parade efficace contre la puissance du feu – il s’agissait d’une adaptation spontanée de la troupe pour survivre que le commandement chercha rapidement à organiser30 –, la fortification de campagne, sommaire au départ et de plus en plus élaborée avec le temps, devint rapidement le cadre spécifique de la guerre sur le front franco-allemand. Combinant protection du combattant, puissance de feu de l’artillerie et des armes automatiques, barbelés pour éviter les surprises et freiner la progression des assaillants, le nouveau système défensif se montra d’une redoutable efficacité, faisant échouer la majorité des offensives durant plus de trois ans. Il conditionna donc largement la réflexion militaire qui cherchait une solution capable de redonner à l’offensive sa supériorité31.
L’arrivée de nouveaux matériels représenta un autre facteur de transformation des pratiques et de la doctrine. Le tableau suivant montre le développement technique considérable que connut l’armée français au cours des quatre années de guerre32.

Cette arrivée massive de nouveaux matériels entraîna bien sûr une succession de réorganisations des armes et des troupes. Le tableau ci-dessous, qui donne l’évolution de l’importance relative des différentes armes entre 1914 et 1918, permet de s’en faire une idée33.

Dernier indice de cette transformation de l’armée, la proportion matériel/hommes équipés de fusils34. En 1914, on compte un engin d’infanterie35 pour 400 fusiliers, en 1918 un pour cinq. Pour le canon de 75, la proportion passe durant la même période de un pour 200 à un pour 55. Les transformations sont si spectaculaires que Claude Franc peut parler d’une « nouvelle armée » mise en place par Pétain à partir de 191736.
Enfin, le dernier facteur fut les pratiques de l’adversaire. D’une part, l’armée française s’inspire très vite des méthodes de combat allemandes, souvent plus efficaces. Comme l’écrit Michel Goya, les Allemands sont « d’excellents professeurs » dans les premiers temps de la guerre : « Le 23 août, durant la bataille de Dinant, le colonel de Fonclare, commandant le 127e RI, voit clairement l’exécution de l’attaque allemande contre une unité voisine : reconnaissance aérienne préalable, préparation d’artillerie intensive, infiltration appuyée par les mitrailleuses. Il conclut : ‹ une merveilleuse leçon pour nous ›37. »
D’autre part, la guerre étant un art dialectique38, chaque innovation technique, tactique ou opérationnelle a fait naître une contre-mesure chez l’adversaire. Michel Goya parle d’une « dialectique ‹ innovation-parade ›39 ». L’armée française s’adapta donc régulièrement pour répondre aux nouvelles pratiques des Allemands, comme le montre, par exemple, la célèbre Directive n° 4 du 22 décembre 1917 du général Pétain déjà mentionnée qui représentait la réponse à la nouvelle tactique offensive allemande développée sur le front de l’Est et mise en application lors de la bataille de Riga40.
Les processus de changement
Avec la guerre, les processus de changement des pratiques et de la doctrine se sont modifiés et complexifiés. Tout d’abord, ils perdirent leur caractère essentiellement pyramidal. Dès le début de la guerre, le Haut-Commandement n’était en effet pas en mesure de traiter l’ensemble des nombreuses difficultés qui se présentaient : « Les problèmes tactiques sont si nouveaux, si urgents et évoluent si vite que seules les unités au contact direct du front sont susceptibles d’y faire face à temps41 ». De nombreuses transformations ont ainsi été l’œuvre des régiments. Toutefois, les moyens limités de ces derniers ne permettaient que des « micro-transformations », c’est-à-dire des adaptations rapides mais de petite ampleur qui n’étaient pas forcément diffusées en dehors de la formation, chacun adoptant ses solutions propres.
Nombre de ces idées remontaient cependant la voie hiérarchique et parvenaient jusqu’au Haut-Commandement. Pour ce dernier, qui ne pouvait pas se contenter de les ignorer et de s’en tenir aux seules innovations issues de ses services, il s’agissait donc d’en assurer la gestion. Son rôle fut de sélectionner, de soutenir et de diffuser les idées remontant de la troupe, tout en veillant à garder une certaine cohérence et à éviter une trop grande évolution séparée des formations.
Entre la troupe et le Haut-Commandement, Michel Goya distingue trois catégories d’acteurs essentiels dans la diffusion de l’innovation42. La première est celle des « experts », parmi lesquels on trouve les as de la guerre aérienne qui en constituent le meilleur exemple. Leur savoir-faire ne se transmettait pas toujours facilement et nécessitait fréquemment un « processus lent d’imitation » et donc un contact au quotidien avec les hommes moins chevronnés. La deuxième catégorie est celle des « entrepreneurs » qui ont porté les projets plus complexes nécessitant davantage de développement technique. Parmi ces nombreux projets dont beaucoup ont été rejetés, signalons le mortier de tranchée proposé en novembre 1914 par le commandant du génie Duchêne et qui aboutit trois mois plus tard au canon de tranchée de 58 mm, ainsi que, dans un registre bien plus complexe, l’artillerie d’assaut du colonel Estienne43. Enfin, les généraux ont joué un rôle déterminant. Plus proches de la troupe que les officiers du Haut-Commandement, ils étaient davantage confrontés aux innovations en provenance de la troupe. De plus, leur position hiérarchique et, parfois, leur prestige, leur permettaient de soutenir efficacement les innovations qu’ils approuvaient. Ainsi de Pétain qui soutint dès 1915 les projets de char du colonel Estienne, commandant de l’artillerie de sa division au début de la guerre.
Les innovations connurent un « cycle de vie » souvent identique. La plupart d’entre elles sont nées de la demande, des besoins du front. Dans le domaine purement technique, elles n’ont pas été la conséquence de l’« offre » des milieux industriels, même si, bien sûr, le facteur scientifique ne saurait être négligé dans les processus d’innovation. L’efficacité de l’innovation suivait ensuite une « courbe en S. Elle débute en général lentement, se développe ensuite très vite puis connaît un ralentissement avant d’être relancée par de nouvelles méthodes ou rendue obsolète par une parade ennemie44 ». Sa durée de vie variait fortement. Elle pouvait être prolongée par la conservation du secret, l’avance technologique sur l’adversaire ou la faiblesse du coût de mise en œuvre par rapport à l’ennemi. Elle dépendait également de la rapidité avec laquelle l’innovation était mise en œuvre, ainsi que de la capacité d’adaptation de l’ennemi.
Deux éléments du processus d’évolution doivent être soulignés : son accélération par rapport à l’avant-guerre et sa discontinuité45. D’après le rythme de publication des règlements de manœuvre, le processus d’évolution a été, dans l’armée française, dix fois plus rapide au cours de la Première Guerre mondiale qu’auparavant. Ces évolutions se sont par ailleurs faites par à-coups, avec d’intenses changements sur des périodes courtes. On comprend dès lors mieux les chocs psychologiques auxquels ont été soumis les acteurs de la guerre et, par réaction, leur résistance aux changements.
En dépit des nécessités de changement, les innovations ont connu de nombreux freins, qui n’étaient pas seulement d’ordre technique ou financier46. Le « scepticisme » face au changement – surtout lorsqu’il est fréquent ou n’apporte pas toujours une solution aux problèmes ou seulement dans un futur considéré comme trop éloigné –, les « rivalités d’arme » ou entre les industries, les « préjugés » et les « rigidités héritées des habitudes » d’avantguerre – Michel Goya mentionne la « répugnance au retranchement », l’esprit offensif et la « phobie du terrain perdu » – ont constitué des obstacles au changement qui ont été plus ou moins difficiles à surmonter.
L’innovation et l’adaptation des pratiques ont constitué un véritable défi pour le Haut-Commandement français47. La gestion de ces nouveautés est venue s’ajouter à la tâche première qui était la sienne : la conduite des opérations. Au début de la guerre, le Haut-Commandement s’est concentré sur cette dernière, d’autant que l’on envisageait une guerre relativement courte, de l’ordre de quelques mois. L’adaptation des pratiques était vue de manière positive car elle était perçue comme une rectification des problèmes d’instruction connus dès avant le début des hostilités. Avec le temps, la question devint cependant plus complexe. D’une part, il ne suffisait plus de laisser les troupes s’adapter par elles-mêmes aux nouvelles conditions de la guerre. Sans un contrôle du Haut-Commandement, la diversité des pratiques en train de se mettre en place de manière anarchique aurait conduit à une autre forme d’absence d’unité de doctrine. D’autre part, nombre d’innovations étaient développées par le Haut-Commandement ou les commandants des grandes unités et devaient être diffusées à l’ensemble des troupes. Par ailleurs, il existait une tension croissante entre conduite des opérations et changements doctrinaux. La première nécessitait de l’autorité, les seconds du dialogue. Un seul et même organe pouvait difficilement faire les deux en même temps. Le GQG fut donc réorganisé. Cette réorganisation ne fut effective qu’à partir de mai 1917, avec l’arrivée de Pétain à la tête de l’armée. La grande innovation résida dans la création, le 23 mai 1917, d’une Section d’instruction au 3e Bureau, commandée par le lieutenant-colonel Paillé, dont la mission était de gérer la documentation en vue de la rédaction de la doctrine48.
Enfin, le Haut-Commandement a été confronté à la question de la diffusion des nouveautés tactiques et techniques et à leur assimilation par les troupes49. Les difficultés à résoudre ont été nombreuses. En effet, fréquemment engagées dans de violents combats, les troupes n’avaient que peu de temps à consacrer à une instruction rationnellement organisée dans des conditions optimales, d’autant que les terrains d’exercices, déjà insuffisants avant guerre, manquaient cruellement. De plus, l’importance des pertes impliquait une rapide disparition des savoir-faire. Enfin, chaque innovation nécessitait de former au préalable un nombre suffisant d’instructeurs avant de pouvoir commencer l’instruction des troupes.
Michel Goya distingue quatre phases dans la gestion du problème de l’instruction. Dans les premiers mois de la guerre, cette dernière se fit essentiellement de manière improvisée au « contact immédiat du front ». En 1915, dans le but de préparer les grandes offensives, les armées et les divisions mirent en place divers cours et écoles. De son côté, le Haut-Commandement créa les centres d’instruction divisionnaires et organisa le front en profondeur. Désormais, les troupes de première ligne étaient réduites au strict nécessaire, ce qui permit aux formations laissées en arrière de perfectionner leur instruction. L’année 1916 marqua une première rupture dans l’organisation de l’instruction. L’introduction de nouveaux équipements dans l’infanterie conduisit à la création d’un bataillon d’instruction dans chaque division. De plus, les commandants de groupe d’armées firent preuve de beaucoup d’initiatives individuelles, tout particulièrement le général Pétain qui se montra très actif dans le domaine, et ce dès sa prise de commandement du Groupe d’Armées Centre (GAC) en avril. Surtout, le Haut-Commandement commença à organiser l’instruction, notamment avec la création de diverses inspections et la parution, le 16 août, d’une note sur l’instruction des grandes unités dans les camps. Dès 1916 également, Pétain joua un rôle grandissant dans ce domaine. La note du GQG du 4 septembre sur l’organisation de l’instruction dans les armées, la première depuis le début de la guerre, reprenait largement les conceptions du commandant du GAC. Enfin, devenu commandant en chef, Pétain fit de l’instruction une de ses priorités50. Désormais, deuxième rupture, le GQG ne se contenta plus d’accompagner les changements. Il organisa l’instruction de manière rationnelle, par le haut. La Directive n° 2 de Pétain du 18 juin 1917 montrait une conception très large du domaine comprenant, outre l’instruction technique et tactique, l’éducation morale et la discipline. Bien qu’acceptée par la plupart des officiers, cette directive se heurta à des oppositions. De plus, de nouveaux enseignements furent tirés des récentes opérations. Ces deux facteurs conduisirent Pétain à émettre une nouvelle directive, la Directive n° 2 bis, qui parut le 30 décembre 191751.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.