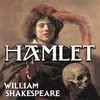Kitabı oku: «La méchante femme mise à la raison», sayfa 2
ACTE PREMIER
SCÈNE I
Padoue. – Place publique.
LUCENTIO ET TRANIO.
LUCENTIO. – Tranio, conduit par le violent désir que j'avais de voir la superbe Padoue, berceau des arts, me voici arrivé dans la fertile Lombardie, le riant jardin de la grande Italie; grâce à l'affection et à la complaisance de mon père, je suis armé de son bon vouloir et de ta bonne compagnie, ô mon loyal serviteur dont l'honnêteté est à toute épreuve; respirons donc ici, et commençons heureusement un cours de sciences et d'études littéraires. Pise, renommée par ses graves citoyens, m'a donné la naissance, et Vincentio, mon père, négociant qui fait un grand commerce dans le monde, descend des Bentivolio. Il convient que le fils de Vincentio, élevé à Florence pour remplir toutes les espérances qu'on a conçues de lui, orne sa fortune d'actions vertueuses. Ainsi, Tranio, pendant le temps que je consacrerai aux études, je veux m'appliquer à la recherche de la vertu, et de cette partie de la philosophie qui traite du bonheur que la vertu donne. Déclare-moi ta pensée, car j'ai quitté Pise, et je suis venu à Padoue comme un homme altéré qui quitte une mare peu profonde pour se plonger dans de profondes eaux et étancher sa soif.
TRANIO. -Mi perdonate9, mon aimable maître; je partage vos sentiments en tout; je suis ravi de vous voir persévérer dans votre résolution de savourer les douceurs de la douce philosophie. Seulement, mon cher maître, tout en admirant la vertu et cette discipline morale, ne devenons pas des stoïques, ni des sots, je vous en prie; ne soyons pas si dévoués aux durs préceptes d'Aristote, qu'Ovide soit entièrement mis de côté. Parlez logique avec les connaissances que vous avez, et pratiquez la rhétorique dans vos conversations journalières; usez de la musique et de la poésie pour ranimer vos esprits; livrez-vous aux mathématiques et à la métaphysique, selon ce que votre estomac pourra supporter; il n'y a point de fruit dans l'étude où il n'y a point de plaisir; en un mot, mon maître, suivez le genre d'étude qui vous plaira davantage.
LUCENTIO. – Grand merci, Tranio; tes avis sont fort sages. – Ah! Biondello, si tu étais arrivé sur ce rivage, nous pourrions faire ensemble nos préparatifs, et prendre un logement propre à recevoir les amis que le temps nous procurera dans Pise. – Mais, un moment, quelle est cette compagnie?
TRANIO. – Mon maître, c'est sans doute quelque cérémonie pour nous recevoir dans la ville.
(Entre Baptista avec Catherine et Bianca, Gremio et Hortensio.)
(Lucentio et Tranio se tiennent à l'écart.)
BAPTISTA. – Messieurs, ne m'importunez pas davantage; vous savez combien ma résolution est ferme et invariable: c'est de ne point donner ma cadette avant que j'aie trouvé un mari pour l'aînée. Si l'un de vous deux aime Catherine, comme je vous connais bien et que j'ai de l'amitié pour vous, je vous donne la liberté de la courtiser à votre gré.
GREMIO. – Plutôt la mettre sur une charrette10… elle est trop rude pour moi. Eh bien! Hortensio, voulez-vous une femme?
CATHERINE, à son père. – Je vous prie, mon père, est-ce votre volonté de me jeter à la tête de ces épouseurs?
HORTENSIO. – Épouseurs, ma belle? Comment l'entendez-vous? Oh! point d'épouseurs pour vous, à moins que vous ne deveniez d'une trempe plus aimable et plus douce.
CATHERINE. – En vérité, monsieur, vous n'avez que faire de craindre: je sais bien qu'on n'est pas encore à mi-chemin du coeur de Catherine. Mais, si l'on en était là, son premier soin serait de vous peigner la tête avec un banc à trois pieds, et de vous colorer la face de façon à vous travestir en fou.
HORTENSIO. – De pareilles diablesses, bon Dieu, préserve-nous!
GREMIO. – Et moi aussi, bon Dieu!
TRANIO, à l'écart. – Silence, mon maître: voici une scène propre à nous divertir. Cette fille est une vraie folle, ou incroyablement revêche.
LUCENTIO. – Mais je vois dans le silence de l'autre la douce réserve et la modestie d'une jeune fille. Taisons-nous, Tranio.
TRANIO. – Bien dit, mon maître; silence, et regardez tout votre soûl.
BAPTISTA. – Messieurs, pour commencer à exécuter la parole que je vous ai donnée… Bianca, rentre dans la maison, et que cela ne te fâche pas, ma bonne Bianca; car je ne t'en aime pas moins, ma mignonne.
CATHERINE. – La jolie petite! – Vous feriez bien mieux de lui enfoncer le doigt dans l'oeil; elle saurait pourquoi.
BIANCA. – Ma soeur, contentez-vous de la peine qu'on me fait. – (A son père.) Mon père, je souscris humblement à votre volonté; mes livres et mes instruments seront ma compagnie; je les étudierai et m'exercerai seule avec eux.
LUCENTIO, à part. – Écoute, Tranio, on croirait entendre parler Minerve.
HORTENSIO. – Seigneur Baptista, voulez-vous donc être si bizarre? Je suis bien fâché que l'honnêteté de nos intentions soit une occasion de chagrin pour Bianca.
GREMIO. – Comment? Voulez-vous donc la tenir en charte privée pour l'amour de cette furie d'enfer, et la punir de la méchante langue de sa soeur?
BAPTISTA. – Messieurs, arrangez-vous; ma résolution est prise. – Rentrez, Bianca. (Bianca sort.) Et comme je sais qu'elle prend beaucoup de plaisir à la musique, aux instruments et à la poésie, je veux faire venir chez moi des maîtres en état d'instruire sa jeunesse. – Si vous, Hortensio, ou vous, seigneur Gremio, en connaissez quelqu'un, amenez-le moi; car, j'accueillerai toujours les hommes de talent, et je ne veux rien épargner pour donner une bonne éducation à mes enfants. Adieu! – Catherine, vous pouvez rester; j'ai à causer avec Bianca.
(Il sort.)
CATHERINE. – Comment? mais je crois que je peux m'en aller aussi: ne le puis-je pas à mon gré? Quoi! on me fixera des heures? comme si, vraiment, je ne savais pas bien moi-même ce qu'il convient de prendre, ou de laisser. Ah!
(Elle sort.)
GREMIO. – Tu peux aller trouver la femme du diable; tes qualités sont si précieuses que personne ne veut de toi. L'amour qu'elles inspirent n'est pas si ardent que nous ne puissions souffler ensemble dans nos doigts, Hortensio, et le rendre nul par l'abstinence; notre gâteau est à moitié cuit des deux côtés. Adieu! Cependant, pour l'amour que je porte à ma douce Bianca, si je peux, par quelque moyen, rencontrer l'homme qui convient pour lui montrer les arts qu'elle chérit, je le recommanderai à son père.
HORTENSIO. – Et moi aussi, seigneur Gremio. Mais un mot, je vous prie. Quoique la nature de notre querelle n'ait jamais souffert les longs entretiens, apprenez aujourd'hui, sur bonne réflexion, que c'est à nous, dans la vue de pouvoir encore trouver accès auprès de notre belle maîtresse, et d'être heureux rivaux dans notre amour pour Bianca, à donner tous nos soins à une chose surtout…
GREMIO. – Qu'est-ce que c'est, je vous prie?
HORTENSIO. – Ce que c'est? C'est de trouver un mari à sa soeur aînée.
GREMIO. – Un mari? Un démon plutôt.
HORTENSIO. – Je dis, moi, un mari.
GREMIO. – Et moi, je dis un démon. Penses-tu, Hortensio, que, malgré toute l'opulence de son père, il y ait un homme assez fou pour épouser l'enfer?
HORTENSIO. – Tout beau, Gremio. Quoiqu'il soit au-dessus de votre patience et de la mienne d'endurer ses importunes clameurs, il est, ami, dans le monde, de bons compagnons, si l'on pouvait mettre la main dessus, qui la prendraient avec tous ses défauts, et assez d'argent.
GREMIO. – Je ne sais qu'en dire; mais j'aimerais mieux, moi, prendre la dot sans elle, à condition que je serais fouetté tous les matins à la grande croix du carrefour.
HORTENSIO. – Ma foi, comme vous dites; il n'y a guère à choisir entre des pommes gâtées. – Mais, allons: puisque cet obstacle commun nous rend amis, notre amitié durera jusqu'au moment où, en trouvant un mari à la fille aînée de Baptista, nous procurerons à sa jeune soeur la liberté d'en recevoir un; et alors, libre à nous de recommencer la querelle. – Chère Bianca! – Que le plus heureux l'emporte! Celui qui court le plus vite, gagne la bague: qu'en dites-vous, seigneur Gremio?
GREMIO. – J'en conviens, et je voudrais lui avoir déjà procuré le meilleur étalon de Padoue, pour venir lui faire sa cour, la conquérir, l'épouser, coucher avec elle, et en débarrasser la maison. – Allons, sortons.
(Gremio et Hortensio sortent.)
(Tranio s'avance.)
TRANIO. – Je vous en prie, monsieur, dites-moi une chose. – Est-il possible que l'amour prenne si fort en un instant?
LUCENTIO. – Oh! Tranio, jusqu'à ce que j'en eusse fait l'expérience, je ne l'avais cru ni possible, ni vraisemblable: mais vois! tandis que j'étais là oisif à regarder, l'amour m'a surpris dans mon insouciance, et maintenant j'en ferai l'aveu avec franchise, à toi, mon confident, qui m'es aussi cher et qui es aussi discret que l'était Anne pour la reine de Carthage: Tranio, je brûle, je languis, je péris, Tranio, si je ne viens pas à bout de posséder cette jeune et modeste fille. Conseille-moi, Tranio, car je sais que tu le peux: assiste-moi, Tranio, car je sais que tu le veux.
TRANIO. – Maître, il n'est plus temps maintenant de vous gronder; on ne déracine pas l'affection du coeur: si l'amour vous a blessé, il ne reste plus que ceci: Redime te captum quam queas minimo11.
LUCENTIO. – Mille grâces, mon ami, poursuis: ce que tu m'as déjà dit me satisfait: le reste ne peut que me consoler; car tes avis sont sages.
TRANIO. – Maître, vous qui avez si longtemps considéré la jeune personne, vous n'avez peut-être pas remarqué le plus important de la chose?
LUCENTIO. – Oh! très-bien; j'ai vu la beauté dans ses traits, égale à celle de la fille d'Agénor12, qui fit humilier le grand Jupiter, lorsqu'au signe de sa main il baisa de ses genoux les rivages de Crète.
TRANIO. – N'avez-vous vu que cela? N'avez-vous pas remarqué comme sa soeur a commencé à s'emporter, comme elle a soulevé une si violente tempête, que des oreilles humaines avaient bien de la peine à endurer son vacarme?
LUCENTIO. – Ah! Tranio, j'ai vu remuer ses lèvres de corail, et son haleine a parfumé l'air; tout ce que j'ai vu dans sa personne était doux et sacré.
TRANIO. – Allons, il est temps de le tirer de son extase. – Je vous en prie, monsieur, réveillez-vous; si vous aimez cette jeune fille, appliquez vos pensées et votre esprit aux moyens de l'obtenir. Voici l'état des choses. – Sa soeur aînée est si maudite et si méchante que, jusqu'à ce que son père soit débarrassé d'elle, il faut, mon maître, que votre amour reste fille au logis; aussi son père l'a resserrée étroitement, afin qu'elle ne soit pas importunée de soupirants.
LUCENTIO. – Ah! Tranio, quel père cruel! Mais, n'as-tu pas remarqué le soin qu'il prend pour lui procurer d'habiles maîtres, en état de l'instruire?
TRANIO. – Oui, vraiment, monsieur; et j'ai même comploté là-dessus…
LUCENTIO. – Oh! j'ai un plan aussi, Tranio.
TRANIO. – En vérité, mon maître, je jure par ma main que nos deux stratagèmes se ressemblent, et se confondent en un seul.
LUCENTIO. – Dis-moi le tien, d'abord.
TRANIO. – Vous serez le maître, et vous vous chargerez d'instruire la jeune personne: voilà quel est votre plan?
LUCENTIO. – Oui. Cela peut-il se faire?
TRANIO. – Impossible: car, qui vous remplacera, et sera ici dans Padoue le fils de Vincentio? Qui tiendra maison, étudiera ses livres, recevra ses amis, visitera ses compatriotes et leur donnera des fêtes?
LUCENTIO. – Basta13! tranquillise-toi, tout cela est arrangé: nous n'avons encore paru dans aucune maison: personne ne peut nous reconnaître à nos physionomies, ni distinguer le maître du valet. D'après cela, voici la suite: – Tu seras le maître, Tranio, à ma place; tu tiendras la maison, tu en prendras les airs, commanderas les domestiques, comme je ferais moi-même; moi, je serai quelqu'autre, un Florentin, un Napolitain, ou quelque jeune homme peu considérable de Pise. Le projet est éclos, et il s'exécutera. – Tranio, déshabille-toi tout de suite; prends mon manteau et mon chapeau de couleur: quand Biondello viendra, il sera à ta suite; mais je veux auparavant lui apprendre à tenir sa langue.
(Ils échangent leurs habits.)
TRANIO. – Vous auriez besoin de le faire. – Bref, mon maître, puisque c'est votre plaisir, et que je suis lié à vous obéir (car votre père me l'a recommandé au moment du départ: rends tous les services à mon fils, m'a-t-il dit; quoique, à mon avis, il l'entendît dans un autre sens), je veux bien être Lucentio, parce que j'aime tendrement Lucentio.
LUCENTIO. – Tranio, sois-le, parce que Lucentio aime, et laisse-moi faire le personnage d'un esclave, pour conquérir cette jeune beauté, dont la soudaine vue a enchaîné mes yeux blessés. (Entre Biondello.) Voici le fripon. – Eh bien! coquin, où as-tu donc été?
BIONDELLO. – Où j'ai été?.. Eh mais! vous, où êtes-vous vous-même à présent? Mon maître, est-ce que mon camarade Tranio vous aurait volé vos habits? ou si c'est vous qui lui avez pris les siens? ou vous êtes-vous volés réciproquement? Je vous prie, parlez, quoi de nouveau?
LUCENTIO. – Drôle, approche ici; il n'est pas temps de plaisanter: ainsi songe à te conformer aux circonstances. Ton camarade que voilà, Tranio, pour me sauver la vie, prend mon rôle et mes habits; et moi, pour échapper au malheur, je mets les siens; car depuis que j'ai abordé ici, j'ai, dans une querelle, tué un homme, et je crains d'être découvert: mets-toi à ses ordres et à sa suite, je te l'ordonne, et sers-le comme il convient, tandis que moi je vais m'échapper pour mettre ma vie en sûreté: tu m'entends?
BIONDELLO. – Oui, monsieur, pas le plus petit mot.
LUCENTIO. – Et pas un mot de Tranio dans ta bouche. Tranio est changé en Lucentio.
BIONDELLO. – Tant mieux pour lui; je voudrais bien l'être aussi, moi.
TRANIO. – Et moi, foi de valet, je voudrais bien, pour former le second souhait, que Lucentio eût la plus jeune fille de Baptista. – Mais, monsieur le drôle… pas pour moi, mais pour l'amour de votre maître, je vous avertis de vous conduire avec discrétion dans toute espèce de compagnie; quand je serai seul, je serai Tranio pour vous; mais partout ailleurs votre maître Lucentio.
LUCENTIO. – Tranio, allons nous-en. – Il reste encore un point que je te charge, toi, d'exécuter: – c'est de te placer au nombre des prétendants. – Si tu m'en demandes la raison… il suffit… Mes raisons sont bonnes et convaincantes.
(Ils sortent.)
(Personnages du prologue.)
PREMIER SERVITEUR. – «Milord, vous sommeillez, vous n'écoutez pas la pièce.
SLY. – «Si, par sainte Anne, je l'écoute. Une bonne drôlerie, vraiment! Y en a-t-il encore à venir?
LE PAGE. – «Milord, elle ne fait que commencer.
SLY. – «C'est vraiment une excellente pièce d'ouvrage, madame Lady; je voudrais être à la fin.»
SCÈNE II
Devant la maison d'Hortensio.
PETRUCHIO, GRUMIO
PETRUCHIO. – Vérone, je prends congé de toi pour quelque temps; je veux voir mes amis de Padoue: mais avant tout, Hortensio, le plus cher et le plus fidèle de mes amis. – Eh! je crois que voici sa maison. – Ici, drôle, allons, frappe, te dis-je.
GRUMIO. – Frapper, monsieur! qui frapperais-je? quelqu'un vous a-t-il offensé?
PETRUCHIO. – Allons, maraud, frappe-moi ici comme il faut, te dis-je.
GRUMIO. – Vous frapper ici, monsieur? Comment donc, monsieur? Qui suis-je, monsieur, pour oser vous frapper ici, monsieur?
PETRUCHIO. – Coquin, frappe-moi à cette porte, et fort, te dis-je, ou je cognerai ta tête de fripon.
GRUMIO. – Mon maître est devenu querelleur. Je vous frapperais le premier: mais je sais qui en porterait la peine.
PETRUCHIO. – Tu t'obstines: je te jure, coquin, que si tu ne frappes pas, je frapperai, moi, et je verrai comment tu sauras dire et chanter sol, fa…
(Il tire les oreilles à Grumio.)
GRUMIO. – Au secours! au secours! mon maître est fou!
PETRUCHIO. – Allons, frappe, quand je te l'ordonne, drôle, coquin!
(Entre Hortensio.)
HORTENSIO. – Comment donc? de quoi s'agit-il, mon vieux ami Grumio, et mon cher Petruchio? Comment vous portez-vous tous à Vérone?
PETRUCHIO. – Signor Hortensio, venez-vous terminer la bataille? -Con tutto il core bene trovato, puis-je dire.
HORTENSIO.
Alla nostra casa bene venuto
Molto honorato signor mio Petruchio.
Lève-toi, Grumio, lève-toi; nous arrangerons cette querelle.
GRUMIO. – Peu m'importe ce qu'il allègue en latin, – si ce n'est pas pour moi un motif légitime de quitter mon service. – Voyez-vous, monsieur, il me disait de le frapper et de le frotter comme il faut, monsieur; eh bien! était-il convenable qu'un serviteur traitât son maître ainsi, ayant sur moi d'ailleurs, autant que je puis voir, l'avantage de trente-deux contre un! Plût à Dieu que je l'eusse frappé d'abord. Grumio n'aurait pas eu tous les coups.
PETRUCHIO. – Un stupide coquin! – Cher Hortensio, je dis à ce drôle de frapper à votre porte, et je n'ai jamais pu obtenir cela de lui.
GRUMIO. – Frapper à la porte? – O ciel! ne m'avez-vous pas dit en propres termes: Coquin, frappe-moi ici, frappe-moi bien, frappe-moi comme il faut? et vous venez maintenant me parler de frapper à la porte.
PETRUCHIO. – Drôle, va-t'en, je te le conseille.
HORTENSIO. – Patience, Petruchio; je suis la caution de Grumio; vraiment la chance est trop inégale entre vous et lui; c'est votre ancien, fidèle et aimable serviteur Grumio. Allons, dites-moi donc, mon cher ami, quel heureux vent vous a conduit de l'antique Vérone ici, à Padoue?
PETRUCHIO. – Le vent qui disperse les jeunes gens dans le monde, et les envoie tenter fortune hors de leur pays natal, où l'on n'acquiert que bien peu d'expérience. En peu de mots, seigneur Hortensio, voici mon histoire: Antonio, mon père, est décédé, et je me suis hasardé à faire ce voyage pour me marier richement et vivre du mieux qu'il me sera possible; j'ai des écus dans ma bourse, des terres dans mon pays, et je suis venu voir le monde.
HORTENSIO. – Petruchio, te parlerai-je sans détour et te souhaiterai-je une laide et méchante femme? Tu ne me remercierais guère de l'avis, et cependant je te garantis qu'elle sera riche, et très-riche; mais tu es trop mon ami, et je ne te la souhaiterai pas pour épouse.
PETRUCHIO. – Seigneur Hortensio, entre amis comme nous, il n'y a que deux mots: ainsi, si tu connais une femme assez riche pour être l'épouse de Petruchio (comme la fortune est le refrain de ma chanson d'amour14, fût-elle aussi laide que l'était l'amante de Florent15, aussi vieille que la Sibylle, et aussi acariâtre, aussi méchante que la Xantippe de Socrate, ou pire encore, cela n'émeut, ni ne rebute mon goût, fût-elle aussi rude que les flots irrités de l'Adriatique. Je viens pour me marier richement à Padoue: si je me marie richement, je me trouverai marié heureusement à Padoue.
GRUMIO. – Vous le voyez, monsieur; il vous dit sa pensée tout platement: oui, donnez-lui assez d'or, et mariez-le à une poupée, à une poupée, à une petite figure d'aiguillette16, ou bien à une vieille octogénaire à qui il ne reste pas une dent dans la bouche, eût-elle autant d'infirmités que cinquante-deux chevaux, tout sera à merveille si l'argent s'y trouve.
HORTENSIO. – Petruchio, puisque nous nous sommes avancés si loin, je veux poursuivre sérieusement l'idée que je t'avais jetée d'abord par pure plaisanterie. Je suis en état, Petruchio, de te procurer une femme assez bien pourvue de la fortune, jeune et belle, élevée comme la fille la mieux née; tout son défaut, et c'est un assez grand défaut, c'est qu'elle est intolérablement méchante, acariâtre, bourrue, à un point si terrible que, ma fortune fût-elle bien plus délabrée qu'elle ne l'est, je ne voudrais pas l'épouser, moi, pour une mine d'or.
PETRUCHIO. – Silence, Hortensio: tu ne connais pas l'effet et la vertu de l'or. – Dis-moi le nom de son père, et cela suffit; car je prétends l'attaquer, quand ses clameurs surmonteraient les éclats du tonnerre, lorsque les nuages crèvent en automne.
HORTENSIO. – Son père est Baptista Minola, gentilhomme affable et courtois, et son nom Catherine Minola, fameuse dans Padoue par sa langue grondeuse.
PETRUCHIO. – Oh! je connais son père, quoique je ne la connaisse pas, elle; et il connut beaucoup feu mon père. – Je ne dormirai pas, Hortensio, que je ne la voie; ainsi, permettez que j'en use assez librement avec vous, pour vous quitter brusquement dans cette première entrevue, si vous ne voulez pas m'accompagner jusqu'à sa demeure.
GRUMIO. – Je vous en prie, monsieur, laissez-le suivre son entreprise, tandis qu'il est en humeur. Sur ma parole, si elle le connaissait aussi bien que je le connais, elle jugerait bientôt que les criailleries feraient peu de chose sur lui; elle pourra bien, peut-être, le traiter dix fois de coquin ou autres épithètes semblables. Eh bien! tout cela n'est rien; s'il s'y met une fois, il s'en moquera avec ses réponses adroites. Voulez-vous que je vous dise, monsieur: pour peu qu'elle lui résiste, il lui jettera une figure17 sur la face, et vous la défigurera si bien qu'elle n'aura pas plus d'yeux pour y voir clair qu'un chat18; vous ne le connaissez pas, monsieur.
HORTENSIO. – Attendez-moi, Petruchio; il faut que je vous accompagne; car mon trésor est enfermé sous la clef de Baptista; il tient entre ses mains le joyau de ma vie, sa fille cadette, la belle Bianca, et il la dérobe à mes regards et aux poursuites de plusieurs autres aspirants, qui sont mes rivaux en amour. En supposant qu'il soit impossible (à cause des défauts que je vous ai exposés) que Catherine soit jamais épousée, Baptista a résolu que jamais homme n'aurait accès auprès de Bianca, que Catherine la méchante n'eût trouvé un mari.
GRUMIO. – Catherine la méchante! c'est, pour une jeune fille, le pire de tous les titres.
HORTENSIO. – Il faut maintenant que mon ami Petruchio me rende un service; c'est de me présenter déguisé sous un costume sévère au vieux Baptista, comme un maître versé dans la musique, et en état de bien l'enseigner à Bianca, afin que, par cette ruse, je puisse au moins avoir la liberté et la commodité de lui faire ma cour, et de l'entretenir elle-même de ma tendresse, sans donner aucun ombrage.
(Entre Gremio, avec lui est Lucentio déguisé avec des livres sous le bras.)
GRUMIO. – Ce ne sont pas là des friponneries? non! – Voyez comme, pour attraper les vieillards, les jeunes gens mettent leur tête sous un bonnet! Maître! maître, regardez autour de vous, qui passe là, hein?
HORTENSIO. – Silence, Grumio, c'est mon rival. – Petruchio, tenons-nous un moment à l'écart.
GRUMIO. – Un joli jeune homme, et un bel amoureux.
(Il se retire.)
GREMIO, répondant à Lucentio. – Oh! très-bien: j'ai bien lu la note. – Écoutez bien, monsieur; je les veux superbement reliés: tous livres d'amour, songez-y bien, et ne lui faites aucune autre lecture. Vous m'entendez? En outre, par-dessus les libéralités que vous fera le seigneur Baptista, j'y ajouterai encore un présent. – Prenez aussi vos papiers, et qu'ils soient bien parfumés, car celle à qui ils sont destinés est plus douce que les parfums mêmes. – Que lui lirez-vous?
LUCENTIO. – Quelque lecture que je lui fasse, je plaiderai votre cause comme pour mon patron (soyez-en bien assuré) et avec autant de chaleur que si vous-même étiez à ma place; oui, et peut-être avec des termes plus éloquents et plus persuasifs que vous, monsieur, à moins que vous ne fussiez un savant.
GREMIO. – Oh! cette science! ce que c'est!
GRUMIO. – Oh! cet oison, quel imbécile c'est!
PETRUCHIO. – Paix, maraud.
HORTENSIO. – Grumio, motus! – Dieu vous garde, seigneur Gremio.
GREMIO. – Ah! charmé de vous rencontrer, seigneur Hortensio. Savez-vous où je vais de ce pas? – Chez Baptista Minola! Je lui ai promis de lui chercher avec soin un maître pour la belle Bianca, et le hasard a voulu que je tombasse sur ce jeune homme; par sa science et ses manières, il est ce qui convient à Bianca, très-instruit dans la poésie, et autres livres; et des bons, je vous le garantis.
HORTENSIO. – C'est à merveille; et moi j'ai rencontré un honnête homme qui m'a promis de m'en procurer un autre, un charmant musicien, pour instruire notre maîtresse: ainsi je ne demeurerai pas en arrière dans ce que je dois à la belle Bianca, qui m'est si chère, à moi.
GREMIO. – Oui, qui m'est si chère: – Et cela, ma conduite le prouvera.
GRUMIO, à part. – Et cela, ses sacs le prouveront.
HORTENSIO. – Gremio, ce n'est pas ici le moment d'éventer notre amour. Écoutez-moi; et si vous êtes honnête avec moi, je vous dirai des nouvelles assez bonnes pour tous deux. Voici un honnête homme que le hasard m'a fait rencontrer, qui, favorisé par nous dans ses goûts, entreprendra de courtiser la méchante Catherine. Oui, et même de l'épouser si sa dot lui convient.
GREMIO. – Soit dit et fait; c'est à merveille. – Hortensio, lui avez-vous révélé tous ses défauts?
PETRUCHIO. – Je sais que c'est une méchante femme qui crie et tempête sans cesse; si c'est là tout, messieurs, je ne vois point de mal à cela.
GREMIO. – Non, dites-vous, ami? – De quel pays est ce cavalier?
PETRUCHIO. – Je suis né à Vérone, le fils du vieillard Antonio; mon père étant mort, ma fortune commence à vivre pour moi, et j'espère voir de longs et heureux jours.
GREMIO. – Oh! monsieur, ce serait une chose bien étrange qu'une pareille vie avec une pareille femme! Mais si vous vous sentez ce courage, allons vite à l'oeuvre, au nom de Dieu! Vous pouvez compter sur mon secours en tout. Mais sérieusement, est-ce que vous voulez faire votre cour à ce chat sauvage?
PETRUCHIO. – Veux-je vivre?
GRUMIO, à part. – S'il veut lui faire sa cour? oui, ou elle ira au diable.
PETRUCHIO. – Et pourquoi suis-je venu ici, si ce n'est dans cette résolution? Croyez-vous que mes oreilles s'épouvantent de quelque bruit? N'ai-je pas entendu dans ma vie des lions rugir? N'ai-je pas vu la mer battue des vents courroucés comme un sanglier écumant et suant de rage? N'ai-je pas entendu une batterie de canons dans la plaine, et l'artillerie des cieux tonner sous leur voûte? N'ai-je pas, dans une bataille rangée, entendu les clameurs confuses, les coursiers hennissants, les trompettes éclatantes? Et vous venez me parler de la langue d'une femme qui ne peut jamais faire dans l'oreille le bruit d'une châtaigne qui éclate dans la cheminée d'un fermier? Bah, bah! c'est aux enfants qu'il faut faire peur des fantômes.
GRUMIO, à part. – Oh! il n'en craint aucun.
GREMIO. – Hortensio, écoutez: ce gentilhomme est heureusement arrivé, à ce que me dit mon pressentiment, pour son avantage et pour le nôtre.
HORTENSIO. – J'ai promis de l'aider de nos services et de porter une partie du fardeau de ses avances, quoi qu'il en soit.
GREMIO. – Et j'y consens aussi, moi, bien volontiers, pourvu qu'il vienne à bout de l'obtenir.
GRUMIO, à part. – Je voudrais être aussi sûr d'un bon dîner. (Entrent Tranio, richement vêtu, et Biondello.)
TRANIO. – Salut, messieurs. Si vous le permettez, dites-moi, je vous en conjure, quel est le chemin le plus court pour se rendre à la maison du seigneur Baptista Minola?
GREMIO. – Celui qui a deux filles si belles? (A part, à Tranio.) Est-ce lui que vous demandez?
TRANIO. – Lui-même. – Biondello!
GREMIO. – Écoutez-moi, monsieur; vous ne demandez pas celle…
TRANIO. – Peut-être lui et elle; que vous importe?
PETRUCHIO. – Non pas celle qui est si querelleuse, monsieur, je vous en prie, en aucune façon.
TRANIO. – Je n'aime pas les querelleurs, monsieur. – Biondello, marchons.
LUCENTIO, à part. – Fort bien débuté, Tranio.
HORTENSIO. – Monsieur, un mot avant de nous quitter. – Êtes-vous un prétendant à la fille dont vous parlez, oui ou non?
TRANIO. – Et si cela était, monsieur, vous en offenseriez-vous?
GREMIO. – Non, pourvu que sans une parole de plus vous prissiez le large.
TRANIO. – Comment, monsieur! Est-ce que les rues ne sont pas ouvertes pour moi comme pour vous?
GREMIO. – Mais non pas elle.
TRANIO. – Et pour quelle raison, je vous prie?
GREMIO. – Pour la raison, si vous voulez le savoir, qu'elle est choisie par le seigneur Gremio.
HORTENSIO. – Et parce qu'elle est choisie par le seigneur Hortensio.
TRANIO. – Doucement, messieurs. Si vous êtes d'honnêtes gentilshommes, faites-moi la grâce de m'écouter avec patience. Baptista est un noble citoyen à qui mon père n'est pas tout à fait inconnu, et si sa fille était plus belle qu'elle n'est, elle pourrait avoir plus d'amants encore, sans que je dusse renoncer à être du nombre. La fille de la belle Léda eut mille soupirants: la charmante Bianca peut bien en avoir un de plus, et elle l'aura aussi. Lucentio se mettra sur les rangs, quand Pâris viendrait se présenter avec l'espoir d'être seul à faire sa cour.
GREMIO. – Quoi! ce jeune homme nous fermera la bouche à tous?
LUCENTIO. – Monsieur, lâchez-lui la bride; je sais qu'il n'ira pas bien loin.
PETRUCHIO. – Hortensio, à quoi bon tant de paroles?
HORTENSIO, à Tranio. – Monsieur, permettez-moi de vous faire une question: avez-vous jamais vu la fille de Baptista?
TRANIO. – Non, monsieur; mais j'apprends qu'il a deux filles: l'une fameuse par sa méchante langue, autant que l'autre l'est par sa modestie et sa beauté.
PETRUCHIO. – Monsieur, monsieur, la première est pour moi; mettez-la de côté.
GREMIO. – Oui, laissez cette tâche au grand Hercule, et ce sera plus que ses douze travaux.
PETRUCHIO. – Monsieur, écoutez et comprenez bien ce que je vais vous dire. – La plus jeune fille, à laquelle vous prétendez, est tenue par son père loin de tout accès aux demandes; et son père ne la promettra à personne que sa soeur aînée ne soit mariée la première. Ce ne sera qu'alors que la cadette sera libre, et non avant.
TRANIO. – Si cela est ainsi, monsieur, et que vous soyez l'homme qui deviez nous servir tous, et moi comme les autres, si vous rompez la glace, et que vous veniez à bout de cet exploit, que vous fassiez la conquête de l'aînée, et que vous nous ouvriez l'accès auprès de la cadette; celui qui aura le bonheur de la posséder ne sera pas assez mal né pour être un ingrat.