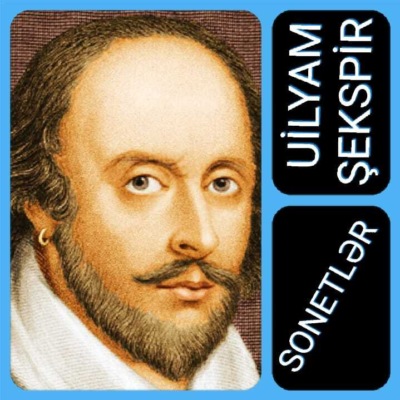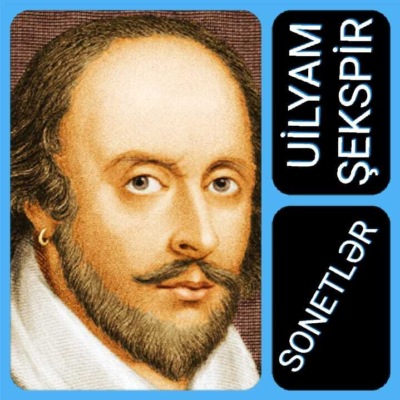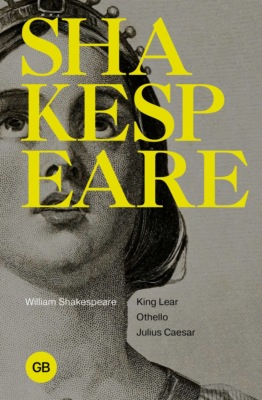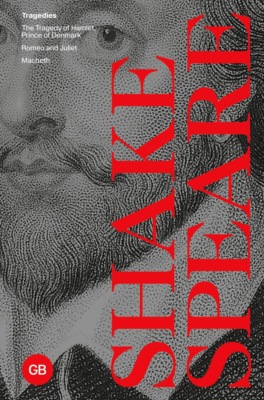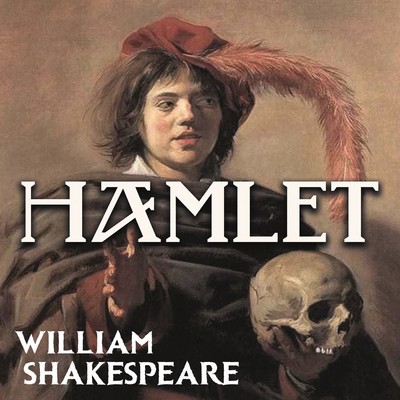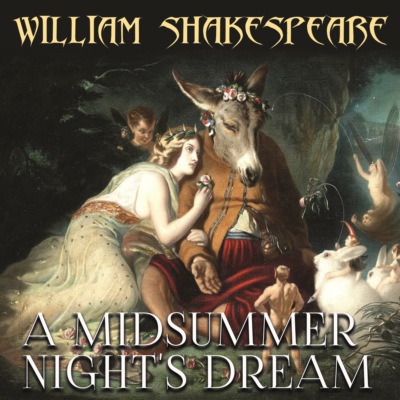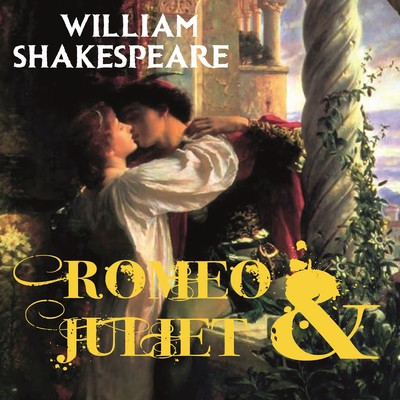Kitabı oku: «La Tempête», sayfa 5
SCÈNE III
(Une autre partie de l'île.)
Entrent ALONZO, SÉBASTIEN, ANTONIO, GONZALO, ADRIAN, FRANCISCO ET AUTRES.
GONZALO. – Par Notre-Dame, je ne puis aller plus loin, seigneur. Mes vieux os me font mal; c'est un vrai labyrinthe que nous avons parcouru là par tant de sentiers, droits ou tortueux. J'en jure par votre patience, j'ai besoin de me reposer.
ALONZO. – Mon vieux seigneur, je ne peux te blâmer; je sens moi-même la lassitude tenir mes esprits dans l'engourdissement. Asseyez-vous et reposez-vous; et moi je veux laisser ici mon espoir, et ne pas plus longtemps lui permettre de me flatter. Il est noyé, celui après lequel nous errons ainsi, et la mer se rit de ces vaines recherches que nous avons faites sur la terre. Soit, qu'il repose en paix!
ANTONIO, bas à Sébastien. – Je suis bien aise qu'il soit ainsi tout à fait sans espérance. – N'allez pas pour un contretemps renoncer au projet que vous étiez résolu d'exécuter.
SÉBASTIEN. – Nous l'accomplirons à la première occasion favorable.
ANTONIO. – Cette nuit donc; car, épuisés comme ils le sont par cette marche, ils ne voudront ni ne pourront exercer la même vigilance que lorsqu'ils sont frais et dispos.
SÉBASTIEN. – Oui, cette nuit; n'en parlons plus.
(On entend une musique solennelle et singulière. Prospero est invisible dans les airs. Entrent plusieurs fantômes sous des formes bizarres, qui apportent une table servie pour un festin. Ils forment autour de la table une danse mêlée de saluts et de signes engageants, invitant le roi et ceux de sa suite à manger. Ils disparaissant ensuite.)
ALONZO. – Quelle est cette harmonie? mes bons amis, écoutons!
GONZALO. – Une musique d'une douceur merveilleuse.
ALONZO. – Ciel! ne nous livrez qu'à des puissances favorables. Quels étaient ces gens-là?
SÉBASTIEN. – Des marionnettes vivantes. Maintenant je croirai qu'il existe des licornes, qu'il est dans l'Arabie un arbre servant de trône au phénix, et qu'un phénix y règne encore aujourd'hui.
ANTONIO. – Je crois à tout cela; et, si l'on refuse d'ajouter foi à quelque autre chose, je jurerai qu'elle est vraie. Jamais les voyageurs n'ont menti, quoique dans leurs pays les idiots les condamnent.
GONZALO. – Voudrait-on me croire si je racontais ceci à Naples? Si je leur disais que j'ai vu des insulaires ainsi faits, car certainement c'est là le peuple de cette île; et, qu'avec des formes monstrueuses, ils ont, remarquez bien ceci, des moeurs plus douces que vous n'en trouveriez chez beaucoup d'hommes de notre temps, je dirais presque chez aucun?
PROSPERO, à part. – Honnête seigneur, tu as dit le mot; car quelques-uns de vous ici présents êtes pires que des démons.
ALONZO. – Je ne me lasse point de songer à leurs formes étranges, à leurs gestes, à ces sons qui, bien qu'il y manque l'assistance de la parole, expriment pourtant dans leur langage muet d'excellentes choses.
PROSPERO, à part. – Ne louez pas avant le départ.
FRANCISCO. – Ils se sont étrangement évanouis.
SÉBASTIEN. – Qu'importe! puisqu'ils ont laissé les munitions, car nous avons faim. – Vous plairait-il de goûter de ceci?
ALONZO. – Non pas moi.
GONZALO. – Ma foi, seigneur, vous n'avez rien à craindre. Quand nous étions enfants, qui aurait voulu croire qu'il existât des montagnards portant des fanons comme les taureaux, et ayant à leur cou des masses de chair pendantes; et qu'il y eût des hommes dont la tête fût placée au milieu de leur poitrine? Et cependant nous ne voyons pas aujourd'hui d'emprunteur de fonds à cinq pour un15 qui ne nous rapporte ces faits dûment attestés.
ALONZO. – Je m'approcherai de cette table et je mangerai, dût ce repas être pour moi le dernier. Eh! qu'importe! puisque le meilleur de ma vie est passé. Mon frère, seigneur duc, approchez-vous et faites comme nous.
(Des éclairs et du tonnerre. Ariel, sous la forme d'une harpie, fond sur la table, secoue ses ailes sur les plats, et par un tour subtil le banquet disparaît.)
ARIEL. – Vous êtes trois hommes de crime que la destinée (qui se sert comme instrument de ce bas monde et de tout ce qu'il renferme) a fait vomir par la mer insatiable dans cette île où n'habite point l'homme, parce que vous n'êtes point faits pour vivre parmi les hommes. Je vous ai rendus fous. (Voyant Alonzo, Sébastien et les autres tirer leurs épées.)
C'est avec un courage de cette espèce que des hommes se pendent et se noient. Insensés que vous êtes, mes compagnons et moi nous sommes les ministres du Destin: les éléments dont se compose la trempe de vos épées peuvent aussi aisément blesser les vents bruyants ou, par de ridicules estocades, percer à mort l'eau qui se referme à l'instant, que raccourcir un seul brin de mes plumes. Mes compagnons sont invulnérables comme moi; et puissiez-vous nous blesser avec vos armes, elles sont maintenant trop pesantes pour vos forces: elles ne se laisseront plus soulever. Mais souvenez-vous, car tel est ici l'objet de mon message, que vous trois vous avez expulsé de son duché de Milan le vertueux Prospero; que vous l'avez exposé sur la mer (qui depuis vous en a payé le salaire), lui et sa fille innocente. C'est pour cette action odieuse que des destins qui tardent, mais qui n'oublient pas, ont irrité les mers et les rivages, et mêmes toutes les créatures contre votre repos. Toi, Alonzo, ils t'ont privé de ton fils. Ils vous annoncent par ma voix qu'une destruction prolongée (pire qu'une mort subite) va vous suivre pas à pas et dans toutes vos actions. Pour vous préserver des vengeances (qui autrement vont éclater sur vos têtes dans cette île désolée), il ne vous reste plus que le remords du coeur, et ensuite une vie sans reproche.
(Ariel s'évapore au milieu d'un coup de tonnerre. Ensuite, au son d'une musique agréable, les fantômes rentrent et dansent en faisant des grimaces moqueuses, et emportent la table.)
PROSPERO, à part, à Ariel. – Tu as très-bien joué ce rôle de harpie, mon Ariel: elle avait de la grâce en dévorant. Dans tout ce que tu as dit, tu n'as rien omis de l'instruction que je t'avais donnée. Mes esprits secondaires ont aussi rendu d'après nature et avec une vérité bizarre leurs différentes espèces de personnages. Mes charmes puissants opèrent, et ces hommes qui sont mes ennemis sont tout éperdus. Les voilà en mon pouvoir: je veux les laisser dans ces accès de frénésie, tandis que je vais revoir le jeune Ferdinand qu'ils croient noyé, et sa chère, ma chère bien-aimée.
GONZALO. – Au nom de ce qui est saint, seigneur, pourquoi restez-vous ainsi, le regard fixe et effrayé?
ALONZO. – O c'est horrible! horrible! il m'a semblé que les vagues avaient une voix et m'en parlaient. Les vents le chantaient autour de moi; et le tonnerre, ce profond et terrible tuyau d'orgue, prononçait le nom de Prospero, et de sa voix de basse récitait mon injustice. Mon fils est donc couché dans le limon de la mer! J'irai le chercher plus avant que jamais n'a pénétré la sonde, et je reposerai avec lui dans la vase.
(Il sort.)
SÉBASTIEN. – Un seul démon à la fois, et je vaincrai leurs légions.
ANTONIO. – Je serai ton second.
(Ils sortent.)
GONZALO. – Ils sont tous trois désespérés. Leur crime odieux, comme un poison qui ne doit opérer qu'après un long espace de temps, commence à ronger leurs âmes. Je vous en conjure, vous dont les muscles sont plus souples que les miens, suivez-les rapidement, et sauvez-les des actions où peut les entraîner le désordre de leurs sens.
ADRIAN. – Suivez-nous, je vous prie.
(Ils sortent.)
FIN DU TROISIÈME ACTE
ACTE QUATRIÈME
SCÈNE I
(Le devant de la grotte de Prospero.)
Entrent PROSPERO, FERDINAND ET MIRANDA.
PROSPERO, à Ferdinand. – Si je vous ai puni trop sévèrement, tout est réparé par la compensation que je vous offre, car je vous ai donné ici un fil de ma propre vie, ou plutôt celle pour qui je vis. Je la remets encore une fois dans tes mains. Tous tes ennuis n'ont été que les épreuves que je voulais faire subir à ton amour, et tu les as merveilleusement soutenus. Ici, à la face du ciel, je ratifie ce don précieux que je t'ai fait. O Ferdinand, ne souris point de moi si je la vante; car tu reconnaîtras qu'elle surpasse toute louange, et la laisse bien loin derrière elle.
FERDINAND. – Je le croirais, un oracle m'eût-il dit le contraire.
PROSPERO. – Reçois donc ma fille comme un don de ma main, et aussi comme un bien qui t'appartient pour l'avoir dignement acquis. Mais si tu romps le noeud virginal avant que toutes les saintes cérémonies aient été accomplies dans la plénitude de leurs rites pieux, jamais le ciel ne répandra sur cette union les douces influences capables de la faire prospérer; la haine stérile, le dédain au regard amer, et la discorde, sèmeront votre lit nuptial de tant de ronces rebutantes, que vous le prendrez tous deux en haine. Ainsi, au nom de la lampe d'hymen qui doit vous éclairer, prenez garde à vous.
FERDINAND. – Comme il est vrai que j'espère des jours paisibles, une belle lignée, une longue vie accompagnée d'un amour pareil à celui d'aujourd'hui, l'antre le plus sombre, le lieu le plus propice, les plus fortes suggestions de notre plus mauvais génie, rien ne pourra amollir mon honneur jusqu'à des désirs impurs; rien ne me fera consentir à dépouiller de son vif aiguillon ce jour de la célébration, que je passerai à imaginer que les coursiers de Phoebus se sont fourbus, ou que la nuit demeure là-bas enchaînée.
PROSPERO. – Noblement parlé. Assieds-toi donc, et cause avec elle; elle est à toi. – Allons, Ariel, mon ingénieux serviteur, mon Ariel!
(Entre Ariel.)
ARIEL. – Que désire mon puissant maître? me voici.
PROSPERO. – Toi et les esprits que tu commandes, vous avez tous dignement rempli votre dernier emploi. J'ai besoin de vous encore pour un autre artifice du même genre. Pars, et amène ici, dans ce lieu, tout ce menu peuple des esprits sur lesquels je t'ai donné pouvoir. Anime-les à de rapides mouvements, car il faut que je fasse voir à ce jeune couple quelques-uns des prestiges de mon art. C'est ma promesse, et ils l'attendent de moi.
ARIEL. – Immédiatement?
PROSPERO. – Oui, dans un clin d'oeil.
ARIEL. – Vous n'aurez pas dit va et reviens, et respiré deux fois et crié allons, allons, que chacun, accourant à pas légers sur la pointe du pied, sera devant vous avec sa moue et ses grimaces. M'aimez-vous, mon maître? non?
PROSPERO. – Tendrement, mon joli Ariel. N'approche pas que tu ne m'entendes appeler.
ARIEL. – Oui, je comprends.
(Il sort.)
PROSPERO, à Ferdinand. – Songe à tenir ta parole; ne donne pas trop de liberté à tes caresses: lorsque le sang est enflammé, les serments les plus forts ne sont plus que de la paille. Sois plus retenu, ou autrement bonsoir à votre promesse.
FERDINAND. – Je la garantis, seigneur. Le froid virginal de la blanche neige qui repose sur mon coeur amortit l'ardeur de mes sens16.
PROSPERO. – Bien. (A Ariel.) Allons, mon Ariel, viens maintenant; amène un supplément plutôt que de manquer d'un seul esprit. Parais-ici, et vivement… (A Ferdinand.) Point de langue; tout yeux; du silence.
(Une musique douce.)
MASQUE17.
(Entre Iris.)
IRIS. – Cérès, bienfaisante déesse, laisse tes riches plaines de froment, de seigle, d'orge, de vesce, d'avoine et de pois; tes montagnes herbues où vivent les broutantes brebis, et tes plates prairies où elles sont tenues à couvert sous le chaume; tes sillons aux bords bien creusés et fouillés qu'Avril, gonflé d'humidité, embellit à ta voix, pour former de chastes couronnes aux froides nymphes; et tes bois de genêts qu'aime le jeune homme délaissé par la jeune fille qu'il aime; et tes vignobles ceints de palissades; et tes grèves stériles hérissées de rocs où tu vas respirer le grand air: la reine du firmament, dont je suis l'humide arc-en-ciel et la messagère, te le demande, et te prie de venir ici sur ce gazon partager les jeux de sa souveraine grandeur; ses paons volent vite: approche, riche Cérès, pour la recevoir.
(Entre Cérès.)
CÉRÈS. – Salut, messagère aux diverses couleurs, toi qui ne désobéis jamais à l'épouse de Jupiter; toi qui de tes ailes de safran verses sur mes fleurs des rosées de miel et de fines pluies rafraîchissantes, et qui des deux bouts de ton arc bleu couronnes mes espaces boisés et mes plaines sans arbrisseaux; toi qui fais une riche écharpe à ma noble terre: pourquoi ta reine m'appelle-t-elle ici sur la verdure de cette herbe menue?
IRIS. – Pour célébrer une alliance de vrai amour, et pour doter généreusement ces bienheureux amants.
CÉRÈS. – Dis-moi, arc céleste, sais-tu si Vénus ou son fils accompagnent la reine? Depuis qu'ils ont tramé le complot qui livra ma fille au ténébreux Pluton, j'ai fait serment d'éviter la honteuse société de la mère et de son aveugle fils.
IRIS. – Ne crains point sa présence ici. Je viens de rencontrer sa divinité fendant les nues vers Paphos, et son fils avec elle traîné par ses colombes. Ils croyaient avoir jeté quelque charme lascif sur cet homme et cette jeune fille, qui ont fait serment qu'aucun des mystères du lit nuptial ne serait accompli avant que l'hymen n'eût allumé son flambeau; mais en vain: l'amoureuse concubine de Mars s'en est retournée; sa mauvaise tête de fils a brisé ses flèches; il jure de n'en plus lancer, et désormais, jouant avec les passereaux, de n'être plus qu'un enfant.
CÉRÈS. – La plus majestueuse des reines, l'auguste Junon s'avance: je la reconnais à sa démarche.
(Entre Junon.)
JUNON. – Comment se porte ma bienfaisante soeur? Venez avec moi bénir ce couple, afin que leur vie soit prospère, et qu'ils se voient honorés dans leurs enfants.
(Elle chante.)
Honneur, richesses, bénédictions du mariage;
Longue continuation et accroissement de bonheur;
Joie de toutes les heures soit et demeure sur vous.
Junon chante sur vous sa bénédiction.
CÉRÈS.
Produits du sol, surabondance,
Granges et greniers toujours remplis;
Vignes couvertes de grappes pressées;
Plantes courbées sous leurs riches fardeaux;
Le printemps revenant pour vous au plus tard
A la fin de la récolte;
La disette et le besoin toujours loin de vous;
Telle est pour vous la bénédiction de Cérès.
FERDINAND. – Voilà la vision la plus majestueuse, les chants les plus harmonieux!.. Y a-t-il de la hardiesse à croire que ce soient là des esprits?
PROSPERO. – Ce sont des esprits que par mon art j'ai appelés des lieux où ils sont retenus, pour exécuter ces jeux de mon imagination.
FERDINAND. – O que je vive toujours ici! Un père, une épouse, si rares, si merveilleux, font de ce lieu un paradis.
(Junon et Cérès se parlent bas, et envoient Iris faire un message.)
PROSPERO. – Silence, mon fils: Junon et Cérès s'entretiennent sérieusement tout bas. Il reste quelque autre chose à faire. Chut! pas une syllabe, ou notre charme est rompu.
IRIS. – Vous qu'on appelle naïades, nymphes des ruisseaux sinueux, avec vos couronnes de jonc et vos regards toujours innocents, quittez l'onde ridée, et venez sur ce gazon vert obéir au signal qui vous appelle: Junon l'ordonne. Hâtez-vous, chastes nymphes; aidez-nous à célébrer une alliance de vrai amour: ne vous faites pas attendre.
(Entrent des nymphes.)
Et vous, moissonneurs armés de faucilles, brûlés du soleil et fatigués d'août, quittez vos sillons, et livrez-vous à la joie. Chômez ce jour de fête; couvrez-vous de vos chapeaux de paille de seigle, et que chacun de vous se joigne à l'une de ces fraîches nymphes dans une danse rustique.
(Entrent des moissonneurs dans le costume de leur état; ils se joignent aux nymphes et forment une danse gracieuse vers la fin de laquelle Prospero tressaille tout à coup et prononce les mots suivants; après quoi les esprits disparaissent lentement avec un bruit étrange, sourd et confus.)
PROSPERO. – J'avais oublié l'odieuse conspiration de cette brute de Caliban et de ses complices contre mes jours: l'instant où ils doivent exécuter leur complot est presque arrivé. (Aux esprits.) Fort bien… Éloignez-vous. Rien de plus.
FERDINAND. – Voilà qui est étrange! Votre père est agité par quelque passion qui travaille violemment son âme.
MIRANDA. – Jamais jusqu'à ce jour je ne l'ai vu troublé d'une si violente colère.
PROSPERO. – Vous avez l'air ému, mon fils, comme si vous étiez rempli d'effroi. Soyez tranquille. Maintenant voilà nos divertissements finis; nos acteurs, comme je vous l'ai dit d'avance, étaient tous des esprits; ils se sont fondus en air, en air subtil; et, pareils à l'édifice sans base de cette vision, se dissoudront aussi les tours qui se perdent dans les nues, les palais somptueux, les temples solennels, notre vaste globe, oui, notre globe lui-même, et tout ce qu'il reçoit de la succession des temps; et comme s'est évanoui cet appareil mensonger, ils se dissoudront, sans même laisser derrière eux la trace que laisse le nuage emporté par le vent. Nous sommes faits de la vaine substance dont se forment les songes, et notre chétive vie est environnée d'un sommeil. – Seigneur, j'éprouve quelque chagrin: supportez ma faiblesse; ma vieille tête est troublée; ne vous tourmentez point de mon infirmité. Veuillez rentrer dans ma caverne et vous y reposer. Je vais faire un tour ou deux pour calmer mon esprit agité.
FERDINAND ET MIRANDA. – Nous vous souhaitons la paix.
PROSPERO, à Ariel. – Arrive rapide comme ma pensée. – (A Ferdinand et Miranda.) Je vous remercie. – Viens, Ariel.
ARIEL. – Je suis uni à tes pensées. Que désires-tu?
PROSPERO. – Esprit, il faut nous préparer à faire face à Caliban.
ARIEL. – Oui, mon maître. Lorsque je fis paraître Cérès, j'avais eu l'idée de t'en parler; mais j'ai craint d'éveiller ta colère.
PROSPERO. – Redis-moi où tu as laissé ces misérables.
ARIEL. – Je vous l'ai dit, seigneur: ils étaient enflammés de boisson, si remplis de bravoure qu'ils châtiaient l'air pour leur avoir soufflé dans le visage, et frappaient la terre pour avoir baisé leurs pieds; mais toujours suivant leur projet. Alors j'ai battu mon tambour: à ce bruit, comme des poulains indomptés, ils ont dressé les oreilles, porté en avant leurs paupières, et levé le nez du côté où ils flairaient la musique. J'ai tellement charmé leurs oreilles, que, comme des veaux, appelés par le mugissement de la vache, ils ont suivi mes sons au milieu des ronces dentées, des bruyères, des buissons hérissés, des épines qui pénétraient la peau mince de leurs jambes. A la fin, je les ai laissés dans l'étang au manteau de boue qui est au delà de ta grotte, s'agitant de tout le corps pour retirer leurs pieds enfoncés dans la fange noire et puante du lac.
PROSPERO. – Tu as très-bien fait, mon oiseau. Garde encore ta forme invisible. Va, apporte ici tout ce qu'il y a d'oripeaux dans ma demeure: c'est l'appât où je prendrai ces voleurs.
ARIEL. – J'y vais, j'y vais.
(Il sort.)
PROSPERO. – Un démon, un démon incarné dont la nature ne peut jamais offrir aucune prise à l'éducation, sur qui j'ai perdu, entièrement perdu toutes les peines que je me suis données par humanité! et comme son corps devient plus difforme avec les années, son âme se gangrène encore… Je veux qu'ils souffrent tous jusqu'à en rugir. – (Rentre Ariel chargé d'habillements brillants et autres choses du même genre.) – Viens, range-les sur cette corde.
(Prospero et Ariel demeurent invisibles.)
(Entrent Caliban, Stephano et Trinculo tout mouillés.)
CALIBAN. – Je t'en prie, va d'un pas si doux que la taupe aveugle ne puisse ouïr ton pied se poser. Nous voilà tout près de sa caverne.
STEPHANO. – Eh bien! monstre, votre lutin, que vous disiez un lutin sans malice, ne nous a guère mieux traités que le Follet des champs18.
TRINCULO. – Monstre, je sens partout le pissat de cheval, ce dont mon nez est en grande indignation.
STEPHANO. – Le mien aussi, entendez-vous, monstre? Si j'allais prendre de l'humeur contre vous, voyez-vous…
TRINCULO. – Tu serais un monstre perdu.
CALIBAN. – Mon bon prince, conserve-moi toujours tes bonnes grâces. Aie patience, car le butin auquel je te conduis couvrira bien cette mésaventure: ainsi, parle tout bas. Tout est coi ici, comme s'il était encore minuit.
TRINCULO. – Oui, mais avoir perdu nos bouteilles dans la mare!
STEPHANO. – Il n'y a pas à cela seulement de la honte, du déshonneur, monstre, mais une perte immense.
TRINCULO. – Cela m'est encore plus sensible que de m'être mouillé. – C'est cependant votre lutin sans malice, monstre…
STEPHANO. – Je veux aller rechercher ma bouteille, dussé-je, pour ma peine, en avoir jusque par-dessus les oreilles.
CALIBAN. – Je t'en prie, mon prince, ne souffle pas. – Vois-tu bien? voici la bouche de la caverne: point de bruit; entre. Fais-nous ce bon méfait qui pour toujours te met, toi, en possession de cette île; et moi, ton Caliban à tes pieds, pour les lécher éternellement.
STEPHANO. – Donne-moi ta main. Je commence à avoir des idées sanguinaires.
TRINCULO. – O roi Stephano19! ô mon gentilhomme! ô digne Stephano! regarde; vois quelle garde-robe il y a ici pour toi!
CALIBAN. – Laisse tout cela, imbécile; ce n'est que de la drogue.
TRINCULO. – Oh! oh! monstre, nous nous connaissons en friperie. – O roi Stephano!
STEPHANO. – Lâche cette robe, Trinculo. Par ma main! je prétends avoir cette robe.
TRINCULO. – Ta Grandeur l'aura.
CALIBAN. – Que l'hydropisie étouffe cet imbécile! A quoi pensez-vous de vous amuser à ce bagage? Avançons, et faisons le meurtre d'abord. S'il se réveille, depuis la plante des pieds jusqu'au crâne, notre peau ne sera plus que pincements; oh! il nous accoutrera d'une étrange manière!
STEPHANO. – Paix, monstre! – Madame la corde, ce pourpoint n'est-il pas pour moi? – Voilà le pourpoint hors de ligne. – A présent, pourpoint, vous êtes sous la ligne; vous courez risque de perdre vos crins et de devenir un faucon chauve20.
TRINCULO. – Faites, faites. N'en déplaise à votre Grandeur, nous volons à la ligne et au cordeau.
STEPHANO. – Je te remercie de ce bon mot. Tiens, voilà un habit pour la peine. Tant que je serai roi de ce pays, l'esprit n'ira point sans récompense. «Voler à la ligne et au cordeau!» c'est un excellent trait d'estoc. Tiens, encore un habit pour la peine.
TRINCULO. – Allons, monstre, un peu de glu à vos doigts, et puis emportez-nous le reste.
CALIBAN. – Je n'en veux pas. Nous perdrons là notre temps, et nous serons tous changés en oies de mer21, ou en singes avec des fronts horriblement bas.
STEPHANO. – Monstre, étendez vos doigts. Aidez-nous à transporter tout cela à l'endroit où j'ai mis mon tonneau de vin, ou je vous chasse de mon royaume. Vite, emportez ceci.
TRINCULO. – Et ceci.
STEPHANO. – Oui, et ceci encore.
(On entend un bruit de chasseurs. Divers esprits accourent sous la forme de chiens de chasse, et poursuivent dans tous les sens Stephano, Trinculo et Caliban. Prospero et Ariel animent la meute.)
PROSPERO. – Oh! la Montagne! oh!
ARIEL. —Argent, ici la voie, Argent!
PROSPERO. —Furie, Furie, là! Tyran, là! – Écoute, écoute! (Caliban, Trinculo et Stephano sont pourchassés hors de la scène.) Va, ordonne à mes lutins de moudre leurs jointures par de dures convulsions; que leurs nerfs se retirent dans des crampes racornies; qu'ils soient pincés jusqu'à en être couverts de plus de taches qu'il n'y en a sur la peau du léopard ou du chat de montagne.
ARIEL. – Écoute comme ils rugissent.
PROSPERO. – Qu'il leur soit fait une chasse vigoureuse. A l'heure qu'il est, tous mes ennemis sont à ma merci. Dans peu tous mes travaux vont finir; et toi, tu vas retrouver toute la liberté des airs. Suis-moi encore un instant, et rends-moi obéissance.
(Ils sortent.)
FIN DU QUATRIÈME ACTE
Mais c'en est assez et plus qu'il ne faut sur cette bizarre plaisanterie.