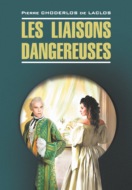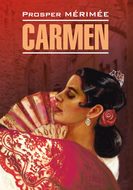Kitabı oku: «Le minotaure. La peste / Минотавр. Чума. Книга для чтения на французском языке», sayfa 2
Les Monuments
Pour bien des raisons qui tiennent autant à l’économie qu’à la métaphysique, on peut dire que le style oranais, s’il en est un, s’est illustré avec force et clarté dans le singulier édifice appelé Maison du Colon. De monuments, Oran ne manque guère25. La ville a son compte de maréchaux d’Empire, de ministres et de bienfaiteurs locaux. On les rencontre sur des petites places poussiéreuses, résignés à la pluie comme au soleil, convertis eux aussi à la pierre et à l’ennui. Mais ils représentent cependant des apports extérieurs. Dans cette heureuse barbarie, ce sont les marques regrettables de la civilisation.
Oran, au contraire, s’est élevé à elle-même ses autels et ses rostres. En plein cœur de la ville commerçante, ayant à construire une maison commune pour les innombrables organismes agricoles qui font vivre ce pays, les Oranais ont médité d’y bâtir, dans le sable et la chaux, une image convaincante de leurs vertus: la Maison du Colon. Si l’on en juge par l’édifice, ces vertus sont au nombre de trois: la hardiesse dans le goût, l’amour de la violence, et le sens des synthèses historiques. L’Égypte, Byzance et Munich ont collaboré à la délicate construction d’une pâtisserie figurant une énorme coupe renversée. Des pierres multicolores, du plus vigoureux effet, sont venues encadrer le toit. La vivacité de ces mosaïques est si persuasive qu’au premier abord on ne voit rien, qu’un éblouissement informe. Mais de plus près, et l’attention éveillée, on voit qu’elles ont un sens: un gracieux colon, à nœud papillon et à casque de liège blanc26, y reçoit l’hommage d’un cortège d’esclaves vêtus à l’antique. L’édifice et ses enluminures ont été enfin placés au milieu d’un carrefour, dans le va-et-vient des petits tramways à nacelle dont la saleté est un des charmes de la ville.
Oran tient beaucoup d’autre part aux deux lions de sa place d’Armes. Depuis 1888, ils trônent de chaque côté de l’escalier municipal. Leur auteur s’appelait Caïn. Ils ont de la majesté et le torse court. On raconte que, la nuit, ils descendent l’un après l’autre de leur socle, tournent silencieusement autour de la place obscure, et, à l’occasion, urinent longuement sous les grands ficus poussiéreux. Ce sont, bien entendu, des on-dit auxquels les Oranais prêtent une oreille complaisante. Mais cela est invraisemblable.
Malgré quelques recherches, je n’ai pu me passionner pour Caïn. J’ai seulement appris qu’il avait la réputation d’un animalier adroit. Cependant, je pense souvent à lui. C’est une pente d’esprit qui vous vient à Oran. Voici un artiste au nom sonore qui a laissé ici une œuvre sans importance. Plusieurs centaines de milliers d’hommes sont familiarisés avec les fauves débonnaires qu’il a placés devant une mairie prétentieuse. C’est une façon comme une autre de réussir en art. Sans doute, ces deux lions, comme des milliers d’œuvres du même genre, témoignent de tout autre chose que de talent. On a pu faire la «Ronde de Nuit», «saint François recevant les stigmates», «David» ou «l’Exaltation de la Fleur». Caïn, lui, a dressé deux mufles hilares sur la place d’une province commerçante, outre-mer. Mais le David croulera un jour avec Florence et les lions seront peut-être sauvés du désastre. Encore une fois, ils témoignent d’autre chose.
Peut-on préciser cette idée? Il y a dans cette œuvre de l’insignifiance et de la solidité. L’esprit n’y est pour rien et la matière pour beaucoup. La médiocrité veut durer par tous les moyens, y compris le bronze. On lui refuse ses droits à l’éternité et elle les prend tous les jours. N’est-ce pas elle, l’éternité? En tout cas, cette persévérance a de quoi émouvoir, et elle porte sa leçon, celle de tous les monuments d’Oran et d’Oran elle-même. Une heure par jour, une fois parmi d’autres, elle vous force à porter attention à ce qui n’a pas d’importance. L’esprit trouve profit à ces retours. C’est un peu son hygiène, et, puisqu’il lui faut absolument ses moments d’humilité, il me semble que cette occasion de s’abêtir est meilleure que d’autres. Tout ce qui est périssable désire durer. Disons donc que tout veut durer. Les œuvres humaines ne signifient rien d’autre et, à cet égard, les lions de Caïn ont les mêmes chances que les ruines d’Angkor27. Cela incline à la modestie.
Il est d’autres monuments oranais. Ou du moins, il faut bien leur donner ce nom puisque eux aussi témoignent pour leur ville, et de façon plus significative peut-être. Ce sont les grands travaux qui recouvrent actuellement la côte sur une dizaine de kilomètres. En principe, il s’agit de transformer la plus lumineuse des baies en un port gigantesque. En fait, c’est encore une occasion pour l’homme de se confronter avec la pierre.
Dans les tableaux de certains maîtres flamands on voit revenir avec insistance un thème d’une ampleur admirable: la construction de la Tour de Babel28. Ce sont des paysages démesurés, des roches qui escaladent le ciel, des escarpements où foisonnent ouvriers, bêtes, échelles, machines étranges, cordes, traits. L’homme, d’ailleurs, n’est là que pour faire mesurer la grandeur inhumaine du chantier. C’est à cela qu’on pense sur la corniche oranaise, à l’ouest de la ville.
Accrochés à d’immenses pentes, des rails, des wagonnets, des grues, des trains minuscules… Au milieu d’un soleil dévorant, des locomotives pareilles à des jouets contournent d’énormes blocs parmi les sifflets, la poussière et la fumée. Jour et nuit, un peuple de fourmis s’activent sur la carcasse fumante de la montagne. Pendus le long d’une même corde contre le flanc de la falaise, des dizaines d’hommes, le ventre appuyé aux poignées des défonceuses automatiques, tressaillent dans le vide à longueur de journée, et détachent des pans entiers de rochers qui croulent dans la pousière et les grondements. Plus loin, des wagonnets se renversent au-dessus des pentes, et les rochers, déversés brusquement vers la mer, s’élancent et roulent dans l’eau, chaque gros bloc suivi d’une volée de pierres plus légères. À intervalles réguliers, dans le cœur de la nuit, en plein jour, des détonations ébranlent toute la montagne et soulèvent la mer elle-même.
L’homme, au milieu de ce chantier, attaque la pierre de front. Et si l’on pouvait oublier, un instant au moins, le dur esclavage qui rend possible ce travail, il faudrait admirer. Ces pierres, arrachées à la montagne, servent l’homme dans ses desseins. Elles s’accumulent sous les premières vagues, émergent peu à peu et s’ordonnent enfin suivant une jetée, bientôt couverte d’hommes et de machines, qui avancent jour après jour, vers le large. Sans désemparer, d’énormes mâchoires d’acier fouillent le ventre de la falaise, tournent sur elles-mêmes, et viennent dégorger dans l’eau leur tropplein de pierrailles. À mesure que le front de la corniche s’abaisse, la côte entière gagne irrésistiblement sur la mer.
Bien sûr, détruire la pierre n’est pas possible. On la change seulement de place. De toute façon, elle durera plus que les hommes qui s’en servent. Pour le moment, elle appuie leur volonté d’action. Cela même sans doute est inutile. Mais changer les choses de place, c’est le travail des hommes: il faut choisir de faire cela ou rien. Visiblement, les Oranais ont choisi. Devant cette baie indifférente, pendant des années encore, ils entasseront des amas de cailloux le long de la côte. Dans cent ans, c’est-à-dire demain, il faudra recommencer. Mais aujourd’hui ces amoncellements de rochers témoignent pour les hommes au masque de poussière et de sueur qui circulent au milieu d’eux. Les vrais monuments d’Oran, ce sont encore ses pierres.
La Pierre D’Ariane
Il semble que les Oranais soient comme cet ami de Flaubert qui, au moment de mourir, jetant un dernier regard sur cette terre irremplaçable, s’écriait: «Fermez la fenêtre, c’est trop beau.» Ils ont fermé la fenêtre, ils se sont emmurés, ils ont exorcisé le paysage. Mais le Poittevin est mort, et, après lui, les jours ont continué de rejoindre les jours. De même, au-delà des murs jaunes d’Oran, la mer et la terre poursuivent leur dialogue indifférent. Cette permanence dans le monde a toujours eu pour l’homme des prestiges opposés. Elle le désespère et l’exalte. Le monde ne dit jamais qu’une seule chose, et il intéresse, puis il lasse. Mais, à la fin, il l’emporte à force d’obstination. Il a toujours raison.
Déjà, aux portes mêmes d’Oran, la nature hausse le ton. Du côté de Canastel, ce sont d’immenses friches, couvertes de broussailles odorantes. Le soleil et le vent n’y parlent que de solitude. Au-dessus d’Oran, c’est la montagne de Santa Cruz, le plateau et les mille ravins qui y mènent. Des routes, jadis carrossables, s’accrochent au flanc des coteaux qui dominent la mer. Au mois de janvier, certaines sont couvertes de fleurs. Pâquerettes et boutons do’r29 en font des allées fastueuses, brodées de jaune et de blanc. De Santa Cruz, tout a été dit. Mais si j’avais à en parler, j’oublierais les cortèges sacrés qui gravissent la dure colline, aux grandes fêtes, pour évoquer d’autres pèlerinages. Solitaires, ils cheminent dans la pierre rouge, s’élèvent au-dessus de la baie immobile, et viennent consacrer au dénuement une heure lumineuse et parfaite.
Oran a aussi ses déserts de sable: ses plages. Celles qu’on rencontre, tout près des portes, ne sont solitaires qu’en hiver et au printemps. Ce sont alors des plateaux couverts d’asphodèles, peuplés de petites villas nues, au milieu des fleurs. La mer gronde un peu, en contrebas. Déjà pourtant, le soleil, le vent léger, la blancheur des asphodèles, le bleu cru du ciel, tout laisse imaginer l’été, la jeunesse dorée qui couvre alors la plage, les longues heures sur le sable et la douceur subite des soirs. Chaque année, sur ces rivages, c’est une nouvelle moisson de filles fleurs. Apparemment, elles n’ont qu’une saison. L’année suivante, d’autres corolles chaleureuses les remplacent qui, l’été d’avant, étaient encore des petites filles aux corps durs comme des bourgeons. À onze heures du matin, descendant du plateau, toute cette jeune chair, à peine vêtue d’étoffes bariolées, déferle sur le sable comme une vague multicolore.
Il faut aller plus loin (singulièrement près, cependant, de ce lieu où deux cent mille hommes tournent en rond) pour découvrir un paysage toujours vierge: de longues dunes désertes où le passage des hommes n’a laissé d’autres traces qu’une cabane vermoulue. De loin en loin, un berger arabe fait avancer sur le sommet des dunes les taches noires et beiges de son troupeau de chèvres. Sur ces plages d’Oranie, tous les matins d’été ont l’air d’être les premiers du monde. Tous les crépuscules semblent être les derniers, agonies solennelles annoncées au coucher du soleil par une dernière lumière qui fonce toutes les teintes. La mer est outremer, la route couleur de sang caillé, la plage jaune. Tout disparaît avec le soleil vert; une heure plus tard, les dunes ruissellent de lune. Ce sont alors des nuits sans mesure sous une pluie d’étoiles. Des orages les traversent parfois, et les éclairs coulent le long des dunes, pâlissent le ciel, mettent sur le sable et dans les yeux des lueurs orangées.
Mais ceci ne peut se partager. Il faut l’avoir vécu. Tant de solitude et de grandeur donne à ces lieux un visage inoubliable. Dans la petite aube tiède, passé les premières vagues encore noires et amères, c’est un être neuf qui fend l’eau, si lourde à porter, de la nuit. Le souvenir de ces joies ne me les fait pas regretter et je reconnais ainsi qu’elles étaient bonnes. Après tant d’années, elles durent encore, quelque part dans ce cœur aux fidélités pourtant difficiles. Et je sais qu’aujourd’hui, sur la dune déserte, si je veux m’y rendre, le même ciel déversera encore sa cargaison de souffles et d’étoiles. Ce sont ici les terres de l’innocence.
Mais l’innocence a besoin du sable et des pierres. Et l’homme a désappris d’y vivre. Il faut le croire du moins, puisqu’il s’est retranché dans cette ville singulière où dort l’ennui. Cependant, c’est cette confrontation qui fait le prix d’Oran. Capitale de l’ennui, assiégée par l’innocence et la beauté, l’armée qui l’enserre a autant de soldats que de pierres. Dans la ville, et à certaines heures, pourtant, quelle tentation de passer à l’ennemi! quelle tentation de s’identifier à ces pierres, de se confondre avec cet univers brûlant et impassible qui défie l’histoire et ses agitations! Cela est vain sans doute. Mais il y a dans chaque homme un instinct profond qui n’est ni celui de la destruction ni celui de la création. Il s’agit seulement de ne ressembler à rien. À l’ombre des murs chauds d’Oran, sur son asphalte poussiéreux, on entend parfois cette invitation. Il semble que, pour un temps, les esprits qui y cèdent ne soient jamais frustrés. Ce sont les ténèbres d’Eurydice et le sommeil d’Isis. Voici les déserts où la pensée va se reprendre, la main fraîche du soir sur un cœur agité. Sur cette Montagne des Oliviers, la veille est inutile; l’esprit rejoint et approuve les Apôtres endormis. Avaient-ils vraiment tort? Ils ont eu tout de même leur révélation.
Pensons à Çakya-Mouni30 au désert. Il y demeura de longues années, accroupi, immobile et les yeux au ciel. Les dieux eux-mêmes lui enviaient cette sagesse et ce destin de pierre. Dans ses mains tendues et raidies, les hirondelles avaient fait leur nid. Mais, un jour, elles s’envolèrent à l’appel de terres lointaines. Et celui qui avait tué en lui désir et volonté, gloire et douleur, se mit à pleurer. Il arrive ainsi que des fleurs poussent sur le rocher. Oui, consentons à la pierre quand il le faut. Ce secret et ce transport que nous demandons aux visages, elle peut aussi nous les donner. Sans doute, cela ne saurait durer. Mais qu’est-ce donc qui peut durer? Le secret des visages s’évanouit et nous voilà relancés dans la chaîne des désirs. Et si la pierre ne peut pas plus pour nous que le cœur humain, elle peut du moins juste autant.
«N’être rien!» Pendant des millénaires, ce grand cri a soulevé des millions d’hommes en révolte contre le désir et la douleur. Ses échos sont venus mourir jusqu’ici, à travers les siècles et les océans, sur la mer la plus vieille du monde. Ils rebondissent encore sourdement contre les falaises compactes d’Oran. Tout le monde, dans ce pays, suit, sans le savoir, ce conseil. Bien entendu, c’est à peu près en vain. Le néant ne s’atteint pas plus que l’absolu. Mais puisque nous recevons, comme autant de grâces, les signes éternels que nous apportent les roses ou la souffrance humaine, ne rejetons pas non plus les rares invitations au sommeil que nous dispense la terre. Les unes ont autant de vérité que les autres.
Voilà, peut-être, le fil d’Ariane de cette ville somnambule et frénétique. On y apprend les vertus, toutes provisoires, d’un certain ennui. Pour être épargné, il faut dire «oui» au Minotaure. C’est une vieille et féconde sagesse. Audessus de la mer, silencieuse au pied des falaises rouges, il suffit de se tenir dans un juste équilibre, à mi-distance des deux caps massifs qui, à droite et à gauche, baignent dans l’eau claire. Dans le halètement d’un garde-côte, qui rampe sur l’eau du large, baigné de lumière radieuse, on entend distinctement alors l’appel étouffé de forces inhumaines et étincelantes: c’est l’adieu du Minotaure.
Il est midi, le jour lui-même est en balance31. Son rite accompli, le voyageur reçoit le prix de sa délivrance: la petite pierre, sèche et douce comme un asphodèle, qu’il ramasse sur la falaise. Pour l’initié, le monde n’est pas plus lourd à porter que cette pierre. La tâche d’Atlas est facile, il suffit de choisir son heure. On comprend alors que pour une heure, un mois, un an, ces rivages peuvent se prêter à la liberté. Ils accueillent pêle-mêle, et sans les regarder, le moine, le fonctionnaire ou le conquérant. Il y a des jours où j’attendais de rencontrer, dans les rues d’Oran, Descartes ou César Borgia. Cela n’est pas arrivé. Mais un autre sera peut-être plus heureux. Une grande action, une grande œuvre, la méditation virile demandaient autrefois la solitude des sables ou du couvent. On y menait les veillées d’armes de l’esprit. Où les célébrerait-on mieux maintenant que dans le vide d’une grande ville installée pour longtemps dans la beauté sans esprit?
Voici la petite pierre, douce comme un asphodèle. Elle est au commencement de tout. Les fleurs, les larmes (si on y tient), les départs et les luttes sont pour demain. Au milieu de la journée, quand le ciel ouvre ses fontaines de lumière dans l’espace immense et sonore, tous les caps de la côte ont l’air d’une flottille en partance. Ces lourds galions de roc et de lumière tremblent sur leurs quilles, comme s’ils se préparaient à cingler vers des îles de soleil. O matins d’Oranie! Du haut des plateaux, les hirondelles plongent dans d’immenses cuves où l’air bouillonne. La côte entière est prête au départ, un frémissement d’aventure la parcourt. Demain, peut-être, nous partirons ensemble.
(1939)
La Peste
extraits
Il est aussi raisonnable de représenter une espèce d’emprisonnement par une autre que de représenter n’importe quelle chose qui existe réellement par quelque chose qui n’existe pas.
Daniel de Foe
I
Les curieux événements qui font le sujet de cette chronique se sont produits en 194., à Oran. De l’avis général, ils n’y étaient pas à leur place, sortant un peu de l’ordinaire. À première vue, Oran est, en effet, une ville ordinaire et rien de plus qu’une préfecture française de la côte algérienne.
La cité elle-même, on doit l’avouer, est laide. D’aspect tranquille, il faut quelque temps pour apercevoir ce qui la rend différente de tant d’autres villes commerçantes, sous toutes les latitudes. Comment faire imaginer, par exemple, une ville sans pigeons, sans arbres et sans jardins, où l’on ne rencontre ni battements d’ailes ni froissements de feuilles, un lieu neutre pour tout dire? Le changement des saisons ne s’y lit que dans le ciel. Le printemps s’annonce seulement par la qualité de l’air ou par les corbeilles de fleurs que de petits vendeurs ramènent des banlieues; c’est un printemps qu’on vend sur les marchés. Pendant l’été, le soleil incendie les maisons trop sèches et couvre les murs d’une cendre grise; on ne peut plus vivre alors que dans l’ombre des volets clos. En automne, c’est, au contraire, un déluge de boue. Les beaux jours viennent seulement en hiver.
Une manière commode de faire la connaissance d’une ville est de chercher comment on y travaille, comment on y aime et comment on y meurt. Dans notre petite ville, est-ce l’effet du climat, tout cela se fait ensemble, du même air frénétique et absent. C’està-dire qu’on s’y ennuie et qu’on s’y applique à prendre des habitudes. Nos concitoyens travaillent beaucoup, mais toujours pour s’enrichir. Ils s’intéressent surtout au commerce et ils s’occupent d’abord, selon leur expression, de faire des affaires. Naturellement, ils ont du goût aussi pour les joies simples, ils aiment les femmes, le cinéma et les bains de mer. Mais, très raisonnablement, ils réservent ces plaisirs pour le samedi soir et le dimanche, essayant, les autres jours de la semaine, de gagner beaucoup d’argent. Le soir, lorsqu’ils quittent leurs bureaux, ils se réunissent à heure fixe dans les cafés, ils se promènent sur le même boulevard ou bien ils se mettent à leurs balcons. Les désirs des plus jeunes sont violents et brefs, tandis que les vices des plus âgés ne dépassent pas les associations de boulomanes32, les banquets des amicales et les cercles où l’on joue gros jeu sur le hasard des cartes.
On dira sans doute que cela n’est pas particulier à notre ville et qu’en somme tous nos contemporains sont ainsi. Sans doute, rien n’est plus naturel, aujourd’hui, que de voir des gens travailler du matin au soir et choisir ensuite de perdre aux cartes, au café, et en bavardages, le temps qui leur reste pour vivre. Mais il est des villes et des pays où les gens ont, de temps en temps, le soupçon d’autre chose. En général, cela ne change pas leur vie. Seulement il y a eu le soupçon et c’est toujours cela de gagné. Oran, au contraire, est apparemment une ville sans soupçons, c’est-à-dire une ville tout à fait moderne. Il n’est pas nécessaire, en conséquence, de préciser la façon dont on s’aime chez nous. Les hommes et les femmes, ou bien se dévorent rapidement dans ce qu’on appelle l’acte d’amour, ou bien s’engagent dans une longue habitude à deux. Entre ces extrêmes, il n’y a pas souvent de milieu. Cela non plus n’est pas original. À Oran comme ailleurs, faute de temps et de réflexion, on est bien obligé de s’aimer sans le savoir.
Ce qui est plus original dans notre ville est la difficulté qu’on peut y trouver à mourir. Difficulté, d’ailleurs, n’est pas le bon mot et il serait plus juste de parler d’inconfort. Ce n’est jamais agréable d’être malade, mais il y a des villes et des pays qui vous soutiennent dans la maladie, où l’on peut, en quelque sorte, se laisser aller. Un malade a besoin de douceur, il aime à s’appuyer sur quelque chose, c’est bien naturel. Mais à Oran, les excès du climat, l’importance des affaires qu’on y traite, l’insignifiance du décor, la rapidité du crépuscule et la qualité des plaisirs, tout demande la bonne santé. Un malade s’y trouve bien seul. Qu’on pense alors à celui qui va mourir, pris au piège derrière des centaines de murs crépitants de chaleur, pendant qu’à la même minute, toute une population, au téléphone ou dans les cafés, parle de traites, de connaissements et d’escompte. On comprendra ce qu’il peut y avoir d’inconfortable dans la mort, même moderne, lorsqu’elle survient ainsi dans un lieu sec.

À Marseille pendant la peste
Ces quelques indications donnent peut-être une idée suffisante de notre cité. Au demeurant, on ne doit rien exagérer. Ce qu’il fallait souligner, c’est l’aspect banal de la ville et de la vie. Mais on passe ses journées sans difficultés aussitôt qu’on a des habitudes. Du moment que notre ville favorise justement les habitudes, on peut dire que tout est pour le mieux. Sous cet angle, sans doute, la vie n’est pas très passionnante. Du moins, on ne connaît pas chez nous le désordre. Et notre population franche, sympathique et active a toujours provoqué chez le voyageur une estime raisonnable. Cette cité sans pittoresque, sans végétation et sans âme finit par sembler reposante, on s’y endort enfin. Mais il est juste d’ajouter qu’elle s’est greffée sur un paysage sans égal, au milieu d’un plateau nu, entouré de collines lumineuses, devant une baie au dessin parfait. On peut seulement regretter qu’elle se soit construite en tournant le dos à cette baie et que, partant, il soit impossible d’apercevoir la mer qu’il faut toujours aller chercher.
Arrivé là, on admettra sans peine que rien ne pouvait faire espérer à nos concitoyens les incidents qui se produisirent au printemps de cette année-là et qui furent, nous le comprîmes ensuite, comme les premiers signes de la série des graves événements dont on s’est proposé de faire ici la chronique. Ces faits paraîtront bien naturels à certains et, à d’autres, invraisemblables au contraire. Mais, après tout, un chroniqueur ne peut tenir compte de ces contradictions. Sa tâche est seulement de dire: «Ceci est arrivé», lorsqu’il sait que ceci est, en effet, arrivé, que ceci a intéressé la vie de tout un peuple, et qu’il y a donc des milliers de témoins qui estimeront dans leur cœur la vérité de ce qu’il dit.
Du reste, le narrateur, qu’on connaîtra toujours à temps, n’aurait guère de titre à faire valoir dans une entreprise de ce genre si le hasard ne l’avait mis à même de recueillir un certain nombre de dépositions et si la force des choses ne l’avait mêlé à tout ce qu’il prétend relater. C’est ce qui l’autorise à faire œuvre d’historien. Bien entendu, un historien, même s’il est un amateur, a toujours des documents. Le narrateur de cette histoire a donc les siens: son témoignage d’abord, celui des autres ensuite, puisque, par son rôle, il fut amené à recueillir les confidences de tous les personnages de cette chronique, et, en dernier lieu, les textes qui finirent par tomber entre ses mains. Il se propose d’y puiser quand il le jugera bon et de les utiliser comme il lui plaira. Il se propose encore… Mais il est peutêtre temps de laisser les commentaires et les précautions de langage pour en venir au récit lui-même. La relation des premières journées demande quelque minutie.
* * *
Le matin du 16 avril, le docteur Bernard Rieux sortit de son cabinet et buta sur un rat mort, au milieu du palier. Sur le moment, il écarta la bête sans y prendre garde et descendit l’escalier. Mais, arrivé dans la rue, la pensée lui vint que ce rat n’était pas à sa place et il retourna sur ses pas pour avertir le concierge. Devant la réaction du vieux M. Michel, il sentit mieux ce que sa découverte avait d’insolite. La présence de ce rat mort lui avait paru seulement bizarre tandis que, pour le concierge, elle constituait un scandale. La position de ce dernier était d’ailleurs catégorique: il n’y avait pas de rats dans la maison. Le docteur eut beau l’assurer qu’il y en avait un sur le palier du premier étage, et probablement mort, la conviction de M. Michel restait entière. Il n’y avait pas de rats dans la maison, il fallait donc qu’on eût apporté celui-ci du dehors. Bref, il s’agissait d’une farce.
Le soir même, Bernard Rieux, debout dans le couloir de l’immeuble, cherchait ses clefs avant de monter chez lui, lorsqu’il vit surgir, du fond obscur du corridor, un gros rat à la démarche incertaine et au pelage mouillé. La bête s’arrêta, sembla chercher un équilibre, prit sa course vers le docteur, s’arrêta encore, tourna sur elle-même avec un petit cri et tomba enfin en rejetant du sang par les babines entrouvertes. Le docteur la contempla un moment et remonta chez lui. […]
Le lendemain 17 avril, à huit heures, le concierge arrêta le docteur au passage et accusa des mauvais plaisants33 d’avoir déposé trois rats morts au milieu du couloir. On avait dû les prendre avec de gros pièges, car ils étaient pleins de sang. Le concierge était resté quelque temps sur le pas de la porte, tenant les rats par les pattes, et attendant que les coupables voulussent bien se trahir par quelque sarcasme. Mais rien n’était venu.
«Ah! ceux-là, disait M. Michel, je finirai par les avoir.»
Intrigué, Rieux décida de commencer sa tournée par les quartiers extérieurs où habitaient les plus pauvres de ses clients. La collecte des ordures s’y faisait beaucoup plus tard et l’auto qui roulait le long des voies étroites et poussiéreuses de ce quartier frôlait les boîtes de détritus, laissées au bord du trottoir. Dans une rue qu’il longeait ainsi, le docteur compta une douzaine de rats jetés sur les débris de légumes et les chiffons sales […].
Rieux n’eut pas de peine à constater ensuite que tout le quartier parlait des rats.
[Vers onze heures, le docteur accompagne à la gare sa femme, qui, malade depuis un an, doit effectuer un séjour en montagne.]
L’après-midi du même jour, au début de sa consultation, Rieux reçut un jeune homme dont on lui dit qu’il était journaliste et qu’il était déjà venu le matin. Il s’appelait Raymond Rambert. Court de taille, les épaules épaisses, le visage décidé, les yeux clairs et intelligents, Rambert portait des habits de coupe sportive et semblait à l’aise dans la vie. Il alla droit au but. Il enquêtait pour un grand journal de Paris sur les conditions de vie des Arabes et voulait des renseignements sur leur état sanitaire. Rieux lui dit que cet état n’était pas bon. Mais il voulait savoir, avant d’aller plus loin, si le journaliste pouvait dire la vérité.
«Certes, dit l’autre.
– Je veux dire, pouvez-vous porter condamnation totale?
– Totale, non, il faut bien le dire. Mais je suppose que cette condamnation serait sans fondement.»
Doucement, Rieux dit qu’en effet une pareille condamnation serait sans fondement, mais qu’en posant cette question il cherchait seulement à savoir si le témoignage de Rambert pouvait ou non être sans réserves.
«Je n’admets que les témoignages sans réserves. Je ne soutiendrai donc pas le vôtre de mes renseignements.
– C’est le langage de Saint-Just», dit le journaliste en souriant.
Rieux dit sans élever le ton qu’il n’en savait rien, mais que c’était le langage d’un homme lassé du monde où il vivait, ayant pourtant le goût de ses semblables et décidé à refuser, pour sa part, l’injustice et les concessions. Rambert, le cou dans les épaules, regardait le docteur.
«Je crois que je vous comprends», dit-il enfin en se levant.
Le docteur l’accompagnait vers la porte:
«Je vous remercie de prendre les choses ainsi.»
Rambert parut impatienté:
«Oui, dit-il, je comprends, pardonnez-moi ce dérangement.»
Le docteur lui serra la main et lui dit qu’il y aurait un curieux reportage à faire sur la quantité de rats morts qu’on trouvait dans la ville en ce moment.
«Ah! s’exclama Rambert, cela m’intéresse.»
À dix-sept heures, comme il sortait pour de nouvelles visites, le docteur croisa dans l’escalier un homme encore jeune, à la silhouette lourde, au visage massif et creusé, barré d’épais sourcils. Il l’avait rencontré, quelquefois, chez les danseurs espagnols qui habitaient le dernier étage de son immeuble. Jean Tarrou fumait une cigarette avec application en contemplant les dernières convulsions d’un rat qui crevait sur une marche, à ses pieds. Il leva sur le docteur le regard calme et un peu appuyé34 de ses yeux gris, lui dit bonjour et ajouta que cette apparition des rats était une curieuse chose.
«Oui, dit Rieux, mais qui finit par être agaçante.
– Dans un sens, Docteur, dans un sens seulement.
Nous n’avons jamais rien vu de semblable, voilà tout. Mais je trouve cela intéressant, oui, positivement intéressant.»
Tarrou passa la main sur ses cheveux pour les rejeter en arrière, regarda de nouveau le rat, maintenant immobile, puis sourit à Rieux:
«Mais, en somme, Docteur, c’est surtout l’affaire du concierge.»
[Les rats meurent de plus en plus nombreux. Les Oranais commencent à s’inquiéter.
Mais, le 28 avril, le docteur est appelé par un de ses anciens malades auprès d’un personnage singulier…]
Quelques minutes plus tard, il franchissait la porte d’une maison basse de la rue Faidherbe, dans un quartier extérieur. Au milieu de l’escalier frais et puant, il rencontra Joseph Grand, l’employé, qui descendait à sa rencontre. C’était un homme d’une cinquantaine d’années, à la moustache jaune, long et voûté, les épaules étroites et les membres maigres.
De monumets, Oran ne manque guère – Оран не испытывает недостатка в памятниках
[Закрыть]
à nœud papillon et à casque de liège blanc – в галстуке-бабочке и белом пробковом шлеме
[Закрыть]
lA’ngkor – Ангкор, руины древней столицы в Камбодже (IX–XIII в.)
[Закрыть]
la Tour de Babel – Вавилонская башня
[Закрыть]
Pâquerettes et boutons d’or – маргаритки и калужницы
[Закрыть]
Çakya-Mouni – принц Шакья-Муни Гаутама, легендарный основоположник буддизма
[Закрыть]
Il est midi, le jour lui-même est en balance – Полдень, сам день пребывает в нерешительности
[Закрыть]
un boulomane – любитель игры в шары
[Закрыть]
un mauvais plaisant – любитель глупых шуток
[Закрыть]
un regard appuyé – пристальный взгляд
[Закрыть]
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.