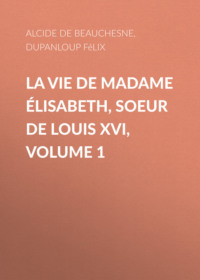Kitap dosya olarak indirilemez ancak uygulamamız üzerinden veya online olarak web sitemizden okunabilir.
Kitabı oku: «La Vie de Madame Élisabeth, soeur de Louis XVI, Volume 1», sayfa 16
Confuse d'un tel éloge, Madame Élisabeth dit en rougissant à l'évêque qu'il la jugeait beaucoup trop favorablement. «Madame, répondit le prélat, je ne suis pas même au niveau de mon sujet. – Vous avez raison, lui dit-elle, car vous êtes bien au-dessus.»
Dans le courant de cette même année, l'abbé Binos120 demandait à Madame Élisabeth la permission de lui dédier un ouvrage de sa composition ayant pour titre: Voyage par l'Italie en Égypte, au mont Liban et en Palestine. Le titre seul de ce livre indique l'intérêt que sa lecture devait offrir à la princesse. «Vous m'avez fait entrevoir la terre promise, dit-elle avec mélancolie à l'auteur quelque temps après121; mais serai-je de ces Israélites à qui Dieu doit donner la grâce d'y arriver?»
LIVRE QUATRIÈME
JANVIER 1787. – SEPTEMBRE 1789
Montreuil annexé à Versailles. – Convocation des notables. – Mort de Vergennes. – Necker remplacé par Calonne. – Concours stérile de l'assemblée des notables. – Mécontentement; besoin d'innovations. – Lettre de Madame Élisabeth. – Idées politiques de cette princesse; son caractère; justice qui lui est rendue, même à la cour. – Ses rapports avec le Roi et la Reine. – Le fils du roi de la Cochinchine à Versailles. – Protection que le Roi lui accorde. – Calonne et Hue de Miromesnil quittent le ministère. – M. de Loménie de Brienne. – Le Dauphin est remis au duc d'Harcourt. – Mort de Madame Sophie, fille du Roi, âgée de onze mois et six jours. – Lettre de Madame Élisabeth. – Buisson, garçon servant. – Réformes. – Difficultés de la situation; lettre de Madame Élisabeth. – Le sultan de Mysore à Versailles. – Retraite de Brienne et de Lamoignon. – Necker, surintendant des finances. – Le Parlement rappelé s'unit aux pairs pour faire au Roi de respectueuses supplications. – Les princesses lui adressent un mémoire. – Indécision du Roi. – Demande d'une double représentation pour le Tiers. – Lettre des pairs du royaume. – Disette et misère. – Charité de Madame Élisabeth. – Lettre adressée par elle à madame Marie de Causans. – Maison Réveillon incendiée. – Ouverture des États généraux. – Montreuil; la basse-cour et l'étable; Jacques Bosson et Marie Magnin. – Leur mariage. – La romance du Pauvre Jacques. – Mort du premier Dauphin; cérémonies funèbres; récit officiel. – Meurtre de Flesselles, de Foulon, de Berthier. – Lettre de Madame Élisabeth à madame de Bombelles; lettre à madame de Raigecourt. – Prière
Par un édit du Roi du mois d'août 1786, il avait été décidé que la commune de Montreuil serait réunie à la ville de Versailles le 1er janvier 1787. En effet, à dater de ce jour, les limites de Versailles furent reculées jusqu'aux extrémités de Montreuil, dont le territoire se trouva ainsi tout entier annexé à la cité de Louis XIV.
Le désordre des finances, les ferments de trouble et de discorde qui se manifestaient de toutes parts engagèrent le Roi à réunir l'assemblée des notables. La convocation en fut faite à Versailles pour le 29 janvier 1787. La maladie de M. de Vergennes122 la fit remettre au 22 février. Le Roi, entouré de sa famille, fit ce jour-là l'ouverture de l'Assemblée. Il annonça, le 9 mars 1787, qu'il était dans l'intention de faire des retranchements de dépenses tant dans sa maison que dans celles de sa famille; que ceux faits dans sa propre maison seraient ceux qui coûteraient le moins à son cœur; qu'enfin il espérait faire monter les économies à une somme de quarante millions. Il ajouta qu'il prendrait les mesures les plus efficaces pour que le déficit ne se renouvelât pas dans l'avenir.
Il restait encore cent millions de déficit. M. de Calonne, qui venait de remplacer Necker aux finances, présentait plusieurs propositions par l'adoption desquelles il eût été facilement couvert; mais le clergé et la magistrature se montrèrent résolus à repousser ces propositions.
Louis XVI ne put trouver dans cette réunion des hommes de France les plus recommandables par leur position et leurs lumières l'énergique appui que devait attendre un prince jaloux d'obvier aux abus et de réparer les désastres. L'esprit d'égalité, né dans les classes intermédiaires de la haine envieuse des supériorités sociales, et qui avait emprunté, pour se faire bien venir de Louis XVI, quelque chose du sentiment religieux, gagna encore dans son esprit par cette résistance des notables aux projets de réformes. Se regardant comme le père de tous les Français, le Roi trouvait naturel qu'ils fussent égaux devant les lois comme ils l'étaient dans ses affections. Marie-Antoinette, qui n'avait pas eu à se louer de la noblesse, et dont les goûts de simplicité s'arrangeaient peu de l'étiquette, espéra peut-être un instant trouver dans cet esprit d'égalité un auxiliaire utile pour les projets de la royauté contrariés par les ordres privilégiés. Ces deux illusions ne durèrent pas longtemps. La France, possédée d'un besoin indéfinissable d'innovations, s'était prise de dégoût pour tout ce qu'elle connaissait, et se flattait de trouver dans l'inconnu une félicité parfaite. Arrêté dans ses projets, M. de Calonne fit circuler dans Paris et dans les principales villes du royaume un Avis au peuple, dans lequel il se prononçait violemment contre le clergé et la noblesse. Le gouvernement se fit ainsi complice de la destruction, espérant conserver par la popularité un pouvoir que les idées nouvelles brisaient dans ses mains. Le sens élevé et pénétrant de Madame Élisabeth jugeait tout autrement la position difficile de l'État.
«Cette fameuse assemblée (écrivait-elle le 15 mars 1787) est réunie; que fera-t-elle? Rien, que faire connoître au peuple la situation critique où nous sommes. Le Roi est de bonne foi dans les conseils qu'il leur demande: le seront-ils autant dans ceux qu'ils lui donneront?.. La Reine est très-pensive; quelquefois nous sommes des heures seules sans qu'elle profère un mot: elle semble me craindre. Eh! qui peut cependant prendre un intérêt plus vif que moi au bonheur de mon frère? Nos opinions diffèrent; elle est Autrichienne, et moi je suis Bourbon… Le comte d'Artois ne comprend rien à la nécessité de ces grandes réformes; il croit qu'on augmente le déficit pour avoir le droit de se plaindre et de demander les états généraux… Monsieur s'occupe beaucoup de son bureau; il est plus grave de moitié, et vous savez qu'il l'étoit déjà assez. J'ai un pressentiment que tout cela tournera à mal. Pour moi, les intrigues me fatiguent… J'aime la paix et le repos. Mais ce n'est pas quand le Roi est malheureux que je me séparerai de lui…»
Cette lettre, qui nous laisse entrevoir les idées politiques de Madame Élisabeth, contient aussi son appréciation de l'attitude de l'assemblée des notables, et témoigne du peu de fond que faisait la princesse sur les services que cette assemblée pouvait rendre; elle nous initie en outre aux opinions des principaux membres de la famille royale, et nous montre à nu le caractère et le cœur de notre admirable princesse. Quelles qualités, quelles vertus n'avait-elle pas? Elle aimait son Dieu de toute son âme; elle aimait le Roi son frère avec un dévouement absolu, et dans cet amour elle faisait entrer l'amour de sa patrie; elle aimait ses sœurs, elle aimait les princes ses frères avec tendresse; elle aimait les malheureux d'une affection miséricordieuse; elle aimait ses amies d'une ardeur sainte et éclairée: sévère pour elle-même, elle était pour ses compagnes d'une tolérance parfaite, les reprenant toujours avec une douceur et une raison admirables. Un jour, la vicomtesse de Mérinville allait à l'Opéra: la jeune marquise des Moutiers, sa belle-fille, lui exprima le plus grand désir de l'accompagner. Madame de Mérinville ne le jugea pas convenable, et partit sans l'emmener. La jeune femme éprouva une vive humeur de ce refus, et s'en vengea en tenant les plus durs propos contre sa belle-mère. Cette rancune durait depuis plusieurs jours. «Mon cher démon, lui dit Madame Élisabeth, sais-tu que tu commets là un très-gros péché? Je vais ce soir à l'Opéra, et je te propose, moi, de t'emmener; car, après tout, si tu fais mal en allant au théâtre, tu fais cent fois pis en déblatérant contre ta mère.»
Ajoutons que Madame Élisabeth chérissait les enfants de ses amies comme elle eût chéri les siens, et il n'en est pas un, ne fût-il âgé que de trois ou quatre ans, qui ne se soit souvenu plus tard de Madame Élisabeth, de sa bonté et de ses caresses.
Mais quel que fût son abandon avec ses amies, jamais un mot de médisance ne trouvait place dans leur causerie. Dans cette pure atmosphère n'entrait jamais le récit des nouvelles galantes, des anecdotes hasardées dont la malignité publique amusait à cette époque la cour et la ville. Madame Élisabeth avait si bien montré tout d'abord le profond éloignement qu'elle éprouvait pour toute conversation relative à de tels sujets, que plusieurs de ses dames qui n'étaient pas mêlées aux intrigues de la cour n'apprirent que plus tard, et en pays étrangers, les mille et une aventures dont le bruit avait couru à Paris et à Versailles.
Rendons aussi cet hommage à Madame Élisabeth, que la renommée de sa perfection était telle à la cour, que, dès qu'elle y paraissait, toute conversation de ce genre tombait aussitôt, et le respect qu'elle inspirait venait se poser comme un sceau sur les bouches les moins timides.
Ses relations avec la Reine, bien qu'exemptes de cette intimité, que ne comportaient ni la différence des âges ni celle des positions, non plus que la dissemblance des occupations journalières, n'en étaient pas moins sur un pied de convenance parfaite et d'attachement véritable. Soumise au Roi avec une respectueuse tendresse, elle ne se permettait jamais de blâmer un acte de son gouvernement, alors même qu'il blessait sa raison ou ses sentiments. Cette retenue était peut-être encore plus mesurée et plus attentive pour tout ce qui se rapportait à la Reine, craignant non-seulement d'apporter un avis dans la région où se mouvait son autorité, mais encore de laisser échapper un geste ou une parole qui pussent être présentés comme une improbation dans la sphère de ses amusements ou de ses fantaisies. Quelques personnes du cercle habituel de la Reine qui connaissaient le mérite de Madame Élisabeth et qui redoutaient son influence sur l'esprit du Roi, n'avaient pas manqué de chercher à faire naître un sentiment jaloux dans le cœur de Marie-Antoinette; mais la réserve de notre princesse fut plus habile avec sa droiture et sa sagesse que la cour avec toutes ses intrigues; la Reine, que la politique étrangère et l'adulation intéressée de son entourage sollicitaient également à gouverner sous le nom de son mari, s'était rassurée aisément devant l'attitude de sa belle-sœur, la réserve de son caractère et la simplicité de ses goûts. Elle eut pour elle une estime confiante, qui plus tard, dans le malheur, devint une tendre amitié.
Éloignée des affaires par ses propres penchants aussi bien que par les principes de son éducation, Madame Élisabeth n'intervenait jamais pour le succès d'une démarche que lorsqu'elle y était portée par les penchants de son cœur et par un sentiment de justice. Le Roi et la Reine savaient que ses recommandations étaient rares, mais qu'elles étaient sérieuses; que son estime ne s'accordait pas à la légère, et que le suffrage de Madame Élisabeth était déjà une prévention favorable qui témoignait pour le solliciteur.
Les dissipations de la cour n'avaient aucun attrait pour Madame Élisabeth; obligée d'y paraître quand les priviléges de son rang, les règles de l'étiquette ou une invitation personnelle du Roi ou de la Reine l'exigeaient, elle ne le faisait qu'à regret et par obéissance, et toujours avec une grande circonspection. Les regards de la cour, les acclamations de la foule ne lui rendaient que plus chers le calme de la solitude et le cercle étroit de l'intimité.
Elle voyait avec peine et avec inquiétude que la Reine se montrait trop facilement, qu'elle allait à Paris sans aucun cérémonial, et que, dans les belles soirées d'été, elle se laissait entourer par la foule des promeneurs sur la terrasse du jardin de Versailles. Madame Élisabeth était persuadée que les succès conquis par la femme enlevaient quelque chose au prestige de la Reine, et que l'accès laissé à la familiarité deviendrait un amoindrissement du respect. Quand les rois demeuraient invisibles, l'imagination des peuples en faisait des êtres surnaturels, et leur enthousiasme éclatait le jour où ces représentants de Dieu, majestueux et inviolables, daignaient leur apparaître un moment. Il était à craindre que, si les souverains descendaient souvent vers le peuple, le peuple ne s'approchât lui-même assez près d'eux pour voir que la Reine n'était qu'une jolie femme, et ne tardât pas à conclure que le Roi n'était que le premier des fonctionnaires. N'osant pas toutefois se faire auprès de Marie-Antoinette l'organe d'une telle pensée, Madame Élisabeth en fit part à Madame Adélaïde, qui essaya de faire comprendre à la Reine que l'étiquette, en s'abdiquant elle-même, ouvrait la porte à la révolution.
Les observations de cette nature ne pouvaient s'appliquer à Trianon: dans cette résidence, la royauté n'était pas en présence des regards publics; c'était au contraire pour être loin de la foule et de la cour elle-même que Marie-Antoinette s'y rendait; c'est pour cela aussi que Madame Élisabeth l'y rencontrait avec plus de plaisir que dans l'éclat des grandeurs souveraines. Tout était simple à Trianon. La royale châtelaine voulait qu'on y trouvât les usages de la vie de château: elle entrait dans le salon sans que les dames quittassent leur tapisserie ou leur clavecin, sans que les hommes suspendissent une partie d'échecs ou de billard; la maîtresse de la maison l'avait réglé ainsi. L'exiguïté du logement ne permettait à aucune dame du palais de s'y établir. Madame Élisabeth seule y accompagnait d'ordinaire la Reine: une robe de percale blanche, un chapeau de paille, un fichu de gaze, telle était la parure habituelle des princesses. Sur l'invitation de la Reine, on arrivait de Versailles à l'heure du dîner. Louis XVI et ses frères y venaient souvent souper. Le plaisir qu'éprouvait la Reine à parcourir avec sa sœur Élisabeth les petites fabriques de son hameau, à pêcher dans son petit lac, à voir traire ses vaches, lui faisait prendre en dégoût la pompeuse résidence de Marly, avec sa multitude de visiteurs, ses jeux et ses fêtes magiques.
Lorsque, dans son charmant asile de Trianon, dégagé de toute représentation, il lui vint à l'idée de jouer la comédie, usage adopté dans presque tous les châteaux pendant la belle saison, elle associa sa jeune belle-sœur à ce divertissement. Ainsi, dans la Gageure imprévue, Madame Élisabeth jouait le rôle de la jeune personne, la Reine celui de Gotte, la comtesse Diane de Polignac celui de madame de Clairville.
Cette distraction n'était pas précisément un amusement pour Madame Élisabeth; mais, comme le travail, elle la sauvait de l'ennui. Jamais son front ouvert n'apparut chargé d'un nuage. Elle avait pour principe de faire céder en toute occasion son goût personnel aux obligations et aux égards indiqués par la convenance, et ce sacrifice ne semblait rien lui coûter.
Les cabinets de l'Europe ne pouvaient plus guère ignorer les difficultés qu'éprouvait le gouvernement de France; mais l'autorité du Roi avait conservé au delà des mers tout son prestige, et les souverains étrangers les plus éloignés de la France briguaient son alliance, et, dans leurs revers, imploraient sa protection. Un enfant de neuf à dix ans, héritier du roi de la Cochinchine, conduit par un missionnaire évêque et accompagné par deux de ses parents, arriva ainsi à Versailles vers ce temps-là, le trône et la vie de son père étant menacés par un ennemi redoutable, ancien intendant des douanes et impôts perçus dans le royaume. Au mois de mars 1787, le maréchal de Castries présenta ce jeune étranger au Roi dans le salon d'Hercule. L'enfant, selon l'étiquette de son pays, se prosterna devant le souverain, qui s'empressa de le relever avec bonté. Ses parents et quelques pages qui formaient sa suite se prosternèrent aussi le front contre terre, tandis que le prélat, compagnon de leur long voyage, restait debout à leur côté. Le jeune prince avait pour vêtement une robe de mousseline qu'enveloppait une espèce de manteau broché de soie et d'or. Il fut aussi présenté à Marie-Antoinette et à la famille royale, pour qui son âge et sa situation aussi bien que sa gentillesse le rendaient fort intéressant. Il fut admis plus d'une fois à jouer avec le premier Dauphin, moins âgé que lui de trois à quatre ans. Madame Élisabeth essaya un jour d'établir une petite conversation avec lui, mais il ne savait que quelques mots de français, qu'il tenait de son gouverneur ecclésiastique ou qu'il avait appris pendant la traversée.
Louis XVI fut ému des larmes d'un enfant qui avait traversé les mers pour venir chercher du secours pour son père, – réfugié sur le point le plus éloigné de ses provinces maritimes, et luttant seul avec ses derniers défenseurs contre la félonie et la rébellion. Des nouvelles envoyées de Cochinchine depuis le départ de cette mission faisaient un tableau affreux de ce malheureux pays: dans les églises, dans les pagodes s'étaient installés les mandarins rebelles; les éléphants habitaient les maisons des riches égorgés ou en fuite. Depuis treize ans jusqu'à soixante-cinq, tout le monde était armé; toute habitation prise était pillée. Il fallait se presser. Louis XVI accorda huit cents hommes, sous la conduite de M. de Clermont, militaire d'un vrai mérite; puis deux frégates, la Méduse et la Dryade, sous le commandement de M. de Kersaint, officier de marine expérimenté. L'apparition de ces huit cents Français ranima le courage de la partie saine de la nation annamite et donna l'élan à une armée de soixante mille Indiens: l'armée révolutionnaire fut culbutée, tandis que les frégates jetaient l'épouvante sur toute la côte habitée par les rebelles. La France eut ainsi la consolation et la gloire d'avoir mis fin aux calamités d'un peuple.
Le crédit de M. de Calonne, quoique soutenu par la Reine et madame de Polignac, croula bientôt. Immoral, prodigue et frivole, il s'était donné les dehors d'une honnêteté rigide. «La probité de Calonne, disait Rivarol, est composée de deux substances: friponnerie et dissipation.» Le 20 avril, il quitta le ministère, et alla dans sa terre de Lorraine méditer sur la fragilité des choses humaines aussi bien que sur l'inflexible éloquence des chiffres. Louis XVI, qui accordait facilement sa confiance, mais qui entrait en fureur dès qu'il croyait voir qu'elle n'était pas justifiée, lui ordonna de ne plus porter les marques de l'ordre du Saint-Esprit.
M. Hue de Miromesnil, garde des sceaux, partagea la disgrâce de M. de Calonne. Tout en l'assurant de son estime et du désir de lui offrir des témoignages de sa bienveillance, le Roi lui écrivit que son grand âge ne lui permettant pas de tenir sa place dans des circonstances si difficiles, il l'engageait à donner sa démission123.
M. de Loménie de Brienne, archevêque de Toulouse, qui convoitait depuis longtemps le ministère des finances, fut nommé chef du conseil royal des finances le 1er mai 1787. M. Bouvart de Fourqueux, conseiller d'État au conseil royal du commerce, donna sa démission; M. de Villedeuil le remplaça le 12 mai. «J'ai trouvé l'anagramme de ce nom, dit Madame Élisabeth à M. Lemonnier; c'est «Dieu le veille!» M. de Brienne, pour masquer d'un titre pompeux la faiblesse de ses moyens, se fit donner par le Roi la qualification imposante de principal ministre d'État, et obtint de lui l'archevêché de Sens et l'abbaye de Corbie.
L'homme qui acceptait ainsi avec empressement les abus qui lui profitaient paraissait disposé à la suppression de ceux qui ne profitaient qu'aux autres. Pour se faire bienvenir de certaines gens qui n'apprécient guère les réformes que lorsqu'elles atteignent les sommités de l'édifice social, il sollicita, peu de temps après, deux édits sur lesquels il comptait pour populariser son administration: l'un, registré en parlement le 14 mars, ordonnait la démolition ou la vente des châteaux de la Muette, de Madrid, de Vincennes et de Blois, ainsi que l'aliénation de celles des maisons dont Sa Majesté était propriétaire à Paris, et qui n'étaient pas comprises dans les plans et projets définitivement arrêtés pour l'isolement du palais du Louvre; l'autre, registré en la chambre des comptes le 25 du même mois, portait suppression de diverses charges de la maison de la Reine. Le nombre des charges supprimées était de cent soixante-treize, et le total de leurs finances formait un objet de 1,206,600 livres.
Ces mesures étaient facilement prises sur le papier; elles l'étaient moins dans la pratique. Des milliers de familles se seraient trouvées réduites à la misère par l'exécution immédiate de ces réformes.
À l'époque où M. de Brienne inaugura son administration, le Dauphin ayant atteint l'âge de cinq ans et sept mois, le Roi se détermina à le remettre entre les mains des hommes. Une note du temps rapporte cet acte en ces termes: «Le duc de Harcourt, gouverneur du Dauphin, ses deux sous-gouverneurs et les autres personnes choisies par Sa Majesté pour être employées à une éducation aussi importante, se rendirent, le 1er mai 1787, vers les onze heures du matin, dans le grand cabinet du Roi. La duchesse de Polignac, gouvernante des Enfants de France, accompagnée de la comtesse de Soucy et de la marquise de Villefort, sous-gouvernantes, ainsi que du service du berceau, y amena Mgr le Dauphin; et, après qu'il eut été rendu compte au Roi de l'état de la santé du prince, duquel il avoit été, le même jour, à huit heures du matin, dressé procès-verbal par la Faculté, le Roi reçut Mgr le Dauphin des mains de la duchesse de Polignac, à laquelle Sa Majesté témoigna sa satisfaction des soins qu'elle avoit pris de ce prince, et le remit au duc de Harcourt, qui, après avoir conduit Mgr le Dauphin chez la Reine, l'accompagna à l'appartement qui lui avoit été réservé.»
Le vendredi 15 juin, la jeune fille du Roi (Sophie-Hélène-Béatrix), qui n'avait que onze mois et six jours, fut atteinte d'un malaise qui causa quelque inquiétude. Le Roi, qui devait chasser, ne sortit pas, non plus que les jours suivants. Madame Élisabeth oublia son cher Montreuil, retenue au château de Versailles par les soins qu'elle pouvait donner à sa pauvre petite nièce; elle ne la quitta que dans de courts intervalles. L'enfant mourut le mardi 19, à trois heures124.
La notification de son décès fut expédiée le jour même à l'abbaye de Saint-Denis125. Cette perte, qui affectait vivement la famille royale, resserra encore les liens de la Reine et de Madame Élisabeth. On se promit de se voir ou de s'écrire plus souvent que jamais. – Le 22 juin, Madame Élisabeth reçut ce billet: «Madame de Polignac a été fort indisposée tout de bon hier et ce matin, et m'a donné de l'inquiétude; voilà pourquoi, mon cher cœur, vous n'avez pas vu de mon écriture, que vous attendiez dans votre petit Trianon. Je veux absolument faire avec vous, ma chère Élisabeth, une visite au mien. Mettons, si vous le voulez, cela au 24 juin. Est-ce arrangé? Le Roi promet d'y venir: nous pleurerons sur la mort de ma pauvre petite ange.
»Adieu, mon cher cœur, vous savez combien je vous aime, et j'ai besoin de tout votre cœur pour consoler le mien.
»Marie-Antoinette.»
»Ce 22 juin 1787.»
La princesse se rendit à cette touchante invitation, et, le 25, elle écrivait à madame de Bombelles une longue lettre où éclataient à la fois son amitié pour la Reine, sa tendresse pour les enfants de sa belle-sœur, sa prédilection pour la jeune Marie-Thérèse, appelée à devenir son élève et la compagne des derniers temps de sa vie, et je ne sais quel pressentiment confus de l'avenir qui lui faisait envier le sort de la petite Sophie, «bien heureuse, disait-elle, d'avoir échappé à tous les périls». Elle ajoutait: «Ma paresse se seroit très-bien trouvée de partager plus jeune son sort… Je l'ai bien soignée, espérant qu'elle prieroit pour moi.» Puis venaient ces paroles sur la fille aînée du Roi, Marie-Thérèse de France: «Ma nièce a été charmante; elle a montré une sensibilité extraordinaire pour son âge et qui étoit bien naturelle.»
Le lendemain (26 juin), Madame Élisabeth accompagna Louis XVI à Rambouillet, d'où, après le déjeuner, ils allèrent courir le cerf à Batouceaux. La Reine les rejoignit dans la soirée, et ils soupèrent ensemble à Rambouillet.
Le 1er août, la Reine s'installa à Trianon et y demeura jusqu'au 25, jour de la fête du Roi. Madame Élisabeth y avait suivi la Reine. Louis XVI y venait dîner ou souper presque tous les jours. On éprouvait de plus en plus de part et d'autre le besoin de se voir, comme si l'on sentait qu'il faudrait bientôt se séparer.
Les améliorations financières imaginées par M. de Brienne pour soulager le trésor public n'étaient point faciles à réaliser.
Ce n'est point par des suppressions de pensions accordées à d'anciens serviteurs ou d'aumônes faites à des familles nécessiteuses que Madame Élisabeth cherchait à opérer des réformes.
Ces réformes se trouvaient faites naturellement par la simplicité de ses goûts, par le train modeste de sa maison, qui plus d'une fois eurent l'honneur d'être critiqués par les magnifiques et les prodigues de la cour.
«J'ai appris, disait-elle un jour, qu'on se moque un peu au château de la simplicité de mon entourage: eh bien, je suis fâchée de le dire, le Roi n'a peut-être pas beaucoup de gens qui aimassent mieux se faire casser la tête à son service que de briser sa porcelaine! C'est pourtant ce qui est arrivé à mon pauvre Buisson, qui portoit le dessert de mon dîner. Le pied lui a glissé sur l'escalier, et toute la porcelaine que contenoit sa barquette126 eût été infailliblement cassée si ce brave garçon ne l'eût soutenue horizontalement en portant sa tête contre le mur. La commotion qu'il en a reçue a été si violente qu'il s'est évanoui dès que sa barquette intacte a été posée à terre.»
Madame Élisabeth avait raison: le Roi avait peu de ministres qui protégeassent ainsi la porcelaine de l'État. Mais ce qu'elle ne raconte point, c'est qu'elle avait fait porter immédiatement à l'infirmerie ce dévoué serviteur, qu'elle recommanda aux meilleurs soins et qu'elle chercha à dédommager par une récompense. Il n'en jouit pas longtemps. Au bout de six semaines, alors même qu'il paraissait remis des suites de cet accident, il mourut subitement, laissant une femme et six enfants dans la misère. Madame Élisabeth supplia le grand maître de donner à cette malheureuse femme la pension des veuves, bien que le nom de son mari ne fût point porté sur le contrôle des gens de la maison royale. Le prince de Condé invoqua les règlements pour légitimer son refus. Mais Madame Élisabeth peignit avec tant d'émotion la position affreuse de cette nombreuse famille mourant de froid et de faim, que le grand maître fit céder l'inflexibilité de la règle aux exigences de la charité. La femme de Buisson reçut la pension des veuves, de vingt sols par jour. Madame Élisabeth en ajouta autant sur sa cassette, et cette double petite rente suffit à l'entretien de cette pauvre famille.
Madame Élisabeth sentait chaque jour ses devoirs grandir avec les périls, car déjà elle apercevait à l'horizon plus d'un point noir qui annonçait des orages prochains. Elle cherchait un remède à tous les maux qu'elle entrevoyait. Le dérangement des finances avait forcé l'État et la cour elle-même à songer à des projets de réforme. Madame Élisabeth entre tout d'abord dans ce complot: avec sa modestie habituelle, elle fait appeler le premier écuyer du Roi: «Monsieur, lui dit-elle, des réformes, je le sais, sont indispensables. Le Roi veut, avant tous, donner l'exemple dans sa maison: je vous demande que les premiers chevaux supprimés dans son écurie soient les miens. J'ai encore un autre service à attendre de vous: le Roi est si bon, qu'il pourrait croire que la privation de mon exercice favori peut être nuisible à ma santé. Promettez-moi que vous me garderez le secret de cette affaire.»
L'écuyer prit cet engagement, et je n'ai pas besoin de dire qu'il y fut fidèle; mais Madame Élisabeth, après avoir offert avec sa générosité naturelle sa part de sacrifices pour alléger le poids des charges publiques, convenait plus tard avec une naïveté charmante, dans une lettre écrite le 25 juin 1787 à madame de Bombelles, qu'elle avait été bien aise que ce sacrifice n'eût point paru nécessaire: «On n'a point accepté le sacrifice que j'avois proposé de faire de mes chevaux, lui dit-elle; je ne puis te dissimuler que cela m'a fait un vrai plaisir, et j'en jouis d'autant plus que je vais demain à la chasse à Rambouillet avec la duchesse de Duras.»
L'hiver de 1788 à 1789 devait inaugurer pour la France l'ère des afflictions et des désastres. La disette et la misère, qu'un froid rigoureux rendait encore plus terribles, avaient éveillé dans tout le royaume un sentiment public de généreuse commisération: le Roi, la Reine, l'archevêque de Paris donnèrent un exemple qui fut suivi par tous les châteaux, aujourd'hui ouverts à la charité, et quelques mois plus tard voués à l'incendie. Madame Élisabeth économisa sur toutes choses dans son intérieur, afin de porter au dehors non pas de son superflu, mais de son nécessaire.
Quelquefois, pour suppléer à l'insuffisance de ses ressources, elle faisait vendre quelque boîte précieuse, une montre, un bracelet ou autres bijoux qui lui appartenaient, et auxquels ne s'attachait pour elle aucun souvenir d'amitié. Un jour qu'on lui en rapportait le prix: «Ce n'est pas seulement de l'argent, dit-elle, c'est aussi du temps gagné; car tels pauvres n'auront pas si longtemps à souffrir.» Pour avancer à ceux qui ne pouvaient attendre, elle n'hésitait pas même à faire des dettes que les privations personnelles devaient acquitter plus tard.
C'est à cette époque que madame Marie de Causans se disposait à entrer au couvent. L'idée de ce grand acte préoccupait vivement Madame Élisabeth. Dans une admirable lettre où se déployaient la prudence et la pénétration de son esprit et la droiture de son noble cœur, la princesse, avec sa piété éclairée, conseillait à la fille de son amie de ne pas s'engager dans la vie religieuse sans s'être bien étudiée elle-même, et de ne pas prendre pour une vocation durable et définitive un attrait passager qui pouvait n'être qu'une tentation déguisée. Les mortifications physiques n'étaient rien, l'habitude suffisait pour s'y faire; mais l'abdication de la volonté, les renoncements, tout ce qui constituait la vie religieuse, voilà à quoi il fallait être sérieusement préparé; et puis, avant de céder au penchant qui l'entraînait vers la retraite, madame Marie de Causans ne devait-elle pas considérer que sa mère mourante lui avait confié une mission envers sa jeune sœur? L'abandonnerait-elle à dix-huit ans aux dangers du monde, et la priverait-elle d'un appui, d'un guide qui lui était peut-être nécessaire? Ne servirait-elle pas plus sûrement Dieu en remplissant ce devoir, qu'en se laissant aller à la pente qui la conduisait vers le cloître? Voilà les considérations que Madame Élisabeth adjurait Marie de Causans de peser, et sur lesquelles elle l'invitait à consulter des personnes consommées dans le discernement des vocations et la conduite des âmes.
«Sire,
»Ce n'étoit point l'intérêt de ma fortune, mais celui de mon amour et de mon attachement respectueux pour Votre Majesté, qui m'enchaînoit à sa personne. J'ai tout perdu quand elle me retire ses bontés; l'état de ses finances ne me permet pas de rien demander; j'ai toujours su vivre de peu; j'étois pauvre quand je suis entré au ministère, et j'ai le bonheur d'en sortir de même; je me bornerai à faire des vœux pour la gloire et la prospérité du règne de Votre Majesté; je la prie seulement de permettre que je mette à ses pieds l'intérêt de mes enfants.»
Chers et bien amés, nous avons ordonné que le corps de notre très-chère et très-amée fille, Sophie-Hélène-Béatrix, dont Dieu a disposé, soit porté à l'abbaye royale de Saint-Denis, pour y être inhumé dans le caveau des princes de la branche de Bourbon, par notre très-cher et bien amé cousin le sieur de Montmorency-Laval, évêque de Metz, grand aumônier de France, commandeur de notre ordre du Saint-Esprit, et nous vous mandons de le recevoir avec la décence nécessaire le jour et ainsi que le grand maître ou le maître des cérémonies vous le dira de notre part. Si n'y faites faute. Car tel est notre plaisir. Donné à Versailles, le 19 juin 1787.
LOUIS. Et plus bas: le baron De Breteuil.
À nos chers et bien amés les Prieur et Religieux de l'abbaye royale de Saint-Denis.