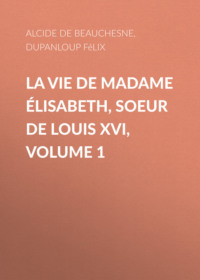Kitap dosya olarak indirilemez ancak uygulamamız üzerinden veya online olarak web sitemizden okunabilir.
Kitabı oku: «La Vie de Madame Élisabeth, soeur de Louis XVI, Volume 1», sayfa 15
Le jour même où Madame Élisabeth traçait ces lignes, la cour prenait le deuil à l'occasion de la mort du duc d'Orléans, mort à Sainte-Assise le 18 novembre, à l'âge de soixante ans et demi.
Ce prince, qui aimait à varier ses amusements, avait fait construire, dans sa maison de campagne de Bagnolet, un théâtre sur lequel il joua lui-même la comédie avec les personnes admises dans son intimité. Ce fut pour cette petite scène que Collé avait fait, en 1766, la Partie de chasse de Henri IV; le duc d'Orléans, qui jouait toujours de préférence les rôles de financier ou de paysan, eut un certain succès dans le rôle du meunier Michau. Mais un souvenir plus élevé recommande la mémoire de ce prince: la passion du plaisir n'avait point refroidi en lui le goût de la charité, dont il avait hérité de son père.
Il se plaisait même à cacher avec tant de soin le bien qu'il faisait, qu'on ne connut qu'après sa mort les droits qu'il avait à la reconnaissance des malheureux. Un particulier investi de sa confiance descendait de sa part, mais non en son nom, dans les plus profonds cachots, montait dans les plus sales greniers, pénétrait enfin dans les plus tristes réduits de la misère, payait les dettes des pères de famille détenus dans les liens, pensionnait des veuves, sauvait des jeunes filles de la tentation de chercher dans l'opprobre des ressources pour leurs besoins, arrachait enfin à l'indigence de braves défenseurs de l'État chargés d'ans et de blessures, et contraints de cacher leur croix de Saint-Louis. La reconnaissance aime à pouvoir nommer le bienfaiteur dans ses prières: «Dites-nous donc, s'écriaient ces infortunés, à qui devons-nous tant de bienfaits? – Ce n'est pas à moi, répondait l'envoyé discret, j'agis pour un autre. La personne voisine, que je charge de veiller à vos besoins, attestera seulement de sa main: Il a été donné la somme de tant au nom de Luc.» Or, c'était sous ce nom inconnu de Luc que se voilait le premier prince du sang.
Lorsqu'il était à la tête des armées, le bien-être du soldat l'occupait sans cesse. Que de fois, dans ses campements, il acheta la récolte de plusieurs jardins chargés de légumes et de fruits! «Allez, mes enfants! disait-il à sa troupe, allez! ces fruits et ces végétaux, ces jardins sont à vous. Ne touchez pas aux propriétés étrangères: vous connaissez nos lois; un châtiment sévère punirait vos rapines; mais ces plates-bandes cultivées avec soin et couvertes des meilleures productions de la nature deviennent, par le don que je vous en fais, vos propriétés personnelles; usez-en à discrétion, vous n'offenserez personne et vous ferez plaisir à un général qui vous aime.»
L'incendie qui avait consumé en 1773 une partie du château du Raincy, appartenant à ce prince, avait atteint le garde-meuble, où se trouvait entassée une multitude d'effets précieux; on se mit en devoir d'y porter secours et d'en sauver du moins une partie: le duc d'Orléans ne permit pas qu'on y entrât. «On peut aisément réparer une perte, dit-il, et je serais inconsolable si quelqu'un y périssait.» Le fermier d'un village voisin avait envoyé au secours tous les gens de sa ferme. Dès que le prince en fut informé, il alla lui-même remercier ce digne homme, qui s'étonna de recevoir la visite du premier prince du sang.
À l'occasion du premier incendie de la salle du Palais-Royal, il avait montré le même amour de l'humanité et le même désintéressement. On était venu lui annoncer à la campagne que cette salle avait été réduite en cendres avec une partie du Palais-Royal. «Quelqu'un a-t-il péri? demanda vivement ce prince. – Non, monseigneur, personne n'a été victime de l'incendie. – Puisqu'il en est ainsi, reprit-il d'un air serein, ce n'est que de l'argent perdu.»
Louis XVI aimait beaucoup ce prince; lors de sa dernière maladie, il envoyait régulièrement trois fois par jour savoir de ses nouvelles. Le duc de Bourbon, séparé de sa femme et brouillé avec son beau-père, s'étant présenté devant le Roi dans cet intervalle, Sa Majesté, en lui montrant le bulletin de la maladie du duc d'Orléans, lui dit: «Je ne sais pas, monsieur, pourquoi je vous donne ces nouvelles, car c'est par vous que j'aurais dû les apprendre.» Le duc de Bourbon se reprocha son indifférence, et se rendit à Sainte-Assise pour offrir à son beau-père une consolation à laquelle ce prince ne s'attendait plus. «Monsieur, lui dit le mourant, je suis reconnaissant de votre visite; mais je le serais bien davantage si vous me la faisiez avec votre femme.» Pendant sa maladie, le duc d'Orléans fut entouré des soins des abbés de Saint-Albin et de Saint-Phar113, et de madame de Lambert, leur sœur. Il montra à ses derniers moments les sentiments de la plus douce piété. Après sa mort, la duchesse de Chartres et la duchesse de Bourbon, se conformant au désir exprimé par leur père, ramenèrent madame de Montesson à Paris, tandis que, de son côté, le duc de Chartres, suivant l'étiquette, alla lui-même informer le Roi de ce triste événement; et Sa Majesté, suivant le même protocole, lui ayant répondu: «Monsieur le duc d'Orléans, je suis très-fâché de la mort du prince votre père», ce prince en prit aussitôt le nom, et le duc de Valois, son fils aîné, prit celui de duc de Chartres.
Le prince qui venait de mourir fut regretté comme homme; comme prince, il occupa peu l'attention: étranger aux intrigues politiques, il n'avait recherché que les jouissances de la vie privée. Cependant on est porté à croire que sa perte fut un malheur public: dévoué de cœur au monarque chef de sa famille, peut-être eût-il, quelques années plus tard, contenu les entraînements de son fils vers une révolution qui devait le dévorer à son tour.
Le 20 février de l'année suivante, l'oraison funèbre du duc d'Orléans114 fut prononcée dans l'église de Saint-Eustache par l'abbé Fauchet, prédicateur du Roi, esprit plus ardent que sage, chez lequel l'imagination gâtait souvent le savoir, et qui, quelques années plus tard, tout en prêchant l'Évangile, rédigeait le journal la Bouche de fer.
La mort du duc d'Orléans remit encore sur le tapis une grave question d'étiquette: il s'agissait de savoir si madame de Montesson, qui passait pour avoir épousé secrètement le feu prince, était apte à draper. Cette affaire fort embarrassante fut remise à la décision du Roi. Sa Majesté déclara que madame de Montesson pourrait dans son intérieur porter le deuil comme bon lui semblerait, mais nullement en public. Madame de Montesson se retira au couvent de l'Assomption et y passa l'année de son veuvage. La décision de Louis XVI peut paraître sévère aujourd'hui; mais si elle eût été autre, elle aurait scandalisé et indigné tous les amis des vieilles coutumes de la monarchie.
Madame de Maintenon n'avait point drapé; elle avait habillé les gens de sa maison couleur de feuilles mortes, et s'était retirée à Saint-Cyr. Il n'était point possible d'accorder à la veuve morganatique d'un prince du sang ce que n'avait pas cru devoir se permettre la veuve morganatique du grand Roi.
J'ai hâte de revenir à Madame Élisabeth, à qui un deuil de famille ne peut faire oublier la position presque désespérée de madame de Causans; elle ne se la dissimulait pas à elle-même, et, tout en éloignant l'imminence du danger de la pensée de ses amies, elle essayait cependant de les y préparer. Vers la fin de novembre, madame de Causans reçut les derniers sacrements; madame de Raigecourt était elle-même extrêmement malade des suites de ses couches. Les lettres de Madame Élisabeth à madame Marie de Causans qui se rapportent à ces tristes circonstances sont remplies de tout ce que peut dicter l'amitié la plus tendre, jointe à la raison la plus sûre et à la foi la plus éclairée et la plus vive. Elle ne veut pas lui ôter toute espérance, et cependant elle ne veut pas non plus lui donner une fausse sécurité. Prier, espérer, mais avec un cœur soumis d'avance à la volonté de Dieu, voilà le résumé de cette douce et sainte lettre. Dans un seul passage on voit percer une pointe de cet esprit primesautier et plein d'enjouement qui était un des attraits de Madame Élisabeth. «M. le prince de Lambesc, qui loge au-dessus de moi, m'impatiente (écrit-elle); je crois qu'il marche avec des bottes fortes, et je le prends toujours pour des nouvelles.»
L'état de madame de Raigecourt, qui, dangereusement malade à Fontainebleau, avait demandé les sacrements, commence à s'améliorer; mais celui de sa mère s'aggrave. Le médecin qui la soigne, M. Séguy, a presque prononcé son arrêt. Madame Élisabeth, dans sa lettre du 8 décembre 1785, prépare madame Marie de Causans au coup qui la menace, et c'est toujours en lui parlant de Dieu. En même temps, son amitié pour la chère malade qu'elle craint de perdre lui inspire ces touchantes expressions: «Si vous ne craignez pas d'attendrir votre mère, dites-lui combien je partage ses douleurs, que je voudrois les prendre toutes, que je suis bien affligée de ne pouvoir lui rendre les soins que ma tendre amitié pour elle me dicteroit. Il m'en coûte bien depuis trois semaines d'être princesse: c'est souvent une terrible charge; mais jamais elle ne m'est plus désagréable que lorsqu'elle empêche le cœur d'agir.»
Les lettres de la princesse se succèdent avec quelques alternatives d'espérance, qui font bientôt place à des craintes plus graves. Madame Élisabeth, avec son affectueuse sollicitude, s'occupe de tout: son cœur a toutes les prévoyances. Madame de Raigecourt est mieux; mais est-elle assez bien pour voir sans danger sa mère souffrante? Si le mieux est assez prononcé, il y aurait de la cruauté à la priver de cette chère vue; mais il ne faut pas commettre d'imprudence. Combien la princesse elle-même souhaiterait de voir encore une fois sa vénérable amie et d'aller s'édifier au spectacle de la souffrance si saintement supportée! Si celle-ci en exprimait le désir, il faudrait le faire tout à l'instant même. Madame Élisabeth n'ose venir sans être demandée, dans la crainte de retrancher quelques instants d'une vie si précieuse, en faisant éprouver à la chère malade une trop vive émotion. Puis viennent ces touchantes lignes qui ferment la lettre du 14 décembre 1785, et présentent au cœur de madame Marie de Causans la seule consolation que puisse goûter sa tendresse filiale: «Vous êtes moins à plaindre que vos sœurs; vous jouissez au moins des derniers moments où vous pouvez voir, entendre votre mère, et lui rendre tous les soins que votre cœur vous dicte, au lieu qu'elles joindront au malheur de ne la plus voir celui de ne l'avoir pas vue jusqu'au dernier moment.»
Tant que madame de Causans vécut, Madame Élisabeth ne cessa d'entretenir avec madame Marie de Causans une correspondance presque quotidienne. Elle se reprenait de temps à autre à espérer, et puis la funeste réalité lui apparaissait, et alors, suivant l'âme de sa vénérable amie vers le ciel, elle était à la fois édifiée et attendrie de la ferveur avec laquelle cette belle âme aspirait à se réunir à son Dieu. C'est à peine si elle osait prier pour une personne qu'elle regardait presque comme une sainte. Elle communia cependant à son intention, sur la demande de sa fille.
Il n'y eut sorte de précautions que Madame Élisabeth ne prît pour que madame de Raigecourt ignorât ou n'apprît que peu à peu le dangereux état de sa mère. Enfin, les longues souffrances de madame de Causans eurent un terme. Marie-Françoise-Madeleine de Louvel-Glizy (veuve de J. T. de Vincens-Mauléon, seigneur marquis de Causans, comte d'Ampuries, maréchal des camps et armées du Roi), dame pour accompagner Madame Élisabeth de France, mourut à Paris le 4 janvier 1786, dans la cinquante-cinquième année de son âge.
Ayant reçu la nouvelle de cette mort digne d'une telle vie, Madame Élisabeth voulut épancher encore une fois son cœur dans celui de madame Marie de Causans. Je détacherai seulement de cette lettre quelques lignes où l'on trouve le secret du courage et de la résignation que Madame Élisabeth devait déployer dans ses épreuves: «Il faut mettre, à l'exemple de votre mère, nos craintes et nos désirs au pied du crucifix; lui seul peut nous apprendre à supporter les épreuves que le ciel nous destine. C'est le livre des livres; lui seul élève et console l'âme affligée.»
Dès que la santé de madame de Raigecourt lui permit de revenir à Versailles, Madame Élisabeth s'empressa de faire disposer des relais et des stations de repos pour adoucir les fatigues du voyage. Elle recommanda de ne point lui apprendre la perte qu'elle avait faite avant son arrivée à Versailles, voulant se trouver auprès d'elle dans les premiers moments de sa douleur. Elle n'eut pas le courage de lui dire elle-même que sa mère n'était plus; mais dès que le premier coup eut été porté, elle accourut, la serra dans ses bras et l'entoura de toutes les consolations.
Dans les premiers jours du mois de février, un bon paysan de Montreuil, que Madame Élisabeth occupait presque chaque jour, fut pris d'un mal subit dans le jardin où il travaillait. Elle le fait immédiatement porter chez lui, et elle s'y rend elle-même. Médecin et curé sont appelés et arrivent en même temps. La présence de ce dernier est d'autant plus nécessaire que les secours du premier demeurent impuissants. Le mal était foudroyant, la lutte fut courte, l'agonie prompte; mais jusqu'au dernier soupir, le malade, demeuré calme et plein de foi, souriait à la mort entre le prêtre qui lui montrait le ciel et cette princesse de sang royal dont l'ardente prière devançait l'âme du moribond, prête à paraître devant Dieu. Quand tout fut fini, et au moment où Madame Élisabeth quittait la chétive demeure du trépassé, le curé lui dit: «Madame donne ici un grand exemple. – Ah! monsieur, répond-elle, j'en reçois un bien plus grand et que je n'oublierai jamais.»
Les traces de l'émotion profonde laissée par cette scène au cœur de Madame Élisabeth se retrouvent dans une lettre qu'elle écrivit quelques jours après à madame Marie de Causans, lettre où l'esprit naturellement enjoué de la princesse se reflète au milieu des souvenirs pénibles et des préoccupations inquiètes.
Le 6 janvier, Madame Élisabeth signa, ainsi que le Roi et tous les membres de la famille royale, le contrat de mariage de mademoiselle Necker avec le baron de Staël-Holstein, ambassadeur extraordinaire du roi de Suède à la cour de France; le 31 du même mois, la baronne de Staël fut présentée au Roi et à la Reine, et le même jour, l'ambassadrice de Suède dîna au palais de Versailles, à une table de quatre-vingts couverts tenue par le marquis de Talaru, premier maître de l'hôtel de la Reine, et dont la princesse de Chimay, dame d'honneur de Sa Majesté, faisait les honneurs.
Quoique prisant peu M. Necker, Madame Élisabeth ne put voir sans intérêt cette jeune femme, déjà citée pour son esprit, s'unir à l'ambassadeur d'un roi ami dévoué de la maison royale de France.
Mais notre princesse recherchait de préférence toutes les émotions qui fortifient l'âme. Elle ne cessait de trouver dans un exemple de piété, de quelque part qu'il vînt, un sujet d'édification pour elle-même. L'humeur facile et gaie s'alliait toujours chez elle à un sentiment élevé du devoir envers le monde, envers ses amies, envers elle-même et envers Dieu. Sa haute raison et son cœur aimant lui dictent toujours les paroles qui, selon les circonstances, doivent être des consolations, des conseils, des encouragements. Quoi de plus amical, de plus noble, de plus touchant, de plus tendrement religieux que les épanchements de cette âme qui cherchait les âmes souffrantes pour les relever, pour leur sourire et les entraîner vers Dieu!
On comprend dès lors que la mort de madame de Causans, loin de relâcher les liens d'affection qui existaient entre les deux filles de cette vertueuse dame et la princesse, les avait resserrés. Aussi la correspondance ne languit-elle pas. Nous possédons neuf lettres écrites par Madame Élisabeth dans les premiers mois de 1786, avec une effusion de cœur et une supériorité d'esprit également remarquables. Le ton en est presque maternel. Il semble que la princesse éprouve le besoin de rendre aux deux sœurs la mère qu'elles ont perdue, en leur donnant les conseils que celle-ci leur eût donnés, et en leur prodiguant ces marques d'affection qui pansent les plaies du cœur, si elles ne les ferment pas. Il est impossible de ne pas être frappé du caractère de haute spiritualité qui règne dans cette correspondance. On dirait que la princesse sent le besoin de s'armer d'avance pour des épreuves qu'elle pressent vaguement, tant elle insiste sur la nécessité de mettre son bonheur sur la terre dans une conformité parfaite de la volonté humaine avec la volonté divine, dans une défiance de soi-même qui se concilie avec une confiance absolue dans la Providence. La dévotion que Madame Élisabeth recommande à ses amies n'a rien d'étroit et de mesquin, c'est la dévotion des âmes généreuses qui doutent d'elles-mêmes, sans jamais douter de la bonté infinie de Dieu. «N'allez pas vous troubler le cœur, écrit-elle le 1er mars 1786, en cherchant à découvrir ce que Dieu exige de vous… Soumettez-vous, allez au jour le jour; dites-vous le matin tout ce que vous devez faire dans la journée et pourquoi vous devez le faire. N'anticipez pas sur le lendemain, et ne changez jamais une résolution bien prise sans des raisons très-fortes. Quelque temps de fermeté sur vous-même remettra le calme dans votre cœur; et, sur toute autre chose, chassez le scrupule, car rien ne trouble et ne jette dans la mauvaise voie comme le scrupule. Le scrupuleux ne peut ni parler, ni se taire, ni agir, ni rester, sans croire avoir offensé Dieu.»
Madame Élisabeth, trop sincèrement vertueuse pour être scrupuleuse, continue ainsi ce qu'elle appelle ses sermons. Ce sont les directions données par une âme à la fois clair-voyante et tendre qui connaît ses jeunes amies, qui voit les obstacles qu'elles ont à surmonter sur le chemin de la perfection, et les leur signale avec une aimable franchise.
À madame Marie de Causans, qui se destine à la vie religieuse, elle rappelle sans cesse les dangers du monde, les séductions qu'il exerce sur les esprits, qui, une fois qu'ils se sont laissé emporter dans ce tourbillon, ont de la peine (elle en a elle-même fait l'épreuve) à se plaire dans la solitude et le silence.
Au milieu de ces réflexions si solides et si vraies, le souvenir de madame de Causans revient toujours avec un charme infini: «J'ai fait mes pâques ce matin, écrit-elle le 10 avril; je me suis rappelé une certaine semaine sainte que j'ai passée avec votre mère. Que nous étions heureuses! Jamais je n'en passerai de pareilles. Elle m'assura que je persévérerois; elle en sera la cause: ses exemples, cette dernière parole, la lettre qu'elle m'a écrite, tout me donne de la confiance. Vous lui avez dit de me mettre au nombre de ses enfants: ah! j'y suis bien de cœur, car je l'aime bien tendrement.»
Je rencontre dans ces lettres des remarques qui témoignent de l'excellent jugement de Madame Élisabeth, celle-ci par exemple: «Quoique notre siècle se pique de beaucoup de sensibilité, elle est plus dans les discours que dans le cœur.» Madame Élisabeth, cette princesse de tant de bonté, blâme la sensibilité qui énerve l'âme; elle reproche même à madame Marie de Causans de trop se repaître du chagrin profond que lui a laissé la perte de sa mère: «Vous vous enfoncez trop, lui écrit-elle, dans les regrets justes que vous avez.» Cette tristesse, qui conduit au dégoût de toute chose, finit par devenir une tentation.
Tel est l'esprit de cette correspondance, qui remplit une grande partie de l'année 1786.
Au commencement de cette même année, deux symptômes d'un désastre champêtre effrayèrent les jardiniers de Montreuil: d'une part, lorsqu'ils remuaient profondément la terre, des milliers de maons ou mans, ces hannetons de l'avenir, se rencontraient sous leur bêche; de l'autre, ils avaient remarqué qu'une multitude de petits vers connus sous le nom de turcs avaient été, par l'extrême sécheresse de l'année, engendrés entre l'écorce et le corps des arbres, dont ils suçaient la séve. De là, grande inquiétude pour le sort des fleurs, des légumes, des fruits, et même pour le sort de cette douce verdure, le plus bel ornement de Montreuil. Le cœur gros de tristesse, ils allèrent annoncer à la propriétaire l'apparition pour le printemps de ces voraces scarabées. «Eh bien, dit-elle, puisque vous nous signalez l'approche de l'ennemi, préparons-nous à le bien recevoir. Prévenons nos voisins; prévenons notre magistrat, afin que par le tambour il exhorte les cultivateurs, les officiers de justice, les curés, à veiller et à concourir à la destruction de l'ennemi commun.» La pensée de Madame Élisabeth fut entendue: l'autorité se chargea de la propager; un appel public fut fait au zèle de tous, afin de combattre le coléoptère sous sa double forme de man et de hanneton. Un nombre prodigieux de ces insectes demeurèrent sur le champ de bataille, et le fléau redouté en fut d'autant amoindri.
Ce fut à cette époque que Louis XVI prit la résolution de visiter les côtes de la Manche. Nous ne raconterons pas ici ce voyage de Cherbourg qui fut peut-être dans la vie du monarque l'événement qui lui offrit le plus de satisfaction et de bonheur; toutefois, nous ne pouvions le passer sous silence, à cause des douces émotions dont il devint la source pour Madame Élisabeth. Le pays aussi, le pays tout entier s'intéressa aux détails d'une circonstance qui avait montré aux populations de la Normandie le Roi dans l'abandon de l'affabilité et de la bienveillance la plus aimable. Mais déjà un mauvais vouloir marqué se manifestait contre le trône. Aussi les heureux effets de ce voyage furent-ils presque aussitôt balancés par l'esprit de dénigrement et de méfiance qui accueillait déjà tous les actes du gouvernement. On révoquait en doute jusqu'aux faits enregistrés par l'histoire, pour accepter les rumeurs les plus absurdes quand elles étaient malveillantes. Les sceptiques, toujours friands de controverses, et préférant souvent la chimère à la réalité, prétendaient à cette époque que le comte de Vermandois, ce fils légitimé de Louis XIV et de la duchesse de La Vallière, qu'on disait être mort à Courtray d'une fièvre maligne le 18 novembre 1683, n'était autre que le personnage mystérieux connu sous le nom de Masque de fer, mort à la Bastille le 19 novembre 1703, sur les dix heures du soir, et enterré le lendemain, à quatre heures de l'après-midi, dans le cimetière de l'église Saint-Paul. On en concluait que la cérémonie funèbre qui avait eu lieu dans la cathédrale d'Arras en novembre 1683115 n'avait été qu'une vaine parade, et que le monument qui portait l'épitaphe du comte de Vermandois n'était qu'un cercueil vide et menteur. Ces bruits impressionnaient tellement les salons et la rue que le pouvoir se crut obligé d'ordonner l'ouverture du tombeau du jeune prince. Elle se fit le 16 décembre116, et rendit évidente l'absurdité des bruits qu'une malveillance systématique s'était plu à propager.
La Reine, qui, dans la matinée du 9 juillet, avait ressenti quelques douleurs, accoucha très-heureusement, à sept heures et demie du soir, d'une princesse très-bien portante, que le Roi nomma Madame Sophie.
À huit heures et demie du soir, la princesse nouveau-née reçut de plus les noms d'Hélène-Béatrix au baptême, qui lui fut administré par l'évêque de Metz, grand aumônier de France, en présence du sieur Jacob, curé de la paroisse Notre-Dame. Elle fut tenue sur les fonts par Monsieur, au nom de l'archiduc Ferdinand, gouverneur de la Lombardie autrichienne, et par Madame Élisabeth de France, en présence du Roi et de la famille royale, ainsi que des ducs d'Orléans, de Bourbon, du prince de Conti et du duc de Penthièvre.
À cette date se rattache une union formée sous les auspices de la famille royale. Ce fut le 9 juillet que le Roi et les princes et princesses de sa famille signèrent le contrat de mariage de M. le comte de Chambors et de mademoiselle Gabrielle de Polignac.
La maison royale de Saint-Cyr, fondée en 1686, et dont les premières élèves nommées par le Roi avaient pris possession le 1er août de cette même année, se préparait à fêter, le 1er août 1786, la fête séculaire de sa fondation. Cette fête dura huit jours: il y eut donc place pour le devoir et pour le plaisir. Aussi rien n'y fut oublié. Cent prêtres de Saint-Lazare célébrèrent les offices; les paroisses voisines y vinrent en procession; on pria pour le Roi et pour le royaume, pour le Pape et pour l'Église, pour tous les peuples chrétiens, afin qu'ils demeurent dans la foi, et pour ceux qui ne le sont pas, afin qu'ils le deviennent; on pria pour la perpétuité de cet établissement public et national, dont un siècle d'existence avait prouvé l'importance et l'utilité117; on pria pour ses fondateurs, et, pour la première fois dans un lieu public, un hommage d'une respectueuse gratitude fut rendu à la mémoire de madame de Maintenon118. Festin et jeux, feux de joie, feux d'artifice, brillant et nombreux concours de monde animèrent la fête: toutes les anciennes élèves y avaient été conviées, tous les vieux amis de Saint-Cyr s'y étaient rendus. M. d'Ormesson, conseiller d'État et chef du conseil institué par le Roi pour la direction du temporel de cette maison, ainsi que tous les membres de ce conseil, étaient présents à cette cérémonie. Madame Élisabeth ne pouvait manquer de s'y trouver. Elle y arriva le premier jour et entendit la grand'messe en musique, de la composition de l'abbé Dugué, maître de musique du chapitre de Notre-Dame de Paris. L'archevêque de Paris officia, et l'abbé Lenfant, prédicateur du Roi, prononça un discours analogue à cette circonstance. Madame Élisabeth assista aussi au Te Deum, dont la musique, composée par M. Asselin, de Versailles, fut chantée avec un grand succès par les élèves de la maison. La fête se termina par un feu d'artifice. La princesse fut invitée à se rendre sur le balcon d'une fenêtre faisant face au parterre du jardin intérieur. Le sieur de Monville, architecte de la maison, avait, pour la circonstance, construit sur ce parterre un temple dédié à l'Immortalité (emblème de la maison de Saint-Cyr), orné d'un péristyle d'ordre dorique. À l'heure dite et au signal convenu, le temple s'illumina de feux chinois, toutes les lignes d'architecture se dessinèrent en jets de flamme, et le monument se couronna du chiffre du Roi et de la Reine, que dominait la devise de Louis XIV, le soleil éclairant le monde, avec ces mots: Nec pluribus impar.
Madame Élisabeth s'était ce soir-là entretenue quelques instants avec une des religieuses de Saint-Cyr qui avait été élève de la maison du temps de madame de Maintenon. En retournant à Versailles, elle se mit à parler du passé et à deviser avec ses dames sur les hautes pensées du grand Roi, qui, occupé avec un égal intérêt et de l'enfance qui cherche sa route et du vieux soldat qui finit la sienne, signait avec la même plume la fondation de la maison de Saint-Cyr et celle de l'hôtel des Invalides. «Ce n'est pas sans raison, disait Madame Élisabeth, que Louis XIV a placé cet institut à l'ombre de son palais et sous sa propre tutelle: l'influence de la femme est grande en France sur les mœurs; combien dès lors est importante l'éducation des jeunes filles appelées à tenir un rang dans la société! Quel air excellent on respire en ce lieu! C'est là que j'ai appris à aimer les champs et la solitude: j'y vais toujours avec plaisir, parce qu'il me semble que j'en reviens meilleure. Toutes ces jeunes têtes sont si intéressantes! j'y deviendrais volontiers la sœur de l'indigente et la mère de l'orpheline.»
On rappela aussi dans cet entretien ce mot de madame de Maintenon à ses chères filles: «Votre maison ne peut manquer tant qu'il y aura un roi en France.»
Madame de Raigecourt, de qui nous tenons ces détails, ajoutait tristement: «Le passé que nous exaltions ce soir-là, c'était un adieu que, quelques années encore, nous lui faisions.» Madame, en effet, en parlant de Louis XIV avec une fierté filiale, ne se doutait pas que bientôt la statue du grand Roi serait renversée; que le pontife qui, ce jour-là, dans la chapelle de Saint-Cyr, célébrait les saints mystères, serait proscrit; que l'orateur qui y prêchait le pardon des injures, la paix et la charité, serait massacré par le peuple; que cette maison centenaire dont on demandait à Dieu la perpétuité verrait bientôt ses portes fermées, et qu'enfin la tête auguste devant laquelle tout le monde s'inclinait à cette fête serait touchée par le bourreau.
Élisabeth rentra le soir à Versailles, et le lendemain matin dans son cher Montreuil, dont le calme lui paraissait toujours plus précieux après quelques heures passées au milieu de la foule. À l'exception des rares occasions qui la retenaient au château de Versailles (comme le 23 et le 25119 août, jour de naissance et jour de fête du Roi son frère), elle vit s'écouler presque toutes les journées de ce mois paisibles et heureuses dans sa résidence favorite, et elle donna tout son temps à ses œuvres de charité, à ses études, à sa correspondance, à son petit cercle d'amies.
Cette vie simple et tranquille qu'elle avait menée dès son adolescence et qui jetait comme un reflet des mœurs cénobitiques au sein de la cour même, ce centre de l'agitation, de l'éclat et du bruit, cette vie qui cherchait la régularité et qui aspirait à l'ombre et au silence, offrait trop de contraste avec l'esprit léger, le ton bruyant et les habitudes évaporées de la cour, pour ne pas être remarquée. Nous ignorons si quelque railleur obscur osa jamais en médire, mais nous savons que les vertus de la sœur de Louis XVI, bien qu'elles craignissent la lumière et le bruit, n'avaient pu se cacher aux regards de la France catholique. Le mardi 29 août 1786, en sortant de l'audience du Roi, Louis-François de Bausset, évêque d'Alais, à la tête d'une députation des états de Languedoc, demanda à offrir ses hommages à Madame Élisabeth, et lui adressa le discours suivant:
«Madame, si la vertu descendoit du ciel sur la terre, si elle se montroit jalouse d'assurer son empire sur tous les cœurs, elle emprunteroit sans doute tous les traits qui pourroient lui concilier le respect et l'amour des mortels. Son nom annonceroit l'éclat de son origine et ses augustes destinées; elle se placeroit sur les degrés du trône; elle porteroit sur son front l'innocence et la candeur de son âme; la douce et tendre sensibilité seroit peinte dans ses regards; les grâces touchantes de son jeune âge prêteroient un nouveau charme à ses actions et à ses discours; ses jours purs et sereins comme son cœur s'écouleroient au sein du calme et de la paix que la vertu seule peut promettre et donner: indifférente aux honneurs et aux plaisirs qui environnent les enfants des rois, elle en connoîtroit toute la vanité, elle n'y placeroit pas son bonheur; elle en trouveroit un plus réel dans les douceurs et les consolations de l'amitié; elle épureroit au feu sacré de la religion ce que tant de qualités précieuses auroient pu conserver de profane: sa seule ambition seroit de rendre son crédit utile à l'indigence et au malheur; sa seule inquiétude, de ne pouvoir dérober le secret de sa vie à l'admiration publique; et dans le moment même où sa modestie ne lui permet pas de fixer ses regards sur sa propre image, elle ajoute sans le savoir un nouveau trait de ressemblance entre le tableau et le modèle.»