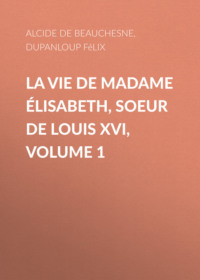Kitap dosya olarak indirilemez ancak uygulamamız üzerinden veya online olarak web sitemizden okunabilir.
Kitabı oku: «La Vie de Madame Élisabeth, soeur de Louis XVI, Volume 1», sayfa 18
»Après la lecture de ce discours, le Roi s'est levé et s'est tenu debout pendant quelques minutes; ensuite Sa Majesté est sortie, suivie et précédée de la cour, de son cortége, aux acclamations de toute l'assemblée. Les cris de Vive la Reine! se sont mêlés aux cris de Vive le Roi! et les applaudissements d'une foule immense ont accompagné Leurs Majestés jusqu'au château.
»Il étoit impossible d'assister à ce grand spectacle, à cette scène sublime, dont les suites vont peut-être décider à jamais du sort de la France, sans éprouver les plus vives émotions de crainte, d'espérance et de respect. Si les détails que nous nous sommes permis de rappeler avec une attention si scrupuleuse n'ont pas tous le même intérêt, on voudra bien nous le pardonner; tout frappe, tout paroît remarquable dans une circonstance où l'âme est vivement émue.»
Il avait été décidé que chaque ordre aurait une chambre spéciale pour ses séances; le tiers, au lieu de se retirer dans la sienne après les discours du Roi, du garde des sceaux et du ministre des finances (M. Necker), resta dans la salle commune. Ce fait, peu important en apparence, avait cependant sa signification: en demeurant dans le local des assemblées générales, le tiers prenait l'attitude de celui qui reçoit et admet, et cet acte pouvait être considéré comme un signe de possession et même de prééminence.
C'était là en effet le but du tiers état. La vérification des pouvoirs donnés par les provinces à leurs députés amena une vive discussion. Le clergé et la noblesse demandaient que chaque ordre vérifiât ceux de ses membres, comme les connaissant mieux. Mirabeau, affilié au tiers ordre de sa province, prétendit que la vérification devait se faire en commun. Les négociations ouvertes pour concilier les prétentions respectives n'ayant pu aboutir, malgré les sollicitations du Roi, qui, chagrin de ces délais, exhortait le clergé et la noblesse à céder, le tiers brusqua l'affaire, désigna, le 3 juin, pour son président Sylvain Bailly, membre des trois académies française, des belles-lettres et des sciences, et fit ensuite appeler par bailliages indistinctement les députés des trois ordres devant les commissaires nommés pour vérifier les pouvoirs.
Une nouvelle fête suspendit un jour cette opération: le 11 juin était le jour de la Fête-Dieu: fête religieuse et populaire dans laquelle, depuis 1681129, se déployaient chaque année les magnificences de la cour, et qui empruntait cette fois un intérêt nouveau par la présence des députations qui devaient y représenter les états généraux. Selon l'usage établi, le Roi se rendit à la paroisse Notre-Dame dans un grand carrosse fait exprès pour cette fête, et attelé de deux énormes chevaux blancs qui ne servaient que dans cette occasion. Toute la famille royale prit place dans ce carrosse avec le Roi. Les pages du Roi avaient le privilége de monter derrière, sur les marches de chaque côté des portières, sur le siége, partout enfin où ils pouvaient tenir. Au départ du château, la maison militaire marchait devant et derrière la voiture. Les gardes du corps, les Cent-Suisses et les officiers de la chambre étaient placés, comme à la chapelle du palais, dans l'église, resplendissante de lumières et de fleurs. Douze membres du clergé, douze de la noblesse et vingt-quatre du tiers état, le président Bailly en tête, observèrent le même ordre qu'à la procession des états généraux qui avait eu lieu le 4 mai: le tiers en avant, la noblesse ensuite, et le clergé le plus près du saint Sacrement. Le Roi, entouré de sa famille et de toute la cour, suivit à pied la procession, qui prit la rue Dauphine (aujourd'hui rue Hoche) jusqu'au reposoir, traversa la place d'Armes, la cour du château, et s'arrêta à la chapelle du château; puis revint à l'église Notre-Dame par le même chemin, décoré des magnifiques tapisseries des Gobelins. À la grand'messe de la paroisse, après la procession, le clergé était placé au bas de la stalle du Roi, la noblesse en face du clergé, du côté de l'évangile, et le tiers état sur des banquettes derrière les chantres, entre le lutrin et la grille du chœur.
Ce fut la dernière cérémonie de la Fête-Dieu à laquelle assista la cour.
Le même jour, 11 juin, trois curés du Poitou donnèrent au clergé le signal d'une défection qui fut bientôt imitée par beaucoup d'autres; et le 17, les députés, ainsi vérifiés, se déclarèrent de leur autorité Assemblée nationale.
À cette époque, pendant une visite à Marly, un pair d'Angleterre se trouvait à table chez la duchesse de Polignac, qui lui fit cette question: «Avez-vous vu, milord, les états généraux? Êtes-vous entré dans les trois chambres? – Oui, madame. – Dites-moi donc ce que vous en pensez.» L'Anglais hésitait à se prononcer. «Expliquez-vous franchement, lui dit la duchesse. – Eh bien, madame, répondit-il, je pense que toute la noblesse de France réside dans la chambre du tiers état.»
Le flair britannique n'était pas en défaut. Pour tous les esprits sérieux, il devenait évident qu'avec sa double représentation et la sympathie unanime du peuple, le tiers devait exercer une influence sans égale sur les destinées du pays. Le 20 juin, Bailly, son président, se présente aux portes de l'Assemblée: une sentinelle lui en refuse l'entrée. Il insiste, et obtient la permission d'entrer seul pour y prendre quelques papiers. Il y dresse un procès-verbal du refus qui lui a été fait, et se retire. Bientôt plusieurs députés se présentent: même refus. Réunis en groupe, ils vont aux Récollets et demandent leur église pour y tenir séance; ces religieux, qui doivent leur existence aux bontés du Roi, répondent qu'ils ne peuvent disposer de leur église sans sa permission. On se transporte à l'église Saint-Louis; le curé fait une réponse semblable. Les députés du tiers, arrivant de minute en minute de tous les quartiers de la ville, se réunirent sur la place d'Armes.
«Faisons, dit l'un d'eux, apporter ici une table et des chaises: partout où nous serons en nombre, là sera l'Assemblée nationale.» Cette proposition parut d'abord acceptable, mais l'affluence des spectateurs la rendit impossible. Les députés se présentèrent alors au jeu de paume, dont la porte s'ouvrit devant eux. La salle était peu aérée, mais vaste; ils s'y installèrent. Ce fut là que, échauffés par la résistance, ils jurèrent de ne se séparer qu'après avoir donné une nouvelle constitution à la France. Dès que la séance fut close, le comte d'Artois fit ordonner au propriétaire de la salle130 de ne point l'ouvrir le lendemain, ayant l'intention d'y faire lui-même une partie de paume. Le propriétaire répondit qu'il n'était plus le maître de son local, et le lendemain 21, les députés s'y assemblèrent de nouveau.
Le 22, la réunion eut lieu dans l'église Saint-Louis. Cent cinquante membres du clergé se joignirent au tiers état.
Le 23 se tint cette fameuse séance royale dans laquelle Louis XVI, par l'organe de son garde des sceaux, M. de Barentin, déclara entre autres choses que le décret du 17 juin, portant constitution de l'ordre du tiers état en assemblée nationale, était supprimé; que tous les actes émanés de cette assemblée étaient abolis comme inconstitutionnels, puisque les deux premiers ordres n'avaient pas concouru à la délibération; que les séances des états ne seraient pas publiques; que le Roi, voulant conserver la distinction des ordres, commandait aux états généraux assemblés de se séparer à l'instant, et à chaque ordre de se rendre dans la salle qui lui était destinée.
Le Roi sortit au milieu d'un morne silence. La noblesse et le clergé obéirent à ses ordres; le tiers état resta en séance, tandis que des ouvriers s'occupèrent à démonter et à emporter le meuble qui avait servi à l'appareil de la royauté.
Quelques troupes et quelques canons gardaient les abords de la salle des états, autour de laquelle se pressait une foule innombrable, attendant avidement le résultat de la séance. Le Roi étant rentré au château, le grand maître des cérémonies revint à l'assemblée et s'y présenta la tête couverte. Le cri de chapeau bas! se fit entendre. M. de Brézé, se découvrant, dit qu'il venait de la part de Sa Majesté ordonner aux députés de se retirer dans le local destiné à chaque ordre. «Allez dire au Roi, répondit le président Bailly, que, quand la nation est assemblée, elle n'a point d'ordres à recevoir…» En ce moment se présente le marquis d'Agoult, officier des gardes du corps, qui appuie l'ordre apporté par M. de Brézé. On connaît la réponse hardie de Mirabeau, un peu arrangée pour l'histoire: «Nous sommes ici par la volonté du peuple, nous ne quitterons nos places que par la puissance des baïonnettes.»
Les deux organes de l'autorité royale se retirent. M. d'Agoult va rendre compte au Roi de l'insuccès de sa mission. Peu de temps après, la troupe qui cernait la salle des états généraux reçoit l'ordre de se retirer. L'Assemblée nationale protesta alors contre le règlement présenté par ordre du Roi, et considérant la séance royale comme un lit de justice, déclara par un arrêté la personne de chaque député inviolable, et traître à la patrie tout auteur ou exécuteur d'ordres qui attenteraient à la liberté de chacun d'eux. C'est ainsi que les futurs constituants commencèrent par s'attribuer la première condition de la souveraineté, l'inviolabilité. On ne leur opposait que des paroles, ils répondaient par des actes. Le 25, ils écrivent à M. Necker pour le féliciter d'avoir pris auprès du Roi la défense des états généraux contre la séance du 23 juin, à laquelle il n'avait pas assisté, considérant son but comme contraire au bien public. Ce jour-là, quarante-sept membres de la noblesse se réunirent à l'Assemblée nationale; on remarquait parmi eux le duc d'Orléans. La minorité donnait pour raison à sa démarche son dévouement pour le Roi, dont les jours étaient menacés par la résistance qu'on imputait à sa personne. Cette minorité se trompait: quand Louis XVI cédait, il cédait tout à fait, et dans cette circonstance il cédait de plein cœur. Il manda le président de la noblesse, et le pria instamment de se réunir aux deux autres ordres. «Sire, répondit le duc de Luxembourg, ce ne sont pas les intérêts de la noblesse, ce sont ceux de la monarchie, ce sont ceux de votre trône que nous défendons: notre abstention frappera de nullité les actes de l'Assemblée nationale, et cette assemblée même demeurera incomplète lorsqu'un tiers de ses membres aura été livré à la fureur de la populace et au fer des assassins. – Je ne veux pas, reprit le Roi, qu'il périsse un seul homme pour ma querelle. Si ce n'est pas assez d'inviter la noblesse à se réunir aux deux ordres, je le lui ordonne; comme Roi, je le veux. Si un de ses membres se croit lié par son mandat, son serment, son honneur, à rester dans la chambre, qu'on vienne me le dire, j'irai m'asseoir à ses côtés, et je mourrai avec lui, s'il le faut.»
La noblesse se rend aux états. Les membres du clergé non encore ralliés s'y rendent également, et les trois ordres se trouvent réunis et confondus dans cette même salle où, peu de jours auparavant, ils avaient été sommés de se séparer.
À partir de ce jour, le principe de la révolution était posé, et les conséquences ne pouvaient que suivre. Le tiers, démentant le mot de Sieyès, était tout; le clergé et la noblesse n'étaient rien, et la royauté était peu de chose.
L'Assemblée était entrée dans la carrière de l'audace, la royauté dans celle des concessions. À mesure que l'une montait, l'autre devait descendre.
Revenons à Montreuil, où ces événements publics avaient un douloureux retentissement. Après s'être faite bourgeoise, la princesse se fit fermière. Les soins ruraux, qui n'étaient d'abord qu'une distraction, devinrent un calcul de la bienfaisance. Si la basse-cour se peupla d'oiseaux domestiques, si l'étable se remplit de vaches aux fortes mamelles, c'était pour que les enfants de Montreuil qui avaient perdu leur mère fussent assurés de ne manquer ni de lait ni d'œufs frais. Madame Élisabeth s'étonna du nombre prodigieux d'orphelins que son industrie lui amenait. Aussi se hâta-t-elle de donner à son exploitation des bases plus étendues. Elle fit venir de Suisse de nouvelles vaches, et témoigna le désir d'avoir, pour les garder et en prendre soin, un vacher de leur pays, sur la fidélité duquel elle pourrait se reposer, car elle était avare d'un lait qui appartenait aux enfants pauvres. Madame de Diesbach, femme d'un officier suisse, indiqua comme pouvant remplir parfaitement les vues de la princesse Jacques Bosson, de la petite ville de Bulle, à cinq lieues au sud de Fribourg. Ce jeune homme avait un père et une mère dont il était tendrement aimé. Madame Élisabeth, ne voulant pas les séparer, leur fit dire de venir tous les trois. Jacques fut investi du gouvernement des bêtes à cornes. Les vaches eurent un bon gîte très-proprement tenu, une nourriture convenable et choisie, et leur lait devint abondant. «Vous vous rappellerez, lui dit Madame Élisabeth dès son début, que ce lait appartient à mes petits enfants: moi-même je ne me permettrai d'y goûter que lorsque la distribution en aura été faite à tous.»
Jacques et ses parents, témoins chaque jour de la bienfaisance de leur royale maîtresse, conçurent pour elle une tendre et pieuse vénération. «Quelle bonne princesse! disait souvent Jacques à madame de Bombelles; la Suisse entière ne connaît rien d'aussi parfait!»
Non, mais la Suisse possédait un objet qui empêchait Jacques de jouir en paix de son élévation à la royauté de l'étable de Montreuil. Le sentiment d'exaltation avec lequel il s'exprimait sur Madame Élisabeth le ramenait, on le voit, malgré lui-même, vers son cher pays. C'est que toutes ses pensées étaient tournées vers ces coteaux de Bulle et ces rives de la Sarine où il avait laissé la plus tendre partie de son cœur. L'image de Marie, sa cousine, et que depuis plusieurs années il lui avait été permis de regarder comme sa fiancée, remplissait son âme d'un indicible regret. Toutefois le travail journalier n'en souffrait pas, au contraire; car le soin de bien faire, le désir de complaire à sa bienfaitrice étaient sa seule consolation. Sa mélancolie fut remarquée. Madame Élisabeth fit prier madame de Diesbach de s'informer si le jeune vacher qu'elle lui avait procuré était content de sa position, et s'il ne regrettait pas la Suisse. Elle apprit bientôt la cause réelle de la tristesse de ce bon serviteur: Jacques regrettait Marie et Marie regrettait Jacques. Marie craignait que l'absence et les nouvelles grandeurs de Jacques ne lui fissent perdre le souvenir de ses promesses, tandis que Jacques, de son côté, s'épouvantait de la double impossibilité de la revoir et de l'oublier. Le récit de cette idylle émut Madame Élisabeth: «J'ai donc fait deux malheureux sans le savoir? dit-elle. Je veux réparer ma faute. Il faut que Marie vienne ici; elle épousera Jacques, et elle sera la laitière de Montreuil.»
La jeune Suissesse arriva bientôt à Paris, et, conduite immédiatement à Versailles, elle fut présentée à celle qu'elle regardait déjà comme sa bienfaitrice. Les bans des deux fiancés ne tardèrent pas à être publiés en l'église de Saint-Symphorien de Montreuil et en celle de Notre-Dame de Versailles, en même temps qu'ils l'étaient en l'église de Saint-Pierre aux Liens, paroisse de Bulle, diocèse de Bâle. Jacques avait retrouvé toute sa gaieté: il lui semblait que Marie avait avec elle apporté à Montreuil la Suisse tout entière; le Ranz des vaches, cette musique écoutée avidement par le voyageur, plus douce encore à l'oreille de l'exilé, retentissait dans son cœur avec le murmure de la Sarine, avec la brise du Molézon.
Le mardi 26 mai 1789, quelques jours après l'ouverture des états généraux, la bénédiction nuptiale fut donnée à Jacques Bosson et à Marie Magnin dans l'église de Montreuil par le curé de la paroisse. Dans cet acte, si important pour nos héros, et dans lequel Jacques est qualifié de régisseur chez Madame Élisabeth de France, figurent comme témoins, du côté de l'époux, Charles Ducroizé, maître d'hôtel de M. le marquis de Raigecourt, et Pierre Hubert, Suisse de Madame Élisabeth de France; du côté de l'épouse, Joseph Bosson, Cent-Suisse de la garde du Roi, rue Montbauron, et Antoine-Joseph Senevey, ancien garde de la porte de Monsieur, à Paris131. Dès le lendemain, Jacques et Marie avaient pris possession d'un logement que leur maîtresse leur avait fait préparer dans le bâtiment attenant à la laiterie, et tous les rêves de bonheur de ces deux enfants de la Suisse étaient enfin réalisés.
Cette fraîche et poétique idylle occupa pendant quelques jours la cour et la ville. Chacun s'intéressait à cette jeune fille qui avait retrouvé son fiancé qu'elle avait cru à toujours perdu pour elle; on n'ignorait pas qu'elle se plaisait, comme le Tityre de Virgile, à faire remonter sa gratitude à une divinité tutélaire; et le nom de cette divinité qui cherchait l'ombre et fuyait le bruit était l'objet de la louange publique. Une femme distinguée de ce temps, madame la marquise de Travanet, née de Bombelles, qui avait été pendant quelque temps dame de Madame Élisabeth, composa à cette occasion trois couplets pleins d'une douce mélancolie qui furent bientôt dans toutes les bouches. Voici les paroles, aujourd'hui oubliées, de cette romance populaire, et dont nos grand'mères ont si souvent fredonné l'air près du berceau de leurs petits-enfants:
Pauvre Jacques, quand j'étois près de toi,
Je ne sentois pas ma misère;
Mais à présent que tu vis loin de moi,
Je manque de tout sur la terre.
Quand tu venois partager mes travaux,
Je trouvois ma tâche légère;
T'en souvient-il? Tous les jours étoient beaux:
Qui me rendra ce temps prospère?
Quand le soleil brille sur nos guérets,
Je ne puis souffrir la lumière:
Et quand je suis à l'ombre des forêts,
J'accuse la nature entière132.
Les heureux que faisait Madame Élisabeth ne pouvaient la distraire du chagrin de cœur qui menaçait sa famille et en particulier le Roi et la Reine. Leur fils aîné était dangereusement malade au château de Meudon. Ni l'air salubre de cette résidence, où le Dauphin était établi depuis le 16 avril, ni les soins éclairés dont il était l'objet, n'avaient pu conjurer la maladie. Le jeune prince mourut dans la nuit du 4 au 5 juin. Le duc d'Harcourt, son gouverneur, vint à Versailles et entra chez le Roi à son réveil pour lui annoncer ce triste événement. Louis XVI, bien que préparé à cette fatale nouvelle, en fut inconsolable. Ce malheureux père, dans le journal sommaire de sa vie, a marqué cette date néfaste: «Jeudi 4, mort de mon fils, à une heure du matin. La messe en particulier à huit heures trois quarts. Je n'ai vu que ma maison et les princes à l'ordre.»
Le 5, le corps du Dauphin fut exposé au château de Meudon, à visage découvert, sur un lit de parade, assisté des Feuillants, des prêtres de la paroisse de Meudon et des Capucins du même lieu.
Dans la journée du 6, il fut placé dans un cercueil sur un lit de parade, couvert du poêle de la couronne.
Les journées du 6 et du 7 furent employées à préparer la chambre ardente, destinée à rendre à Mgr le Dauphin les honneurs funèbres.
Le 8, les princes se rendirent au château de Meudon pour jeter de l'eau bénite sur le cercueil. Monsieur y alla à dix heures, M. le comte d'Artois à onze, le duc d'Angoulême et le duc de Berry ensemble vers midi. Ces princes furent conduits successivement à la chapelle ardente par le marquis de Brézé, grand maître, le comte de Nantouillet, maître, et le sieur de Watrouville, aide des cérémonies de France, précédés du roi d'armes et des hérauts, depuis la salle des Cent-Suisses. Les princes du sang, réunis ensuite, furent reçus et conduits à la chapelle ardente par les officiers des cérémonies, précédés du roi d'armes et des hérauts depuis l'antichambre.
Les députations des trois ordres se présentèrent le même jour; celle du clergé était composée de douze archevêques ou évêques, et d'un nombre égal d'ecclésiastiques du second ordre; celle de la noblesse, de douze gentilshommes, et celle du tiers état de vingt-huit députés de cet ordre. Ces députations furent conduites séparément à la chapelle ardente par le grand maître, le maître et l'aide des cérémonies, précédés du roi d'armes de France et des hérauts.
En sortant du château de Meudon, les députés du tiers, Bailly à leur tête, se présentèrent aux portes de l'appartement du Roi. Louis XVI leur fit exprimer sa gratitude pour le témoignage d'intérêt qu'ils venaient lui offrir, et ses regrets de ne pouvoir les recevoir dans ces premiers moments de douleur. Comme ils insistaient pour obtenir audience: «Il n'y a donc pas de pères dans l'assemblée du tiers?» s'écria le Roi avec un serrement de cœur indicible.
Le parlement, la chambre des comptes, la cour des aides, le grand conseil, la cour des monnaies, le Châtelet, le corps de ville de Paris, allèrent aussi rendre les derniers devoirs au Dauphin dans les journées du 9 et du 10.
Dans celle du 12, le cœur de ce prince fut transporté sans cérémonie à l'abbaye royale du Val-de-Grâce; le cardinal de Montmorency, grand aumônier de France, le présenta à l'abbesse. Le duc de Chartres, accompagné du duc de Fitz-James, assista avec le duc d'Harcourt, gouverneur des Enfants de France, à cette cérémonie, à laquelle se trouvaient le marquis de Brézé, le comte de Nantouillet et le sieur de Watrouville.
Le 13, le cardinal de Montmorency fit la levée du corps de M. le Dauphin, qui fut transporté sans cérémonie à l'abbaye royale de Saint-Denis, accompagné du duc d'Harcourt et de toute la maison du prince. Il fut inhumé le même jour, en présence du prince de Condé et du duc de Laval, dans le caveau des princes de la maison royale.
L'orage qui grondait depuis quelques années sur la France éclata à Paris dans la soirée du dimanche 12 juillet 1789. L'émeute envahit la place de Grève; un conflit d'autorités municipales se forme à l'hôtel de ville. Flesselles, le prévôt des marchands, ne croit qu'à une révolte passagère, et c'est une révolution qui commence; il ne s'attend qu'à une disgrâce de la part du pouvoir, et c'est sa tête qu'on doit lui prendre de la part du peuple. Le mardi 14, le meurtre de ce premier magistrat de la cité est le signal d'une insurrection générale. La Bastille est assiégée et prise. Les haines aveugles de la populace vont chercher, au château de Viry, Foulon, à qui la retraite de Necker a remis le portefeuille de contrôleur général. On répand dans les rues des propos attribués à ce financier par des ennemis qui ont conspiré sa perte. On prétend qu'à Louis XVI, effrayé de la situation du trésor public, il aurait dit que la banqueroute était le véritable moyen de rétablir le crédit national; et qu'à des philanthropes qui lui parlaient de la misère du peuple et des violences auxquelles il se portait, il avait fait cette réponse: «Eh bien, si la canaille n'a pas de pain, elle mangera du foin.» – Ces propos ont, pour les chefs de l'agitation, le double mérite d'irriter contre Foulon la classe nombreuse et craintive des créanciers de l'État, aussi bien que la grande masse du peuple, éprouvé par une longue et affreuse disette. N'ignorant pas les dispositions malveillantes du public, Foulon s'est caché dans son château, où il se fait passer pour mort. Ses gens ont pris le deuil; mais l'esprit révolutionnaire de Paris a trouvé un écho dans les campagnes. Des paysans découvrent Foulon, dont le déguisement et le rôle de mort-vivant leur semblent dénoncer la culpabilité; ils se saisissent de sa personne, lui attachent à la boutonnière de son habit une poignée d'orties en forme de bouquet, et derrière le dos une botte de foin avec cet écriteau en grosses lettres: «Si la canaille n'a pas de pain, elle mangera du foin.»
C'est dans cet état qu'il est livré aux émissaires parisiens, et qu'à travers les huées et les avanies il est conduit à l'hôtel de ville. Là, d'acerbes accusations s'élèvent contre lui. La Fayette, espérant prévenir un assassinat, ordonne qu'on le conduise en prison et qu'on lui fasse son procès, ainsi qu'à ses complices. Les paroles du général sont d'abord appuyées par des applaudissements, et l'accusé se croyant sauvé applaudit lui-même. Cette imprudence lui devient fatale. Des murmures s'élèvent aussitôt, auxquels répondent les cris impatients de la populace qui remplit la place de Grève. Dès qu'il paraît sur l'escalier de l'hôtel de ville, cette exclamation s'élève de toutes parts: «Qu'on nous le livre! qu'on nous le livre! et que justice soit faite!» Les gardes peu nombreux qui l'escortent ne peuvent résister aux mille bras qui les pressent: la populace saisit sa proie, elle l'étreint, elle l'entraîne, s'arrête sous une lanterne, dont la corde, aussitôt descendue, enlace le cou du patient et l'enlève dans l'air au milieu des cris de triomphe d'une multitude en délire.
Dès la veille, on avait arrêté à Compiègne M. Berthier, intendant de Paris et gendre de Foulon. On l'amenait à Paris, et il était arrivé à la rue Saint-Denis: déjà reconnu dans sa voiture, dont les stores étaient baissés, il était en butte aux outrages de la populace, lorsqu'un cortége considérable semble venir à sa rencontre: ce sont les auteurs et les témoins du meurtre du contrôleur général, qui, ayant décroché son cadavre et lui ayant coupé le cou, viennent présenter à Berthier la tête de son beau-père, dégouttante de sang et la bouche remplie de foin. Cette abominable escorte l'accompagne jusqu'à la place de Grève, où sa course doit s'arrêter. Là, arraché des mains de ses gardes, il tombe percé de coups de baïonnette; son corps est aussitôt mis en pièces, et sa tête et son cœur, placés au bout des piques, vont montrer aux carrefours de la ville les jeux horribles de la révolution qui commence.
Madame Élisabeth n'était point encore informée de tous ces massacres lorsqu'elle écrivait à madame de Bombelles une touchante lettre où les préoccupations de la chose publique se nuancent de la plus tendre sollicitude pour son amie. Dans cette lettre, écrite le jour même de la prise de la Bastille, on voit percer l'incertitude qui régnait à Versailles, où l'on n'avait pas encore mesuré les conséquences de cet événement. Le Roi sortira-t-il de cette ville? Madame Élisabeth n'en sait rien. Mais elle engage vivement madame de Bombelles à ne pas venir; la santé de la jeune mère et le lait de la nourrice pourraient en souffrir. Ainsi, au milieu des débris de l'ancienne société qui s'écroule, cette excellente princesse trouve le temps de songer à ses amies. Les nouvelles de la veille, si menaçantes et si affreuses, n'ont pu lui arracher une larme; mais un témoignage d'intérêt et d'affection la fait pleurer. Son âme reste intrépide en face du péril, mais son cœur s'émeut devant une marque d'amitié.
Les jours se faisaient sombres pour Madame Élisabeth. D'une part, éclairée par son sens profond, elle partageait l'inquiétude générale qui s'emparait des meilleurs esprits; de l'autre, elle voyait partir ses amis les plus chers. Le marquis de Bombelles, qui était d'une société extrêmement agréable, bon musicien, causeur aimable, jouant la comédie dans la perfection, était retenu à Ratisbonne par ses fonctions de ministre du Roi. Sa femme devait l'y rejoindre, et ce double départ enlevait un grand charme au cercle habituel de Montreuil. Le dévouement de madame de Bombelles se refusait à une séparation aussi pénible pour elle-même; mais l'affection désintéressée de la princesse mit sur le second plan ses propres jouissances et fit passer avant tout la paix et le bonheur de celle qu'elle chérissait si tendrement. Le dernier jour qu'elle la posséda près d'elle, elle l'entoura de tous les témoignages de l'amitié, s'occupant des détails de son départ, des intérêts de sa famille, de la sûreté de son voyage: elle lui indiqua les étapes d'où elle devait lui donner de ses nouvelles. L'entretien se prolongea pendant la nuit. L'heure des adieux sonna enfin:
«Nous nous séparons pour un temps, dit Madame Élisabeth; il le faut. Mais nous demeurerons toujours unies par une communauté d'intentions, de pensées et de prières.» L'entretien se termina dans les larmes; et cependant, quelque sombre que parût l'avenir, on était loin de se le représenter tel qu'il pouvait être. «Cet adieu, disait quelques années plus tard madame de Bombelles à M. Ferrand, qui nous a raconté cette scène, cet adieu devait être éternel. Ce moment, si j'avais pu le prévoir, eût été le dernier de ma vie: je serais morte à ses pieds.»
Quelques jours après, madame de Raigecourt dut s'éloigner de nouveau. Cette séparation fut également pénible: elle devait aussi être éternelle. Madame Élisabeth s'isolait, afin que le malheur qu'elle voyait venir n'atteignît personne autour d'elle. Avant de dire adieu à sa dernière amie, elle lui remit un paquet cacheté avec son sceau, en lui disant: «Quand je ne serai plus, tu le remettras à sa destination.»
C'est aussi dans cette suprême entrevue qu'elle donna à madame de Raigecourt une prière composée par elle dans un de ces moments d'affliction qui, de jour en jour, devaient revenir plus souvent:
PRIÈRE AU SACRÉ CŒUR DE JÉSUS
Cœur adorable de Jésus, sanctuaire de cet amour qui a porté un Dieu à se faire homme, à sacrifier sa vie pour notre salut et à faire de son corps la nourriture de nos âmes, en reconnoissance de cette charité infinie, je vous donne mon cœur et avec lui tout ce que je possède au monde, tout ce que je suis, tout ce que je ferai, tout ce que je souffrirai. Mais enfin, mon Dieu, que ce cœur, je vous en supplie, ne soit plus indigne de vous; rendez-le semblable à vous-même, entourez-le de vos épines pour en fermer l'entrée à toutes les affections déréglées; établissez-y votre croix; qu'il en sente le prix, qu'il en prenne le goût; embrasez-le de vos divines flammes. Qu'il se consume pour votre gloire, qu'il soit à vous après que vous avez voulu être tout à lui. Vous êtes sa consolation dans ses peines, le remède à ses maux, sa force et son refuge dans les tentations, son espérance pendant la vie, son asile à la mort. Je vous demande, ô cœur tout aimable, cette grâce pour mes associés. Ainsi soit-il.
ASPIRATION
Ô divin cœur de Jésus, je vous aime, je vous adore et je vous invoque avec tous mes associés, pour tous les jours de ma vie, et particulièrement à l'heure de ma mort. Ainsi soit-il.
O vere adorator et unice amator Dei, miserere nobis. Amen 133.
La vie de Madame Élisabeth s'écoulait ainsi, toujours pure, mais déjà moins paisible et moins heureuse, au sein de l'intimité, du travail, de la prière et des œuvres de la charité. Sa répugnance innée pour toute ostentation lui avait fait fuir ces actions d'éclat qui font les réputations brillantes, mais qui ne vivifient pas l'âme et demeurent stériles aux yeux de Dieu, et tout ce que le ciel avait déposé de richesse dans son humble cœur devait être employé pour la gloire du ciel. Dévouée par nature et par devoir, elle avait accepté, avec un courage qui ne se démentit pas un seul jour, le soin de secourir ce qui souffrait autour d'elle, et de partager les soucis, les tourments, les périls et les défaillances d'une royauté dont elle ne cherchait pour elle ni le prestige, ni la puissance, ni la gloire. Je ne dirai pas qu'elle se priva des jouissances de la vie, mais je dois dire en vérité qu'elle les ignora. Occupée sans relâche de l'examen de son âme, elle mettait un soin constant à la rendre digne d'être offerte à son Créateur. C'était là toute son ambition; c'était là la seule grandeur qu'elle eût en haute estime. C'est ainsi que cette jeune femme simple et douce, qui aimait à se dérober aux regards, devint la femme forte que l'Esprit divin nous montre dans l'Écriture sainte.