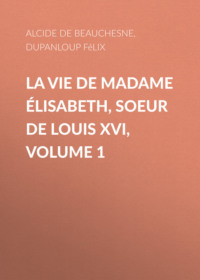Kitap dosya olarak indirilemez ancak uygulamamız üzerinden veya online olarak web sitemizden okunabilir.
Kitabı oku: «La Vie de Madame Élisabeth, soeur de Louis XVI, Volume 1», sayfa 19
LIVRE CINQUIÈME
Les suites du 14 juillet. – Banquet des gardes du corps. – Journées des 5 et 6 octobre. – Conseils de fermeté donnés inutilement par Madame Élisabeth. – Récit de madame de Tourzel sur le départ du Roi, son voyage à Paris, son arrivée à l'hôtel de ville. – Ces événements appréciés par Rivarol. – MM. de Lally-Tolendal, Mounier et Bergasse donnent leur démission de députés. – Adieu de Madame Élisabeth à Montreuil. – Installation de la famille royale aux Tuileries. – Demeure délabrée. – Appartement de Madame Élisabeth. – Le peuple se rassemble sous les fenêtres de la cour des Princes. – Le Roi et la Reine, comme s'ils étaient dans la plénitude de leur autorité, conservent les usages de l'étiquette. – Nouvelle disposition des appartements. – La sainte Geneviève des Tuileries. – L'Assemblée tient ses séances au Manège. – La Reine et Madame Élisabeth entreprennent ensemble un grand travail de tapisserie. – MM. Miomandre et Bernard. – Bonne grâce de la Reine et de Madame Élisabeth. – Timidité du Roi. – Affaire de Favras. – Son jugement inique. – Son calme devant ses juges; son héroïsme devant la mort. – Pension accordée à sa veuve. – Pensée de Madame Élisabeth à ce sujet. – Madame de Favras et son fils, vêtus de noir, se présentent au dîner public de la famille royale. – Pénibles réflexions de la Reine. – Vente des biens ecclésiastiques. – Mot de Montlosier. – Mot de l'abbé Maury. – La porte des couvents ouverte. – Anxiété; vertige. – Ambassade du genre humain; Anacharsis Cloots. – Le marquis de Biencourt. – M. de Boulainvilliers. – Vœu de Madame Élisabeth. – La marquise des Montiers; amitié que Madame Élisabeth lui témoigne; conseils qu'elle lui donne. – Lettre de la princesse à madame de Raigecourt. – Lettre de la Reine à madame de Polignac. – Correspondance de Madame Élisabeth avec ses amies. – Elle revoit Saint-Cyr pour la dernière fois. – La révolution dans l'institut de Saint-Louis. – La Fête-Dieu – Division causée par la constitution civile du clergé. – Sentiments de Grégoire; du curé de Sainte-Marguerite; de l'évêque d'Agen; des curés de Puy-Miclau et de la Cambe. – L'évêque de Poitiers. – Agitation générale en France. – Départ de Mesdames. – La populace installée dans leur demeure. – Leur arrestation à Moret, puis à Arnay-le-Duc. – Huées qui les accompagnent jusqu'à la frontière. – Sympathies qui les accueillent au delà, à Chambéry, à Turin, à Parme, à Rome. – Bonté affectueuse du Pape: lettre que lui écrivait Louis XVI. – Ce qu'on mandait de Rome à Paris. – L'abbé Edgeworth remplace près de Madame Élisabeth l'abbé Madier, parti avec Mesdames. – Récit de ce saint prêtre sur ses premières relations avec Madame Élisabeth. – Installation de l'évêque constitutionnel de Paris. – Émeutes. – Mort de Mirabeau; honneurs rendus au grand orateur. – Projet de voyage de la famille royale à Saint-Cloud. – La populace et la garde nationale y mettent obstacle. – La Fayette, dont l'autorité est méconnue, donne sa démission. – Supplié par la garde nationale, il reprend son poste. – La Reine et Madame Élisabeth jugent différemment la politique de l'Autriche. – La solitude se fait autour de Madame Élisabeth. – Domine salvam fac reginam. – Situation devenue intolérable
Dans les jours de détresse et de misère, Élisabeth avait donné l'exemple de l'économie et de la charité; elle donna celui de la patience et du courage aux heures de l'insulte et du péril. L'orage qui grondait depuis quelques années sur tout le royaume se concentra sur le château de Versailles. L'explosion du 14 juillet 1789 fut un réveil pour Louis XVI; elle fut une révélation pour Madame Élisabeth. Les catastrophes publiques troublent les esprits faibles; elles éclairent les fortes intelligences. De ce jour la lumière se fit pour Madame Élisabeth: elle comprit jusqu'où les agitateurs étaient capables de mener le Roi et d'entraîner la nation. Forcée de quitter la retraite où se plaisaient la simplicité de ses goûts, sa piété et ses tranquilles affections, elle entra résolûment dans la sphère des tempêtes, jugeant d'un œil sûr les événements qui se déroulaient devant elle et les conséquences qu'il fallait en tirer. Rivée par sa tendresse et son dévouement à la destinée du Roi son frère, elle se leva près de lui comme une vedette placée en observation, regardant de haut venir l'émeute, non pas pour jeter le cri d'alarme, mais pour donner des avertissements marqués au coin de la sagesse et de la fermeté, et pour réclamer sa place au péril.
Dans la journée du jeudi 1er octobre, elle avait été informée que les gardes du corps du Roi devaient offrir, dans la salle de spectacle du château, un banquet aux officiers du régiment de Flandre qui, en vertu d'une délégation de la municipalité de Versailles, provoquée par le commandant de la garde nationale, inquiet des bruits de désordre, venait fortifier la garnison à Versailles. Elle n'avait vu d'abord dans ce projet (consacré par les habitudes militaires) qu'un acte de fraternité fait pour réchauffer en faveur du Roi le dévouement héréditaire de l'armée, et elle ne pouvait que s'en réjouir. Dans la matinée du lendemain, elle apprend quelques détails. Pendant le festin, une dame du palais, lui dit-on, est accourue chez la Reine, lui vantant la gaieté de la fête et lui demandant d'y envoyer le Dauphin, que ce spectacle divertirait. La Reine hésite; le Roi, qui venait de chasser dans le parc de Meudon, rentre en ce moment au château. Marie-Antoinette lui propose de l'accompagner, et tous deux sont entraînés avec l'héritier du trône dans la salle du banquet. Leur arrivée inattendue excite des transports d'allégresse. Marie-Antoinette prend son fils dans ses bras et fait le tour de la table au milieu d'un tonnerre de vivat et d'applaudissements. Après ce vif et court triomphe, la famille royale se retire; mais cette mère auguste et charmante, ce Roi déjà discuté chaque jour, ce petit prince paré de toutes les grâces de l'enfance, laissent derrière eux un intérêt et un enthousiasme qui se traduisent par des chants et des libations; l'orchestre exécute quelques morceaux de musique qui, comme la Marche des Houlans (d'Iphigénie) et l'air de Ô Richard, ô mon roi, l'univers t'abandonne! échauffent jusqu'au délire l'imagination des convives. Le pressentiment des périls dont la famille royale est menacée surexcite les âmes, et dans ces cris mille fois répétés de Vive le Roi! dans ce serment de mourir pour lui, ceux qui ne veulent plus qu'on meure pour le Roi, parce que déjà dans leur cœur la royauté est condamnée à mourir, pourront voir une menace ou un défi. Il importe de ne pas l'oublier: c'était la municipalité de Versailles qui avait provoqué la venue du régiment de Flandre, et le motif qui l'avait décidée était la conviction que la ville où résidait le Roi et où siégeait l'Assemblée nationale était menacée d'un coup de main par les perturbateurs de Paris.
Madame Élisabeth se rend chez la Reine pour la féliciter, et pourtant elle n'est point certaine de l'heureux effet de la scène qu'on vient de lui raconter; et comme quelques courtisans exaltaient devant Sa Majesté les vivat reçus par elle dans cette fête, vivat si bruyants, disaient-ils, qu'ils avaient dû être entendus de Paris: «Pourvu, dit à son retour Madame Élisabeth à madame de Cimery, que la populace de Paris n'y réponde point par des injures.» Cette crainte était une prédiction. Les folliculaires avaient déjà transformé cette réunion de militaires restés fidèles en une orgie où l'on avait insulté l'Assemblée nationale et foulé aux pieds la cocarde tricolore. Ce double outrage, qui était imputé à la Reine, prépara l'attentat des 5 et 6 octobre.
Je passe sous silence les actes de violence et de cruauté, si souvent décrits, qui ensanglantèrent ces deux journées. Madame Élisabeth était à sa maison de Montreuil lorsque le peuple de Paris vint envahir Versailles. De la terrasse de son jardin, dès qu'elle aperçoit les premières troupes s'avançant dans l'avenue de Paris, elle pense qu'une répression vigoureuse et immédiate peut épargner bien des malheurs. Il lui semble évident que quelques coups de canon, en repoussant l'avant-garde de l'anarchie, iraient jeter la confusion dans les bataillons qui suivent, et, en imposant à la partie hostile de l'Assemblée d'utiles réflexions, relèveraient le moral de tous les amis de l'ordre effrayés de la pusillanimité du gouvernement. Madame Élisabeth accourt au palais; elle développe son idée avec cette fermeté de raison et cette éloquence du cœur que Dieu lui avait départie. Elle est convaincue, d'une part, qu'on peut par une leçon sérieuse et motivée comprimer les démonstrations de la populace, et, de l'autre, qu'on peut justifier le départ de la famille royale pour une ville plus éloignée de Paris que Versailles, en alléguant la tyrannie que les factions prétendent exercer sur le Roi, et l'attitude équivoque de l'Assemblée nationale, maîtrisée elle-même par l'anarchie.
Les paroles d'Élisabeth sont un instant écoutées, et c'est sans doute à l'effet qu'elles produisent sur l'esprit du Roi qu'il faut attribuer l'acquiescement momentané qu'il donna dans le conseil à l'avis de M. de Saint-Priest, ministre de l'intérieur, avis complétement conforme à celui de Madame Élisabeth; mais ces résolutions de fermeté ne tinrent pas devant l'observation faite par M. Necker, que si l'on tirait l'épée contre l'insurrection, on donnait le signal de la guerre civile; et l'on s'arrêta au parti de traiter de puissance à puissance avec l'émeute.
Vaincue dans sa tentative, Madame Élisabeth se retire chez la Reine et ne la quitte qu'à deux heures du matin, sur l'affirmation que vient apporter M. de la Fayette que tout est tranquille par la ville et qu'il répond de la sûreté du château. Louis XVI, inquiet dès l'aurore de ne point voir sa sœur, la fait chercher dans le palais, où le danger a dû l'appeler. Elle se rend chez le Roi, apprend bientôt combien étaient vaines les assurances données par le chef de la milice nationale; elle demeure présente à la lutte et au péril; elle encourage les gardes du corps par la fermeté de son attitude, et en arrache quelques-uns, par sa présence d'esprit, à la rage des factieux. Elle a des paroles qui apaisent les ardeurs de la haine et qui modèrent les emportements du courage; mais l'affliction que lui fait éprouver l'effusion du sang n'ôte rien à la clairvoyance de son esprit et à la fermeté de son caractère.
Inspirée par des chefs qui ne perdaient pas de vue le but de leur entreprise, la populace demandait à grands cris que Louis XVI vînt fixer sa résidence à Paris, et M. de la Fayette envoyait avis sur avis pour l'y déterminer. Madame Élisabeth émettait une opinion contraire: «Ce n'est point à Paris, Sire, qu'il faut aller; des bataillons encore dévoués, des gardes fidèles vont protéger votre retraite; mais, je vous en supplie, mon frère, n'allez pas à Paris.»
Le Roi, tiraillé entre des avis contraires, hésita longtemps; le moment de la résistance fut bientôt passé. La veille, on avait fait partir huit cents gardes du corps pour Rambouillet. Le régiment de Flandre, indigné de s'être vu enlever ses canons et d'avoir été pendant la nuit enfermé dans les écuries, n'avait plus la même ardeur ni la même résolution; une grande partie de cette troupe avait même fait défection. Louis XVI déféra au vœu de la multitude, et malgré sa répugnance à s'établir dans la ville des émeutes, il donna sa parole de partir. «Cette promesse, raconte un des principaux témoins de ces tristes scènes134, cette promesse lui attira les acclamations populaires, et bientôt les coups de canon et les feux roulants de la mousqueterie y répondirent. Le Roi parut une seconde fois sur le balcon pour confirmer sa promesse, et l'ivresse de cette multitude fut à son comble. On s'empara des gardes du corps qu'on avait arrachés à la mort, et on leur fit prendre des bonnets de grenadier. Ces braves gens consentirent à se mêler à eux pour servir d'escorte à la malheureuse famille royale, et j'en remarquai plusieurs suivant à pied la voiture du Roi, plus touchés des malheurs de ce prince que de leur triste situation.
»Les poissardes étoient toujours en grand nombre dans les cours du château, chantant, dansant, et faisant éclater les transports de la joie la plus bruyante et la plus indécente. La cour de marbre, sur laquelle donnoient les fenêtres de l'appartement du Roi, étoit remplie de ces femmes, qui, enivrées de leurs succès, demandèrent à voir la Reine. Cette princesse parut sur le balcon, tenant par la main M. le Dauphin et Madame. Toute cette multitude la regardant avec fureur s'écria: «Faites retirer les enfants!» La Reine les fit rentrer et se montra seule. Cet air de grandeur et de courage héroïque à la vue d'un danger qui faisoit tressaillir tout le monde, imposa tellement à cette multitude qu'elle abandonna à l'instant ses sinistres projets, et que, pénétrée d'admiration, elle s'écria unanimement: Vive la Reine! On remarqua, comme chose singulière, que toutes ces poissardes avoient le teint blanc, de belles dents, et portaient un linge plus fin qu'elles n'ont coutume d'en porter, ce qui prouvoit évidemment qu'il y avoit parmi elles beaucoup de personnes payées pour jouer un rôle dans cette horrible journée.
»Le Roi (c'est toujours madame de Tourzel qui parle) monta en voiture à une heure et demie… Il étoit dans le fond de la voiture avec la Reine et Madame, sa fille. J'étois sur le devant, tenant sur mes genoux M. le Dauphin, et Madame étoit à côté de ce prince. Monsieur et Madame Élisabeth étoient aux portières. M. de la Fayette, commandant la garde nationale de Paris, et M. d'Estaing celle de Versailles… étoient tous deux à cheval aux portières de la voiture…
»Un grand nombre d'habitants de la ville de Versailles, travaillés par les meneurs de la révolution, en avoient adopté les principes, et quoiqu'ils eussent tout à perdre à l'établissement du Roi à Paris, ils éprouvèrent la plus grande joie de son départ. La populace s'assembla dans l'avenue; une partie suivit la voiture du Roi…
»Mirabeau, qui s'étoit opposé à la motion d'envoyer des députés auprès du Roi dans le moment du danger, fit décréter que cent députés accompagneroient ce prince à Paris, et eut l'audace de sortir du milieu d'eux pour le regarder fixement quand il passa devant l'Assemblée nationale.
»Le cortége de ce malheureux prince étoit digne de cette effroyable journée. On vit défiler d'abord le gros des troupes parisiennes, dont chaque soldat portoit un pain au bout de sa baïonnette. Elles étoient accompagnées d'une populace effrénée portant sur des piques les têtes des malheureux gardes du corps qu'elle avoit massacrés, suivie de charrettes remplies de sacs de farine et de poissardes décorées de guirlandes de feuillage, tenant chacune un pain à la main. Toute cette multitude ne cessait de répéter ce cri de Vive la nation! prélude de toutes les horreurs qui se sont commises pendant la révolution. Les gardes nationales, parmi lesquelles s'étoient mêlés les fidèles gardes du corps, entouroient la voiture du Roi, qui alloit au pas.
»Le Roi et la Reine parloient avec leur bonté ordinaire à ceux qui entouroient leur voiture, et leur représentoient combien on les égaroit sur leurs véritables sentiments. «Le Roi, leur disoit cette princesse, n'a jamais voulu que le bonheur de son peuple. On vous a dit bien du mal de nous; ce sont ceux qui veulent vous nuire…»
»On jeta à Sèvres, dans la voiture du Roi, un petit paquet qui tomba sur mes genoux. «Mettez-le dans votre poche, me dit le Roi, nous l'ouvrirons en arrivant.» Il tomba dans la voiture: je n'ai jamais su ce qu'il contenoit…
»Le régiment de Flandre formoit une haie sur le chemin d'Auteuil à Paris. Il partageoit alors les sentiments de la populace, et tous les soldats crioient avec elle: Vive la nation! À bas les calotins! refrain continuel de cette multitude qui remplissoit les chemins; tous ces gens-là, à moitié ivres, tiroient continuellement des coups de fusil, et ce fut un grand bonheur qu'il n'en soit résulté aucun accident.
»M. le duc d'Orléans étoit sur le chemin de Passy, et ses enfants avec madame de Genlis sur le balcon de la maison qu'il y avoit louée. Elle les y avoit placés pour jouir à son aise du spectacle de l'abaissement de la famille royale, qui ne put s'empêcher d'en faire la remarque. La Reine en parla tristement à madame la duchesse d'Orléans, qui soupira sans pouvoir rien répondre. Cette excellente princesse étoit bien loin de partager les sentiments du duc son époux. Elle s'aveugloit encore sur son compte, et fut complétement malheureuse quand, l'illusion cessant, elle ne put s'empêcher d'apercevoir la part active qu'il prenoit à la révolution.
»En arrivant à la grille de Chaillot, on aperçut M. Bailly, maire de Paris, qui venoit présenter au Roi les clefs de cette ville et haranguer Sa Majesté et sa famille…
»Le Roi comptait arriver le soir aux Tuileries, lorsque M. Bailly le supplia de vouloir bien descendre à l'hôtel de ville, où toute la commune étoit rassemblée, et de l'honorer de sa présence. Le Roi s'y refusa, disant que sa famille et lui avoient trop grand besoin de repos pour prolonger les fatigues d'une telle journée; il insista, et M. de la Fayette l'en pressa tellement à plusieurs reprises, que le Roi, malgré sa répugnance, fut obligé de s'y laisser conduire.
»Pendant le chemin, M. de la Fayette s'approcha plusieurs fois de la portière de la voiture, assurant Sa Majesté qu'elle seroit contente de la manière dont elle seroit reçue dans sa capitale. Les rues étoient illuminées, et les cris continuels de Vive le Roi! accompagnèrent le prince depuis son entrée dans la rue Saint-Honoré jusqu'à l'hôtel de ville. Ces cris étoient plus bruyants que touchants, et avoient quelque chose de violent et de pénible à entendre.
»Arrivé à la place de Grève, la foule étoit si considérable, que le Roi, pour éviter quelque malheur, descendit de la voiture, ainsi que la famille royale, et on eut beaucoup de peine à écarter la foule pour lui faire un passage jusqu'à l'hôtel de ville. M. Bailly fit au Roi un nouveau discours, auquel il répondit… J'étois si occupée de M. le Dauphin, excédé de fatigue et endormi entre mes bras, que je n'entendis ni l'un ni l'autre. M. le duc de Liancourt, qui accompagnoit le Roi, le pria de renouveler sa promesse de se déclarer inséparable de l'Assemblée nationale; ce malheureux prince, qui étoit dans la triste position de ne pouvoir rien refuser, acquiesça à cette demande, et les cris répétés de Vive le Roi! terminèrent enfin cette séance.»
Ce simple récit, tout exact et touchant qu'il soit, ne suffit pas cependant pour faire apprécier toute l'horreur de ces événements. «Ô nuit d'octobre, s'écriait Rivarol, nuit affreuse, à laquelle il est plus aisé de donner des larmes qu'un véritable nom! où M. de la Fayette ignore ce qu'il sait, traite de ouï-dire ce qu'il entend et de vision ce qu'il voit; où il trompe le Roi, une partie de l'Assemblée et tout le château, laisse les postes dégarnis, et, pour se donner un air d'innocence, va consacrer au sommeil cette nuit qui fut la dernière pour la monarchie.»
Atterré des excès dont il est témoin, M. de Lally-Tolendal voulut dès ce jour-là, comme Mounier et Bergasse, renoncer à siéger dans l'Assemblée nationale. «Ni cette ville coupable, écrit-il sous l'impression du 6 octobre, ni cette Assemblée encore plus coupable, ne méritent que je les justifie… Mes fonctions me sont devenues impossibles; il est au-dessus de mes forces de supporter plus longtemps l'horreur qu'elles me causent. Ce sang, ces têtes, cette Reine presque égorgée, ce Roi emmené esclave en triomphe à Paris, au milieu des assassins, et précédé des têtes de ses malheureux gardes du corps; ces perfides janissaires, ces femmes cannibales, ces cris de Tous les évêques à la lanterne! dans le moment où le Roi est entré dans la capitale avec deux archevêques de son conseil dans sa voiture de suite; un coup de fusil que j'ai vu tirer dans une des voitures de la Reine; M. Bailly appelant cela un beau jour; l'Assemblée ayant déclaré froidement le matin qu'il n'étoit pas de sa dignité d'aller tout entière environner le Roi; M. le comte de Mirabeau disant impunément dans cette Assemblée nationale que le vaisseau de l'État, loin d'être arrêté dans sa marche, s'élançoit avec plus de rapidité que jamais vers la régénération; M. Barnave riant avec lui quand des flots de sang couloient autour de nous; le vertueux Mounier échappant par miracle à dix-neuf assassins qui vouloient faire de sa tête un trophée de plus: voilà ce qui m'a fait jurer de ne plus mettre les pieds dans cette caverne d'anthropophages, où je n'avois plus la force d'élever ma voix, où, depuis six semaines, je l'avois élevée en vain135.» Ces fortes paroles, malgré l'emphase ordinaire de celui qui les a écrites, n'exagèrent point la vérité; elles ne font que l'exprimer. Le Roi aurait pu résister à Versailles: la révolution était allée l'y chercher pour l'amener dans la capitale, ce champ de bataille où elle savait qu'elle était irrésistible.
En venant à Paris avec sa famille, Madame Élisabeth avait le pressentiment qu'elle ne retournerait pas à Versailles. Comme le carrosse royal touchait la grille de l'avenue de Paris, elle s'était penchée pour voir la tête des arbres de son petit domaine. Témoin de ce mouvement, Louis XVI lui avait dit: «Ma sœur, vous saluez Montreuil? – Sire, avait-elle répondu doucement, je lui dis adieu.» Pendant ce pénible trajet, qui avait duré sept heures, et dont nous sommes heureux d'avoir pu donner à nos lecteurs une narration exacte et inédite, la contenance assurée de Madame Élisabeth, au milieu de cette escorte avinée et hurlante, ne s'était pas démentie un instant. Occupée plus particulièrement de son neveu et de sa nièce, elle avait caché sous un air calme et presque indifférent la profonde émotion que lui causaient l'humiliation du trône et le trouble de ces deux enfants, plus surpris encore qu'effrayés du spectacle qui se déroulait sous leurs yeux.
Il était environ dix heures et demie du soir quand Louis XVI et sa famille arrivèrent aux Tuileries: ce palais, inhabité presque sans interruption depuis 1655, leur parut plus sombre par le contraste que faisait sa façade noire avec les illuminations des rues qu'ils venaient de traverser. Ils y retrouvèrent leurs fidèles serviteurs, qu'une si longue attente avait jetés dans une vive anxiété, et qui n'avaient pu se procurer ce qui était nécessaire pour disposer convenablement les appartements. Madame de Tourzel (c'est elle qui nous a raconté ces détails) fut installée avec le Dauphin dans un appartement ouvert de tous côtés et dont les portes pouvaient à peine se fermer. Elle s'y barricada avec le peu de meubles qu'elle y trouva, s'assit auprès du lit du royal enfant, et passa la nuit dans les plus sombres réflexions.
Madame Élisabeth, on le comprend, n'était pas mieux logée que l'héritier du trône: l'aspect de son appartement, situé au rez-de-chaussée et donnant sur la cour, empruntait à cette double circonstance un caractère de tristesse aggravé par son aspect intérieur: ses voussures sculptées avec art, mais endommagées par les doigts humides du temps; ses tapisseries riches, mais flétries et délabrées; la vétusté de l'ameublement, qui datait de Louis XIV et qui n'en révélait l'époque que par les lignes et nullement par les couleurs; cet ensemble de choses brillantes et moisies imposait tout à la fois le souvenir de la grandeur de la royauté et le sentiment profond de sa décadence.
La situation de cet appartement rapprochait ceux qui l'habitaient du regard des curieux: aussi ce fut sous ses fenêtres que, dans la matinée du 7 octobre, les cris de la foule vinrent solliciter par des vivat la présence des augustes hôtes conquis la veille. Les cris de la Reine! la Reine! dominèrent un moment tous les autres. Marie-Antoinette parut bientôt à la fenêtre; mais comme son chapeau lui couvrait une partie du visage, on la pria de le lever, parce qu'on ne la voyait pas, ce qu'elle fit. Toutes les personnes de la famille royale, portant la cocarde nationale, espèce de sceau dont la révolution marquait ses captifs, s'y montrèrent au peuple à plusieurs reprises.
Les cours supérieures, qui étaient dans l'usage de complimenter le Roi dans les différentes occasions, se trouvaient presque toutes en vacance à cette époque; elles ne purent donc remplir ce devoir qu'à des jours différents. Le Parlement fut admis à l'audience royale le vendredi 9 octobre. Le Roi, suivant l'immuable étiquette, le reçut assis dans son fauteuil, placé dans la chambre du lit. Cependant une infraction fut faite aux usages établis: les gardes nationales prirent les armes dans leur salle. Le Parlement n'avait pas droit à cet honneur; mais l'officier supérieur de service sachant que la commune de Paris, qui devait ensuite avoir audience, exigerait certainement qu'on le lui rendît, en parla aux officiers des cérémonies, qui, sans rien décider, répondirent qu'ils ne pensaient pas qu'il y eût d'inconvénient à faire pour le Parlement ce qu'on devait faire pour la ville. La garde nationale rendit donc les honneurs militaires quand le Parlement passa devant elle. Les Cent-Suisses suivirent l'ancienne coutume et ne prirent pas les armes.
Le Roi et la Reine reçurent ensuite les représentants de la commune de Paris, et dans les jours qui suivirent, ils donnèrent successivement audience aux représentants des districts, à la cour des aides, à l'université, au grand conseil, à la chambre des comptes, à la cour des monnaies, au conseil d'État, à la juridiction consulaire et aux six corps des marchands, et enfin, pour couronner ces cérémonies, à l'Assemblée nationale elle-même.
On le voit, la royauté, qui venait de perdre son pouvoir, cherchait à conserver encore quelques lambeaux de son prestige et à sauver dans son naufrage les épaves de son ancienne étiquette pour en voiler la défaillance de son autorité. Les serviteurs mêmes de la couronne demeuraient dans le passé, parlaient de l'Œil-de-bœuf comme sous Louis XIV, et ne paraissaient pas comprendre que la révolution avait fait marcher l'aiguille sur l'horloge du temps. Le Roi ne régnait plus: l'étiquette, dans ses idées, régnait encore136.
La multitude, pendant plusieurs jours, ne cessa d'encombrer la cour des Princes, et son indiscrétion fut poussée à un tel point, que plusieurs femmes de la halle se permirent de sauter dans l'appartement de Madame Élisabeth. La princesse prit ce logement en grande aversion, et supplia le Roi de lui en donner un autre. Un nouvel arrangement eut lieu pour les appartements: la Reine occupa le rez-de-chaussée ayant vue sur la terrasse des Tuileries, et donna à sa fille les petits entre-sols au-dessus de la chambre du Roi; Louis XVI céda une partie de son appartement au Dauphin, et donna à Madame Élisabeth celui que le jeune prince avait occupé à son arrivée, au premier étage du pavillon de Flore. Les serrures en avaient été refaites, et, bien qu'il ne fût ni élégant ni commode, Élisabeth s'y sentit à l'aise, à l'abri des regards importuns et de l'invasion des poissardes.
Toutefois, il faut le dire, les dames de la halle, malgré leur familiarité indiscrète, leur grossièreté proverbiale et la fâcheuse influence que les passions politiques du temps avaient exercée sur elles, conservaient pour Madame Élisabeth un culte particulier qui survivait à leurs anciens sentiments pour la famille royale: elles l'appelaient la sainte Geneviève des Tuileries.
La cour essaya de reprendre un peu de vie. La princesse de Lamballe songea à réunir quelques personnes chez elle; mais la Reine ne parut pas longtemps à ces assemblées, d'où la confiance et la franchise étaient bannies.
Le lendemain de l'audience, l'Assemblée nationale continua ses travaux et vota, le jour même, la loi martiale contre les attroupements.
J'ai oublié de dire que lors de sa première séance dans une des salles de l'archevêché, un amphithéâtre construit provisoirement pour les spectateurs s'était écroulé; que plusieurs personnes avaient été blessées, et qu'une voix s'était écriée: Le début est fatal. L'Assemblée, le 9 novembre, alla tenir ses séances dans la salle du Manége, et continua, sous le bruit incessant des passions grondant à ses portes, à préparer une constitution.
Lorsque la famille royale eut été convenablement établie aux Tuileries, la Reine reprit ses habitudes ordinaires: elle employa ses matinées à veiller à l'éducation de sa fille, et elle entreprit, de concert avec Madame Élisabeth, un grand ouvrage de tapisserie. Leur esprit était trop préoccupé des événements qui se succédaient, des périls du présent et des menaces de l'avenir, pour qu'elles pussent se livrer à la lecture: le travail de l'aiguille devenait leur seule distraction. Mademoiselle Dubuquois, qui tenait un magasin de tapisseries, a longtemps conservé et montré chez elle un tapis de pied fait par ces deux princesses pour la grande pièce de l'appartement de la Reine, au rez-de-chaussée des Tuileries. On rapporte que l'impératrice Joséphine ayant vu et admiré ce tapis, avait donné l'ordre de le conserver, dans l'espoir de le faire un jour parvenir à Madame, fille et nièce de ces deux royales ouvrières.
MM. Miomandre et Bernard, tous deux anciens gardes du corps, blessés le 6 octobre, le premier à la porte de la Reine, le second dans une autre partie du château, après avoir été soignés ensemble et guéris à l'infirmerie de Versailles, se trouvaient à Paris, où ils avaient été reconnus et insultés. Leur séjour dans la capitale mettait leur vie en péril, car la fidélité et le dévouement étaient devenus un titre de proscription. «La Reine, raconte madame Campan, me dit d'écrire à M. Miomandre de Sainte-Marie de se rendre chez moi à huit heures du soir, et de lui communiquer le désir qu'elle avoit de le voir en sûreté, et m'ordonna, quand il seroit décidé à partir, de lui ouvrir sa cassette, et de lui dire en son nom que l'or ne payoit point un service tel que celui qu'il avoit rendu; qu'elle espéroit bien être un jour assez heureuse pour l'en récompenser comme elle le devoit; mais qu'une sœur offroit de l'argent à un frère qui se trouvoit dans la situation où il étoit dans ce moment, et qu'elle le prioit de prendre tout ce qui étoit nécessaire pour acquitter ses dettes à Paris et payer les frais de son voyage. Elle me dit aussi de lui mander d'amener avec lui son ami Bernard, et de lui faire la même offre qu'à M. Miomandre. Les deux gardes arrivèrent à l'heure prescrite et acceptèrent chacun cent ou deux cents louis. Un moment après, la Reine ouvrit ma porte; elle étoit accompagnée du Roi et de Madame Élisabeth; le Roi se tint debout, le dos contre la cheminée; la Reine s'assit dans une bergère, Madame Élisabeth assez près d'elle; je me plaçai derrière la Reine, et les deux gardes restèrent en face du Roi. La Reine leur dit que le Roi avoit voulu voir avant leur départ deux des braves qui lui avoient donné les plus grandes preuves de courage et d'attachement. Miomandre prit la parole et dit tout ce que ces mots touchants et honorables pour les gardes devoient lui inspirer. Madame Élisabeth parla de la sensibilité du Roi; la Reine reprit de nouveau la parole pour insister sur la nécessité de leur prompt départ. Le Roi garda le silence: son émotion pourtant étoit visible, et des larmes d'attendrissement remplissoient ses yeux. La Reine se leva, le Roi sortit, Madame Élisabeth le suivit; la Reine avoit ralenti sa marche, et, dans l'embrasure d'une fenêtre, elle me dit: «Si le Roi eût dit à ces braves gens le quart de ce qu'il pense de bien pour eux, ils auroient été ravis; mais il ne peut vaincre sa timidité.»