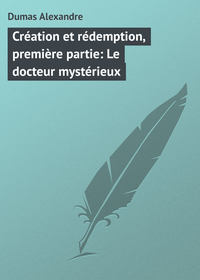Kitabı oku: «Création et rédemption, première partie: Le docteur mystérieux», sayfa 17
Et, de même qu'en terminant le dernier chapitre nous nous sommes inclinés devant ces hommes qui avaient sauvé militairement la France, inclinons-nous devant ces autres hommes dont la mission était bien autrement dangereuse et fut pour eux bien autrement mortelle.
Une seule fois j'ai été appelé à assister à un spectacle donné dans cette salle des Tuileries où se tint cette formidable séance que nous venons de rapporter, et tant d'autres qui en furent la suite et la conséquence.
On jouait le Misanthrope et Pourceaugnac.
On applaudissait ce double chef-d'œuvre de Molière, qui présente les deux faces de son auteur, le rire et les larmes.
Deux rois et deux reines étaient assis avec une foule de princes sur une estrade et applaudissaient.
Et je me demandais comment les rois osaient entrer dans une pareille salle, où la royauté avait été abolie, où la république avait été proclamée, où tant de spectres sanglants secouaient leurs linceuls, sans craindre que ce dôme, qui avait entendu les applaudissements du 21 septembre 1792, ne s'écroulât sur eux.
Oui, certes, nous devons beaucoup à ces hommes, à Molière, à Corneille, à Racine, qui ont tant fait pour la gloire de la France, à laquelle ils ont consacré leur génie.
Mais combien ne devons-nous pas plus à ces hommes qui ont prodigué leur sang pour la liberté.
Les premiers ont fondé les principes de l'art.
Les autres ont consacré ceux du droit.
Sans les premiers nous serions encore ignorants peut-être; sans les autres, à coup sûr, nous serions encore esclaves.
Et ce qu'il y a d'admirable dans ces hommes de 1792, c'est que tous lavèrent dans leur propre sang leurs erreurs ou leurs crimes.
Je mets à part Marat, dont le couteau de Charlotte Corday a fait justice, et qui n'était d'aucun parti.
Les girondins, qui causèrent la mort du roi, furent punis de cette mort par les cordeliers.
Les cordeliers furent punis de la mort des girondins par les montagnards.
Les montagnards furent punis de la mort des girondins par les hommes de thermidor.
Enfin ceux-ci se détruisirent entre eux.
Ce qu'ils ont fait de mal, ils l'ont emporté dans leurs tombes sanglantes.
Ce qu'ils ont fait de bon est resté.
Et tous, malgré leurs erreurs, leurs fautes, leurs crimes mêmes, étaient de grands citoyens, d'ardents amis de la patrie; leur amour jaloux pour la France les aveugla, ce fut cet amour frénétique qui en fit des Orosmane et des Othello politiques: ils haïrent et tuèrent parce qu'ils aimaient.
Mais, parmi ces sept cent quarante-cinq hommes, pas un traître, pas un concussionnaire. Rien de lâche en eux. Fondateurs de la république, ils l'avaient dans le cœur. La république, c'était leur foi, c'était leur espoir, c'était leur déesse. Elle montait avec eux dans la charrette, elle les soutenait dans le douloureux trajet de la Conciergerie à la place de la Révolution. C'était elle qui les faisait sourire jusque sous le couteau.
Le dix thermidor, elle ne voulut point descendre de l'échafaud et fut guillotinée entre Saint-Just et Robespierre.
Et voilà ce à quoi je pensais, voilà ce que je voyais comme à travers un nuage dans cette salle des Tuileries où des rois et des reines, inintelligents du passé et insoucieux de l'avenir, applaudissaient ces deux excellents comédiens que l'on appelait Mlle Mars et Monrose.
Notre récit serait incomplet si, le lendemain de ce grand jour que nous venons de faire apparaître rayonnant dans le lointain de notre histoire, nous ne suivions pas Jacques Mérey retournant près de Dumouriez, portant des instructions secrètes de Danton.
Jacques Mérey avait été absent trois jours; à son retour à Sainte-Menehould, il ne trouva rien de changé: les Français, faisant toujours face à la France, semblaient l'envahir; les Prussiens, lui tournant le dos, semblaient la défendre.
Les instructions de Danton étaient précises:
Tout faire pour que les Prussiens abandonnassent la France, et, en abandonnant matériellement la France, abandonnassent moralement le roi.
En somme, la bataille de Valmy n'était qu'un échec; ce n'était point une bataille, mais une canonnade; comme nous l'avons dit, les Prussiens y avaient perdu douze ou quinze cents hommes, nous sept à huit cents.
Les Prussiens n'étaient nullement entamés matériellement; démoralisés, oui.
Les deux armées comptaient un nombre à peu près égal de combattants, soixante-dix à soixante-quinze mille hommes; mais celle des coalisés était dans un état déplorable.
Les escarmouches sur le front de l'armée n'amenaient aucun résultat, et il avait été convenu d'un commun accord de les cesser; mais Dumouriez avait détaché toute sa cavalerie dans les environs: il avait lancé tous ses cavaliers à cette chasse des vivres dont nos soldats se faisaient un plaisir et qui amenait l'abondance dans notre camp tout en poussant la famine dans le camp prussien.
L'armée coalisée perdait deux ou trois cents hommes par jour de la dysenterie.
Cependant Sa Majesté Frédéric-Guillaume tint bon pendant douze jours.
Mais nul n'était, dans toute cette armée composée d'éléments divers, plus troublé que le roi de Prusse lui-même. Il y avait schisme dans son camp, guerre civile dans sa tente, combat dans son cœur.
Le roi avait une maîtresse qu'il adorait. Les femmes n'aiment pas la guerre; la comtesse de Lichtenau était à la tête du parti des pacifiques; elle s'était avancée jusqu'à Spa et n'osait aller plus loin.
Elle craignait pour la vie de son royal amant, bien plus encore pour son cœur; les fêtes qu'on lui avait données à Verdun, ces vierges voilées qui avaient été au-devant de lui avec des fleurs et des dragées, n'étaient aucunement rassurantes. On voile souvent les vilains visages; mais plus souvent encore les beaux. Elle écrivait au roi des lettres désespérées.
En échange, la nouvelle de l'échec de Valmy avait été reçue par le parti de la paix avec autant de joie que la trahison de Verdun avait causé de terreur. Brunswick, qui prenait ses soixante-huit ans, voyant que la campagne de France ne serait point, comme il l'avait cru, précisément une promenade militaire, aspirait au repos et à son duché, loin de se douter encore que son fameux manifeste les lui ferait perdre tous les deux. Le roi, de l'avis de Brunswick et des pacifistes, n'était plus retenu que par un certain respect humain. À toutes les observations des uns et des autres, et même de sa maîtresse, il répondit:
– Mais la cause des rois, mais la liberté de Louis XVI! c'est une affaire d'honneur qu'un roi ne saurait abandonner sans une suprême honte.
Puis, il faut le dire, les nouvelles arrivaient désastreuses pour la coalition. Le 21 septembre, abolition de la royauté et proclamation de la république; le 24, Chambéry ouvre ses portes; le 29, c'est Nice: la république, comme le Nil, commençait à déborder sur le monde pour le fertiliser.
Vers les derniers jours de septembre, le malaise devint intolérable dans l'armée des coalisés. Frédéric-Guillaume, que l'empereur d'Autriche et l'impératrice Catherine attendaient à la table splendide où ils dévoraient la Pologne, n'avait pas de quoi manger dans son camp.
Dumouriez lui envoya douze livres de café, c'est tout ce qu'il en avait lui-même.
Ces douze livres de café furent le prétexte des accusations qui s'élevèrent contre Dumouriez, et, il faut le dire aussi, la seule preuve.
Aux propositions faites par les premiers parlementaires envoyés, Dumouriez avait répondu au nom de l'Assemblée:
– Les Français ne traiteront avec l'ennemi que lorsqu'il sera sorti de France.
Mais les instructions secrètes que rapportait Jacques Mérey étaient loin d'avoir cette rudesse toute romaine:
Remporter une victoire moins glorieuse, mais aussi importante que celle de Valmy, sans combattre;
Ne pas pousser l'ennemi à un de ces désespoirs qui nous ont valu Crécy et Poitiers;
Reconduire l'armée prussienne avec tous les honneurs de la guerre, mais enfin la reconduire jusqu'à la frontière;
Constater bien clairement que Frédéric-Guillaume, en abandonnant la cause de Louis XVI, abandonnait la cause des rois; au lieu de mettre obstacle à la retraite des Prussiens, leur donner toute facilité de l'opérer.
Enfin, le 1er octobre, les Prussiens, ne pouvant tout à la fois résister à l'épidémie et à la disette, commencèrent à décamper.
Ils firent une lieue ce jour-là, une lieue le lendemain, mais enfin c'étaient deux lieues en arrière.
Le 30 septembre, une entrevue avait eu lieu entre Kellermann et Brunswick.
Brunswick avait deviné le plan de Dumouriez, mais Kellermann, esprit moins délié, ne l'avait pas compris.
Kellermann tenait absolument à poser les bases d'un arrangement.
Brunswick l'évitait; il trouvait qu'il avait bien assez écrit comme cela.
Trop peut-être!
– Mais, insista Kellermann, comment tout cela finira-t-il?
– Rien de plus simple, répondit Brunswick; nous nous en retournerons chacun chez nous, comme les gens de la noce.
– D'accord, dit Kellermann. Mais qui payera les frais de la noce? Il me semble que l'empereur, qui a attaqué le premier, nous doit bien les Pays-Bas pour indemniser la France.
– Quant à cela, la chose ne nous regarde en rien; c'est l'affaire des plénipotentiaires.
Et, comme nous l'avons dit, la retraite commença le lendemain.
La retraite fut un échange de bons procédés. Dillon seul, qui n'approuvait pas cette manière de faire la guerre, se fit donner deux ou trois fois sur les ongles en voulant serrer l'ennemi de trop près.
L'ennemi, on le caressait, on le choyait, on lui donnait du pain et du vin pour qu'il eût la force de gagner plus vite la frontière.
Verdun fut abandonné le 14, Longwy le 22.
Enfin, le 26 octobre, le dernier Prussien vivant repassait la frontière.
L'armée coalisée laissait trente-cinq mille morts pour engraisser les plaines de la Champagne.
XXIX
Une soirée chez Talma
Le 25 octobre de la même année, il y avait double fête, au théâtre des Variétés du Palais-Royal, où Monvel avait engagé nos meilleurs artistes, un peu effarouchés par les premiers événements de la révolution.
Mlle Amélie-Julie Candeille, qui était la maîtresse de Vergniaud, donnait la première représentation de sa pièce de la Belle Fermière, où elle jouait le rôle principal, et Dumouriez, le vainqueur de Valmy, devait venir au théâtre.
Enfin, après la représentation, artistes, comédiennes, auteurs et hommes politiques devaient se rencontrer chez Talma, dans la petite maison de la rue Chantereine qu'il venait d'acheter, et où il donnait une de ces soirées, moitié bal, moitié bel esprit, où l'on dansait et où l'on disait des vers.
Dumouriez était arrivé depuis quatre jours à Paris avec Jacques, chez lequel il avait trouvé un homme qui lui convenait sous tous les rapports.
L'œil loyal et profond du docteur l'inquiétait bien de temps en temps, en ce qu'il plongeait jusqu'au fond de sa poitrine, comme s'il n'était pas entièrement convaincu du dévouement de Dumouriez à la République; mais sous ce rapport il avait affaire à forte partie; d'ailleurs les faits étaient là pour démentir les soupçons.
On accusait Dumouriez d'avoir été un peu trop courtois pour les Prussiens en retraite; mais Jacques Mérey savait d'où lui en était venu l'ordre, puisque cet ordre c'était lui-même qui l'avait transmis.
Dumouriez, sous prétexte de présenter au ministère son plan favori de l'invasion belge, était revenu à Paris étudier de son œil intelligent la situation. La royauté abolie, la république proclamée, venaient mettre un obstacle à son plan favori: faire du duc de Chartres un roi de France; mais il savait combien facilement la France, bonne fille au fond, se laisse aller à ses haines et à ses enthousiasmes du moment.
Il pensait donc que tout espoir n'était point perdu et qu'il fallait laisser faire au temps.
À sa première entrevue avec Mme Roland, Dumouriez, qui n'avait pas encore changé les talons rouges de Versailles contre les bottes de Valmy, avait traité un peu trop lestement la sévère matrone qui disait d'elle-même: «Personne moins que moi n'a connu la volupté.» Mme Roland, qui était le véritable ministre, qui sentait sa supériorité sur Roland et qui craignait avant tout le ridicule pour son mari, lui avait plus gardé rancune de ses façons cavalières envers elle, que de sa chute du ministère. En tout cas, le ministère girondin avait été admirable pour Dumouriez. Il l'avait, dans la mesure de son pouvoir, soutenu physiquement, et, dans la mesure de sa popularité, soutenu moralement. C'était à Dumouriez vainqueur de reconnaître à son retour à Paris la part que ses loyaux ennemis avaient prise à sa victoire, et à amener, s'il était possible, un rapprochement entre la Montagne et la Gironde. La chose était d'autant plus facile qu'il y avait déjà eu rapprochement entre Dumouriez et Danton.
La première représentation de la Belle Fermière devait compléter ce raccommodement.
En arrivant à Paris, Dumouriez s'était présenté au ministère de l'Intérieur; puis, en passant du cabinet du ministre au salon de Mme Roland, il avait fait prendre dans sa voiture un magnifique bouquet qu'il lui avait offert. Mme Roland avait reçu en souriant cet emblème des choses frivoles et éphémères; et, sur cette demande de Dumouriez:
– Voyons, que pensez-vous de moi?
Elle avait répondu:
– Je vous crois quelque peu royaliste.
Puis elle était entrée, en femme politique, dans les projets de son mari et de ses collègues; elle avait reconnu la grande intelligence de Dumouriez; mais plus cette intelligence était grande, plus il fallait s'en défier.
– Plus vous avez de talent, lui dit-elle, plus vous êtes dangereux, et la République désormais se gardera bien de vous subordonner les autres généraux.
Dumouriez haussa les épaules:
– La défiance est le défaut des républiques; c'est avec la défiance qu'elles tuent le génie; c'est la défiance qui crée ces éternelles paniques, ces cris de trahison poussés au hasard, qui ôtent toute force morale à l'homme que vous employez, et qui l'envoient impuissant et désarmé devant l'ennemi. Si les autres généraux ne m'avaient pas été subordonnés, je n'eusse pas pu réunir les forces de Beurnonville aux miennes, je n'eusse pas pu tirer Kellermann de Metz et le conduire à temps à Valmy, et à l'heure qu'il est les Prussiens seraient à Paris et c'est moi qui serais prisonnier à Berlin.
Dumouriez quitta Mme Roland pour se rendre à la Convention; c'était là qu'on l'attendait.
Il y avait eu changement de gouvernement; il y avait donc un nouveau serment à prêter.
Mais Dumouriez s'était avancé à la barre, avait écouté les compliments de Pétion, et avait répondu:
– Je ne vous ferai pas de nouveaux serments. Je me montrerai digne de commander aux enfants de la liberté et de soutenir les lois que le peuple souverain va se faire par votre organe.
Le soir, il se présenta aux jacobins. La dernière fois, il n'avait pas marchandé avec la situation, et il avait mis le bonnet rouge; cette fois, il y vint tout simplement avec son chapeau de général; quoique ce fût le même qu'il portait à Valmy, il fut reçu très froidement.
Collot-d'Herbois le comédien monta à la tribune, remercia le général de l'éminent service qu'il avait rendu à la patrie; mais lui reprocha d'avoir reconduit le roi de Prusse avec trop de politesse.
Danton lui succéda à la tribune, et, après avoir expliqué les causes de cette conduite courtoise:
– Console-nous, lui dit-il, par des victoires sur l'Autriche, de ne pas voir ici le despote de Prusse.
On le voit, à la coupe où Dumouriez croyait venir boire le vin enivrant de la victoire, l'ingratitude démocratique mêlait déjà son fiel.
Deux des plus grands généraux de la Révolution, deux des hommes à qui la République devait ses premières et ses plus belles victoires, devaient boire successivement à la coupe amère:
À peine vidée par Dumouriez, elle allait se remplir pour Pichegru.
Enfin, comme nous l'avons dit, cette fameuse soirée devait tout raccommoder, et c'était à l'œuvre innocente de Mlle Candeille que le baiser de paix devait se donner.
Roland avait mis sa loge à la disposition de Dumouriez.
Mme Roland devait y venir; puis, quand Roland aurait fini son labeur ministériel, il les rejoindrait.
Danton avait loué la loge à côté, pour lui, sa femme et sa mère.
Soit qu'il se trompât de loge, soit qu'il le fît exprès, il entra avec Dumouriez et sa femme dans la loge de Roland et s'y installa. Mme Roland et Mme Danton ne se connaissaient pas. Mme Roland était un grand esprit, Mme Danton était un grand cœur. Les deux femmes devaient se convenir; les deux femmes liées rapprocheraient les deux maris.
Puis l'effet était admirable pour le public:
On avait vu, dans la même loge, Dumouriez et Mme Roland, Danton et Vergniaud! car Vergniaud avait promis de venir. La maladresse d'une ouvreuse de loge fit manquer tout ce beau plan.
Lorsque Mme Roland se présenta au bras de Vergniaud pour entrer dans sa loge:
– Pardon, madame, lui dit l'ouvreuse, mais la loge est occupée.
Mme Roland voulut savoir qui se permettait d'occuper une loge qui était louée au nom de son mari.
– Ouvrez toujours, dit-elle.
La femme ouvrit.
Mme Roland jeta un coup d'œil rapide dans sa loge, reconnut Dumouriez, vit Danton avec une femme tenant la place qu'elle devait occuper.
Elle savait Danton peu soucieux de l'honorabilité des femmes avec lesquelles il se montrait en public; elle prit Mme Danton pour une femme près de laquelle elle ne pouvait s'asseoir.
– C'est bien, dit-elle.
Et elle repoussa la porte, qui se ferma seule.
Avant que Danton l'eût ouverte, elle avait gagné l'escalier.
D'ailleurs ce refus d'entrer dans une loge où se trouvait Mme Danton était une insulte. Danton adorait sa femme, et d'autant plus en ce moment, qu'elle avait déjà le cœur brisé par les journées de Septembre. Une violente palpitation la prit, à la suite de laquelle elle s'évanouit. Elle était déjà atteinte de la maladie dont elle mourut, d'une anémie. Une partie du sang versé le 2 septembre semblait être le sien.
Il avait un dernier espoir de revoir Roland chez Talma; quant à sa femme, à coup sûr elle n'y viendrait pas.
Danton passa sa soirée dans la même loge que Dumouriez, qui fut fort applaudi, mais beaucoup moins que s'il eût apparu au public entre Mme Roland et Vergniaud.
Dieu seul sait combien coûta de têtes cette vivacité de Mme Roland à refermer la porte de sa loge.
La pièce de Mlle Candeille, quoique appartenant à cette littérature molle et insipide de l'époque, eut un grand succès et resta au répertoire. Quarante ans après cette première représentation, j'y vis débuter Mlle Mante.
Le spectacle fini, l'auteur nommé au milieu des applaudissements, Danton chercha inutilement son ami Jacques Mérey pour lui confier sa femme, dont la santé commençait à l'inquiéter; mais Jacques Mérey, qui devait venir le joindre au spectacle, n'avait point paru.
Les deux hommes reconduisirent Mme Danton chez elle, la laissèrent passage du Commerce, et revinrent rue Chantereine, chez Talma.
La soirée était des plus brillantes. Talma était déjà à cette époque à l'apogée de sa réputation. Quoique appartenant par son opinion au club des Jacobins, quoique lié intimement avec David, l'ami de Marat, il appartenait par l'esprit, par l'art, par la littérature, à la Gironde, le plus élégant de tous les partis. Il en résultait qu'il réunissait chez lui hommes d'État, poètes, artistes, peintres, généraux, de toutes les opinions et de tous les partis.
Lorsque Dumouriez et Danton entrèrent, Mlle Candeille avait eu le temps de changer de costume et de venir recevoir les félicitations de ses camarades.
Ces félicitations étaient d'autant plus sincères que c'était un talent, comme poète, qui ne portait ombrage à personne.
Les nouveaux venus joignirent leurs compliments à ceux que Mlle Candeille était en train de recevoir, et, comme on venait de lui offrir une couronne de laurier, elle força Dumouriez de l'accepter.
Dumouriez la prit et alla la déposer sur un buste de Talma, où elle se fixa définitivement.
Talma présenta à Dumouriez tous ces hommes portant déjà des noms célèbres ou qui devaient le devenir. Tous ces noms étaient connus de Dumouriez, l'un des généraux les plus lettrés de l'armée; mais, éloigné par son état de la société parisienne, il ne connaissait que les noms.
Là étaient Legouvé, Chénier, Arnaud, Lemercier, Ducis, David, Girodet, Prud'hon, Lethière, Gros, Louvet de Couvrai, Pigault-Lebrun, Camille Desmoulins, Lucile, Mlle de Keralio, Mlle Cabarrus, Cabanis, Condorcet, Vergniaud, Guadet, Gensonné, Garat, Mlle Raucourt, Rouget de l'Isle, Méhulo, les deux Baptiste, Dazincourt, Fleury, Armand Dugazon, Saint-Prix, Larive, Monvel, tout l'art, toute la politique du temps.
Là enfin, Dumouriez, applaudi par tous, goûtait cette joie sans mélange du triomphateur au triomphe duquel ne se mêle pas la voix de l'esclave.
Il croyait du moins que la chose se passerait ainsi.
Tout à coup une rumeur sourde courut dans les salons; une inquiétude vague sembla s'emparer de tout le monde, et le nom de Marat, vingt fois répété, tomba sur les conviés du grand artiste, non pas comme des langues de feu, mais comme des gouttes d'huile bouillante.
– Marat! dit Talma, que vient-il faire ici? Que l'on m'appelle deux domestique, et qu'on me le mette à la porte!
Mais David s'y opposa.
– Laisse-moi d'abord voir ce qu'il veut, dit David, ensuite tu décideras.
Talma fit un signe d'assentiment.
David s'avança jusqu'au vestibule.
– Que veux-tu? demanda-t-il à Marat.
– Je veux parler au citoyen Dumouriez, répondit Marat.
– Ne pourrais-tu choisir un autre moment que celui où l'on donne une fête?
– Pourquoi donne-t-on des fêtes à un traître?
– Un traître qui vient de sauver la patrie.
– Un traître! un traître! un traître! te dis-je.
– Mais enfin que viens-tu demander?
– Je viens demander sa tête.
– Avec combien d'autres? demanda Danton qui parut à la porte.
– Avec la tienne, dit Marat, avec celle de tous ceux qui ont pactisé avec le roi de Prusse. Oui, ajouta-t-il en montrant le poing, on sait que vous avez reçu chacun deux millions.
– Laissez entrer ce fou afin que je le saigne! Il voit rouge! dit Cabanis.
Marat entra.
Mais déjà beaucoup avaient disparu ou avaient passé dans les pièces à côté.
Dugazon avait pris une pelle et l'avait mise à rougir au feu.
Marat était flanqué de deux jacobins, longs et maigres, ayant la tête de plus que lui.
Il venait demander compte à Dumouriez de l'épuration des volontaires de Châlons, dont il avait fait chasser les maratistes et ceux qui demandaient du sang.
Il comptait, le folliculaire gonflé de fiel et de venin, épouvanter le général vainqueur comme il épouvantait les badauds de Paris.
Dumouriez l'attendit, calme, appuyé sur le pommeau de son sabre.
– Qui êtes vous? demanda-t-il.
– Je suis Marat, répondit celui-ci, tordant sa bouche baveuse.
– Je n'ai affaire ni à vous ni à vos pareils.
Et il lui tourna le dos avec un profond mépris.
Tous ceux qui entouraient le général, et particulièrement les militaires, éclatèrent de rire.
– Ah! dit Marat, ce soir je vous fais rire, demain je vous ferai pleurer!
Et il sortit en montrant le poing et en menaçant.
À peine fut-il sorti, que Dugazon tira du feu la pelle rouge, prit une poignée de sucre en poudre, et, sans dire une parole, partout où avait passé Marat, brûla du sucre.
Cet épisode grotesque rendit la gaieté qui avait disparu.
Mais le but de la réunion de la Gironde à la Montagne était manqué, aussi bien dans le salon de la rue Chantereine que dans la loge du théâtre des Variétés du Palais-Royal.
Danton, en rentrant chez lui, trouva Jacques Mérey qui l'attendait avec impatience.
Le docteur vint à lui, et, sans lui donner le temps de l'interroger:
– Ami, lui dit-il, je ne veux pas, quelques jours après mon entrée à la Convention, demander un congé, mais il faut, pour une affaire de la plus haute importance, que tu m'obtiennes une mission qui me laisse quinze jours de liberté appliqués à mes propres affaires.
– Diable! fit Danton, à qui veux-tu que je demande cela? Je suis mal avec Servan et Clavier. Ce qui vient d'arriver ce soir ne m'a pas mis au mieux avec Roland. Mlle Manon Philippon, ajouta-t-il avec un accent de mépris, lui aura raconté la chose à sa manière. Il reste donc Garat, le ministre de la justice.
– Et comment es-tu avec celui-là?
– Oh! celui-là n'a rien à me refuser.
– C'est Garat justement qui a proposé, le 9 octobre dernier, la loi qui prononce la peine de mort contre les émigrés pris les armes à la main et leur exécution immédiate, n'est-ce pas?
– C'est lui.
– Eh bien! qu'il me charge de rechercher l'identité du seigneur de Chazelay, pris à Mayence le 21 et fusillé le 22. Bien entendu que la mission est tout honoraire, et que je ferai les recherches à mes frais.
– La chose a l'importance que tu lui donnes?
– Il y va de mon bonheur.
– Tu auras ta mission demain.
Jacques Mérey avait lu le soir même dans le Moniteur:
«Le chef d'une petite bande d'émigrés, après avoir combattu en Champagne avec ses hommes, voyant qu'il n'y avait plus rien à faire de ce côté-là, est venu vers les premiers jours d'octobre s'enfermer dans la ville de Mayence.
»Mais la ville de Mayence s'étant rendue le 21 octobre dernier, et aucune condition n'ayant été stipulée par le gouverneur en faveur des émigrés, M. de Chazelay a été pris les armes à la main et, en vertu de la loi du 9 octobre, fusillé dans les vingt-quatre heures.
»On dit que le seigneur de Chazelay possédait de grands biens dans le département de la Creuse, aux environs de la ville d'Argenton.
»Encore un bel héritage pour la République!»
Le lendemain, Jacques Mérey avait sa mission signée Garat, mission à laquelle il pouvait consacrer depuis le 26 octobre jusqu'au 10 novembre inclusivement.
En conséquence, sans perdre un seul instant, il repartit pour Mayence avec une lettre de recommandation du général Dumouriez pour le général Custine.
La veille de son départ, sur la proposition de Garnier (de Saintes), la Convention avait rendu un décret qui bannissait les émigrés à perpétuité et qui punissait de mort ceux qui rentraient en France – sans distinction d'âge ni de sexe.