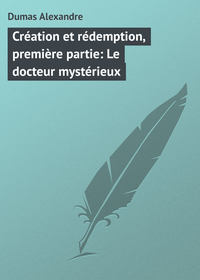Kitabı oku: «Création et rédemption, première partie: Le docteur mystérieux», sayfa 16
On annonça à Jacques Mérey qu'un des soldats qui avaient combattu sous lui avait à lui remettre divers objets précieux qu'il ne voulait remettre à personne. Il fit venir l'homme; c'était un caporal. Il avait fouillé le chef des émigrés, avait trouvé sur lui une bourse contenant cent vingt louis, un portefeuille dans lequel était une lettre commencée pour sa femme, une montre enrichie de diamants et plusieurs bagues précieuses.
Il apportait le tout au docteur, sous ce prétexte tout militaire que, puisque c'était lui qui avait tué le prince, c'était lui qui en devait hériter.
– Mon ami, lui dit Jacques Mérey, je ne me crois aucun droit à tous ces objets, et cependant, comme ils sont entre mes mains, voilà à mon avis ce qu'il faut en faire: il faut faire venir des médecins de Mézières, de Sedan, de Rethel, de Reims et de Sainte-Menehould, accepter le dévouement de ceux qui seront riches, et payer les soins de ceux qui seront pauvres avec les cent vingt louis du prince de Ligne. Es-tu de cet avis?
– Parfaitement, citoyen représentant.
– Comme le prince de Ligne n'est point un émigré, mais un prince de Hainaut, et que ses biens ne sont pas confisqués, mon avis est encore qu'il faut remettre le portefeuille, la montre et les bijoux trouvés sur lui au général Dumouriez; il les fera passer à sa femme, qui, quoi que tu en dises, a encore plus de droits à son héritage que moi.
– C'est encore juste, dit le caporal.
– Enfin, continua Jacques, comme il ne faut pas t'ôter aux yeux de qui de droit le mérite de ta belle action, c'est toi qui porteras au général, avec une lettre de moi, le portefeuille, la montre et les bijoux. Après quoi, aussi vite que possible, tu me rapporteras ici la réponse du général, et, comme il faut que cette réponse arrive le plus tôt possible, tu prendras le cheval du prince, que je regarde comme ma propriété, et tu diras au général que je le prie, pour l'amour de moi, de le mettre dans ses écuries.
Quatre heures après, le caporal était de retour sur un cheval que Dumouriez envoyait à Jacques Mérey en échange du sien.
Il était porteur d'une lettre de Dumouriez qui ne contenait que ces mots:
Venez vite: j'ai besoin de vous.
DUMOURIEZ.
– Eh bien! dit-il au soldat, tu as l'air content, mon brave.
– Je crois bien, répondit celui-ci: le général m'a fait sergent et m'a donné sa propre montre.
Et il montra à Jacques Mérey la montre que lui avait donnée Dumouriez.
– Bon, dit en riant Jacques, elle est d'argent.
– Oui, répondit le soldat; mais les galons sont d'or!
XXVII
Kellermann
Jacques Mérey trouva Dumouriez calme, quoique la situation fût presque désespérée.
Charot, au lieu de se retirer sur Grand-Pré, avait été prévenu et s'était retiré sur Vouziers.
Dumouriez, avec ses quinze mille hommes, se trouvait séparé de Charot, qui était, comme nous l'avons dit, à Vouziers, et de Dubouquet, qui était au Chêne Populeux, par les trente mille hommes de Clerfayt.
Le général en chef écrivait.
Il donnait l'ordre à Beurnonville de hâter sa marche sur Rethel, où il n'était pas encore et où il eût dû être le 13; à Charot et à Dubouquet de faire leur jonction et de marcher sur Sainte-Menehould.
Enfin, il écrivait une dernière lettre à Kellermann, dans laquelle il le priait, quelques bruits qu'il entendît venir de l'armée, et si désastreux que fussent ces bruits, de ne pas s'arrêter un instant et de marcher sur Sainte-Menehould.
Il chargea des deux premières lettres ses deux jeunes hussards, qui, connaissant le pays et admirablement montés, pouvaient en quatre ou cinq heures atteindre Alligny par un détour; il leur ordonna de prendre deux chemins différents, afin que si l'un des deux était arrêté en route, l'autre suppléât.
Tous deux partirent.
Alors, prenant Jacques Mérey à part:
– Citoyen Jacques Mérey, lui dit-il, depuis deux jours vous nous avez donné de telles preuves de patriotisme et de courage, et de votre côté vous m'avez vu agir si franchement, qu'il ne peut plus y avoir entre nous ni doutes ni soupçons.
Jacques Mérey tendit sa main au général.
– À qui avez-vous besoin que je réponde de vous comme de moi-même? dit-il.
– Il n'est pas question de cela. Vous allez prendre mon meilleur cheval et vous rendre au-devant de Kellermann; vous ne lui parlerez pas en mon nom, le vieil Alsacien est blessé d'avoir été mis sous les ordres d'un plus jeune général que lui, voilà pourquoi il ne se presse pas d'obéir; mais vous lui parlerez au nom de la France, notre mère à tous; vous lui direz que la France, les mains jointes, le supplie de faire sa jonction avec moi; une fois sa jonction faite, je lui abandonnerai le commandement s'il le désire, et je servirai sous lui comme général, comme aide de camp, comme soldat. Kellermann, très brave, est en même temps prudent jusqu'à l'irrésolution: il ne doit être qu'à quelques lieues d'ici. Avec ses 20 000 hommes, il passera partout; trouvez-le, amenez-le. Dans mon plan, je lui réserve les hauteurs de Gizaucourt; mais qu'il se place où il voudra, pourvu que nous puissions nous donner la main. Voilà mon plan: Dans une heure, je lève le camp; je m'adosse à Dillon, que je laisse aux Islettes. Je rallie Bournonville et mes vieux soldats du camp de Maulde, cela me fait 25 000 hommes; les 6 000 hommes de Charot et les 4 000 de Dubouquet me font 35 000 hommes; les 20 000 de Kellermann, 55 000. Avec 55 000 soldats gais, alertes, bien portants, je ferai tête, s'il le faut, à 80 000 hommes. Mais il me faut Kellermann. Sans Kellermann, je suis perdu et la France est perdue. Partez donc, et que le génie de la nation vous mène par la main!
Une heure après, en effet, Dumouriez recevait un parlementaire prussien qu'il promenait par tout le camp de Grand-Pré; mais le parlementaire était à peine à Chevières, qu'il faisait décamper et marcher en silence, ordonnant de laisser tous les feux allumés.
L'armée ignorait que le défilé de la Croix-aux-Bois avait été forcé. Elle ignorait le motif de cette marche et croyait faire un simple changement de position. Le lendemain, à huit heures du matin, on avait traversé l'Aisne et l'on s'arrêtait sur les hauteurs d'Autry.
Le 17 septembre, après deux de ces paniques inexplicables qui éparpillent une armée comme un tourbillon fait d'un tas de feuilles sèches, tandis que des fuyards couraient annoncer à Paris que Dumouriez était passé à l'ennemi, que l'armée était vendue, Dumouriez entrait à Sainte-Menehould avec son armée en excellent état; il y était accompagné par Dubouquet, Charot et Beurnonville, et il écrivait à l'Assemblée nationale:
J'ai été obligé de quitter le camp de Grand-Pré, lorsqu'une terreur panique s'est mise dans l'armée; dix mille hommes ont fui devant quinze cent hussards prussiens. La perte ne monte pas à plus de cinquante hommes et quelques bagages.
Tout est réparé. Je réponds de tout!
Pendant ce temps, Jacques Mérey courait après Kellermann.
Il ne le rejoignit que le 17, vers cinq heures du matin, à Saint-Dizier. En apprenant le 17 l'évacuation des défilés, il s'était mis en retraite.
Ce qu'avait prévu Dumouriez serait arrivé s'il n'avait eu l'idée d'envoyer Jacques Mérey à Kellermann.
Jacques Mérey lui expliqua tout comme eût pu le faire le stratégiste le plus consommé. Il lui raconta tout ce qui était arrivé, lui fit toucher du doigt les ressources infinies du génie de Dumouriez; il lui dit quelle gloire ce serait pour lui de participer au salut de la France, et il lui dit tout cela en allemand, dans cette langue rude qui a tant de puissance sur le cœur de ceux qui l'ont bégayée tout enfant.
Kellermann, convaincu, donna l'ordre de la retraite et le lendemain celui de marcher sur Gizaucourt.
Le 19 au soir, Jacques Mérey entrait au galop dans la ville de Sainte-Menehould, et entrait chez Dumouriez en criant:
– Kellermann!
Dumouriez leva les yeux au ciel et respira.
Il avait vu pendant toute la journée les Prussiens venir, par le passage de Grand-Pré, occuper les collines qui sont au-delà de Sainte-Menehould et le point culminant de la route.
Le roi de Prusse s'était logé à une mauvaise auberge appelée l'Auberge de la Lune, ce qui fit donner à son campement, ou plutôt à son bivouac, le nom de Camp de la Lune, nom que cette hauteur porte encore aujourd'hui.
Chose étrange! l'armée prussienne était plus près de Paris que l'armée française, l'armée française plus près de l'Allemagne que l'armée allemande.
Le 20 au matin, Dumouriez sortit de Sainte-Menehould pour aller prendre sa position de bataille, et fut tout étonné de voir les hauteurs de Gizaucourt dégarnies et celles de Valmy occupées.
Y avait-il erreur, ou Kellermann, forcé d'obéir, avait-il voulu au moins prendre une position de son choix?
Par malheur, sa position était mauvaise pour la retraite. Il est vrai qu'elle était bonne pour le combat. Seulement, il fallait vaincre.
Battu, Kellermann était obligé de faire passer son armée par un seul pont; à droite ou à gauche, des marais à enfoncer jusqu'au cou si l'on essayait de se replier.
Mais, pour le combat, nous le répétons, la position était belle et hardie.
Le matin, de la fenêtre de l'Auberge de la Lune, le roi de Prusse regarda avec sa lunette la position des deux généraux.
Puis, après avoir bien regardé, il passa la lunette à Brunswick.
Brunswick examina à son tour.
– Qu'en pensez-vous? demanda le roi de Prusse.
– Ma foi! sire, dit Brunswick en secouant la tête, je pense que nous avons devant nous des gens qui veulent vaincre ou mourir.
– Mais, en effet, dit le roi en indiquant Valmy, il me semble que ce n'est pas là, comme nous l'avait dit M. de Calonne, une armée de vagabonds, de tailleurs et de savetiers.
– Décidément, dit Brunswick en rendant au roi sa lunette, je commence à croire que la Révolution française est une chose sérieuse.
En ce moment, un brouillard commença de flotter dans l'air et de se répandre dans la plaine, cachant l'une à l'autre chacune des trois armées.
Mais l'instant d'éclaircie avait suffi à Dumouriez pour juger la position de Kellermann.
Si Clerfayt et ses Autrichiens s'emparaient du mont Yron, placé derrière Valmy, ils canonnaient de là Kellermann, qui, ayant les Prussiens en tête et les Autrichiens en queue, ne pouvait recevoir de lui aucun secours. Il envoya donc le général Steingel avec 4 000 hommes pour occuper le mont Yron, qui n'était occupé que par quelques centaines d'hommes qui ne pouvaient résister.
Puis il ordonna à Beurnonville d'appuyer Steingel avec seize bataillons.
Enfin, il dépêcha Charot avec neuf bataillons et huit escadrons pour occuper Gizaucourt.
Mais Charot s'égara dans le brouillard et alla se heurter à Kellermann, auquel il demanda ses ordres, et qui, déjà embarrassé de ses vingt mille hommes sur son promontoire de Valmy, le renvoya à Dumouriez.
Dumouriez le renvoya à Gizaucourt; mais Brunswick, de son côté, avait reconnu la faute que l'on avait commise en n'occupant pas tout d'abord ce village, qui offrait une position aussi avantageuse que le mont de la Lune, et l'avait fait occuper.
Vers onze heures, le brouillard se leva. Dumouriez, avec son état-major si leste et si élégant, traversa la plaine de Dammartin-la-Planchette à Valmy, alla serrer la main de Kellermann, honneur qu'il rendait à son doyen d'âge, puis, sous prétexte de communiquer avec lui, il lui laissa, avec le titre de son officier d'ordonnance, le jeune duc de Chartres.
Puis, tout bas à celui-ci:
– C'est ici, dit-il, que sera le danger; c'est ici que vous devez être. Arrangez-vous de manière à être remarqué.
Le jeune prince sourit, serra la main de Dumouriez.
Il n'avait pas besoin de cette recommandation.
Quelque temps avant que le brouillard eût disparu, les Prussiens, qui avaient une batterie de soixante pièces de canon braquées sur Valmy, sachant que les Français ne pouvaient bouger de là, commencèrent le feu.
Tout à coup, nos jeunes soldats entendirent éclater un tonnerre, et en même temps un ouragan de fer s'abattit sur eux.
Ils commençaient leur éducation militaire par la chose la plus difficile: recevoir sans bouger le feu de l'ennemi.
Nos artilleurs répondaient, c'est vrai; mais leurs boulets à eux portaient-ils? Au reste, c'est ce qu'ils verraient bientôt, le brouillard s'enlevait doucement et se dissipait peu à peu.
Quand le brouillard eut disparu tout à fait, les Prussiens virent l'armée française à son poste, pas un homme n'avait bougé.
En ce moment où la lumière du soleil reparut comme pour voir cette grande lutte de laquelle dépendait le destin de la France, les obus des Prussiens, mieux dirigés, tombèrent sur deux caissons qui éclatèrent; il en résulta un peu de trouble. Kellermann mit son cheval au galop pour juger lui-même de l'importance de l'accident. Un boulet atteignit le cheval à la poitrine, à 25 centimètres du genou du général: l'homme et l'animal roulèrent dans la poussière. Un instant on les crut tués tous deux; mais Kellermann se releva avec une ardeur toute juvénile, monta sur un cheval qu'on lui amenait, refusant celui du duc de Chartres qui avait mis pied à terre et qui lui offrait le sien. Mais, lorsqu'il arriva sur le lieu de la catastrophe, le calme était déjà rétabli.
Brunswick, voyant que, contre toute attente, cette prétendue armée de vagabonds, de tailleurs et de savetiers recevait la mitraille avec le calme de vieux soldats, pensa qu'il fallait en finir et ordonna de charger. Entre onze heures et midi, il forma trois colonnes qui reçurent l'ordre d'enlever le plateau de Valmy.
Kellermann voit les colonnes se former, donne le même ordre, mais seulement ajoute:
– Ne pas tirer; attendre les Prussiens à la baïonnette.
Du camp de la Lune à Valmy, il y a à peu près deux kilomètres; le terrain, pendant un quart de kilomètre, descend par une pente douce; puis, pendant trois quarts de kilomètre à peu près, on coupe en travers une petite vallée, on arrive à un ressaut de terrain, puis, au bout de deux cents pas, se présente la montée assez abrupte de Valmy.
Il y eut un moment de silence pendant lequel on n'entendit que le tambour prussien battant la charge; les trompettes de la cavalerie qui accompagnaient les colonnes pour les soutenir se taisaient. Le roi de Prusse et Brunswick, appuyés au mur de l'auberge, leur lunette à la main, ne perdaient pas un détail.
Pendant ce moment de silence, les trois colonnes prussiennes étaient descendues et commençaient de franchir l'espace intermédiaire.
Brunswick et le roi de Prusse ne perdaient pas de vue le plateau de Valmy; ils virent les vingt mille hommes de Kellermann, les six mille hommes de Steingel et les trente mille hommes de Dumouriez mettre leurs chapeaux au bout de leurs fusils et faire retentir la vallée d'un seul cri, du cri tonnant de «Vive la nation!»
Puis le canon commença de gronder. Seize grosses pièces du côté de Kellermann, trente pièces du côté de Dumouriez; Kellermann serrant les Prussiens en tête, Dumouriez les brisant en flanc.
Et, dans chaque intervalle des détonations de l'artillerie, les chapeaux toujours agités au bout des baïonnettes, et l'éternel cri de «Vive la nation!»
Brunswick repoussa avec colère les canons de sa lunette les uns dans les autres.
– Eh bien? demanda le roi de Prusse.
– Il n'y a rien à faire contre de pareils hommes, dit Brunswick; ce sont des fanatiques.
Les Prussiens montaient toujours, fermes et sombres; chaque volée de Kellermann plongeait en profondeur et traçait de longs sillons dans les rangs; chaque volée de Dumouriez coupait les lignes par des vides immenses; les lignes flottaient un instant, puis se remplissaient de nouveau, et le mouvement de progression continuait.
Mais, arrivé au ressaut de terrain que nous avons indiqué, c'est-à-dire à un tiers de portée de canon de Valmy, il sembla qu'une barrière de fer et de feu, que personne ne peut franchir, venait de s'élever; les vieux soldats de Frédéric s'y entassaient par monceaux; mais, comme aux flots, Dieu criait:
– Vous n'irez pas plus loin!
Et ils n'allèrent pas plus loin; ils n'eurent pas l'honneur d'aborder nos jeunes soldats. Brunswick frémissant ordonna d'arrêter un massacre inutile: à quatre heures, il fit sonner la retraite. La bataille était gagnée.
L'ennemi venait de faire son premier pas en arrière; la France était sauvée.
Le jeune duc de Chartres n'avait rien fait et n'avait rien pu faire de remarquable. Il était resté bravement au milieu du feu. C'est tout ce que lui demandait Dumouriez, et cela suffisait à ce que son nom fût dans le bulletin de la bataille.
…
Que l'on ne s'étonne pas que celui qui écrit ces lignes s'étende avec une si profonde vénération sur tous les détails de notre grande, de notre sainte, de notre immortelle Révolution; ayant à choisir entre la vieille France, à laquelle appartenaient ses aïeux, et la France nouvelle, à laquelle appartenait son père, il a opté pour la France nouvelle; et, comme toutes les religions raisonnées, la sienne est pleine de confiance et de foi.
J'ai visité cette longue ligne qui s'étend du camp de la Lune à ce ressaut que ne purent franchir les Prussiens. J'ai gravi la colline de Valmy, véritable Scala santa de la Révolution, que tout patriote devrait monter à genoux. J'ai baisé cette terre sur laquelle, pendant une de ces journées qui décident des destins du monde, battirent tant de vaillants cœurs et où le vieux Kellermann, l'un des deux sauveurs de la patrie, voulut que le sien fût enterré.
Puis je me relevai en disant avec fierté:
– Là aussi était mon père, venu du camp de Maulde comme simple brigadier, avec Beurnonville.
Un an après, il était général de brigade.
Un an après, il était général en chef.
XXVIII
Les hommes de la Convention
Ce fut le lendemain de la grande journée que nous venons de raconter, que la salle de spectacle des Tuileries s'ouvrit pour recevoir les membres de la Convention.
Nous connaissons tous ce petit théâtre de cour, destiné à contenir cinq cents personnes à peine et qui allait recevoir sept cent quarante-cinq conventionnels.
En général, plus l'arène est petite, plus le combat est acharné.
Le rapprochement, qui rend l'amitié plus solide, rend la haine plus grande.
Quand deux ennemis se touchent, ils ne se menacent plus, ils se frappent.
Que devait être la Convention?
Un concile politique où la France, écrivant son nouveau dogme, allait assurer son unité.
Par malheur, avant d'être, elle était déjà divisée.
Et cependant où était le centre de l'unité vitale? où était le cœur de la France dans la Convention?
Forte comme elle l'était, la France pouvait lutter contre le monde.
Mais pouvait-elle lutter contre elle-même?
Là était la question.
Triompherait-elle avec le schisme de la Montagne et de la Gironde dans son sein?
Triompherait-elle avec la guerre civile dans la Vendée?
Elle ne craignait pas la royauté. Le jour où le roi avait menti, il avait donné sa démission.
UN ROI NE MENT PAS.
Elle craignait sa guerre civile de l'Ouest, ses prêtres armant le peuple contre le peuple.
Ce qu'elle craignait, c'est ce qui arriva.
Au fur et à mesure qu'ils entraient, ces hommes, tous enfants du 10-Août, tous inspirés de l'esprit qui avait présidé à cette grande journée, ces hommes se désignaient par les noms de royalistes et d'hommes de Septembre.
Ces hommes qui venaient combattre pour la France et qui, au lieu de combattre pour la France, avaient combattu l'un contre l'autre, ces hommes s'ignoraient complètement.
Ils se frappèrent sans se connaître.
Les girondins n'étaient pas royalistes, c'étaient eux que l'on désignait sous ce nom.
Ce fut un discours de Vergniaud qui fit le 10-Août. «Nous avons vu, avait-il dit en désignant du doigt les Tuileries, nous avons vu vingt fois la terreur sortir de ce château. Qu'elle y rentre une fois, et que tout soit dit!»
Les montagnards n'avaient rien à faire avec Septembre. On savait que Danton lui-même, qui en avait pris la responsabilité pour que le sang versé ne tachât point la France, on savait que Danton n'y était pour rien.
On savait que c'était Marat et Robespierre qui avaient tout fait, avec un agent secondaire, Panis.
Les deux accusations était donc fausses.
Presque tous les girondins, qu'on accusait de royalisme, votèrent la mort du roi.
Presque tous les montagnards désapprouvèrent Septembre.
Seulement, ils ne voulurent pas que Septembre fût puni. Au moment où la France avait besoin de tous ses enfants, ce n'était pas le moment, parmi les plus ardents patriotes, de se juger, de se punir et de s'épurer.
On a calculé du reste que, sur sept cent quarante-cinq membres qui s'assirent sur les bancs de la Convention le jour de son ouverture, cinq cents n'étaient ni girondins ni montagnards; tous ces nouveaux arrivants de province, marchands, avocats, bourgeois, professeurs, journalistes, venaient en amis du bien, de l'humanité, de la France. Ils voulaient tous la prospérité de la nation; mais ils n'étaient, nous le répétons, ni girondins ni montagnards.
C'était à la Montagne à les attirer à elle par la terreur.
C'était à la Gironde à les rallier à son parti par l'éloquence.
Cependant on put voir, à la nomination du président et des secrétaires, combien l'horreur de Septembre dominait l'envie qu'inspirait la Gironde.
Pétion fut nommé président.
Les six secrétaires furent: Camus et Rabaud-Saint-Étienne, deux constituants;
Les quatre autres, Brissot, Vergniaud, Lassource, des girondins; Condorcet, un ami de la Gironde, qui devait mourir avec elle, et par sa mort comme par sa vie – juste qu'il était – la justifier dans l'histoire.
Pas un homme de la Montagne, tout est pris à droite. La majorité est donc à la droite.
Aussi, dès son entrée, la masse, cette éternelle victime de l'erreur, était-elle dans l'erreur. Ses instincts vulgaires, ses craintes personnelles, la vue basse de la bourgeoisie, ne lui permettaient pas de regarder en face l'énergique légion de la Montagne, dans laquelle était le salut national.
Il est vrai qu'au sommet de cette âpre et dure Montagne siégeait la pâle et froide figure de Robespierre, peau de parchemin collée sur un crâne d'inquisiteur, sphinx étrange posant éternellement des énigmes dont il ne disait jamais le mot; Danton, masque terrible du damné, avec sa bouche torse, son visage labouré par la petite vérole, sa voix de dictateur, son attitude de tyran; et Marat, ce roi des batraciens, qui semblait, comme Philippe-Égalité, avoir renoncé à la royauté – des reptiles – pour s'appeler Marat tout court; Marat, par son père Sarde; Marat, par sa mère Suisse, n'ouvrant la bouche que pour demander des têtes, n'ouvrant ses lèvres jaunes que pour demander du sang.
Danton le méprisait, Robespierre le haïssait, et tous deux cependant le toléraient.
Marat faisait peur physiquement et moralement.
En opposition à cette masse de républicains farouches, formée à cette heure encore du double club des Jacobins et des Cordeliers, on voyait les vingt-neuf girondins autour desquels se groupait le parti de la Gironde, tous hommes de bien sur lesquels la calomnie même n'avait pas de prise, ou n'avait à reprocher que des fautes communes à beaucoup dans cette époque de mœurs légères, plusieurs jeunes et beaux, presque tous pleins de talent, Brissot, Roland, Condorcet, Vergniaud, Louvet, Gensonné, Duperret, Lassource, Fonfrède, Ducos, Garat, Fauchet, Pétion, Barbaroux, Guadet, Buzot, Salles, Sillery.
Évidemment la sympathie était là.
Chacun prit sa place bruyamment.
Puis on fit l'appel nominal.
Quand on en vint au nom de Jacques Mérey, Danton répondit pour lui:
– En mission près de Dumouriez.
L'appel nominal fini, le président et les secrétaires nommés, la Convention constituée enfin, le premier qui parla, au milieu d'un silence solennel, fut le cul-de-jatte Couthon, l'apôtre de Robespierre.
Il se souleva, et de sa place dit quelques paroles qui avaient une portée immense.
– Je propose d'ouvrir la nouvelle session en jurant haine à la royauté, haine à la dictature, haine à toute puissance individuelle.
Quoique venant de la Montagne, la proposition fut accueillie par un bravo unanime, auquel succéda un formidable cri de: «Vive la nation!»
On eût dit l'écho de celui qui avait été poussé la veille sur le champ de bataille de Valmy.
Mais Danton se leva.
On fit silence.
– Avant, dit-il, d'exprimer mon opinion sur le premier acte que doit faire l'Assemblée nationale, qu'il me soit permis de résigner dans son sein les fonctions qui m'avaient été déléguées par l'Assemblée législative. Je les ai reçues au bruit du canon; hier nous avons reçu la nouvelle que la jonction des armées était faite; aujourd'hui la jonction des représentants est opérée. Je ne suis plus que mandataire du peuple, et c'est en cette qualité que je vais parler. Il ne peut exister de constitution que celle qui sera textuellement, nominativement, acceptée par la majorité des assemblées primaires. Ces vains fantômes de dictature dont on voudrait effrayer le public, dissipons-les; disons qu'il n'y a de constitution que celle qui est acceptée du peuple. Jusqu'ici, on l'a agité, il fallait l'éveiller contre les tyrans. Maintenant que les lois sont aussi terribles contre ceux qui les violeraient que le peuple l'a été en foudroyant la tyrannie, qu'elles punissent tous les coupables, abjurons toute exagération, déclarons que toute propriété territoriale et industrielle sera éternellement maintenue.
Cette déclaration répondait si merveilleusement aux paroles du roi de Prusse à Verdun et aux craintes de la France, qu'elle fut couverte d'applaudissements, quoiqu'elle vînt de celui que l'on regardait comme le chef des septembriseurs.
Et, en effet, la crainte générale n'était pas le massacre. Chacun savait bien que, dans ce cas, organiser la défense serait chose facile. Non, la crainte générale était qu'on ne reprît les biens des émigrés, et que l'on ne déclarât nuls les ventes et les achats.
Le peuple français avait admirablement compris le mot révolution. Il l'avait décomposé, il savait qu'il voulait dire: Propriété facile, à bon marché, à la portée de tous, un toit pour le pauvre, un foyer pour le vieillard, un nid pour la famille.
Au milieu des bravos suscités par cette promesse de l'Adamastor de la Chambre, deux voix protestèrent.
– J'eusse mieux aimé, dit Cambon, que Danton se bornât à sa première proposition, c'est-à-dire qu'il établît seulement le droit que le peuple a de voter sa constitution. Mais Danton est en opposition avec lui-même. Quand la patrie est en danger, a-t-il dit, tout appartient à la patrie. Qu'importe alors que la propriété subsiste si la personne périt!
Du groupe des girondins une voix, celle de Lassource, s'éleva:
– Danton, s'écria-t-il, en demandant que l'on consacre la propriété, la compromet. Y toucher, même pour l'affermir, c'est l'ébranler. La propriété est antérieure à la loi!
La Convention alla aux voix et les deux propositions de Danton furent résumées ainsi:
1º Il ne peut y avoir de constitution que lorsqu'elle est acceptée par le peuple;
2º La sûreté des personnes et des propriétés est sous la sauvegarde de la nation.
Ce fut alors que Manuel se leva et dit, en étendant la main avec ce geste qui commande l'attention et le silence:
– Citoyens, ce n'est pas tout! Vous avez consacré la souveraineté du vrai souverain, le peuple; il faut le débarrasser de son faux souverain, le roi.
À ces mots, une voix de droite s'écria:
– Le peuple seul doit juger.
Mais, à ces mots, Grégoire, l'évêque de Blois, se leva.
Grégoire avait eu une grande autorité dans la première assemblée où il avait siégé. Il s'y était trouvé le chef du clergé populaire. La fusion des ordres consommée, il avait été élu secrétaire à la presque unanimité, avec Mounier, Sieyès, Lally-Tollendal, Clermont-Tonnerre et Chapelier. Dans la Déclaration des droits de l'Homme, il fit inscrire celle de ses devoirs, et le nom de Dieu; le premier il avait adhéré à la constitution civile du clergé.
Les membres de la Constituante ne pouvaient être réélus à la Législative. Grégoire alors s'était établi dans son diocèse et avait publié ses lettres pastorales; enfin, à la presque unanimité encore, il avait été nommé à la Convention.
On attendait avec impatience les paroles qui allaient sortir de sa bouche dans cette grave question.
– Inutile d'attendre, dit-il; certes, personne ne proposera jamais de conserver en France la race funeste des rois. Nous savons trop bien que toutes les dynasties n'ont jamais été que des races dévorantes vivant de chair humaine. Mais il faut pleinement rassurer les amis de la liberté; il faut détruire ce talisman dont la force magique serait propre à stupéfier encore bien des hommes. Je demande donc que, par une loi solennelle, vous consacriez l'abolition de la royauté.
Au milieu des bravos et des cris frénétiques de toute l'Assemblée, d'accord en principe sur ce point, le montagnard Bascle se leva:
– Je demande, dit-il, que l'on ne précipite rien et qu'on attende le vœu du peuple.
Mais Grégoire, qui s'était rassis, se redressa à ces paroles, et, tirant du plus profond de son cœur cette terrible phrase, il la jeta au visage de son adversaire:
– Le roi est dans l'ordre moral ce que le monstre est dans l'ordre physique.
Et, à l'instant même, d'un élan unanime, toute la salle s'écria:
– La royauté est abolie.
En ce moment, un homme dont la pâleur dénonçait la fatigue, les habits un long voyage, le costume un représentant du peuple aux armées, entra brusquement dans la salle, tenant entre ses bras trois drapeaux, deux autrichiens et un prussien.
– Citoyens, s'écria-t-il l'œil rayonnant d'enthousiasme, l'ennemi est battu, la France est sauvée. Dumouriez et Kellermann vainqueurs vous envoient ces drapeaux pris sur les vaincus. J'arrive à temps pour entendre la grande voix de la Convention proclamer l'abolition de la royauté. Place parmi vous, citoyens, car je suis des vôtres!
Et, sans répondre aux signes que lui faisait Danton pour venir prendre place près de lui sur la Montagne, il alla s'asseoir, agitant son chapeau aux plumes tricolores encore tout imprégnées de la fumée de la bataille:
– Vive la République! cria-t-il, et qu'elle date sa naissance du jour qui l'a consolidée: 21 septembre 1792.
........
Et en même temps on entendit le canon tonner. Il croyait ne tonner que pour la victoire de Valmy, il tonnait en même temps pour l'abolition de la royauté et la proclamation de la république.