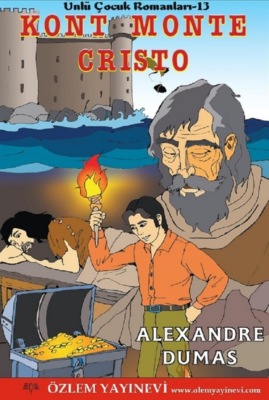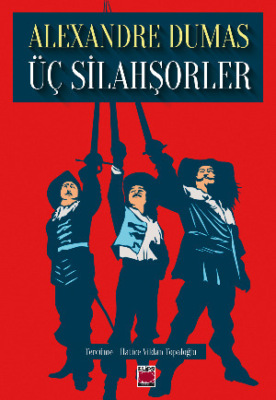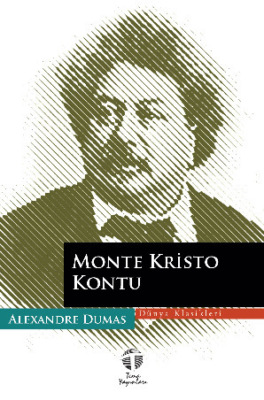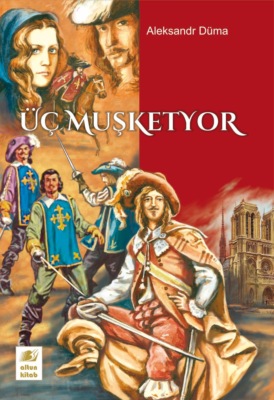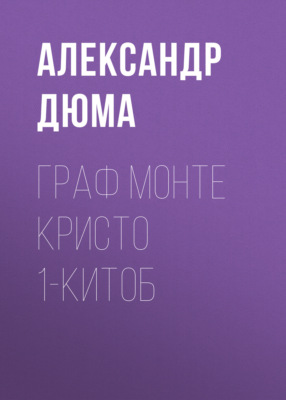Kitabı oku: «Création et rédemption, première partie: Le docteur mystérieux», sayfa 24
XLII
La communion de la terre
Liége n'avait pas suivi l'exemple de Bruxelles; elle s'était donnée de grand cœur à la Révolution. Sur cent mille votants, quarante seulement avaient refusé de se donner à la France, et dans tout le pays Liégeois qui réunissait vingt mille votants, il n'y eut que quatre-vingt-douze voix contre la réunion.
Il y a trois ou quatre ans, habitant momentanément Liége, j'eus le malheur d'écrire: Liége est une petite France égarée en Belgique. Cette phrase, bien historique cependant, souleva un tonnerre de malédictions contre moi.
Hélas! le malheur de Liége fut d'être trop française! Après avoir cru à la parole de la monarchie sous Louis XI, elle crut à la parole de la république sous la Convention; deux fois elle fut perdue par sa trop grande sympathie pour nous. Les Liégeois avaient à me reprocher l'ingratitude de la France. Ils nièrent le dévouement de Liége.
Par malheur, Liège ne savait pas quel était cet homme à face double qu'on appelait Dumouriez. Elle ignorait qu'il est difficile de tenir droite et haute l'épée loyale du soldat quand on a tenu la plume ambiguë des diplomaties secrètes de Louis XV; elle ne vit en lui que le défenseur de l'Argonne, que le vainqueur de Jemmapes, que l'homme qui avait eu besoin de se faire une position pour la vendre. Elle ne savait pas que cet homme ne pouvait s'empêcher d'écrire, de se mettre en avant, de se proposer; qu'après Valmy, il avait écrit au roi de Prusse, après Jemmapes à Metternich; qu'avant d'entrer en Hollande, il écrivait à Londres à M. de Talleyrand.
Il attendait toutes ces réponses qui ne venaient pas, lorsque Danton, qu'il n'attendait point, arriva.
Il le trouva, entre Aix-la-Chapelle et Liége, derrière une petite rivière qui ne pouvait servir de défense, la Roër.
Ce dut être une curieuse entrevue que celle de ces deux hommes.
Danton – chose incontestable – , avec son matérialisme en toute chose, avait un immense amour de la patrie.
Dumouriez, tout aussi matérialiste, mais plus hypocrite, n'avait, lui, qu'une volonté bien arrêtée de tout sacrifier, même la France, à son ambition.
Assez étonné en voyant Danton, il se remit aussitôt.
– Ah! dit-il, c'est vous?
– Oui, dit Danton.
– Et vous venez pour moi?
– Oui.
– De votre part ou de celle de la Convention?
– De toutes les deux. C'est moi qui ai proposé de vous envoyer quelqu'un, et c'est moi qui en même temps ai proposé d'y venir.
– Et que venez-vous faire?
– Voir si vous trahissez, comme on le dit.
Dumouriez haussa les épaules:
– La Convention voit des traîtres partout.
– Elle a tort, dit Danton, il n'y a pas tant de traîtres qu'elle le croit, et puis n'est pas traître qui veut.
– Qu'entendez-vous par là?
– Que vous êtes trop cher à acheter, Dumouriez; voilà pourquoi vous n'êtes pas encore vendu.
– Danton! dit Dumouriez en se levant.
– Ne nous fâchons pas, dit Danton, et laissez-moi, si je le puis, faire de vous l'homme que j'ai cru que vous étiez, ou l'homme que vous pouvez être.
– Avant tout, là où sera Danton, restera-t-il une place qui puisse convenir à Dumouriez?
– Si un autre que Danton pouvait tenir la place de Danton, soyez certain que je la lui céderais bien volontiers. Mais il n'y a que moi qui, d'une main, puisse souffleter ce misérable qu'on appelle Marat, et de l'autre arracher, quand le moment sera venu, le masque de cet hypocrite qu'on appelle Robespierre. Mon avenir, c'est la lutte contre la calomnie, contre la haine, contre la défiance, contre la sottise. Comme je l'ai déjà fait plus d'une fois, et comme je viens de le faire à la dernière séance de la Convention, je serai obligé de me ranger avec des gens que je méprise ou que je hais, contre des gens que j'estime et que j'aime. Crois-tu que je n'estime pas plus Condorcet que Robespierre et que je n'aime pas mieux Vergniaud que Saint-Just? Eh bien! si la Gironde continue à faire fausse route, je serai forcé de briser la Gironde, et cependant la Gironde n'est ni fausse ni traître; elle est sottement aveugle. Crois-tu que ce ne sera pas un triste jour pour moi que celui où je demanderai à la tribune la mort ou l'exil d'hommes comme Roland, Brissot, Guadet, Barbaroux, Valazé, Pétion?.. Mais, que veux-tu, Dumouriez, tous ces gens-là ne sont que des républicains.
– Et que te faut-il donc?
– Il me faut des révolutionnaires.
Dumouriez secoua la tête.
– Alors, dit Dumouriez, je ne suis pas l'homme qu'il te faut, car je ne suis ni révolutionnaire ni républicain.
Danton haussa les épaules.
– Que m'importe! dit Danton, tu es ambitieux.
– Et, à ton avis, comment suis-je ambitieux?
– Par malheur, ce n'est ni comme Thémistocle ni comme Washington; tu es ambitieux comme Monck. Belle renommée dans l'avenir que celle d'avoir remis sur le trône un Charles II!
– Les Thémistocle ne sont pas de nos jours.
– Aussi ai-je dit: ou un Washington.
– Accepterais-tu donc un Washington?
– Oui, quand la révolution du monde sera faite.
– Celle de la France ne te suffit pas?
– Les véritables tempêtes ne sont pas celles qui soulèvent un coin de l'Océan; ce sont celles qui l'agitent d'un pôle à l'autre, et voilà où tu as manqué à ta mission, Dumouriez. Au lieu de faire la tempête en Belgique, et le vent de nos grandes journées ne demandait pas mieux que de souffler de l'Atlantique à la mer du Nord, tu y as fait le calme; au lieu de réunir la Belgique à la France, tu l'as laissée maîtresse d'elle-même.
– Et que devais-je faire?
– Tu devais mettre une main forte sur la Belgique et t'en servir pour délivrer l'Allemagne; la Belgique devait être pour toi un instrument de guerre et pas autre chose. Tu devais pousser en avant la vaillante population du pays wallon, qui ne demandait pas mieux, et en faire l'épée de la France contre l'Autriche. Toi, pendant ce temps, tu aurais organisé le Brabant et les Flandres; tu aurais décrété la révolution partout; tu aurais saisi les biens des prêtres, des émigrés, des créatures de l'Autriche; tu en aurais fait l'hypothèque et la garantie du million d'assignats que nous venons d'émettre. Tu devais enfin ne plus rien demander à la France, ni pain, ni solde, ni vêtements, ni fourrage. La Belgique devait fournir tout cela.
– Et de quel droit aurais-je disposé du bien des Belges?
– Est-ce sérieusement que tu demandes cela? Du droit du sang que l'on venait de verser pour eux à Jemmapes; du droit de l'Escaut qui va nous coûter une guerre acharnée, interminable, ruineuse contre l'Angleterre. Quand nous entreprenons pour la Belgique et pour le monde une lutte qui dévorera peut-être un million de Français; quand la France répandra du sang à faire déborder le Rhin et la Meuse, la Belgique hésiterait à donner en échange dix, vingt, trente, quarante millions! Impossible! Quand la France s'est levée, en 89, elle a dit: Tout privilège du petit nombre est usurpation. J'annule et casse par un acte de ma volonté tout ce qui fut fait sous le despotisme. Eh bien! du moment où la France a mis ce principe en avant, elle ne doit pas s'en départir. Partout où elle entre, elle doit se déclarer franchement pouvoir révolutionnaire, se déclarer franchement, sonner le tocsin. Si elle ne le fait pas, si elle donne des mots et pas d'actes, les peuples, laissés à eux-mêmes, n'auront pas la force de briser leurs fers. Nos généraux doivent donner sûreté aux personnes, aux propriétés, mais celles de l'État, celles des princes, celles de leurs fauteurs, de leurs satellites, celles des communautés laïques et ecclésiastiques, c'est le gage des frais de la guerre. Rassurez les peuples envahis, donnez-leur une déclaration solennelle que jamais vous ne traiterez avec leurs tyrans. S'il s'en trouvait d'assez lâches pour traiter eux-mêmes avec la tyrannie, la France leur dira: «Dès lors, vous êtes mes ennemis,» et elle les traitera comme tels. Oh! quand on creuse, en fait de révolution, il faut creuser profond, sans quoi l'on creuse sa propre fosse.
– Mais alors, dit Dumouriez, qui avait écouté avec la plus profonde attention, vous voulez donc qu'ils deviennent comme nous misérables et pauvres?
– Précisément, dit Danton; il faut qu'ils deviennent pauvres comme nous, misérables comme nous; ils accourront à nous, nous les recevrons.
– Et après?
– Nous en ferons autant en Hollande.
– Et après?
– Non, non, plus loin, toujours plus loin, jusqu'à ce que nous ayons fait la terre à notre image.
Dumouriez se leva.
– Vous êtes fou, dit-il.
Et il alla s'appuyer le front à une vitre; la tête lui flambait.
– C'est vous qui êtes fou, dit tranquillement Danton, puisque c'est vous qui êtes forcé de rafraîchir votre tête.
Puis, après un instant de silence:
– Vous avez donc oublié ce que vous avez dit à Cambon, quand nous vous avons fait nommer général de l'armée que nous envoyions en Belgique, reprit Danton.
– J'ai dit bien des choses, répliqua Dumouriez du ton d'un homme qui ne se croit pas obligé de se souvenir de tout ce qu'il a dit.
– Vous avez dit: «Envoyez-moi là-bas et je me charge de faire passer vos assignats.»
– Faites qu'ils ne perdent pas, et alors je les ferai passer, dit Dumouriez.
– Le beau mérite, fit Danton; mais c'est à vous autres généraux de la Révolution de nous conquérir assez de terre pour que nos assignats ne perdent pas; la Révolution française n'est pas seulement une révolution d'idées, c'est une révolution d'intérêts, c'est l'émiettement de la propriété dont l'assignat est le signe. Vous n'avez qu'un assignat de vingt francs, mon brave homme, soit, nous vous donnerons pour vingt francs de terre; quand vous aurez pour vingt francs de terre vous en voudrez quarante, rien n'altère comme la propriété. Il y a chez nos paysans et même chez ceux de la Vendée, il y a chez les paysans belges, il y a chez les paysans du monde entier, qui ont été pauvres, qui ont connu la glèbe, la corvée, le servage, qui ont fécondé enfin la terre pour d'autres, il y a une religion bien autrement enracinée que la religion catholique, apostolique et romaine, il y a la religion naturelle, celle de la terre; appelez tous les indigènes à cette communion, et que l'assignat en soit l'hostie! Et alors vous pourrez dire à tous les rois du monde: «Oh! rois du monde, nous sommes plus riches que vous tous.»
– Et c'est alors, dit en riant Dumouriez, que vous me permettrez d'être Washington.
– Alors soyez ce que vous voudrez, car la France sera assez forte pour ne plus craindre même César.
– Mais jusque-là…
– Jusque-là, si vous songez à trahir, à nous donner un roi ou à vous faire dictateur, guerre à mort!
– Oh! quant à moi, fit Dumouriez, ma tête tient bien sur mes épaules; elle y est soutenue par vingt-cinq mille soldats.
– Et la mienne, dit Danton, par vingt-cinq millions de Français.
Et les deux hommes se quittèrent sur ces paroles, envisageant déjà chacun de son côté le moment où l'on en viendrait aux mains.
XLIII
Liége
Deux heures après, Danton était à Liége, examinant par lui-même l'état des esprits.
L'annonce de l'arrivée du célèbre tribun fut reçue diversement par les Liégeois, mais cependant il est juste de dire que le sentiment le plus général fut celui de la crainte.
Depuis que Danton, voyant Marat, Robespierre et Panis assez lâches pour renier le 2 septembre, qui était leur œuvre, avait pris la responsabilité de ces terribles journées, il apparaissait aux populations ignorantes de son dévouement comme le fantôme de la terreur. En voyant ce visage labouré par la petite vérole, bouleversé par les passions, en écoutant cette voix tonnante qui avait quelque chose du rauquement du lion, le premier sentiment qu'on éprouvait était l'effroi. Ceux-là seuls qui avaient vu ce visage terrible s'adoucir devant la douleur, cet œil orageux se mouiller des larmes de la pitié, qui avaient senti pénétrer jusqu'à leur cœur cette voix dont les cordes douces étaient accompagnées d'un tendre frémissement, savaient tout ce qu'il y avait dans cette âme d'amour pour la France et de fraternité pour le genre humain.
À peine arrivé, Danton se rendit à la commune, où il convoqua au son de la cloche, comme au jour des grandes assemblées nationales, les notables et le peuple.
Là il monta à la tribune, là il exposa le plan de la France; il mit son cœur à nu, le montra plein de l'amour des peuples opprimés. Il raconta Valmy, il raconta Jemmapes, il expliqua la nécessité de la mort du roi. Il déplora que la France eût fait le procès d'un seul individu et non pas celui de la race tout entière. Il les montra assignés tour à tour à la barre de la Convention, faisant défaut, mais accusés, mais jugés tour à tour, Frédéric-Guillaume avec ses maîtresses, Gustave de Suède avec ses mignons, Catherine de Russie avec ses amants; Léopold, épuisé à quarante ans, et composant lui-même les aphrodisiaques à l'aide desquels il essaye de redevenir homme; Ferdinand, nouveau Claude aux mains d'une autre Messaline; enfin Charles IV d'Espagne pansant ses chevaux, tandis que son favori Manuel Godoy et sa femme Marie-Louise conduisaient son royaume à la guerre civile et à la famine. Le procès, non pas du roi, mais de la royauté, fait alors, la révolution commençait la conquête du monde.
Puis, tout en exaltant le dévouement de Liége, tout en montrant ce qu'elle venait de mettre au jour de courage et de patriotisme, il sépara la Belgique en vrais Belges et en faux Belges.
Il montra que les vrais Belges étaient ceux-là qui voulaient la vie de la Belgique, c'est-à-dire qu'elle respirât par l'Escaut et par Ostende cet air vivace de la mer que l'on appelle le commerce.
Il montra que les vrais Belges étaient ceux-là qui voulaient la tirer des mains improductives et égoïstes des moines pour la remettre aux mains de ses grands artistes, les Rubens, les van Dyck, les Paul Porter, les Ruysdaël et les Hobbema.
Il montra enfin que les vrais Belges étaient ceux qui reniaient la vieille tyrannie des Pays-Bas, la suprématie des villes sur les campagnes, qui voulaient la liberté et l'égalité pour les paysans comme pour les notables et qui luttaient franchement contre les faux Belges, qui mettaient la patrie dans les confréries et les corporations et qui voulaient maintenir le pays étouffé et captif.
Tout cela, c'est ce que les Liégeois avaient pensé tous, mais ce que personne ne leur avait formulé encore; puis on sait combien dans ses moments de grandeur Danton se transfigurait. Homme étrange qui avait l'enthousiasme et qui n'avait pas la foi!
Tout à coup une vague inquiétude se répand dans l'auditoire; quelques personnes entrent et ressortent effarées, et trois ou quatre voix font entendre ces paroles terribles:
– Les Français sont en retraite sur Liége!.. Dans une heure, les Autrichiens seront ici!..
– Un cheval et vingt-cinq hommes de bonne volonté pour faire une reconnaissance! s'écria Danton.
Les vingt-cinq hommes se présentèrent; dans dix minutes ils seront à cheval à la porte de l'hôtel de ville.
Au bout de cinq minutes, on amenait à Danton un cheval tout caparaçonné.
Il saute dessus en excellent cavalier qu'il était, court à la boutique d'un armurier, achète une paire de pistolets, les charge, les met dans ses fontes, se fait donner un sabre dont la poignée aille à sa puissante main, paye en or, met son chapeau à plumes au bout de son sabre, crie: «À moi les volontaires!» les réunit et s'élance sur la route de Maestricht.
Quinze jours auparavant, Miranda, qui l'a attaquée parce que, sur la parole de Dumouriez, à la première bombe elle devait se rendre, a jeté sur Maestricht cinq mille bombes, et cela inutilement.
Avant d'arriver aux portes de Liége, Danton a déjà rencontré des fugitifs. Ils appartiennent au corps d'armée de Miaczinsky qui, après un combat meurtrier contre les Autrichiens commandés par le prince de Cobourg, combat dans lequel il a défendu une à une les maisons d'Aix-la-Chapelle, est obligé de faire retraite sur Liége.
Alors Danton change de route, et, au lieu de s'avancer vers Maestricht, il pousse sa reconnaissance du côté d'Aix-la-Chapelle.
Il interroge alors les fugitifs et apprend que, outre le prince de Cobourg et les Autrichiens qu'il a devant lui, le prince Charles pousse hardiment les impériaux au-delà de la Meuse et est à Tongres. Mais cela ne lui suffit pas, il veut voir de ses yeux; il s'avance jusqu'à Soumagne, et voit de là les têtes de colonnes autrichiennes qui débouchent d'Henry-Chapelle.
Il n'y a rien à faire qu'à protéger dans sa retraite cette noble population de Liége. Il rentre dans la ville. Il espérait y trouver Miranda, dont on lui avait fort vanté le calme et le courage; il n'y trouve que Valence, Dampierre et Miaczinsky, qui, se jugeant trop faibles pour risquer une bataille, veulent se retirer immédiatement sur Saint-Trond, où ils feront leur jonction avec Miranda et où ils attendront Dumouriez. Dès lors, il n'y a pas un instant à perdre. Au son des cloches, Danton rassemble de nouveau les Liégeois au palais communal. Là, il expose la situation à cette malheureuse population sans lui rien cacher, lui offre l'hospitalité au nom de la France; il ne l'abandonnera pas qu'elle ne soit hors de danger, mais il lui avoue qu'il y va de la mort pour elle à ne pas s'exiler.
Il était cinq heures de l'après-midi; la neige tombait à ce point que les Autrichiens ne crurent pas devoir se risquer dans les trois lieues qui leur restaient à faire pour atteindre Liége. Heureux répit donné à la ville. S'ils eussent continué leur marche, ils surprenaient les Liégeois avant qu'ils eussent eu le temps d'évacuer la ville.
C'est là que Danton déploie cette merveilleuse activité dont la nature l'a doué pour les situations extrêmes. Il va chez les riches, quête de l'argent pour les pauvres, met en réquisition tous les chevaux, toutes les voitures, toutes les charrettes, envoie commander du pain à Landen et à Louvain, fait prévenir Bruxelles de l'émigration, garnit les charrettes de paille et de foin et y entasse les femmes et les enfants, fait placer les malades dans les voitures les plus douces, forme un corps de cavalerie avec les quatre cents chevaux qu'il trouve dans la ville, un corps d'infanterie avec tout ce qu'il y a d'hommes valides, donne son cheval au bourgmestre, et se met à l'arrière-garde, à pied, le fusil sur l'épaule.
Dans la nuit du 4 mars, par un temps épouvantable plus froid qu'en hiver, par une grêle effroyable qui lui coupe le visage, la lugubre procession se met en chemin, comme ces anciennes populations chassées par les barbares et qui, sans savoir où elles s'arrêtaient, allaient en quête d'une nouvelle patrie.
Il y avait huit lieues de Liége à Landen.
Les pleurs des enfants, les gémissements des femmes, les plaintes des malades et des blessés, mêlés à la population fugitive, faisaient de cette retraite quelque chose qui brisait le cœur et surtout le cœur de Danton, si pitoyable aux Liégeois.
Puis joignez à cette douleur profonde la séparation de Paris, cet arrachement du cœur; sa femme adorée mourante dans sa triste maison du passage du Commerce, qu'il trouverait vide en rentrant.
Et cependant il n'eut pas l'idée d'abandonner un instant, mauvais pasteur, le troupeau douloureux qu'il conduisait. Son devoir était là qui le rivait à la triste émigration bien plus sûrement qu'une chaîne.
Vers huit heures, les premières voitures atteignirent Landen. Alors Danton passa de l'arrière-garde à la tête de la colonne; il fit ouvrir toutes les portes, faire du feu devant toutes les maisons et barricader avec les voitures vides la rue de Maestricht.
Des sentinelles à cheval furent placées sur la grand-route. Si l'on avait à craindre une attaque de l'ennemi, c'était du côté de Saint-Trond, que nos troupes avaient abandonné pendant la nuit.
Vers midi, les sentinelles se retirèrent; on entendait les pas d'une troupe de chevaux.
Danton plaça dans les deux premières maisons une vingtaine de chevaliers de l'arquebuse et une soixantaine d'autres derrière les charrettes; il recommanda à chacun de viser les hommes et d'épargner les chevaux dont on avait besoin pour les malades et les nouvelles charrettes que l'on pourrait se procurer à Landen.
Ces cavaliers dont on avait entendu le bruit, c'était un escadron de uhlans qui allaient à la découverte.
La neige tombait épaisse, on ne voyait pas à cinquante pas devant soi; les cavaliers autrichiens approchèrent sans défiance jusqu'à trente pas de la barricade. Tout à coup une fusillade terrible éclata, et une soixantaine d'hommes tombèrent de leurs chevaux qui, tout effarés, s'élancèrent dans toutes les directions.
Les uhlans en désordre se retirèrent pour aller se reformer à un quart de lieue, puis ils revinrent au grand galop sur la barricade; mais, en arrivant à la ligne de morts qu'ils avaient laissée, ils essuyèrent une seconde grêle de balles qui leur faucha encore une trentaine d'hommes.
Cette fois ils tournèrent bride, mais pour ne plus reparaître.
Chacun se mit alors à courir après les chevaux sans maître, tandis que de nouveaux volontaires accourus au bruit commencèrent à dépouiller les uhlans de leurs pelisses et de leurs colbacks, destinés à faire des fourrures pour les femmes et pour les enfants.
Toutes les maisons de la rue de Saint-Trond furent ouvertes pour recevoir les Liégeois fugitifs, et de grands feux furent faits dans les cheminées. Là, on eut du pain et de la bière en abondance. Danton paya en bons sur le trésorier général.
À deux heures, on put se remettre en route. Il n'y avait que six lieues de Landen à Louvain. Les chevaux, les pelisses et les colbacks des uhlans avaient apporté de grands soulagements dans la retraite.
Ils avaient été d'autant mieux reçus que nous n'avions eu ni tués ni blessés.
On arriva à Louvain vers neuf heures du soir. Toute la ville était illuminée pour faciliter les bivouacs dans la rue; les femmes et les enfants furent reçus dans les maisons, les hommes restèrent dehors.
Danton refusa les logements et les lits qu'on lui offrait, il se jeta sur une botte de paille et dormit.
Il se réveilla sombre et frissonnant entre minuit et une heure. Il avait vu sa femme en rêve. Il était convaincu qu'elle était morte à cette heure et était venue lui dire adieu.
C'était dans la nuit du 6 au 7 mars.
Le lendemain, il voulait prendre congé des pauvres fugitifs; ils n'avaient plus rien à craindre de l'ennemi. Les lignes françaises s'étaient reformées derrière Saint-Trond. Le corps d'armée de Miranda tout entier bivaquait entre Landen et Louvain.
Mais il semblait à ces pauvres gens que Danton, ce tribun si redouté, cet homme de sang, était leur palladium. Les femmes se mirent à genoux sur son chemin; elles firent joindre les mains aux petits enfants.
Il pensa à ses petits enfants et à sa femme, poussa un soupir… mais il resta.