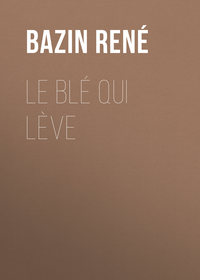Kitap dosya olarak indirilemez ancak uygulamamız üzerinden veya online olarak web sitemizden okunabilir.
Kitabı oku: «Le Blé qui lève», sayfa 16
XIV
LE REVENANT
Il avait quitté Faÿt-Manage le mardi dans l'après-midi, avec le boucher de Quiévrain. A pied, l'un près de l'autre, ils refaisaient le chemin de Faÿt à la Louvière. Gilbert se taisait; il se demandait si la joie qu'il éprouvait ne tenait pas à la compagnie des missionnaires et des ouvriers belges, au parc, aux chants, à la nouveauté des choses et à leur présence. Mais non: à mesure qu'il s'éloignait, il sentait que la paix était en lui, vivante. A la Louvière, ils prirent le chemin de fer. Le jour baissait, bien qu'il ne fût pas tard. Il faisait froid; il faisait gris. Les routes plantées d'arbres, les terres ensemencées ou labourées, bordées de maisons, les buttes des mines de charbon, les bourgs où vingt cheminées d'usines fumaient au-dessus des blés en herbe, tout cela passait, et le contentement ne passait pas. Serrés l'un contre l'autre, le col de la jaquette relevé, un petit foulard autour du cou, les deux hommes, assis sur la même banquette, regardaient le pays fuyant que l'ombre effaçait. Le boucher nommait des villages, des gens, des fermes, il était revenu à sa pensée de tous les jours. Pas Gilbert. De ses bras croisés, il serrait fortement contre lui-même son maigre vêtement et la couverture, et c'était sans doute pour se garantir du froid, mais aussi, et secrètement, pour contenir je ne sais quelle force jeune, qui voulait parler, crier, s'échapper: son âme heureuse. Et, n'ayant pas l'habitude, il s'étonnait d'une joie qui dure.
– Eh bien! dit le boucher, quand ils furent arrivés à la maison de Quiévrain, je pense que vous avez changé d'avis, et que vous restez au moins jusqu'à demain?
– Même chez vous, je ne peux pas: il faut que je retourne au pays. Je ne voulais plus le revoir, parce que j'y souffrais. A présent, savez-vous pourquoi je n'ai plus peur d'y retourner?..
– Je devine, dit le Belge tranquille.
– Vous devinez parce que vous avez toujours été comme je suis à présent. Mais moi, je m'étonne de ce que je fais. Je retourne chez nous parce que je n'ai plus le même cœur: la peine m'est égale.
Et comme Hourmel insistait pour garder son ami, Gilbert dit:
– Ma force a grandi: pourtant, je commence à être vieux, et je pense que je mourrai pauvre.
Il disait cela en présence de la femme de Hourmel, empressée, émue, et qui tenait la lampe levée devant le visage des deux voyageurs. Elle aurait bien voulu savoir ce qui était arrivé. Cependant, lorsqu'elle entendit parler Gilbert, elle ne demanda rien. Elle dit, laissant voir toute son âme sur son visage transparent et usé:
– Mon homme, il ne faut pas retenir ceux qui vont à leur devoir. Il y en a trop peu. Monsieur Cloquet nous quittera quand il aura bu un verre de bière avec nous.
Lorsque les deux hommes eurent donc trinqué ensemble, Gilbert dit adieu au boucher et à madame Hourmel. Et il s'enfonça, tout seul, entre les maisons de Quiévrain, vers la frontière de France et vers son destin nouveau.
Le tramway l'eut bientôt mené à Onnaing. Alors, Gilbert fut saisi par l'angoisse. Il allait revoir la ferme du Pain-Fendu. Jusqu'alors, cette pensée avait seulement traversé son esprit, vite, entre deux longs moments de calme, comme une giboulée. Maintenant, elle ne le quittait plus; ne fallait-il pas rentrer, régler les comptes, reprendre les quelques hardes laissées dans la bauge? Il s'engagea dans la rue qui passe devant l'église. Dans les usines, le feu des fours s'éteignait. Aux portes, des enfants mangeaient un morceau de pain avant de se coucher; des hommes se tenaient debout, respirant la nuit, après tant d'heures d'atelier; ils étaient éclairés en arrière par les lampes, et leurs vêtements pendaient en plis mous, las comme eux, le long de leurs corps. Gilbert les enviait au passage, parce qu'ils avaient un abri. Une grande pitié de lui-même le tentait et lui disait: «Cède-moi?» Quand il fut dans la plaine, et que devant lui, il devina la ferme, à l'ombre énorme qu'elle levait dans le désert des guérets, il eut peur. «Ce n'est pourtant pas Heilman que je crains, songeait-il. S'il veut me battre, pour la première fois de ma vie je me laisserai battre: je l'ai mérité…» Non, il avait peur de lui-même, d'un désir qu'il sentait s'émouvoir et grandir dans son cœur, celui de se retrouver près de la femme du contremaître et de lui dire adieu. «Oh! pas longtemps… Je lui demanderais pardon… Je lui raconterais que je suis tout changé!..» Pour ne pas écouter ces voix qui le troublaient, il fit un grand effort, et essaya de songer, en marchant, à ses bœufs, à chacun des objets qu'il avait apportés de la Nièvre et qu'il devait empaqueter tout à l'heure… Les murs sombres montaient; les pignons des étables, des bergeries, de l'habitation, de la grange, se détachaient déjà vaguement l'un de l'autre, dans la nuit devenue laiteuse et glacée. Et toujours il sentait, au fond de lui-même, la poussée de cette volupté insinuante, dont il vidait son âme en disant non, mais qui sourdait de nouveau.
A pareille heure, les domestiques devaient avoir fini de souper. Quelques-uns fumaient sans doute ou causaient devant le grand portail. Gilbert n'alla pas jusque-là. Coupant à travers champs, il se dirigea vers une petite porte percée dans l'enceinte du Pain-Fendu, du côté d'Onnaing. Elle n'était heureusement pas fermée au verrou. Il n'eut qu'à soulever le panneau de bois, en se servant d'une pierre comme d'un levier, et la porte tourna sur les gonds. Le verger était désert, et désert le large couloir que bordaient les magasins, la forge, la première étable. Gilbert en arrivant dans le bas de la cour, ne vit qu'un seul homme autour du parc à fumier où les bœufs de Picardie dormaient: un journalier qui ne reconnut pas la silhouette du Nivernais, et qui se remit à verser la pulpe dans les mangeoires. Il s'abrita un moment derrière le pilier d'angle du hangar. On entendit la voix de Heilman, dans la salle à manger, puis dans le corridor. Sur le seuil, le contremaître parut. Gilbert le vit serrer la main d'un domestique qui, le souper fini, regagnait le village. Il s'avança rapidement, traversa la cour, monta les marches du perron.
– Monsieur Heilman?
Celui-ci avait ouvert la porte de la salle à manger; il se pencha en arrière, tournant la tête vers l'entrée du couloir d'où venait la voix. Ses yeux, déjà réhabitués à la lumière de la lampe, firent effort pour s'adapter à l'ombre…
– Ah! c'est vous, Cloquet? Entrez!
Gilbert était tout défaillant. Il monta les marches; il entra, et regarda d'abord tout autour de lui. Madame Heilman n'était pas dans la salle à manger, où toutes choses venaient d'être mises en ordre par elle, comme chaque soir: la lampe sur la table bien nette, les chaises le long des murs, la cafetière près du foyer éteint, pour le café du lendemain. Heilman se tenait debout, les jambes appuyées au haut bout de la table, et face à la porte. Il considéra, en reniflant et le visage en défiance, ce bouvier de hasard, qui revenait sans doute demander du travail après son équipée. Il en avait déjà bien vu, de ces aventuriers, traversant les terres frontières, venus de l'ouest ou de l'est, ivrognes ou débauchés, nomades avant tout. Il en avait trop vu pour se montrer violent avec eux. Un long moment il attendit, surpris que Gilbert ne s'excusât pas.
– C'est un joli exemple que vous avez donné! dit-il. Quatre jours de noce! Moi qui vous avais pris pour un bon ouvrier! Ma femme m'avait bien dit. «Il fera un coup de tête!» Elle n'a rien compris, samedi soir, quand vous êtes parti… Mais vous êtes comme les autres, sans cœur à l'ouvrage. Où avez-vous été?
Gilbert fit un geste vague:
– J'ai vu beaucoup de pays, dit-il.
– Et maintenant vous voudriez rentrer? Je connais ça; mais je dois vous prévenir:… je vous ai remplacé; j'ai pris un jeune homme qui passait, quelqu'un qui ne vaut sans doute pas mieux que vous… ce qu'on trouve à présent.
– Non, je ne demande pas à rentrer; je m'en retourne chez nous.
– Ah!.. C'est bien!.. Je vais vous payer, alors… Monsieur Walmery me remboursera…
Le contremaître alla ouvrir un des placards, et revint, les doigts plongés dans un sac en toile dont il avait dénoué la ficelle. Il fit claquer sur le bois de la table, une à une, les pièces d'or…
– … Cent francs… cent vingt… cent quarante… Cela fait le compte, et même largement?
– Oui.
– A présent, mon garçon, j'ai une lettre à vous remettre. Elle est arrivée à midi.
Il ouvrit le tiroir de la table, et tendit la lettre. Gilbert reconnut le timbre de Fonteneilles. Il laissa les pièces d'or sur la table, prit la lettre, déchira l'enveloppe. Il n'avait pas lu deux lignes, que ses yeux s'emplirent de larmes.
– Ah! mon Dieu! dit-il, monsieur Michel qui est mort!
Il avait cessé de lire. Ses mains étaient retombées le long de son corps. Sur ses joues et sa barbe les larmes coulaient, et il ne les essuyait pas, et il ne se cachait pas…
– Il est mort dimanche… C'est Étienne Justamond qui me le marque… Mon ami qui est mort!
Heilman, bien qu'il fût peu sensible aux peines des autres, fut remué par ce chagrin.
– Qui était-ce donc? Un de vos parents?
– Non.
– Ce n'était pourtant pas votre maître?
– Je n'en ai pas. C'était un noble, monsieur Heilman. J'avais fauché pour son père, et puis pour lui. Il nous aimait, il causait avec moi: il aurait pu changer le pays.
Il compta sur ses doigts:
– Cinq heures d'ici Paris, puis six ou sept… J'arriverai peut-être trop tard pour l'enterrement…
Heilman hocha la tête, pour donner plus d'importance à sa réponse. Il admirait, au fond de lui-même, ce passant, et il le regrettait.
– Vous êtes un curieux homme, Gilbert.. Vous êtes le premier que j'aie entendu parler ainsi… Écoutez, il y aurait peut-être moyen de s'arranger…
– Lequel? Est-ce qu'il y a un train tout de suite?
– Je n'en sais rien, et ce n'est pas ce que je veux dire. Non Cloquet; mais je pourrais vous garder…
Gilbert leva les bras, comme s'il sortait d'un rêve.
– Non, non! Il ne faut pas me proposer cela… Je serais capable d'accepter… Laissez-moi aller…
Il s'avança, rafla l'or de ses deux mains, et l'enfouit dans sa poche. A ce moment, la porte qui faisait communiquer la salle avec la chambre de Heilman s'ouvrit. Une femme parut dans l'entre-bâillement, la tête à demi tournée vers quelqu'un qui la suivait et qui lui parlait sans doute.
– Gilbert? appela Heilman, Gilbert? venez donc au moins dire adieu à la patronne?
Mais Gilbert avait disparu. Il fuyait. Il était déjà dans la cour, il gagnait le hangar, il entrait dans l'ombre. Heilman voulut le suivre et le rappeler. Sa femme l'arrêta. Elle avait les mots justes qui font céder les hommes.
– Laisse-le, dit-elle. Tu ne le connais pas bien: c'est un homme qui a eu plusieurs chagrins.
Gilbert était entré dans l'étable. En un tournemain, il eut plié les vêtements qu'il avait laissés dans le coin de sa bauge. Il lia le paquet avec une ceinture de cuir, et le jeta sur son dos. Puis il prit son bâton. En passant derrière ses six grands bœufs, qui mangeaient au râtelier, il ralentit sa marche.
– Adieu, mes bœufs! Travaillez bien avec l'autre: moi, je retourne au pays.
Une des bêtes poussa un meuglement bref.
– Il me répond, dit le bouvier.
Il avait reconnu Griveau, qui avait la voix basse et le souffle court. Et il continua son chemin rapidement, retraversant le verger jusqu'à la petite porte ouverte dans le mur d'enceinte.
Les champs le revirent bientôt sur leurs guérets détrempés, puis sur le chemin qui mène à Onnaing. Les champs étaient nivelés et nus. Le village dormait. Quelques fumées traînaient encore, plus noires que l'ombre et couchées par le vent d'est. L'homme ne pensait plus à la ferme qu'il quittait. Toute son imagination et tout son cœur étaient dans la Nièvre. Il gémissait, il répétait: «Monsieur Michel que je ne verrai plus! Mon ami qui est mort!» Quand il arriva à la gare, il demanda:
– Je voudrais aller à Fonteneilles, qui est dans la Nièvre. Est-ce que j'y serai demain matin?
– Le train 2916 va passer tout à l'heure. Prenez votre billet pour Paris. A Paris, on vous renseignera, si on connaît votre pays.
Gilbert monta dans un compartiment où il n'y avait qu'un voyageur. Il s'étendit sur la banquette, ses vêtements sous la tête, et il ferma les yeux. Le sommeil ne vint pas. Gilbert continuait de songer au lendemain, au travail, à la peine des jours à venir. Et maintenant il disait:
– Je ferai ma vie nouvelle comme si monsieur Michel me voyait.
XV
LE DÉPART DU MAITRE
Michel de Meximieu était mort presque subitement, dans la nuit du dimanche au lundi. La nouvelle avait couru tout le pays, plus vite qu'un cheval au galop. «Monsieur de Fonteneilles est mort. – Le vieux? – Non, le petit. – C'est dommage; c'était le meilleur des deux; il n'était pas fier.» Le lundi et le mardi, à l'angélus du matin et à celui du soir, les cloches de Fonteneilles sonnèrent longtemps, pour annoncer le trépas. Toutes les futaies, tous les taillis, tous les buissons des collines frémirent au passage de leur voix, et quelques âmes aussi, qui aimaient Michel de Meximieu.
Le château demeura pendant vingt-quatre heures entièrement clos, vide et muet. Puis on commença à transformer le vestibule en chapelle ardente. Une animation inusitée rompit le silence de l'avenue, de la cour, des granges voisines. A l'appel du marquis, arrivé dans la soirée du lundi, des ouvriers du pays, des employés de Corbigny affluèrent. Le bruit des scies et des marteaux s'éleva autour des murs. La curiosité, un peu de pitié humaine, un peu de regret s'émurent en même temps. Des voitures de châtelains descendirent l'avenue; des paysans vinrent, assez rares d'abord, puis enhardis par le nombre, «pour donner l'eau bénite»; d'autres, qui n'entrèrent point, se découvrirent devant la porte, et rôdèrent un moment dans le domaine que la mort avait ouvert à tous.
On rencontrait le marquis ici et là. Il veillait à tout; il donnait des ordres, il régnait à Fonteneilles pour la première fois, salué de loin, respecté, obéi à demi-voix. Sa douleur l'avait rétabli en autorité et presque en amitié. Il disait: «Madame de Meximieu ne pourra venir; elle est brisée; plaignez-la». La douleur lui inspirait des formules qui n'étaient point dans sa manière à lui, et que le cœur de tous les hommes entendait. Ils pensaient: «Comme il souffre, pour être doux comme ça!» Les noms des fermiers, des domestiques de ferme, des bergers, au moins des plus anciens, il se les rappelait aussi bien que ceux de ses cavaliers. «Méhaut, mon ami, allez ouvrir le caveau de famille; faites le nécessaire; je ne veux pas de mains étrangères pour toucher à la demeure de nos morts. Il ne l'aurait pas permis, lui. Allez, mon ami, je sais que tout sera bien.» Il disait encore: «Monsieur l'abbé, je vous serai toute ma vie reconnaissant de l'avoir assisté à sa dernière heure. Vous avez tenu ma place, sans doute mieux que je n'aurais fait; vous le compreniez mieux; nous étions si différents, lui et moi: éducation, occupations, idéal même. Ah! monsieur l'abbé, je souffre de n'avoir pas connu mon fils. Car ces différences, j'en ai souffert longtemps, mais je ne les ai approfondies que depuis qu'il est mort. C'est lui qui avait raison. Et nous voilà séparés à jamais, après avoir été absents, l'un pour l'autre, toute la vie…»
Le mercredi dès l'aube, Renard et le sacristain, le charron et le maréchal-ferrant de Fonteneilles achevaient de clouer à l'intérieur de l'église, de tendre, devant la porte qui ouvre sur le cimetière, de hautes draperies noires, semées de ces larmes qui sont l'image de tant d'autres et qui ne tombent pas. La paroisse n'avait que de vieilles tentures trop courtes; on avait envoyé chercher tout le matériel des enterrements de première classe à Corbigny. Les hommes se hâtaient, aidés par des ouvriers de la ville. Ils ouvraient des caisses de cierges; ils élevaient, à l'entrée de la nef tronquée, un catafalque si haut que jamais les gens du bourg n'en avaient vu un «si beau, avec des plumes aux coins». Les voitures des marchands, qui montaient au pas la côte, s'arrêtaient; des enfants, des vieilles femmes, de jeunes mères, le petit au poing, se tenaient autour du mur du cimetière, jasant, et parfois s'avançaient jusqu'à la porte, pour voir. Une odeur d'étoffe, comme il en flotte chez les drapiers, de cire et de moisi, emplissait la vieille église et alourdissait l'air.
L'heure est venue. Devant le château, dans la grande cour sablée, une foule considérable s'est massée. Elle fait deux taches mouvantes: l'une à droite, à l'entrée de l'avenue, l'autre, la plus grosse, du côté des communs. Ce sont des hommes de Fonteneilles, des bourgs voisins, de Corbigny et d'ailleurs, laboureurs, journaliers, artisans, petits propriétaires, marchands, auxquels se mêlent des femmes, en petit nombre, voilées de deuil ou vêtues de la canette des aïeules. On cause à voix basse. La rumeur augmente par moments et quelquefois s'éteint presque entièrement. Dans l'espace demeuré libre les voitures s'engagent au pas; elles s'arrêtent devant le château, et vont se ranger en file devant les écuries à demi cachées par un massif d'arbres. Il en vient de tous les modèles et de toutes les époques, automobiles ou landaus amenant quelques parents ou amis des Meximieu, cabriolet du notaire, tilbury d'un homme d'affaires, carrioles élégantes ou charrettes anglaises des grands fermiers de la région, fiacres loués par des voyageurs dans quelque gare voisine. «Ça, c'est une voiture de chez Touchevier de Saint-Saulge; celle-là de l'hôtel de la Poste; celle-là de chez monsieur Cahouët, de Corbigny… Ah! voici monsieur Honoré Fortier.» Le fermier de la Vigie arrive à pied, coiffé d'un chapeau de soie, très alerte encore et rose malgré l'âge, entrouvrant à peine, pour répondre aux bonjours de partout murmurés, ses lèvres minces, serrées depuis l'enfance par le secret paysan. «Reconnais-tu le gros qui passe? C'est le marchand de bois de Saint-Imbert… – As-tu vu monsieur Jacquemin? – Non, ni mademoiselle Antoinette…» Les yeux accompagnent les voitures; on se pousse pour mieux voir; on essaye de distinguer les visages derrière les vitres levées des portières, de surprendre les mots, le geste, la physionomie des nouveaux venus qui entrent dans le château par la porte tendue de noir, et derrière laquelle remuent des ombres vagues. La foule grossit constamment. Mais peu de paysans descendent l'avenue. Ils viennent par petits groupes, des bois, des terres, par les échaliers et les adresses, évitant les espaces découverts, qu'il faudrait parcourir sous le feu de tant de regards. La cour est pleine comme une place un jour de marché. A neuf heures, un grand mouvement se produit. Toutes les têtes se tournent du même côté. L'abbé Roubiaux, précédé de la «croix en or», cravatée de crêpe, et d'un peloton d'enfants de chœur, a été aperçu au haut de l'avenue. Derrière lui, descend le corbillard des pompes funèbres de Corbigny. C'est la seconde fois que «les pompes funèbres de la ville» pénètrent dans cette campagne de Fonteneilles. La première fois, on est venu chercher le corps d'une grosse dame, qui avait commencé par être nourrice à Paris, et qui était revenue au pays pour y mourir, très riche, on ne sait comment. Mais ce n'est pas la même voiture; ce ne sont plus les deux chevaux caparaçonnés, emplumés, la voiture habillée de noir et d'argent; non, c'est tout autre chose.
– Quel pauvre corbillard!
– Pour un comte!
– Ça serait bon pour des gens comme nous, des petites gens, comme ils disent.
– Un seul cheval!
– Et pas beau. On lui compte les côtes. Pas seulement la queue peignée.
– Comprends-tu pourquoi?
– Non. C'est peut-être parce que le maire de Corbigny n'a pas voulu laisser sortir la grande voiture.
– La politique alors?
– Est-ce qu'on sait? Un noble, n'avoir qu'un cheval pour son enterrement, voilà ce que je n'ai jamais vu… Il y en a pourtant, des rentes, dans cette maison-là! Plus de trente mille francs, que le marquis a touchés de la vente de ses bois!
– Vous n'y êtes pas! Le garde Renard vient de me dire ce qui en est!
Trente personnes enveloppent l'homme qui sait.
– Eh bien?
– Il paraît que le comte a fait un testament; il a demandé la première classe à l'église, et la quatrième pour l'y mener…
– Il aura voulu faire gagner les curés.
– Sais-tu ce qui m'étonne? C'est qu'il n'ait pas demandé à être porté à bras, par les hommes de ses fermes…
– Il n'a peut-être pas voulu les fatiguer: il était capable de penser à cela.
– Peut-être.
L'abbé Roubiaux récite les prières, les mots passent au-dessus de l'assemblée, dont leur pouvoir de discipline apaise la rumeur. Les fronts se découvrent. Subitement, un silence absolu, émouvant, fait d'émotion poignante. La voiture se remet en marche, et dans l'encadrement de la porte par où le fils, couché dans sa bière, vient de passer, le père apparaît, magnifique et douloureux, devenu tout blanc en quatre jours, le visage levé, le regard de ses yeux bleus fixé en avant, sur les couronnes de chrysanthèmes et de roses d'automne accrochées au toit du char funèbre, le corps sanglé dans une redingote où éclate un point rouge à l'endroit du cœur, le chapeau de soie au bout de la main droite, pendante et dégantée, la main gauche gantée, pendante aussi et immobile. Tous le regardent. Il ne voit personne. Il marche militairement. On dirait qu'il s'avance au son d'une fanfare qui chante le deuil du monde entier. Sa réputation de bravoure et de richesse, sa noblesse, ses années le grandissent, et la douleur y ajoutant son sacre, bien des hommes sentent les larmes leur monter aux yeux, et les pires ennemis des châteaux trouvent ce noble bien brave et bien digne de pitié. Il va lentement, il domine la foule, sa barbiche blanche et ses moustaches tremblent seules au vent.
Tous les amis suivent, les voisins, les clients et toute la campagne. Au bout de l'avenue de hêtres, le petit cheval maigre qui traîne le corbillard tourne à gauche, et le corps de Michel, autrefois comte de Meximieu, quitte à jamais la terre aimée de Fonteneilles.
A cet endroit, un homme se joint au cortège. C'est monsieur Jacquemin. Il n'a pas voulu entrer avant l'heure dans le domaine qui est le sien. Les cloches sonnent. Les futaies diminuent en arrière. Et devant les premières maisons du bourg, sur la place, dans le cimetière en terrasse qui enveloppe la tour de l'église, beaucoup de femmes, et des hommes encore, attendent le passage de la longue procession.
Lorsque la nef, les deux bras du transept, le chœur furent remplis de monde, tous les murs étant frôlés par des épaules, l'office commença. La flamme des cierges ne dissipait point les ténèbres amassées par les tentures. Elle luisait comme une étincelle arrêtée au vol et clouée dans la nuit. L'officiant se tenait près de la table de communion. Dans l'allée centrale, entre les bancs, une nouvelle procession s'organisait, celle des hommes et des femmes qui avaient connu le défunt, et, pour lui faire honneur, allaient «à l'offerte». L'abbé Roubiaux considérait ces paroissiens que la mort et non pas Dieu amenait à l'église. «Elle est leur maîtresse, pensait-il, elle lève encore au-dessus d'eux la croix.» Ils venaient sur deux rangs; ils baisaient le crucifix d'argent; lèvres bien différentes de respect et d'amour; lèvres inertes, dédaigneuses et déshabituées; lèvres qui, à longueur de jour, blasphémaient, et qui n'osaient pas refuser en ce moment le geste traditionnel; lèvres de vieilles femmes qui pressaient le métal, à l'endroit des pieds percés du Christ, et semblaient vouloir le dévorer. Et tous, et toutes, les hommes et les femmes de Fonteneilles, après avoir baisé le crucifix, déposaient un sou ou deux dans le plateau que tenait, sur son ventre, un enfant de chœur placé près de l'officiant. Les riches, les pauvres défilaient. Les pauvres avaient pris la monnaie de l'offerte non dans leur poche, mais dans un autre plateau, où s'empilait une colline de billon, et que portait gravement, surveillant les preneurs à côté du bénitier, le garde de Fonteneilles. Toute la paroisse avait connu Michel, et presque toute elle donnait pour le repos de l'âme, parce que les anciens avaient cru, avaient aimé, avaient espéré fraternellement.
Un autre prêtre du canton avait remplacé l'abbé Roubiaux à l'offerte, et la procession continuait, et le bruit sec des sous tombant dans le plateau, quelquefois celui d'un baiser, se mêlait aux chants de la mort, aux invocations à la miséricorde, aux promesses de résurrection et d'éternité.
Le général, au premier rang, à gauche, debout, ne remuait qu'un bras, qu'il levait par moments jusqu'à la hauteur de ses yeux.
Et, l'office terminé, l'absoute donnée, le père sortit, retraversant la nef. Il se mit sur la haute marche du perron, le dos au montant du portail, en pleine lumière, répondant d'un signe de tête à tous les assistants qui passaient près de lui. Il n'entendait pas les mots qu'on lui disait: «Mon général, je vous plains; mon général, je ne l'oublierai pas…» Il attendait. Il abaissait continuellement son regard sur ce cercueil placé là devant lui, sur le bord de l'allée qui traversait le cimetière, à la place la plus fréquentée et la plus honorable, près d'une grande dalle levée, marquée d'une croix, et qui portait l'inscription: «N'a failli Meximieu». Six laboureurs de Fonteneilles avaient porté le corps jusqu'au seuil de cette demeure où il allait entrer, avant-dernier de son nom et dernière espérance de la race. Les six hommes étaient beaux, recueillis, émus par le voisinage et l'appareil des choses de la mort, et par le regard du général, qu'ils croyaient voir se poser sur eux. Des chants encore s'élevèrent; une bénédiction descendit sur le cercueil. Le cimetière était plein; il y avait des hommes, des enfants, des femmes entre toutes les tombes et jusque sur le mur d'enceinte. Et le soleil gris apparaissait et disparaissait, couvert par les brumes voyageuses.
Alors, comme le prêtre avait fini les prières et rentrait dans l'église, du haut du perron, le père étendit le bras. Une seconde fois, l'énorme foule fit silence. «Gens de Fonteneilles, dit-il, ma famille est finie; mon fils est mort; moi, vous ne me verrez plus! Pendant quatre cents ans, les Meximieu ont vécu avec vos pères. Je vous constitue les gardiens du tombeau de cet enfant, et de mes aïeux qui dorment ici. Quand vous passerez, que ceux qui savent encore prier prient pour mon fils. Il vous aimait. Vous ne l'avez pas compris, pas assez. Je n'ai pas le droit de vous le reprocher, car, moi non plus, je n'ai su que dans les derniers temps ce qu'il valait. Il était meilleur que nous. Vous apprendrez par votre prêtre qu'il est mort en pensant à vous. Je n'ai pas la force de parler de ces choses-là. Je vous dis seulement: c'était un brave; ne l'oubliez pas. Tâchez aussi d'être plus justes pour ceux qui prendront sa place sur la terre de Fonteneilles… Moi, je vous quitte. Mais je prie les pauvres de me permettre de leur distribuer moi-même les bons de la donnée de pain. Venez, mes amis! Et pour tous les autres, adieu!»
Des mots murmurés répondirent, ici et là:
«Est-ce qu'il a fait une donation au bureau de bienfaisance? – Ça serait-il un hôpital qu'il aurait donné, pour Fonteneilles? – Mais non, il n'avait pas même sa légitime, monsieur Michel, il vivait dans le bien de ses parents.»
Le garde s'approcha, avec un paquet de bons de pain, de chacun douze livres à prendre chez le boulanger du bourg. Le marquis descendit, jusqu'à la plus basse marche du perron, celle qui touchait la terre inégale et creusée en coquille par le pied des fidèles de tous les temps. Les pauvres vinrent, se mettant en file d'eux-mêmes, boiteux, cagneux, bossus, vieux du village ou des villages voisins, coureurs de la forêt, bonnes femmes en mantes noires, pareilles à des religieuses, mères qui traînaient une grappe d'enfants après elles. Et à chacun, le vieux gentilhomme donnait vingt-quatre livres de pain. «En souvenir de Michel de Meximieu!» disait-il. La file était longue; le marquis, tout ferme qu'il fût, fermait par moments les yeux pour s'empêcher de pleurer; les assistants disaient entre eux: «C'est vrai qu'il était un bon homme, monsieur Michel; on aurait peut-être fini par nous entendre avec lui.» Ils disaient encore: «Voilà qu'on va vendre Fonteneilles. Le marquis n'a plus le courage de revenir, et il vend sa terre. Car il n'a pas besoin d'argent, il est riche à millions.»
– En souvenir de Michel de Meximieu, répétait le marquis sur la plus basse marche de l'église.
Auprès de la tombe, une jeune fille, agenouillée dans l'herbe, penchée, accablée par sa peine, indifférente à tout le reste, pleurait. On ne l'avait pas vue venir. Elle était là. Les femmes surtout s'apitoyaient sur elle et disaient: «Il faut croire qu'elle l'aimait, la pauvre petite! Quel joli ménage ça eût fait, et doux au pauvre monde!»
Il y avait encore une douzaine de pauvres à servir, et qui formaient une file de quelques mètres à la droite du marquis, lorsqu'un homme, arrivant par la route et refoulant les groupes qui commençaient à descendre, monta les marches du cimetière. Comme il était de haute taille, toute l'assemblée le vit. Une grande rumeur courut: «Gilbert Cloquet qui revient de chez les Picards! Regardez-le! Sa barbe a blanchi, mais il a bon air tout de même! Où va-t-il? Il passe entre les tombes. Peut-être il veut parler au marquis?»
Il voulait, en effet, parler à M. de Meximieu, et, jugeant peu poli de l'aborder de face et de troubler la distribution, il gagnait la partie de l'enclos où s'était formée la procession, maintenant finissante, des quêteurs de pain. Il se plaça au dernier rang, derrière une femme qui traînait un enfant, et il attendit son tour, piétinant comme elle dans l'herbe. On l'observait. Lui, la tête droite, et la barbe immobile sur sa veste boutonnée, il n'avait de regard que pour ce grand vieux noble qui se baissait en mesure, et qui disait si tristement: «En souvenir de Michel de Meximieu.» Ils furent bientôt l'un devant l'autre. Le châtelain de Fonteneilles, qui avait la vue troublée par les larmes, ne reconnut pas le faucheur de ses prés, et tendit un carré de carton sur lequel il y avait deux lignes d'écriture. Mais Gilbert dit, très bas, pour ne pas l'offenser: