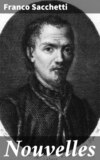Kitabı oku: «Curiosa», sayfa 12
XXV
DEUX DIALOGUES
du
LANGAGE FRANÇOIS ITALIANIZÉ
PAR HENRI ESTIENNE80
Au temps de Henri II et de Catherine de Médicis, les courtisans avaient la manie de tout accommoder à l’Italienne, même la langue Française. Le mal datait de loin. Les expéditions de Charles VIII, de Louis XII et de François Ier, la possession intermittente du Milanais, prétexte incessant de guerres et de voyages, le retentissement en France des chefs-d’œuvre littéraires d’outre-mont, écrits dans une langue plus tôt formée que la nôtre, plus fleurie et plus sonore, avaient depuis longtemps entretenu entre les deux peuples, de même race Latine, un continuel échange d’idées, tantôt sympathiques, tantôt hostiles: les Florentins venus chez nous en foule, à la suite de la nièce de Clément VII, firent décidément pencher la balance du côté de la sympathie. Ils tenaient le haut du pavé, jouissaient bruyamment de la faveur royale, et, pour ne leur point céder en élégance, il fut dès lors de bon air de les imiter dans la somptuosité des équipages et des vêtements, les velours, les soies, les brocarts, les dentelles, d’user de leurs fards et de leurs onguents, de singer leurs mœurs, de parler comme eux. De là, partout où résidait la cour, des nouveautés vues d’un mauvais œil par les Français de vieille roche, attachés aux anciennes coutumes, des modes extravagantes et un langage italianizé des plus choquants pour leurs oreilles. Avoir sa stanse en la cour, capiter ou s’imbatter quelque part, être tout sbigottit, spaceger par la strade, faire scorne, stenter, indugier à quelque chose, se montrer de bonne voglie, étaient des locutions journellement employées dans la conversation, et dire la même chose en Français n’eût pas été de bon garbe, aurait montré de la salvatichesse et même de la gofferie dans la façon de s’exprimer. Le parler de l’escholier Limosin de l’alme, inclyte et célèbre Académie que l’on vocite Lutèce, déambulant par les compites et quadrivies de l’urbe, et transfretant la Séquane pour capter la bénévolence de l’omnijuge, omniforme et omnigène sexe féminin, n’est pas plus ridicule.
C’est de ce travers que se moque Henri Estienne. Il l’avait attaqué déjà dans la préface du Traité de la Conformité du langage François avec le Grec; il y revient dans sa Précellence du langage François, deux ouvrages qui, avec les Dialogues du langage François italianizé et autrement desguizé, forment une sorte de trilogie écrite pour la défense et la glorification de notre idiome national. «Pourquoi,» disait-il, «ne pas feuilleter nos romans, et desrouiller force beaux mots, tant simples que composez, qui ont pris la rouille pour avoir esté si long temps hors d’usage? Non pas pour se servir de tous sans discrétion, mais de ceux pour le moins qui seroient le plus conformes à l’usage d’aujourd’huy. Mais il nous en prend comme aux mauvais mesnagers, qui, pour avoir plus tost faict, empruntent de leurs voisins ce qu’ils trouveroient chez eux, s’ils vouloient prendre la peine de le cercher. Et encore faisons-nous souvent bien pis, quand nous laissons (sans savoir pourquoy) les mots qui sont de notre creu, et que nous avons en main, pour nous servir de ceux que nous avons ramassez d’ailleurs. Je m’en rapporte à manquer et à son fils manquement, à baster et à sa fille bastance, et à ces autres beaux mots: à l’improviste, la première volte, grosse intrade, grand escorne… Car qui nous meut à dire manquer, manquement, plus tost que défaillir, défaut? baster et bastance, plus tost que suffire et suffisance? Pourquoy trouvons-nous plus beau à l’improviste, que au despourvu? la première volte, que la première fois? grosse intrade, que gros revenu? il a receu un grand escorne, plus tost que, il a receu une grande honte, ou ignominie, ou vitupère, ou opprobre? J’alléguerois bien la raison, si je pensois qu’il n’y eust que ceux de mon pays qui la deussent lire estant ici escripte, mais je la tairay, de peur d’escorner ou escornizer ma nation envers les estrangers81.»
Le scrupule qui l’arrêtait alors, il ne l’avait sans doute plus quand il composa les Dialogues; il y a mis tant de raillerie désobligeante pour les Italiens, qu’on l’accusera volontiers d’avoir exagéré, et qu’on se demandera si le jargon composite de son gentilhomme Courtisanopolitois, Jan Franchet, dit Philausone, s’adressant aux lecteurs tutti quanti, n’est pas tout à fait de son invention. Nous avons heureusement, dans les écrivains de l’époque, des témoignages positifs en faveur de la véracité d’Estienne. M. de Blignières82 a relevé, après Paul-Louis Courier, un assez grand nombre de tournures Italiennes dans Amyot: Trop plus, trop mieux (troppo più, troppo meglio), le plus du temps (il più del tempo); à tant (a tanto), pour à ce point; pour tant (per tanto), au lieu de pour cela; non pour tant (non per tanto), au lieu de néanmoins; comme ainsi soit que (conciosiachè); au moyen de quoi (per mezzo di che); à l’occasion de quoi (a cagion di che); là où (là dove); fors que et hors que (fuorchè); premier que, combien que, comment que (prima che, quantunque, come che); impropère (improperio), pour reproche; issir (uscire), pour sortir; rober et roberie (robare, roberia), pour voler et larcin; se partir (partirsi), pour s’en aller; être entre deux (star infra due), pour hésiter entre deux partis à prendre; un qui (uno che), etc. Feugère83 en conclut que, de la conversation, les Italianismes avaient passé dans les livres, et que les auteurs les plus purs leur payaient leur tribut. Mais on remarquera que beaucoup de ces locutions, aujourd’hui tombées en désuétude, étaient employées chez nous bien avant le XVIe siècle; elles se trouvent dans les deux idiomes, d’origine commune, sans qu’on puisse distinguer bien nettement qui les a empruntées à l’autre. L’examen de Rabelais est, à notre avis, beaucoup plus probant, car l’auteur du Gargantua et du Pantagruel italianise avec autant d’aplomb que latinisait l’escholier Limosin dont il se moque: Ainsi font mes compaignons, dont, par adventure, sommes dicts parabolains… – Nous, à ceste heure, n’avons autre faciende que rendre coignées perdues?.. – Pour dix mille francs d’intrade ne quitteriez vos soubhaits… – Ils pourront tirer denares… – Voire les escuz de guadaigne… – Un entonnoir d’ébène tout requamé d’or… – Elle l’appelait son estivallet… – Corpe de galline! respondit Frère Jean… – Le portier joyeusement sonne la campanelle… – Révérend père, si m’avez trouvé bonne robbe… – Un gros et large anneau dans la palle duquel estoit enchâssée… – Considérans le minois et les gestes de ces poiltrons magnigoules… – Iceulx, après avoir à belles dents tiré la figue, la monstroient au boie… etc. etc. Parabolain (parabolano, jaseur, hâbleur); faciende (facienda, besogne); intrade (intrata, rente); denares (danari, deniers, argent); guadaigne (guadagno, gain); requamé (ricamato, enrichi, orné); estivallet (stivale, botte); galline (gallina, poule); campanelle (campanella, clochette); de bonne robbe (di buona roba, de bonne composition); palle (palla, boule, chaton); magnigoule (manigoldo, bélître); boie (boia, bourreau) ne peuvent plus guère être compris aujourd’hui que des Italianisants. Or, Rabelais a précisément ajouté au IVe livre du Pantagruel, auquel nous empruntons tous ces lambeaux de phrases, une «Briefve déclaration des dictions plus obscures»; il y donne le sens de mythologie, prosopopée, catastrophe, misanthrope, thème, sarcasme, catégorique, solécisme, période et autres mots sans doute alors étranges, quoique devenus depuis si Français, et pas un de ceux que nous venons de citer ne figure dans cet Index: c’est qu’ils étaient assez dans le langage courant pour ne devoir arrêter aucun lecteur, et que l’usage les avait dès longtemps naturalisés. On regretterait peut-être de ne pas les trouver dans Rabelais; ils contribuent, avec tant d’autres vocables qu’il tirait du Grec, du Latin, de l’Hébreu, ou qu’il forgeait de toutes pièces, à donner à son style cette exubérance qui nous émerveillera toujours. Mais, en somme, ils font double emploi avec autant de mots de notre vieille langue, de tout aussi bon aloi, et c’étaient des richesses superflues.
Avant Catherine de Médicis et ce débordement d’Italianismes qui menaça de submerger notre idiome, on se montrait volontiers assez tolérant; on admettait que les deux nations n’avaient qu’à gagner à se prêter mutuellement ce qui leur manquait, et que la douceur, la mollesse, la fluidité du Toscan corrigeait heureusement la rudesse un peu sauvage de nos vieux dialectes. Une quarantaine d’années avant les Dialogues du François Italianizé, Lemaire de Belges écrivait sa Concorde des deux langages (1540, in-8o); il supposait, comme Estienne, deux personnes devisant entre elles de la comparaison du Français et du Florentin, «lesquels», dit-il, «sont dérivés et descendus d’un même tronc et racine, c’est à savoir de la langue Latine, mère de toute éloquence, tout ainsi comme les ruisseaux procèdent de la fontaine», et concluait qu’ils doivent «vivre et persévérer ensemble en amoureuse concordance, pour ce que», ajoutait-il, «aux temps modernes, plusieurs nobles hommes de France fréquentant les Itales se délectent et excercitent audit langage Toscan à cause de sa magnificente élégance et douceur: et, d’autre part, les bons esprits Italiques prisent et honorent la langue Françoise et s’y déduisent mieux qu’en la leur propre, à cause de la résonnance de sa gentillesse et courtoisie humaine.»
Henri Estienne est loin de ces idées de conciliation; pour lui, ce sont des gaste-françois, ceux qui empoisonnent notre langue de termes étrangers, et, dans les quelques néologismes qu’il admet, perce son antipathie pour nos voisins d’au-delà les Alpes. Il trouve, par exemple, excellent qu’on tire de l’Italien poltronnerie et forfanterie, car ces qualités n’étant pas Françaises, force a bien été d’en demander les noms au pays dont elles sont, dit-il, une production naturelle; intrigant, charlatan, baladin, bouffon, sont aussi de bonne prise, «car nous ne pourrions trouver de mots Français signifiant telles gens, veu que le mestier duquel ils se mêlent est tel, qu’à grand’peine le pourroit-on descrire à un François, si non en les contrefaisant;» quant à spadassin, assassin, sicaire, il est de toute justice qu’ils soient de provenance Italienne, puisque le métier d’assassiner était exercé en Italie longtemps avant qu’on sût en France ce que c’était. En garder l’usage, c’est faire à la langue Italienne l’honneur qui lui appartient, c’est reconnaître que ces beaux mots sont de son fief. Pour le reste, nous n’avons que faire de lui rien emprunter, notre fonds étant suffisamment riche. Henri Estienne met là quelque méchanceté; mais, en qualité de protestant, il détestait les Italiens comme dévots au Pape et à la messe; il abhorrait surtout ceux de la cour de France, comme complices des persécutions qu’il avait lui-même subies, avec ses coreligionaires. Il gardait contre eux la rancune d’un expatrié, et peu s’en faut qu’il ne les accuse de profiter de ce qu’il n’était pas là, pour opérer des dégâts dans son propre domaine, cette vieille bonne langue que son père et lui se sont tant évertués à nourrir de Grec et de Latin. Il ne reproche pas seulement aux courtisans l’abus des mots nouveaux: il leur en veut encore d’énerver et d’affadir la langue par la substitution de l’è ouvert ou de l’é fermé au plein et bon son de l’oi; de dire mé, fé, ré, lé, pour moi, foi, roi, loi; puis, par une affectation contraire, de changer aussi oi en oa, dans certains cas, et de faire échec à toute bonne prononciation, à toute syntaxe, quand ils disent chouse pour chose, j’avions, j’étions, etc.:
N’estes vous pas bien de grands fous
De dire Chouse au lieu de Chose?
De dire I’ouse au lieu de I’ose?
Et pour Trois mois, dire Troas moas;
Pour Ie say, vay, Ie soas, je voas?
En la fin vous direz La guarre,
Place Maubart, frere Piarre.
Ces querelles ne nous intéressent plus beaucoup; l’usage a depuis longtemps fixé la prononciation et décidé, non sans inconséquence, que de deux mots qui s’écrivaient au XVIe siècle avec la diphtongue oi, l’un se prononcerait comme il s’écrit et l’autre comme s’il y avait ai. Étret, dret, fret, comme on disait, à l’Italienne, à la cour de Henri II, n’ont pas prévalu contre étroit, droit et froid; tandis que François, j’irois, j’étois, je venois sont devenus Français, j’irais, j’étais et je venais; on a continué de dire loi, moi, foi, roi, mais en exagérant le son ouvert de la diphtongue oi, qu’Estienne prononçait oè (Françoès, loè, moè, foè, roè), comme le font encore nos paysans, et que nous sommes bien près de prononcer oa. Remarquons d’ailleurs que la prononciation dret, endret, pour droit, endroit, qui subsiste encore dans les campagnes, était bien antérieure au XVIe siècle; on la rencontre dans les trouvères. Sans remonter plus haut que Villon, qui fait rimer Chollet avec souloit, exploits avec laiz, Robert et haubert avec plus part et poupart, La Barre avec terre, et appert avec despart, on voit qu’Estienne semble mettre sur le dos des courtisans des fautes de langage dont ils n’étaient pas responsables. «Bien qu’il possédât son idiome Roman mieux que ses contemporains», dit à ce propos M. Francis Wey84, «on s’aperçoit que les manuscrits lui étaient étrangers, qu’il lisait nos vieux auteurs dans des textes rajeunis.» C’est une grosse erreur: Estienne reproche aux courtisans, non pas d’inventer une mauvaise prononciation, mais de la remettre à la mode, après un ou deux siècles de désuétude; il savait très bien que du temps de Villon on disait la tarre pour la terre, comme le disent encore les paysans, et un haubart pour un haubert85. Où il se trompe un peu, c’est lorsqu’il fait affirmer à son Celtophile que si le roi Henri II se délecte à entendre dire chouse pour chose, cousté pour costé, et j’avions, j’étions, etc., François Ier, «de tres celebre et perpetuelle mémoire», n’eût pas été de si bonne composition. «Car luy qui avoit faict si heureusement fleurir en son royaume l’estude des trois langages, l’Hebrieu, le Grec, le Latin, estoit si jaloux de l’honneur du sien maternel, qu’il est vraysemblable que le meilleur marché qu’eussent eu les inventeurs de cest écorchement de langage, c’eust été d’avoir le dos écorché à coups de fouet86.» François Ier aurait donc été forcé de se faire donner d’abord les étrivières, car il s’amusait aussi parfois, lui aussi, à parler et à écrire de la sorte: «Le cerf nous a menés jusqu’au tartre de Dumigny… J’avons espérance qu’y fera beau temps, veu ce que disent les estoiles que j’avons eu le loisir de voir… Perot s’en est fouy, qui ne s’est ousé trouver devant moy87.»
Dans ce procès qu’il faisait aux Italianismes, Henri Estienne a eu le plus souvent cause gagnée: Aconche, amorevolesse, capiter, favoregger, disturbe, goffe et gofferie, s’imbatter, indugier, s’inganner, mercadant, leggiadre, mariol, menestre, poignelade, ringracier, salvatichesse, sbigottit, scorne, spaceger, spurquesse, straque, usance, voglie, s’en sont allés où sont les neiges d’antan; bon voyage! A peine regretterons-nous usance et amorevolesse, qui ne manquent pas de garbe. A plus forte raison, l’usage n’a-t-il pas consacré, dans le sens qu’ils ont en Italien, amasser, attaquer, fermer, forestier, piller, poste, triste, volte, etc.; ces mots avaient déjà, chez nous, pris une acception autre, dont il aurait fallu les déposséder; de même bugie (bugia, mensonge), cattif (cattivo, méchant), stanse (stanza, chambre), auraient fait équivoque. Salade (celata) s’est dit longtemps pour casque: on a fini par l’abandonner, peut-être seulement avec les casques. Mais un grand nombre de mots dont Estienne se moquait et qu’il voulait arrêter à la frontière: caprice, citadin, courtoisie, disgrâce, estaffier, estafilade, gentillesse, s’estomaquer, manquer, réussir, riposte, risque, vocable, etc., sont néanmoins entrés et font même assez bonne figure dans notre langue. Nous avions au dépourvu; cela ne nous a pas empêchés de prendre à l’improviste, et de les garder tous deux: un ami nous arrive à l’improviste, et un billet à payer peut nous prendre au dépourvu; il y a une nuance, et c’est la variété des nuances qui fait la richesse d’un idiome. Fastide n’est pas resté: nous en avons dérivé fastidieux, qui est excellent; pérégriner ne s’emploie guère: nous en avons tiré pérégrination, très bon mot qui nous permet de conserver à pèlerinage, lequel est exactement le même, une acception spéciale. Quelques Italianismes ne se sont naturalisés chez nous qu’en subissant des métamorphoses bizarres; comme l’Alfana du chevalier de Cailly, ils ont beaucoup changé en route, supercherie, par exemple. L’Italien soverchiare veut dire surpasser et être de superflu; comment supercherie, que l’on en a dérivé, a-t-il le sens d’imposture? Ceux qui l’ont introduit, ne se doutant pas de ce qu’il voulait réellement dire, lui ont attribué une signification de fantaisie, qui a prévalu tout de même.
Ces Dialogues ont un grand mérite; ils sont d’une lecture attrayante, tout en roulant sur des sujets qui ne semblent pas précisément appeler le mot pour rire. En les achevant, on s’aperçoit qu’on vient de passer quelques longues heures en compagnie de Mesdames Grammaire, Linguistique et Syntaxe, personnes maussades entre toutes, non seulement sans ennui, mais avec plaisir. Henri Estienne, ce laborieux érudit, tout bourré de Grec et de Latin, est le moins pédant des savants. Il écrit sans plan bien arrêté d’avance, au courant de la plume; son Celtophile et son Philausone engagent, plutôt qu’une discussion dogmatique, une conversation à bâtons rompus qu’un rien fait dévier. Des anecdotes, des reparties, des souvenirs, des citations, rompent continuellement la trame de l’entretien et l’empêchent d’être jamais monotone; la satire des mots amène la satire des mœurs et donne prétexte à d’amusantes digressions. «Les imperfections mêmes de cet ouvrage, très patriotique au fond», dit avec beaucoup de justesse M. Francis Wey, «contribuent à en rehausser l’intérêt historique, car, délaissant parfois le sujet principal, l’auteur, emporté par l’instinct comique, affuble son courtisan de tous les ridicules du jour et profite de l’occasion pour généraliser la satire, en l’étendant à quantité de préjugés, d’usages et de prétentions des gens du bel air. La physionomie des Raffinés d’une époque où la chose que ce mot a désignée depuis n’avait pas encore reçu de sobriquet, se trouve là tout entière; ce livre équivaut à des Mémoires intimes.»
Qui croirait que ces inoffensifs Dialogues furent vus d’aussi mauvais œil à Genève que l’Apologie pour Hérodote, cette grosse machine de guerre dirigée insidieusement contre la superstition religieuse? Ils attirèrent à Henri Estienne tant de tracasseries, qu’il prit le parti de rentrer en France. Depuis que l’Apologie avait tant bien que mal réussi à passer par les mailles de la censure, on le surveillait étroitement; il était obligé de montrer en épreuves chaque feuille qui sortait de ses presses: on l’accusa, pour les Dialogues, d’avoir fait des additions sur ses épreuves, introduit en fraude des récits d’un tour trop libre, des anecdotes inconvenantes. L’édition fut saisie. Au fond, ce qui déplaisait chez Henri Estienne, c’était son franc parler sur toutes matières et sa force satirique. Les sectaires ne détestent pas la raillerie quand ils s’en servent eux-mêmes, et Théodore de Bèze, l’un de ses rigides censeurs, ne s’en faisait pas faute à l’occasion; mais c’est une arme dangereuse, qu’ils n’aiment pas voir aux mains des autres.
Mai 1883.
XXVI
LES CADENAS
ET CEINTURES DE CHASTETÉ88
On verra si l’on veut l’origine des Cadenas de chasteté dans ce nœud spécial, appelé Herculéen, qui attachait la ceinture de laine des vierges Grecques, et que le mari seul devait dénouer, le soir de ses noces. Solidifiez ce nœud, appliquez-le à une armature de métal, et vous avez à peu près le Cadenas; mais les Grecs ne paraissent pas avoir connu cet appareil de sûreté. Ce n’est que dans le conte de Voltaire que l’on voit Proserpine défendue par une armure de ce genre; Vulcain, l’habile ouvrier, ne réussit jamais qu’à forger le fameux filet qui lui permit de surprendre le flagrant délit, non de l’empêcher; et quand Ulysse fermait la porte de son royal logis au moyen d’une cheville passée dans des courroies, il eût sans doute été bien en peine de mettre une serrure à Pénélope.
La ceinture de virginité des jeunes Grecques se revêtait à la nubilité et se quittait dès le mariage; tout au contraire, la Ceinture de chasteté était présentée par le mari à la femme le matin de la nuit de noces, comme excellemment propre à maintenir entre eux l’union et le bon accord en dissipant toutes ses défiantes appréhensions. Dans l’Aloysia du pseudo-Meursius, cette élégante peinture des mœurs du XVIe siècle, voici par quels arguments un mari, qui a bien ses raisons pour se tenir sur ses gardes, décide sa femme à en revêtir une. C’est elle-même, Tullia, qui raconte l’incident à son amie Ottavia: «Certes,» me dit-il, «je suis bien persuadé que tu es on ne peut plus honnête et chaste; néanmoins j’ai peur pour ta vertu, si toi et moi ne lui venons en aide. – Qu’ai-je donc fait pour qu’il te vienne à l’idée un soupçon pareil, mon cœur?» demandai-je; «quelle opinion as-tu de moi? Je n’entends pourtant pas m’opposer à ce que tu as pu résoudre. – Je veux,» reprit-il, «te mettre une Ceinture de chasteté; si tu es vertueuse, tu ne t’en fâcheras pas; dans le cas contraire, tu conviendras que c’est avec raison que je suis porté à agir de la sorte. – Je mettrai tout ce que tu voudras,» répliquai-je; «je n’existe que pour toi, je ne serai femme que pour toi, bien volontiers, isolée de tout le reste du monde, que je méprise ou que je déteste. Je ne parlerai pas même à Lampridio, je ne le regarderai même pas. – Ne fais pas cela,» s’écria-t-il; «au contraire, je veux que tu en uses avec lui familièrement, quoique honnêtement, et que ni lui ni moi nous n’ayons sujet de nous plaindre de toi: lui, si tu le traitais trop rudement, moi, si tu lui faisais trop bonne mine. La Ceinture de chasteté te permettra de vivre en pleine liberté avec lui, et me donnera vis-à-vis de Lampridio sécurité entière.» A l’aide d’un ruban de soie dont il m’entoura le corps au-dessus des reins, il prit alors la mesure, à la grosseur de mon corps, des dimensions que devait avoir la ceinture, puis, d’un autre ruban de soie, mesura l’intervalle de mes aines à mes reins. Cela fait: «J’aurai soin,» ajouta-t-il, «de te montrer ostensiblement combien je t’estime. Les chaînettes, qui doivent être recouvertes de velours de soie, seront en or; l’ouverture sera en or, et le grillage, en or aussi, sera extérieurement constellé de pierres précieuses. Un orfèvre, le plus renommé de notre ville, à qui j’ai souvent rendu des services, va s’appliquer à en faire le chef-d’œuvre de son art. Je te ferai donc honneur, tout en semblant te faire injure89.»
Quel honneur! M. de Laborde90 semble croire que les spécimens qui nous restent de ces engins sont dépourvus d’authenticité. «Des interprétations forcées,» dit-il, «ont donné une sorte d’existence légale à un conte et servi de passeport à des pièces curieuses de musées d’amateurs. Comme usage établi, ces Ceintures n’ont point existé, surtout chez une nation aussi spirituelle que la nôtre: comme lubie de quelque maniaque, elles peuvent avoir été forgées exceptionnellement. Je les rejette donc, et conseille aux amateurs d’en faire autant.» Qu’une telle pratique ait existé chez un peuple Européen à l’état de coutume générale, d’usage établi, nul ne le prétend; mais en Espagne, en Italie et même en France, les maris ou les amants jaloux qui ont jugé à propos d’y contraindre leurs femmes étaient peut-être plus nombreux qu’on ne pense. Quoi qu’en ait dit Molière, les verroux et les grilles sont des obstacles d’une efficacité réelle; l’efficacité sera bien plus grande encore si cette serrurerie est appliquée non seulement aux portes et aux fenêtres, mais à la personne même de la femme, rendue ainsi artificiellement invulnérable. A un point de vue très égoïste, le corps de la femme est comme le garde-manger des plaisirs de l’homme; quoi de plus simple que de mettre au garde-manger un cadenas, de peur que quelque intrus ne vienne faire main basse sur les meilleurs morceaux et dévorer les friandises?
En Europe, le plus ancien personnage dont l’histoire ou plutôt la légende fasse mention comme ayant appliqué à ses femmes ou à ses maîtresses un appareil de ce genre est Francesco da Carrara, le dernier seigneur souverain de Padoue au XIVe siècle. Freydier l’en considère comme l’inventeur. Il avait puisé ses renseignements dans l’abbé Misson (Voyage d’Italie, tome Ier, p. 112), qui dit avoir vu au Palais Ducal de Venise le buste de ce tyran «fameux par ses cruautés,» étranglé avec ses quatre enfants et son frère, par ordre du Sénat de Venise. «On y montre de plus,» ajoute-t-il, «un coffret de toilette dans lequel il y a six petits canons qui y sont disposés avec des ressorts ajustés d’une telle manière, qu’en ouvrant le coffret les canons tirèrent et tuèrent une dame, la comtesse Sacrati, à laquelle Carrara avait envoyé la cassette en présent. On montre avec cela de petites arbalètes de poche et des flèches d’acier dont il prenait plaisir à tuer ceux qu’il rencontrait sans qu’on s’aperçût presque du coup, non plus que de celui qui le donnait. Ibi etiam sunt seræ et varia repagula quibus turpe illud monstrum pellices suas occludebat91.» Dulaure, après Freydier, a quelque peu brodé sur ce passage. Il prétend, ce que ne dit pas Misson, quoiqu’il le laisse entendre, que ses actes de cruauté traînèrent sur l’échafaud Francesco da Carrara; qu’un des chefs d’accusation relevés contre lui fut l’emploi des Ceintures de chasteté dont il avait cadenassé toutes les femmes de son sérail, et que l’on conserva longtemps un coffre rempli de ces Ceintures et Cadenas comme pièces de conviction dans le procès fait à ce monstre. Le désir tout naturel d’avoir quelques détails sur un procès si extraordinaire et sur un tyran Moyen-âge si bien réussi, nous a conduit à faire quelques recherches, et notre désappointement a été grand de ne rien trouver, ou de ne trouver que des faits en contradiction complète avec les assertions de Misson, de Freydier et de Dulaure. Francesco II da Carrara, dont les Chroniques Italiennes recueillies par Muratori parlent presque toutes et très longuement, car il joua un rôle considérable à la fin du XIVe siècle, fut bien étranglé dans sa prison à Venise, mais comme ennemi politique, pour s’être emparé de Vérone et de quelques villes Lombardes à la mort de Galéaz Visconti. Bloqué dans Padoue et forcé de capituler, il reprit les armes, après avoir feint d’accepter les conditions du vainqueur qui, s’étant emparé de lui, résolut de s’en défaire. Son procès et son exécution sont racontés dans leurs plus menus détails par Andrea Navagero (Storia della republica Veneziana), par Sanuto (Vite dei Duchi di Venezia), par l’auteur du Chronicon Tarvisianum, et surtout dans l’Istoria Padovana d’Andrea Gattaro; de son sérail, de ses femmes cadenassées, de la boîte à surprise qui tua la comtesse Sacrati, des arbalètes de poche, il n’est pas dit un traître mot. L’abbé Misson aura prêté une oreille trop confiante aux contes d’un cicerone fallacieux. Restent donc seulement ces Cadenas et ferrements qu’il a dû voir et dont l’existence paraît certaine, qu’ils provinssent de Francesco da Carrara ou de tout autre. Moins d’un siècle après ce voyageur, quand le président de Brosses visita le petit Arsenal du Palais des Doges, ces engins se trouvaient réduits à un seul, et le sérail du tyran, diminué dans la même proportion, ne se composait plus que d’une femme, son épouse légitime. «C’est aussi là,» dit le spirituel président, «qu’est un Cadenas célèbre dont jadis un certain tyran de Padoue se servoit pour mettre en sûreté l’honneur de sa femme. Il falloit que cette femme eût bien de l’honneur, car la serrure est diablement large!» (Lettres familières, XVIe). Voilà comment s’évanouissent les légendes quand on les examine d’un peu près.
Le président de Brosses n’ayant pas jugé à propos de nous décrire ce Cadenas, et la pudeur de l’abbé Misson l’ayant empêché de dire autre chose que quelques mots, en Latin, de ceux qu’il avait vus, nous ne pouvons que conjecturer ce qu’ils étaient. Les divers systèmes employés dans la construction de ces appareils ingénieux nous sont heureusement connus, soit par des descriptions précises, soit par des spécimens encore existant dans les collections publiques. Le plus simple est celui d’une des Ceintures de chasteté conservées au Musée de Cluny. L’occlusion est formée par un bec d’ivoire rattaché par une serrure à un cerceau d’acier muni d’une crémaillère. Le bec d’ivoire, dont la courbe suit celle du pubis et s’y adapte exactement, est creusé d’une fente longitudinale pour le passage des sécrétions naturelles; la crémaillère permet d’ajuster à la taille le cerceau, qui est recouvert de velours, pour ne pas blesser les hanches, et on la maintient au cran voulu en donnant un tour de clef. Une tradition que rien ne justifie prétend que cette Ceinture est celle dont Henri II revêtait Catherine de Médicis; son exiguïté n’aurait pas permis de l’ajuster à une femme d’un aussi riche embonpoint que l’était la reine, à qui un soldat fit la réponse rapportée par Brantôme. Elle demandait pourquoi les Huguenots avaient donné son nom à une énorme couleuvrine: – «C’est, Madame,» lui dit l’homme, «parce qu’elle a le calibre plus grand et plus gros que toutes les autres.»
La Ceinture de chasteté décrite par N. Chorier dans l’ouvrage cité plus haut reposait sur une combinaison différente: un grillage d’or était maintenu fixe sur le pubis par quatre chaînettes dont deux, soudées au haut de la grille, s’attachaient par devant à la ceinture; deux autres s’attachaient par derrière en passant sous les cuisses.
Mais tout n’était pas en sûreté avec ce système, pas plus qu’avec le précédent. La grille d’or, comme le bec d’ivoire, ne protégeait que la chasteté du devant, en laissant l’autre absolument sans défense. Un Français pouvait s’en contenter, aussi croirions-nous volontiers ces engins de fabrication Française; mais un Italien du XVIe siècle (ménageons nos contemporains), n’aurait jamais cru sa femme entièrement sauvegardée par un appareil si incomplet. Les maris jaloux de ce temps-là étaient trop soupçonneux, trop bien au fait des habitudes de leurs compatriotes, pour ne prendre leurs précautions que d’un seul côté.