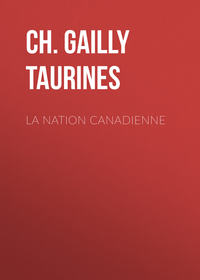Kitap dosya olarak indirilemez ancak uygulamamız üzerinden veya online olarak web sitemizden okunabilir.
Kitabı oku: «La Nation canadienne», sayfa 12
CHAPITRE XX
CANADIENS DANS LA NOUVELLE-ANGLETERRE
L'immigration canadienne a été plus grande encore dans la Nouvelle-Angleterre108 que dans l'Ouest. Là, le milieu était autre, les Canadiens pénétraient dans des pays depuis longtemps colonisés, leur vie fut plus modeste et plus calme. Simples ouvriers, pour la plupart, attirés par la prospérité manufacturière des État-Unis, ils n'ont pas eu à mener la pénible existence, ils n'ont pas traversé les émouvantes aventures, ils n'ont pas non plus acquis la bruyante renommée des Salomon Juneau, des Dubuque et des Joseph Rollette. S'il est une chance pourtant, pour les émigrants canadiens en Amérique, de conserver leur nationalité, c'est aux modestes ouvriers des États de l'Est qu'elle appartient, bien plus qu'aux descendants des brillants pionniers de l'Ouest.
On comptait en 1867 dans la Nouvelle-Angleterre plus de 360,00 °Canadiens, et les autorités les plus compétentes ne les portent pas aujourd'hui à moins de 500,000, non pas épars en petits groupes isolés, comme ceux de l'Ouest, mais parfaitement reliés entre eux, groupés d'une façon si compacte qu'en certaines localités ils ont la majorité dans les élections. Le lien religieux et l'organisation paroissiale les tiennent étroitement unis; voisins d'ailleurs de la province de Québec, demeurés en relations constantes avec elle, ils puisent là des exemples de patriotisme et d'attachement à leur nationalité.
Les Américains, si fiers du pouvoir d'absorption du leur République, s'étonnent et s'irritent de cette force de résistance. Ils avaient reçu les Canadiens avec la conviction qu'eux aussi se fondraient bientôt dans le grand creuset, et voilà qu'au lieu d'être absorbés, ce sont eux qui débordent, qu'au lieu de céder, ils attaquent. Les Allemands, les Scandinaves et toutes les populations d'Europe qui, depuis un siècle, se sont déversées en Amérique, sont devenues américaines; les Canadiens seuls demeurent Canadiens. C'est là un fait dont on commence à s'inquiéter aux États-Unis.
«L'émigration, dit le Times de New-York, n'est une source de force pour le pays qu'autant qu'elle est susceptible de s'assimiler à la population américaine, en d'autres termes à s'américaniser. Or les Canadiens-Français ne promettent nullement de s'incorporer à notre nationalité. Le danger n'est encore imminent dans aucun des États de l'Union, cependant dès maintenant il est suffisamment accusé, pour imposer à tout Américain, dans les États où les Canadiens-Français forment une partie considérable de la population, le devoir patriotique de maintenir les principes politiques américains contre toute atteinte qui pourrait leur être fait109.»
De ces ombrageux avertissements à un commencement de persécution, il n'y a pas loin. Déjà quelques fanatiques commencent à désigner les Canadiens des États-Unis à l'animosité de leurs concitoyens protestants.
L'American journal, de Boston, disait le 28 décembre 1889: «les Jésuites français ont conçu le projet de former une nation catholique avec la province de Québec et la Nouvelle-Angleterre; et ce projet de rendre la Nouvelle-Angleterre catholique et française a déjà pris des proportions capables d'alarmer les plus optimistes… Bientôt unis aux Irlandais, les Canadiens vous gouverneront, vous Américains, ou plutôt le Pape vous gouvernera, car ces masses le reconnaissent pour maître110.»
C'est là une de ces exagérations haineuses faisant appel aux plus mauvaises passions, car on sait ce que peut produire en pays protestant la menace de la domination du Pape.
Ces excitations ont commencé à porter leurs fruits; déjà l'on s'efforce de mettre des entraves à l'établissement des écoles canadiennes. Elles s'étaient multipliées à un tel point que dans certains États, dans le Massachussets par exemple, le nombre de leurs élèves dépassait de beaucoup celui des écoles publiques américaines. Le rapport officiel du bureau d'Éducation pour 1890 constatait le fait: «Le récent mouvement qui s'est opéré dans l'État, disait-il, par suite duquel l'accroissement annuel du nombre des élèves des écoles publiques est tombé au-dessous de l'accroissement correspondant des écoles privées, est de nature à provoquer une impression de profond regret111.»
Des règlements sévères ont été faits pour arrêter la multiplication des écoles de paroisses. Des difficultés sont suscitées aux familles, des condamnations et des amendes infligées, et la population canadienne de la Nouvelle-Angleterre va être soumise peut-être à une persécution semblable à celle que subissent les Canadiens du Manitoba.
Mais, remarquons qu'ici leur situation semble autrement favorable. Dans la Nouvelle-Angleterre nous nous trouvons en présence d'un double mouvement ethnographique considérable et incontesté: l'accroissement rapide de la population canadienne et la décroissance non moins rapide des populations américaines. Le mot de décadence ne serait lui-même pas trop fort, et si dans la province anglaise d'Ontario, comme nous l'avons dit plus haut, le nombre moyen des membres de la famille a notablement diminué depuis vingt ans, aux États-Unis, et spécialement dans la Nouvelle-Angleterre, cette diminution a pris les proportions d'un véritable désastre. Il faut lire dans l'ouvrage d'un Anglais, M. Epworth Dixon112, grand ami et grand admirateur pourtant de l'Amérique et des Américains, le curieux chapitre intitulé: Elles ne veulent pas être mères, pour juger de la plaie qui ronge les États-Unis dans leur avenir, et pour se rendre compte que l'égoïsme de la richesse produit en Amérique des effets autrement désastreux encore qu'en Europe.
La décadence de la population des États-Unis! Cela semble un paradoxe en présence de ses 60 millions d'habitants, presque tous gagnés en notre siècle; rien de plus exact pourtant. L'augmentation de la population américaine est tout artificielle, elle lui vient de l'extérieur, et sans la formidable immigration qui la renouvelle sans cesse, bien des États verraient décroître le nombre de leurs habitants.
Ce sont là des faits constatés par tous les écrivains qui ont étudié les États-Unis113; ils sont appuyés sur le témoignage des statisticiens, des médecins et des journalistes américains eux-mêmes, et nul ne conteste plus aujourd'hui les témoignages de tant d'hommes compétents et éclairés.
Le dernier recensement a rendu ces faits plus évidents encore. Nulle part le mouvement de dépopulation des campagnes ne se fait sentir comme aux États-Unis, ce pays où la terre ne manque pas aux agriculteurs, mais où les agriculteurs manquent à la terre. De 1870 à 1880, 138 comtés ruraux avaient vu décroître leur population. De 1880 à 1890, il y en a eu 400114!
Bien que dans la dernière décade l'immigration ait précisément atteint son maximum, l'augmentation de la population s'est trouvée moindre que dans toutes les précédentes. Le flot grossissant venant d'Europe n'est pas parvenu à combler les déficits causés par la diminution de la natalité, et tandis que de 1880 à 1890 trois millions d'émigrants sont arrivés en plus que dans la période précédente, l'augmentation de population n'a atteint que la proportion de 24 pour 100, tandis qu'avec un moindre renfort et un plus faible appoint elle s'était élevée à 30 pour 100 de 1870 à 1880115.
Certains États ont même vu décroître le nombre absolu de leurs habitants, et ce sont justement les États nouveaux dans lesquels la population manque, tandis qu'elle va s'agglomérer dans les grandes villes, où son accumulation devient un danger116.
L'État du Kansas a vu diminuer sa population. Celui du Névada, de 62,000 habitants qu'il possédait en 1871, est tombé à 45,000. Un publiciste facétieux a calculé qu'en continuant sur le même pied, la population du Névada serait dans vingt-cinq ans réduite à un seul habitant. «Cet heureux coquin, ajoute-t-il, accaparera toutes les places, s'élira lui-même sénateur et touchera le per diem, ce qui est le point essentiel117.»
L'immigration, qui seule empêche la population des autres États de décroître, n'est en somme qu'une ressource précaire; elle peut diminuer, cesser même entièrement. Le territoire des États-Unis n'offre pas des ressources illimitées; un jour viendra où il ne tentera plus l'émigrant, et ce jour n'est peut-être pas éloigné. Déjà-la décadence des districts ruraux en est la preuve-il n'attire plus l'émigrant agricole. Attirera-t-il longtemps encore l'émigrant industriel, l'ouvrier? La question sociale ne se pose-t-elle pas déjà aux États-Unis tout comme en Europe, et dès que les conditions de travail y seront les mêmes que dans le vieux monde, quel avantage le nouveau aura-t-il sur celui-ci?
Si l'immigration venait à cesser, quelle serait la situation des populations de langue anglaise aux États-Unis, saisies, au milieu de leur décadence, par des populations pleines de sève et de vigueur, prêtes à prendre leur place, et dont les plus vivaces sont les Canadiens et les Allemands?
Dans l'Ouest, les Allemands commencent à relever la tête et cessent de s'américaniser. Dans la Nouvelle-Angleterre, voisine des frontières de Québec, les Canadiens se multiplient rapidement, et non contents d'occuper tous les emplois dans les fabriques, s'emparent encore de la terre, en acquérant les fermes, abandonnées de plus en plus par leurs propriétaires américains.
Il n'est donc nullement chimérique d'avancer que la population canadienne se maintiendra et s'augmentera dans les États-Unis. Son mouvement d'expansion n'est qu'à son début, et nous voyons aujourd'hui peut-être les symptômes d'un changement ethnographique considérable qui se prépare en Amérique.
M. E. Reclus a établi que si la marche de la population reste au Canada ce qu'elle est aujourd'hui, la Nouvelle-France l'emportera sur l'ancienne par le nombre de ses habitants avant la fin du vingtième siècle. Quelle action prendra cette France américaine, toute vivante et toute vigoureuse, sur une population anglo-saxonne en décadence!
Déjà l'influence politique des Canadiens des États-Unis-malgré les tracasseries et les persécutions auxquelles on essaye de les soumettre-est en concordance avec leur accroissement numérique. Dans chacune des Chambres législatives des États de la Nouvelle-Angleterre, ils comptent des représentants. Ils en ont 4 dans le Maine, 8 dans le New-Hampshire, 1 dans Massachussets, 1 dans le Vermont, 1 dans Rhode-Island (en 1890).
Au delà même de la petite sphère des États qu'ils habitent, les Canadiens commencent à gagner une certaine influence sur la politique générale de l'Union. Dans les élections présidentielles, les candidats recherchent leurs voix et s'efforcent de les obtenir en promettant aux Canadiens des faveurs et des emplois. Dans la dernière élection, les partisans du président Harisson avaient publié une liste de tous les Canadiens admis ou maintenus dans des fonctions publiques sous son administration.
Les Canadiens des États-Unis possèdent une presse active, représentée par une vingtaine de journaux publiés en français. Ils ont un clergé, patriote comme sait l'être le clergé canadien. Unis entre eux par un lien de cohésion puissant, ils se groupent en des sociétés nationales très vivaces. Ils possèdent en un mot tous les éléments de force par lesquels les Canadiens ont conservé leur nationalité sous le régime anglais; pourquoi ne la conserveraient-ils pas sous le régime américain?
CHAPITRE XXI
PATRIOTISME ET SENTIMENT NATIONAL DES CANADIENS
Territoire vaste et productif, population exubérante, ces deux éléments matériels de toute nationalité, les Canadiens les possèdent; mais ils ont mieux encore, ils ont ce sentiment puissant sans lequel la prospérité matérielle d'une nation n'est rien: le patriotisme.
Ne nous trompons pas, toutefois, nous Français, sur la nature du patriotisme des Canadiens, et si nous les voyons vénérer avec nous la vieille France et aimer la nouvelle, s'enorgueillir de nos triomphes et pleurer nos défaites, n'allons pas nous imaginer qu'ils regrettent notre domination et que leur espérance est de s'y soumettre de nouveau. Ce ne sont là ni leurs regrets, ni leurs désirs. Ils sont aussi jaloux de leur particularisme national que fiers de leur origine française.
Ce n'est pas d'hier qu'est né ce sentiment tout particulier et tout local. Il n'est pas dû à la conquête anglaise. Depuis la création même de la colonie, il existait à l'état latent, mais ne se révélait que par de légers indices. S'il s'affirme aujourd'hui par d'éclatantes manifestations, c'est que la colonie est devenue une nation.
Les premières générations de Français qui virent le jour sur la terre d'Amérique apprirent à joindre, dans une même affection, cette patrie nouvelle à la vieille patrie de France. Mais pour l'une cette affection n'était basée que sur des souvenirs; pour l'autre, elle l'était sur la plus poignante des réalités, la lutte pour la vie, la conquête d'un patrimoine et d'un foyer. La préférence n'était pas douteuse, et c'est ainsi que se forma parmi les Canadiens une sorte d'esprit particulariste, non pas blâmable, mais basé au contraire sur l'un des meilleurs instincts du cœur humain: l'amour du sol natal.
Les gouverneurs français ne surent pas toujours discerner les louables origines de ce sentiment; ils s'efforcèrent de le combattre quand il eût fallu peut-être l'encourager. S'il n'y eut jamais de conflits, il se produisit du moins des froissements; ils auraient pu s'aggraver si la domination française s'était prolongée avec le même esprit de centralisation, le même parti pris de faire dominer en tout les idées et les intérêts de la métropole. Et qui sait alors ce que seraient devenus la fidélité des Canadiens et leur amour de la patrie française, mis en opposition avec leurs intérêts et leur patriotisme local?
Déjà durant la malheureuse campagne qui nous fit perdre le Canada, avaient commencé à se manifester-à cette heure de périls où l'union eût été si nécessaire-des signes de division et de rivalité. On voit alors dans la colonie deux partis s'agiter et intriguer l'un contre l'autre: le parti canadien et le parti français. Ils ont chacun leurs chefs parmi les officiers ou les administrateurs, et correspondent l'un et l'autre en France avec les ministères, auprès desquels ils se combattent à outrance, à coups de dépêches et de dénonciations.
Le gouverneur général, marquis de Vaudreuil118, né au Canada, et fils lui-même d'un ancien gouverneur, défend auprès du ministre de la marine, – dont il dépend, – les intérêts des Canadiens.
Le marquis de Montcalm, commandant en chef des troupes de terre envoyées pour la campagne, a trop de tendance, ainsi que ses officiers, à mépriser les colons, et ce mépris, très injustifié, perce dans ses dépêches au ministre de la guerre.
Soldats et officiers ne peuvent se faire à cette idée que, dans ce pays si différent de l'Europe, désert, couverts d'épaisses forêts, sillonné de rivières et de lacs solitaires, la guerre puisse se faire d'une autre façon que sur le vieux continent. De l'expérience des troupes de la colonie-dépendant du gouverneur et de la marine-ils ne peuvent admettre qu'ils puissent rien apprendre, et c'est presque à regret qu'ils gagnent des batailles suivant des principes nouveaux pour eux: «La conduite que j'ai tenue, écrit Montcalm au ministre après la prise du fort Oswego en 1756, et les dispositions que j'avais arrêtées sont si fort contre les règles ordinaires, que l'audace qui a été mise dans cette entreprise doit passer pour témérité en Europe. Aussi, je vous supplie, Monseigneur, pour toute grâce, d'assurer Sa Majesté que, si jamais elle veut m'employer dans ses armées, je me conduirai par des principes différents119»
Du peu d'égards témoignés par Montcalm aux troupes de la colonie, de ses duretés même envers les Canadiens, Vaudreuil se plaignait amèrement au ministre de la marine: «Les troupes de terre, écrit-il à M. de Machault, le 23 octobre 1756, sont difficilement en bonne intelligence avec nos Canadiens; la façon haute dont leurs officiers traitent ceux-ci produit un très mauvais effet. Que peuvent penser des Canadiens les soldats qui voient leurs officiers, le bâton ou l'épée à la main sur eux?.. M. de Montcalm est d'un tempérament si vif qu'il se porte à l'extrémité de frapper les Canadiens. Je lui avais recommandé instamment d'avoir attention que MM. les officiers des troupes de terre n'eussent aucun mauvais procédé envers eux; mais comment contiendrait-il ses officiers puisqu'il ne peut pas lui-même modérer ses vivacités120.»
De leur côté, les amis du commandant des troupes de terre dénonçaient violemment Vaudreuil, et comme gouverneur et comme Canadien, au ministre de la guerre: «Si l'on veut sauver et établir solidement le Canada, écrit un commissaire des guerres au maréchal de Belle-Isle, que Sa Majesté en donne le commandement à M. le marquis de Montcalm. Il possède la science politique comme les talents militaires. Homme de cabinet et de détail, grand travailleur, juste, désintéressé jusqu'au scrupule, clairvoyant, actif, il n'a d'autre vue que le bien; en un mot, c'est un homme vertueux et universel… Quand M. de Vaudreuil aurait de pareils talents en partage, il aurait toujours un défaut originel: il est Canadien.»
Stupéfiante appréciation qui, en un seul mot, montre dans toute son étendue la méfiance qui régnait alors contre l'esprit local dans les colonies. Être Canadien était un défaut qui, de prime abord, devait rendre inhabile à l'exercice du pouvoir. Pour gouverner les Canadiens, il fallait des Français. La métropole était tout, la colonie et les colons, rien!
Ces divergences, ces froissements même, se seraient peut-être envenimés avec le temps. L'affranchissement des colonies est un événement que l'histoire nous montre comme inévitable; qui sait si le Canada, froissé dans tous ses sentiments, réprimé dans toutes ses aspirations, ne se serait pas séparé violemment d'une patrie autoritaire et injuste? Qui sait si de pénibles souvenirs ne fussent pas demeurés pour longtemps-pour toujours, peut-être-entre ces deux rameaux d'une même nation: entre la France humiliée de la rupture, et sa colonie affranchie mais pleine de rancune de la lutte?
La conquête anglaise a prévenu peut-être cet événement; violente elle aussi et douloureuse, mais moins désastreuse à tout prendre que ne l'eût été une lutte fratricide entre Français. Séparés de force d'une patrie qu'ils voulaient conserver et pour laquelle ils avaient énergiquement combattu, les Canadiens lui ont gardé un souvenir pieux et voué un culte inaltérable.
Dès lors, le vague sentiment de l'amour du sol natal se compléta, s'élargit, se transforma peu à peu en un véritable sentiment de patriotisme, auquel il ne manque aujourd'hui aucun des caractères que, chez les nations les plus grandes et les plus unies, revêt cette fière passion: souvenirs vénérés du passé, juste fierté du présent, et foi dans l'avenir.
De souvenirs du passé, les Canadiens n'en manquent pas. Peuple tout nouveau et né d'hier, ils n'ont derrière eux que trois cents ans d'histoire; et qu'est-ce que trois cents ans dans la vie d'une nation? Mais de combien d'actions héroïques et d'événements glorieux ils ont su remplir cette brève existence!
Les premières traditions canadiennes se trouvent justement liées aux plus belles traditions de notre propre histoire: c'est au temps de notre plus grande gloire nationale que le Canada prend naissance. François Ier, Henri IV, Richelieu, Louis XIV, Colbert, tous ces noms appartiennent aux Canadiens comme ils nous appartiennent; ce sont ces grands hommes qui ont présidé à la création de leur pays et l'ont protégé en même temps qu'ils agrandissaient la France et la rendaient glorieuse. Le navigateur qui découvre le fleuve Saint-Laurent, Jacques Cartier, le colonisateur qui le premier y établit une colonie, Samuel de Champlain, ce sont là certes des héros français, dignes de leur temps, de leur pays et des rois qu'ils servaient, mais ce sont aussi des héros canadiens, et de la gloire qu'ils ont donnée à l'histoire de France, les Canadiens revendiquent une part pour leur propre histoire.
C'est à travers les œuvres mêmes de leurs historiens et de leurs poètes qu'il faut étudier ces héros pour apprécier le culte dont ils les entourent, et reconnaître l'attitude spéciale, presque hiératique, qu'ils leur donnent. L'abbé Casgrain, un des meilleurs historiens du Canada, nous montre «la noble figure de Cartier, d'une grandeur et d'une simplicité antiques, ouvrant dignement la longue galerie de portraits héroïques qui illustrent les annales canadiennes121» Sous la plume de ces écrivains patriotes, le navigateur malouin dépasse la taille humaine et prend les proportions d'un prophète, d'un de ces hommes sacrés que le doigt de Dieu marque pour changer les destinées du monde, et que sa main pousse, d'une façon invisible, mais constante et irrésistible, à l'accomplissement d'un mystérieux devoir. Cartier n'est plus le hardi marin au cœur de bronze, au bras robuste, qui lance sans crainte son vaisseau dans des eaux et vers des rivages inconnus; c'est un homme prédestiné, presque un saint, qui, les yeux fixés au ciel et le bras tendu vers l'infini, marche à la conquête d'une nouvelle terre pour un peuple nouveau. «Cartier, ce n'est plus le maître pilote, ou même le capitaine général du seizième siècle; Cartier, pour nous, c'est le précurseur de Champlain, de Laval, de Brébeuf, de Frontenac, de tous nos héros et de tous nos apôtres122.»
Un éclair brille au front de ce prédestiné,
dit encore le poète Fréchette123. Et avec quel lyrisme mêlé pour ainsi dire de respect le même poète nous montre, du haut des vieilles tours de Saint-Malo,
Cartier et ses vaisseaux s'enfonçant dans la brume,
puis, marchant toujours vers sa providentielle destinée, aborder enfin ces rives mystérieuses et désertes où
Nul bruit ne vient troubler le lugubre silence
Qui, comme un dieu jaloux, pèse de tout son poids
Sur cette immensité farouche des grands bois.
Mais ce charme magique, Cartier l'a rompu; cette terre déserte sur laquelle il débarque, c'est celle que Dieu a réservée au peuple canadien: elle est prête, il peut venir, et c'est lui qui va fonder
«Sur ces rives par Dieu lui-même fécondées
Un nouvel univers aux nouvelles idées.»
… Donc, gloire à toi Cartier,
Gloire à vous, ses vaillants compagnons, groupe altier
De fiers Bretons taillés dans le bronze et le chêne!
Vous fûtes les premiers de cette longue chaîne
D'immortels découvreurs, de héros canadiens
Qui, de l'honneur français inflexibles gardiens,
Sur ce vaste hémisphère où l'avenir se fonde,
Ont reculé si loin les frontières du monde!
Après le précurseur Cartier, le fondateur Champlain: nouveau héros, nouveaux panégyriques. Quel patriotique lyrisme anime encore l'abbé Casgrain en nous présentant à son tour cette grande figure: «Quand, aux heures de solitude, dit-il, dans le silence et le recueillement de l'âme, nous remontons vers le passé, et que, saisis d'une religieuse émotion, nous pénétrons dans le temple de notre histoire, parmi tous ces héros dont les robustes épaules soutiennent les colonnes de l'édifice, nul mieux que Champlain ne porte sur un visage plus noble de plus majestueuses pensées. Type et modèle de tous ces héros qu'un même honneur assemble, il occupe le rang suprême près de l'autel de la patrie124.»
La légende elle-même et le merveilleux se mêlent aux origines de la nation canadienne.
La France ancienne a ses héroïnes tout entourées d'auréoles et de religieuse poésie; les Canadiens, eux aussi, veulent pour leur pays des saintes et des héroïnes: «Parfois, aux jours suprêmes, dit encore Casgrain, la femme apparaît au premier rang pour le salut des peuples. Élue de Dieu, dans le palais ou sous le chaume, elle portera le bandeau royal ou la houlette et s'appellera sainte Hélène, Geneviève de Paris, Clotilde, Blanche de Castille ou Jeanne d'Arc. Autour du berceau du peuple canadien, un cercle de vierges la saluera avec Bossuet du nom de Thérèse de la Nouvelle-France125.»
Thérèse de la Nouvelle-France, c'est la fondatrice des Ursulines de Québec, la Mère Marie de l'Incarnation, dont l'abbé Casgrain a écrit la touchante et captivante histoire. Plein d'amour et de respect pour un sujet qui touche à la fois ses sentiments religieux de prêtre et ses sentiments patriotiques de Canadien, voyez avec quelle finesse de pinceau, avec quelle délicatesse de touche il peint le berceau de son héroïne! «Il existe, dit-il, au centre de la France, une contrée charmante entre toutes celles qui l'environnent, et dont le nom seul réveille d'agréables souvenirs. Le doux pays de la Touraine, qui fut le berceau de plusieurs familles de la Nouvelle-France, a de tout temps été célèbre par la fertilité de ses vastes prairies, la richesse de ses vignobles, la douceur de son climat et l'aménité de ses habitants. Arrosées par l'un des plus beaux fleuves de la France, ses campagnes sont émaillées de riants bocages et de villages pittoresques qui s'élèvent au fond des vallées ou couronnent les collines, dont les courbes harmonieuses se prolongeant au loin jusqu'à l'horizon, encadrent tout le paysage dans cadre de gracieuses ondulations.
«Les grands seigneurs du royaume, attirés par la beauté du pays, aimèrent de tout temps à y fixer leur séjour, et l'on voit encore aujourd'hui surgir, du sein des massifs de verdure, les tourelles élancées de leurs antiques châteaux. Longtemps aussi les rois de France tinrent leur cour dans la capitale de cette province qui a été nommée le jardin de la France et le plaisir des rois126.»
Un tel paysage n'était-il pas seul digne d'encadrer la naissance de l'héroïne religieuse du Canada?
Nous avons parlé déjà des missionnaires martyrs du dix-septième siècle, les Jogues, les Brébeuf, les Lallemand, auxquels les Canadiens ont voué un véritable culte, et dont ils inscrivent avec orgueil les noms à côté de ceux de leurs grands administrateurs et de leurs grands capitaines. Tels sont leurs souvenirs religieux et sacrés.
De gloires militaires ils ne manquent pas non plus. Sol généreux que le sol canadien, deux générations à peine l'avaient foulé qu'il produisait déjà des héros! N'est-ce pas une véritable odyssée que l'histoire de ces sept frères, les Le Moyne, tous nés à Montréal, tous marins, et qui tous se distinguèrent dans les guerres navales de la fin du dix-septième siècle? Tous les sept: Le Moyne de Sainte-Hélène, Le Moyne de Maricourt, Le Moyne de Longueil, Le Moyne de Serigny, Le Moyne de Châteauguay, Le Moyne de Bienville, Le Moyne d'Iberville, au nord, au sud, à l'orient et à l'occident, combattent à la fois les Anglais. Mais entre ces sept noms, il en est un qui brille d'un éclat capable d'effacer à lui seul tous les autres, c'est celui d'Iberville.
Dans les glaces de la mer d'Hudson comme sous le soleil brûlant du golfe du Mexique, à Terre-Neuve comme aux Antilles, partout, durant les guerres de la Ligue d'Augsbourg et celle de la succession d'Espagne, d'Iberville fait connaître aux Anglais la vigueur de son bras et la valeur de son sang canadien. Toujours vainqueur des éléments et des hommes, c'est lui qui pouvait écrire au ministre de la marine après plusieurs campagnes dans les mers de l'extrême Nord: «Je suis las, Monseigneur, de conquérir la baie d'Hudson!»
«Si ses campagnes prodigieuses par leurs résultats, obtenus avec les plus faibles moyens matériels, avaient eu l'Europe pour témoin, et non les mers sans retentissement des voisinages du pôle, il eût eu, de son vivant et après sa mort, un nom aussi célèbre que ceux des Jean-Bart, des Duguay-Trouin et des Tourville, et fût, sans aucun doute, parvenu aux plus hauts grades et aux plus grands commandements dans la marine127.»
Canadien, d'Iberville l'est autant par le théâtre de ses exploits que par sa naissance; il ne quitte pas les mers d'Amérique bien qu'il n'en touche guère la terre. Pas une heure de repos dans sa vie: toujours embarqué, toujours en guerre, toujours vainqueur. En 1693, entre deux campagnes, il prend pourtant le temps de descendre à Québec et d'y épouser la fille d'un vieil officier du régiment de Carignan, Marie-Thérèse Lacombe de Lapocatière, puis se rembarque aussitôt avec sa femme, et leur premier-né vient au monde à bord dans les eaux de Terre-Neuve!
Aventures, combats, canonnades, naufrages, amour, mariage, tout cela se mêle et se heurte dans la vie de d'Iberville. Quel plus beau héros de contes et de légendes populaires? Aussi les soirs d'hiver, quand les portes sont closes, que le vent souffle et que le feu pétille, est-ce son histoire que content, à leurs petits-enfants attentifs, les aïeuls à la voix tremblotante dans les frileuses maisons canadiennes.
D'Iberville mourut à la Havane en 1706, durant une campagne. De ses six frères, deux furent tués à l'ennemi: Le Moyne de Sainte-Hélène au siège de Québec en 1690, et Le Moyne de Châteauguay à la baie d'Hudson en 1694. Un autre d'entre eux, Le Moyne de Bienville, est, presque à l'égal de d'Iberville, célèbre parmi les marins français, comme fondateur de la Nouvelle-Orléans et premier gouverneur de la Louisiane.
Cette famille qui donna tant de héros au Canada128 n'est pas éteinte, elle est représentée aujourd'hui à Québec par M. J. – M. Le Moyne, écrivain de talent, qui a enrichi la littérature canadienne de plusieurs ouvrages intéressants.
Les exemples, d'ailleurs, qu'elle a donnés n'ont pas été sans imitateurs; d'autres familles aussi nombreuses ont rivalisé avec celle-là, et par l'importance des services qu'elles ont rendus à leur patrie, et par le nombre même des héros qu'elles ont produits. Le dix-huitième siècle a vu l'incroyable odyssée de Varennes de La Vérandrye, qui, avec ses fils et ses neveux, parcourt pendant sept ans les régions alors inconnues du centre de l'Amérique, au nord des Grands Lacs, et découvre enfin vers l'ouest la grande chaîne des Montagnes Rocheuses.
Tous ces noms, depuis les Jacques Cartier jusqu'aux d'Iberville et aux La Vérandrye, appartiennent à l'histoire de France en même temps qu'à celle du Canada. Mais la séparation des deux pays n'a pas interrompu, au delà de l'Atlantique, la chaîne des traditions canadiennes, ni tari la source des héroïsmes. Que de noms glorieux encore dans les nouvelles annales! Ce sont d'abord les miliciens de 1812, ces 60 °Canadiens qui, sous les ordres du colonel de Salaberry, défendent, contre l'invasion d'une armée de 3,000 Américains, le défilé de Châteauguay, – les Thermopyles canadiennes! – conquérant ainsi le double orgueil d'une victoire brillante contre un ennemi redoutable, remportée pour sauver le drapeau compromis de leurs fiers conquérants britanniques. Quelle chevaleresque revanche de la défaite de Montcalm dans les plaines d'Abraham! Le poète canadien peut aujourd'hui s'écrier:
Le nouveau gouverneur avait été d'abord gouverneur de la Louisiane de 1742 à 1755.