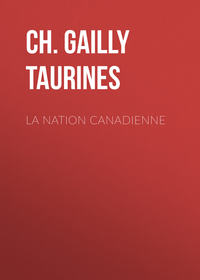Kitap dosya olarak indirilemez ancak uygulamamız üzerinden veya online olarak web sitemizden okunabilir.
Kitabı oku: «La Nation canadienne», sayfa 13
Maintenant, sur nos murs, quand un geste ironique
Nous montre, à nous Français, l'étendard britannique
Que le sang de Wolfe y scella,
Nous pouvons, et cela suffit pour vous confondre,
Indiquer cette date, ô railleurs, et répondre:
«Sans nous, il ne serait plus là129!»
A côté des héros militaires, les martyrs politiques. L'insurrection de 1837-1838 crée de nouveaux souvenirs, fait surgir de nouveaux noms. C'est Chénier, l'un des chefs du mouvement, qui, au combat de Saint-Eustache, le 14 décembre 1837, interpellé par quelques-uns de ses hommes qui se plaignaient de n'avoir pas d'armes, répond par cette parole digne de l'antiquité: «Attendez le combat, vous aurez celles des morts130», et qui, après une défense héroïque, mais sans espoir, tombe percé de balles avec la plupart de ses compagnons.
Après la sanglante répression opérée par les troupes anglaises contre ces quelques poignées de braves, après les incendies, après les massacres, l'échafaud se dresse à Montréal et, du 23 décembre 1838 au 15 février 1839, voit se succéder douze victimes131.
Le sang répandu devait, en effet, devenir pour le peuple canadien une source de souvenirs patriotiques et une semence féconde de liberté.
L'une des victimes, Marie-Thomas Chevalier de Lorimier, la veille même de son exécution, avec le calme et la foi d'un martyr, se réjouissait, dans une sorte de testament politique, de donner bientôt sa vie à une si belle cause, et de verser son sang pour «arroser l'arbre de liberté sur lequel flottera un jour le drapeau de l'indépendance canadienne133».
Rien n'égale l'attachement et la fierté des Canadiens pour tous ces souvenirs, anciens ou nouveaux, militaires, religieux ou civils. Partout, dans les salons des villes comme dans la primitive demeure de l'habitant défricheur ou dans le chantier des bûcherons au sein de la forêt, vous en entendez le récit, fait avec la même foi, le même respect et le même enthousiasme. Les historiens, les romanciers, les poètes prennent soin eux-mêmes de raviver par leurs écrits la mémoire de tant de hauts faits.
Pour que les générations futures elles-mêmes ne puissent oublier ni ces grands hommes, ni leurs actions, les Canadiens ont érigé des monuments à leur mémoire. Peuple tout jeune, ils veulent avoir, comme les vieilles nations, des panthéons pour leurs gloires nationales: navigateurs, missionnaires, guerriers, administrateurs, tous ont été célébrés par le marbre ou par le bronze.
En face de Québec, au confluent de la petite rivière Saint-Charles dans le Saint-Laurent, à l'endroit même où Jacques Cartier passa l'hiver de 1535 à 1536, s'élève le monument que les habitants de la ville ont, en 1889, érigé au découvreur du Canada. A Montréal, le fondateur de la ville, M. de Maisonneuve, a lui aussi, depuis cette année, un monument auquel a contribué par une souscription le gouvernement français: «La France, disait à cette occasion l'un des orateurs qui prirent la parole lors de l'inauguration, la France s'est souvenue, les Canadiens n'ont jamais oublié134!»
Sur le plateau qui domine Québec, nommé par les habitants les plaines d'Abraham135 et sur lequel, par deux fois, le sort du Canada s'est joué par les armes, un monument encore rappelle la dernière victoire gagnée par les Français sur le sol canadien, sous les ordres du chevalier de Lévis, le 28 avril 1760.
Nous avons parlé déjà, et tout le monde a lu quelque description de la pyramide élevée sur la terrasse de Québec à la mémoire de Montcalm et de Wolfe, et connaît l'inscription célèbre qui rappelle leur mort glorieuse, l'un dans la défaite, l'autre dans la victoire:
«Mortem virtus, communem famam historia, monumentum posteritas dedit.»
Salaberry, le héros de Châteauguay, a, lui aussi, dans le lieu qui fut sa résidence et qui reste sa sépulture, une statue, due au ciseau d'un sculpteur canadien, connu à Paris, où ses œuvres ont figuré avec honneur au Salon annuel et aux Expositions universelles, M. Hébert.
A ceux de leurs gouverneurs anglais eux-mêmes qui se sont montrés justes envers leur nationalité, la reconnaissance des Canadiens a voué des monuments, et parmi les œuvres de sculpture qui doivent orner la façade du Palais législatif à Québec, figurera la statue de lord Elgin, à côté de celles des Cartier, des Champlain, des Frontenac et des Montcalm. Lord Elgin est ce gouverneur aux larges vues et au cœur droit qui, en 1849, ne craignit pas de sanctionner le bill voté par l'Assemblée législative canadienne en faveur des victimes de l'insurrection de 1837, et qui, réparant ainsi une grande injustice, s'attira à la fois la reconnaissance des Canadiens et la haine farouche de la portion fanatique de la population anglaise.
Le sculpteur a pris soin de le représenter tenant dans la main gauche la copie du fameux bill, tandis que de la droite il semble s'apprêter à signer cet acte de réparation et de justice. La présence de cette figure de grand seigneur anglais parmi le groupe des héros français n'est-elle pas elle-même une preuve de l'attachement des Canadiens à leur nationalité, puisqu'elle témoigne de la reconnaissance qu'ils gardent à ceux qui savent la respecter?
Les victimes glorieuses de 1837 ont, elles aussi, un monument érigé en leur mémoire dans le cimetière de Montréal, et rappelant leurs noms, la date des combats livrés et celle de leur mort.
Presque tous ces monuments sont modestes par leurs proportions, mais ils sont grands par l'idée qui présida à leur érection.
Le Palais législatif de Québec répond d'ailleurs, par le développement de sa majestueuse façade, par sa superbe situation en terrasse dominant la ville, à la grandeur même du dessein suivant lequel il a été construit. Les statues qui ornent ses murs136, les inscriptions et les devises qui courent en lettres d'or sur ses lambris intérieurs en font comme un monumental résumé de l'histoire des Canadiens-Français, comme le vrai Panthéon de leurs gloires nationales137.
CHAPITRE XXII
LA LANGUE FRANÇAISE AU CANADA
Le sculpteur et l'architecte ne sont pas les seuls à célébrer les gloires canadiennes, les prosateurs et les poètes, d'une façon bien plus active et bien plus efficace, alimentent, par l'histoire, le roman ou les chants lyriques, la flamme sacrée du patriotisme. Nous dirons plus loin leur grande tâche et leurs succès. Mais avant de parler de la littérature française au Canada, il est intéressant de dire un mot de la langue française elle-même, des assauts que les Anglais lui ont fait subir depuis la conquête et de l'inutilité absolue de ces attaques.
Les conquérants avaient cru tout d'abord imposer facilement leur langue à leurs nouveaux sujets. Ils en doutaient si peu, que le général Murray, à peine installé à Montréal, désorganisa les tribunaux français, et fit rendre la justice suivant les lois anglaises, par des commissions militaires prises parmi ses officiers. Les Canadiens refusèrent de s'en remettre à ces «juges éperonnés» (comme les appelle Garneau), et soumirent tous leurs différends à leurs curés et aux notables de leurs villages. Cette organisation militaire de la justice ne dura que pendant la période de guerre, de la capitulation de Montréal jusqu'à la paix. Dès que le traité de Paris eut, d'une façon définitive, transféré le Canada aux Anglais, ceux-ci, déjà mieux instruits des dispositions des habitants par une occupation de quatre années, comprirent l'inutilité de leurs efforts pour imposer tout d'un coup la langue anglaise aux populations. De nouveaux tribunaux furent créés, devant lesquels les deux langues furent également admises.
Si, renonçant à la violence pour l'imposer, les Anglais comptaient sur le temps pour faire accepter la langue anglaise aux Canadiens, ils se trompaient encore; les canadiens demeurèrent strictement fidèles à leur langue maternelle, et surent bientôt conquérir pour elle, non plus seulement la tolérance de leurs vainqueurs, mais un véritable droit de cité qui la mit sur un pied d'égalité parfaite avec la langue anglaise elle-même.
L'acte de 1774, arraché au gouvernement anglais par des nécessités politiques, et par l'obligation où il était réduit de s'assurer de la fidélité des Canadiens contre l'hostilité croissante de tous les autres colons d'Amérique, déclara que la langue française serait désormais langue officielle à l'égal de l'anglais, et servirait, conjointement avec lui, à la promulgation des lois et des règlements.
Ce privilège lui demeura jusqu'en 1840. L'acte d'Union qui intervint alors et organisa au Canada une nouvelle constitution, entièrement combinée pour la répression et l'humiliation des Canadiens, en punition de leur révolte de 1837-38, enleva à la langue française son titre et ses prérogatives de langue officielle.
Une telle mesure, prise dans un pays presque entièrement français, méritait une protestation. Cette langue que la loi prétendait exiler de leur Parlement, les Canadiens l'y rétablirent de force. Dès la première séance, l'un de leurs députés, M. Lafontaine, invité par un de ses collègues anglais à s'exprimer en anglais, fit cette fière réponse: «Quand même la connaissance de la langue anglaise me serait aussi familière que celle de la langue française, je n'en ferais pas moins mon premier discours dans la langue de mes compatriotes, ne fût-ce que pour protester solennellement contre la cruelle injustice de cette partie de l'acte d'Union qui tend à proscrire la langue maternelle d'une moitié de la population du Canada. Je le dois à mes compatriotes, je le dois à moi-même138.»
Une telle situation était tellement anormale; il était si contraire à la réalité des faits de proscrire une langue que tout le monde parlait, et de maintenir un règlement journellement violé, qu'un pareil état de choses ne pouvait se prolonger. En 1845, une proposition, votée par l'Assemblée législative canadienne, demanda au gouvernement métropolitain l'abolition de cette clause vexatoire de la constitution. Mesure réparatrice qui fut adoptée aussitôt, et en 1849, lord Elgin, ce gouverneur généreux auquel la reconnaissance des Canadiens a élevé une statue, put dire en ouvrant la session de 1849:
«Je suis fort heureux d'avoir à vous apprendre que, conformément au désir de la législature locale, le Parlement impérial a passé un acte révoquant la clause de l'acte d'Union qui imposait des restrictions à l'usage de la langue française139.»
Lord Elgin poussa la courtoisie jusqu'à prononcer lui-même le discours du trône en français, chose inouïe dans les fastes parlementaires canadiennes. La langue française avait dès lors repris la place officielle qui lui était due dans une province toute française, et jamais on n'a plus songé à la lui ravir.
Depuis que la constitution fédérale de 1867 a donné aux provinces une sorte d'autonomie, la langue française est à peu près seule en usage dans l'Assemblée législative provinciale de Québec, bien que l'anglais n'en soit pas proscrit et partage avec elle le titre de langue officielle. Réciproquement, dans le Parlement fédéral, où la grande majorité est anglaise, le français est admis sur le même pied que l'anglais.
Tel est le résumé des luttes que la langue française eut à subir pour demeurer langue officielle du gouvernement et des lois. C'est sur ce terrain seul d'ailleurs qu'elle a pu être attaquée. S'en prendre à son existence même, essayer de la faire abandonner par le peuple, parut dès les premières années au vainqueur une chose tellement impossible qu'elle ne fut même pas tentée sérieusement. A peine, en 1799, l'évêque protestant demanda-t-il l'établissement, dans les villes et dans les principaux villages, de maîtres d'école chargés d'enseigner gratuitement la langue anglaise aux Canadiens-Français. Cet essai n'eut aucun succès: «Les Canadiens, dit M. Garneau, sortaient d'une nation trop fière et trop vaillante pour consentir jamais à abandonner la langue de leurs aïeux», et cette organisation scolaire anglaise, connue sous le nom d'Institution royale, qui subsista assez longtemps, mais toujours en végétant d'une façon chétive, n'avait, en 1834, de l'aveu de tous, donné que des résultats négatifs; elle n'avait à cette époque que 22 écoles, fréquentées par un millier d'élèves, tandis que les écoles paroissiales françaises étaient au nombre de 1,321, avec plus de 36,000 élèves140!
L'Institution royale a disparu, mais des lois scolaires marquées au coin d'un remarquable libéralisme ont, – tout en assurant l'instruction de la masse du peuple selon sa langue maternelle et sa religion, – réservé et protégé les droits des minorités dissidentes. La première remonte à 1841, mais elle a plusieurs fois été remaniée depuis, et celle qui régit aujourd'hui la province de Québec fut votée en 1867, après l'organisation des provinces en union fédérale.
Il serait difficile d'imaginer quelque chose de plus ingénieux et de plus libéral, et l'on peut dire que la loi scolaire de Québec résout le difficile problème de contenter, comme dit le fabuliste, «tout le monde et son père»; chose difficile en toute circonstance, mais tout particulièrement ardue quand il s'agit de mettre d'accord sur des questions d'instruction, et de réunir sous une législation commune des populations catholiques et des populations protestantes.
Au point de vue scolaire, la commune canadienne-qui à tout autre point de vue jouit déjà d'une très large autonomie-est absolument omnipotente. C'est elle seule qui nomme et révoque les maîtres, les paye, leur fournit et le logement et le local de l'école, entretient ses bâtiments, et qui, pour subvenir à ces dépenses, vote des taxes spéciales et les perçoit.
Ces fonctions et ces droits n'appartiennent pas, toutefois, aux conseils municipaux. Elles sont dévolues, dans chaque commune, à un conseil de commissaires d'écoles spécialement nommés à cet effet par les électeurs communaux.
Le seul contrôle exercé par le surintendant de l'instruction publique, et le Conseil de l'instruction publique, siégeant à Québec, consiste dans l'admission des livres employés à l'instruction et la constatation de la capacité des maîtres.
Tels sont les droits assurés aux majorités dans chaque commune. Les minorités elles-mêmes n'y sont pas moins favorisées, et je tiens à citer ici le texte même de la loi: «Dans les municipalités où les règlements des commissaires d'écoles ne conviennent pas à un nombre quelconque de propriétaires ou contribuables professant une croyance religieuse différente de celle de la majorité des habitants, ces propriétaires ou contribuables peuvent signifier par écrit, au président des commissaires d'écoles, leur intention d'avoir des écoles séparées.»
Cette simple déclaration les dispense du payement des taxes imposées par les commissaires d'écoles, mais les met en même temps dans l'obligation d'ouvrir eux-mêmes une école, et de nommer des syndics, qui rempliront envers eux les fonctions que les commissaires d'écoles exercent envers les représentants de la majorité.
Une loi fort peu différente de celle-ci est en vigueur dans la province anglaise d'Ontario, et là, les dispositions qu'elle contient en faveur des minorités protègent des Canadiens-Français et des catholiques, tandis que dans la province de Québec elles protègent les Anglais protestants.
Sous une loi identique, les résultats pratiques sont bien différents dans chacune des deux provinces; car, si, malgré la large tolérance, on pourrait presque dire les encouragements qui leur sont accordés, les écoles anglaises ne se multiplient pas dans Québec, mais restent stationnaires ou diminuent, en revanche les écoles françaises deviennent de plus en plus nombreuses dans Ontario, en dépit des entraves qu'on s'efforce d'apporter à la juste application de la loi, et des protestations des plus fanatiques ennemis des Canadiens, contre ce «système d'écoles qui tend à rendre une partie d'Ontario aussi française que Québec».
D'après un tableau publié par M. de Laveleye en 1872141, les résultats du système scolaire canadien, au point de vue de l'instruction, seraient merveilleux. Les écoles primaires du Haut-Canada auraient compris alors un élève par quatre habitants, celles du Bas-Canada, un élève par six habitants, tandis qu'elles n'auraient eu qu'un élève par neuf habitants en France (1864), par treize habitants en Angleterre (1870), par dix-neuf en Italie, et par cent seize en Russie.
L'instruction secondaire, donnée en français, est largement répandue dans la province de Québec. Elle possède un grand nombre de collèges et d'écoles supérieures, presque tous dirigés par des ecclésiastiques et subventionnés par l'État, à condition de se conformer à certaines prescriptions de la loi.
Pour l'instruction supérieure, les Canadiens ont une Université, comprenant les quatre facultés: de théologie, de droit, de médecine et des arts (lettres et sciences), c'est l'Université Laval, fondée en 1852, institution privée, mais subventionnée pourtant par la province de Québec et qui, lors de sa fondation, a reçu une charte d'approbation de la reine Victoria.
L'Université Laval, qui a pris le nom d'un illustre prélat du Canada au dix-septième siècle, Mgr de Montmorency-Laval, est une institution toute française; tous les cours s'y font en français et tous les professeurs sont Français. Elle possède une bibliothèque de plus de 100,000 volumes, une des plus belles de l'Amérique, et l'on peut dire que l'Université Laval est le flambeau de l'instruction supérieure pour tous les Canadiens-Français, non seulement de la province de Québec, mais du continent entier.
Telles sont, depuis la modeste école jusqu'à la savante université, les institutions qui contribuent au maintien et à la propagation de notre langue; voyons quels résultats ont été obtenus et quel est actuellement l'état de la langue française au Canada.
Disons d'abord que dans la province française, pas un des descendants des 70,000 Français demeurés en 1763 n'a abandonné sa langue maternelle pour adopter celle du vainqueur. Le contraire s'est produit quelquefois, et l'on a vu, paraît-il, des descendants d'Écossais, placés au milieu des Canadiens, oubliant, après plusieurs générations, et leur langue et leur filiation, se croire, de très bonne foi, de pure race française142.
Il est vrai, et des touristes français ont pu s'en affliger, que même à Québec, ville la plus française de toute l'Amérique, on n'est pas sans trouver un certain nombre d'affiches anglaises et de noms anglais. Pour nous rassurer, levons les yeux dans Paris. Les affiches et les noms anglais ne s'étalent-ils pas sur les devantures même des magasins de notre capitale? les Parisiens sont-ils pour cela devenus des Anglais?
Si les détracteurs des Canadiens les accusent à tort d'abandonner la langue française, des admirateurs trop enthousiastes ont, par contre, proclamé qu'ils avaient conservé la langue du dix-septième siècle, qu'ils parlent aujourd'hui la langue de Bossuet et de Pascal!
La langue de Bossuet, c'est bien ambitieux! Bossuet seul la parla de son temps; on ne l'entendait guère, même alors, dans les campagnes. La vérité est que la langue populaire canadienne diffère fort peu de la langue populaire en France, et que l'une et l'autre ne sont pas sensiblement différentes de la langue populaire du dix-septième siècle; ce qui a changé depuis deux siècles, c'est la langue littéraire et scientifique, non la langue courante et celle du peuple.
La distance et le temps ont bien amené, entre le langage des Français et celui des Canadiens, quelques petites différences de prononciation ou d'expressions, mais elles ne vont pas au delà de celles que nous pouvons constater, en France même, entre nos différentes provinces.
Venus pour la plupart des contrées riveraines de l'Océan, les Canadiens ont conservé un certain nombre de termes de marine auxquels ils ont appliqué une signification générale; ce n'est pas un des traits les moins piquants de leur langage. On vous montrera par exemple, dans les rues de Québec, un cocher qui amarre son cheval, ou fait virer sa voiture. Il grée son attelage au lieu de le harnacher, et se grée lui-même le dimanche de son plus beau butin!
Toutes ces expressions locales-je pourrais en citer cent-rappellent l'origine normande, bretonne ou saintongeaise des Canadiens, et réjouissent les oreilles françaises bien plus qu'elles ne les choquent. Elles sont assez nombreuses pour donner à la langue un cachet tout spécial, sans jamais l'être assez pour la rendre absolument incompréhensible, comme elle le devient quelquefois en certains coins de France dans la bouche du paysan français.
D'une façon générale, on peut dire que la langue populaire des Canadiens est infiniment meilleure et plus correcte que la langue populaire en France. Je visitais un jour un village canadien, éloigné et de création nouvelle. La population, assez mélangée, comprenait, avec une grande majorité de Canadiens, quelques Anglais, deux ou trois Indiens demeurés là, je ne sais trop pourquoi, et un petit nombre d'émigrants français venus de France. L'école du village comprenait des enfants de chacune de ces nationalités. L'une des élèves, fille de l'aubergiste canadien chez qui j'étais logé, me disait avec une sorte de fierté: «Dans notre école, on parle quatre langues: le français, l'anglais, le sauvage, et le français des petites filles françaises!» Et je puis affirmer que le français des Français venus de France, un patois de je ne sais quelle province, ne valait pas le français des Canadiens.
Si du langage du peuple nous passons à la langue littéraire ou savante, parlée ou écrite, l'appréciation ne peut plus être la même. Si l'une a conservé intact le pur cachet de son origine, l'autre s'est un peu laissé pénétrer et envahir par quelques tournures et quelques expressions anglaises. Rien d'étonnant ni de bien blâmable à cela.
Pas plus au Canada qu'en France, le langage populaire n'a eu à s'enrichir de termes nouveaux. Le cercle dans lequel se meut l'activité du paysan n'a guère changé: la terre est toujours la même, fournit toujours les mêmes récoltes, obtenues dans les mêmes saisons, par des procédés peu différents de ce qu'ils étaient autrefois. Pour exprimer les mêmes choses, la langue est restée identique.
Mais quelle différence, quand, du domaine de la vie matérielle, on passe dans celui de la science! que de changements, que de progrès, que de bouleversements d'idées depuis deux siècles! Pour exprimer tant d'idées nouvelles inconnues de nos pères, un vocabulaire nouveau a dû se former, le génie de la langue littéraire et savante s'est modifié de fond en comble; sous la plume de nos écrivains contemporains, elle est devenue un instrument nouveau, entièrement différent de celui dont se servirent leurs aînés du dix-septième et du dix-huitième siècle.
Or, tout ce bouillonnement d'idées, toute cette fermentation de connaissances nouvelles, tout cela est arrivé aux Canadiens, non pas par nous, séparés d'eux depuis près de deux siècles, mais par le canal des publications et de l'enseignement anglais. Quoi d'étonnant à ce que ce passage, comme à travers un crible étranger, ait laissé à leur langue scientifique et littéraire une certaine saveur britannique, et qu'on y rencontre aujourd'hui quelques expressions et quelques tournures anglaises!
Le langage judiciaire, surtout, a été particulièrement envahi par l'anglicisme. Un Canadien de beaucoup d'esprit, M. Buies, qui, sous le titre: «Anglicismes et Canadianismes», a écrit une série d'articles pour signaler le danger de laisser ainsi envahir la langue française par des expressions, et surtout par des tours de phrase contraires à son génie, a lancé cet anathème contre le langage bizarre que se sont forgé, à l'aide de mots anglais, les hommes de loi canadiens: «Il est impossible, dit-il, de comprendre quelque chose à la plupart de nos textes de lois, de nos bills et de nos documents parlementaires.»
La rédaction et les termes en sont en effet totalement différents de ceux auxquels nous sommes habitués en France. Oserions nous en faire un reproche à nos compatriotes d'Amérique? Leur réponse serait trop facile: – Qui nous a appris à faire nos lois? pourraient-ils répondre; est-ce vous? Alors que nous vivions sous le même sceptre, vous ne saviez pas vous-même faire les vôtres! Ceux qui nous l'ont appris, ce sont les Anglais; instruits par eux, quoi d'étonnant à ce que nous ayons retenu certaines des formules de leur procédure législative et parlementaire?
L'auteur d'un très remarquable travail sur la constitution canadienne, travail très précis et très clair quant au fond, très châtié et très pur quant au style, M. Mignault, prévient lui-même dans sa préface le lecteur français de la nécessité où il est contraint, par son sujet même, d'employer certaines tournures, certaines expressions anglaises:
«Il n'y a pas jusqu'à la langue, dit-il, qui n'éprouve des difficultés réelles à traiter une science qui est presque exclusivement anglaise, et le lecteur devra nous pardonner des expressions comme aviseur, originer, et tant d'autres qui ont presque acquis le droit de cité dans le langage parlementaire et qui se sont glissées sous notre plume143.»
Pour les mêmes motifs, cette incorrection et cette obscurité ont envahi le barreau, et voici le jugement, beaucoup trop sévère, je crois, porté sur lui, – d'une façon plaisante qui en fait passer l'exagération, – par M. Buies, dans les articles cités plus haut: «Dût le barreau tout entier se ruer sur moi, je dirai qu'en général nos avocats ne parlent ni l'anglais ni le français, mais un jargon coriace qu'on ne peut comprendre que parce qu'on y est habitué, et parce que l'on sait mieux ce qu'ils veulent dire que ce qu'ils disent.»
C'est là une grande sévérité pour quelques expressions anglaises échappées dans le feu d'une plaidoirie, mais l'amour de la langue française anime M. Buies, et certes, ce n'est pas à nous à l'en blâmer.
Dans la presse aussi, on relève quelquefois, – non pas dans les articles de fond, confiés la plupart du temps à d'habiles rédacteurs, mais dans les informations et les faits divers, laissés aux débutants, – des expressions singulières, et des traductions assez bizarres des articles anglais. Les méprises de ces jeunes traducteurs sont parfois amusantes, et leurs confrères se plaisent à les relever d'une façon quelque peu malicieuse. L'un a traduit les mots: spring carriage (voiture suspendue), par: voiture de printemps. Un autre annonce que l'Angleterre a envoyé un homme de guerre (man of war, vaisseau de ligne) en Extrême-Orient; un troisième, que les Banques de la Seine (banks, les rives) sont inondées par la crue du fleuve! On a trouvé mieux encore. La traduction d'une dépêche d'Ottawa, du 21 août 1890, qui fit le tour de la presse canadienne, annonçait que le général Middleton, l'ancien commandant en chef de l'expédition du Nord-Ouest, alors traduit devant une commission d'enquête pour avoir rapporté de sa campagne beaucoup trop de fourrures et pas assez de gloire, se déclarait prêt, s'il était poursuivi, à rendre témoignage sur certains faits qui devaient jeter, disait la dépêche «beaucoup de lumière sur divers incidents relatifs à M. William Outbreack…». Ce M. W. Outbreack n'était autre que la traduction des mots: N. W. Outbreack, North-West Outbreack, les troubles du Nord-Ouest144!
De toutes ces singularités relevées dans les journaux, M. Buies conclut que le dictionnaire ne devrait pas être le seul guide des traducteurs. Il conseille, très-judiciairement, aux journalistes canadiens, de moins emprunter aux feuilles anglaises, et, lorsque la traduction d'un article important est nécessaire, d'en confier le soin à des hommes également versés dans le maniement des deux langues, plutôt que de le laisser à des jeunes gens sans expérience.
Il serait tout à fait faux et tout à fait injuste de tirer des conclusions générales de quelques exemples plaisants choisis à titre de curiosité. La presse canadienne tout entière déploie, au contraire, un zèle remarquable pour le développement de notre langue; elle est représentée par une quantité considérable de journaux, et plusieurs d'entre ces grands organes, fort sérieux, fort bien informés et fort bien rédigés, ne le cèdent en rien à la plupart de nos journaux de France.
Tous les anglicismes, d'ailleurs, ne doivent pas être repoussés à priori; ce serait faire preuve d'un chauvinisme bien étroit et bien mal placé que de prétendre que notre langue est la seule parfaite et que les autres n'ont rien de bon à lui prêter. Ne peut-elle, au contraire, leur emprunter avec fruit, ne doit-elle pas le faire? Bien des mots anglais exprimant une idée très précise n'ont pas d'équivalent en français. Pourquoi nous étonner que les Canadiens les traduisent pour leur usage? pourquoi ne les traduirions-nous pas nous-mêmes?
Aucun mot français n'exprime le dravage des bois, expression que les Canadiens ont tirée du verbe anglais to drive, pour expliquer cette périlleuse descente des bois à travers les rapides de leurs rivières. Aucune expression française non plus n'équivaut à celle de maison de logues (log house)… maison construite de troncs d'arbres est une périphrase bien trop longue, et dans un pays où les habitations de la moitié de la population sont construites en logues, on comprend qu'un mot spécial soit au moins nécessaire pour les désigner.
On voit même par ces exemples que les Canadiens font mieux que nous, et que quand ils confèrent le droit de cité à un mot étranger, ils l'habillent au moins à la française.
Pour un grand nombre des inventions faites dans notre siècle: les machines, la vapeur, les chemins de fer, nous avons emprunté des termes aux Anglais, et avons adopté leurs mots tels quels, sans même changer leur orthographe, bizarre à nos yeux, nous contentant de les prononcer d'une façon incorrecte. Plus puristes et plus patriotes, les Canadiens ont voulu avoir leur mot propre, à eux appartenant, et ils ont traduit ce que nous avions adopté sans modification. Nous avons accepté rail et wagon, ils ont traduit lisse et char, et tandis que nous montons en chemin de fer, expression des plus bizarres quand on l'examine de près, eux, prennent les chars, ce qui est beaucoup plus logique.
Le 23 décembre 1838: Joseph Cardinne et Joseph Duquet;
Le 18 janvier 1839: Decoigne, Robert, deux frères Sanguinet et Hamelin;
15 février: Hindelang (Français), Narbonne, Nicolas, Donais et Chevalier de Lorimier.
Lord Elgin est d'une famille normande; son nom est James Bruce, comte d'Elgin, de Kinkardine et de Torrey, il compte des rois d'Écosse parmi ses ancêtres; de là sa devise: Fuimus.