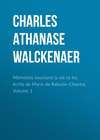Kitabı oku: «Mémoires touchant la vie et les écrits de Marie de Rabutin-Chantal, Volume 1», sayfa 17
CHAPITRE XXI.
1651
Le marquis de Sévigné peu regretté du monde.—Il était dissipateur et fâcheux.—Explication de ce mot.—Madame de Sévigné fut violemment affligée de la mort de son mari.—Signes qu'elle donne de sa douleur deux ans après l'événement.—Elle revient à Paris aussitôt qu'elle l'a appris.—Elle est obligée de s'adresser à madame de Gondran pour avoir des cheveux de son mari et son portrait.—État de Paris lorsque madame de Sévigné y arriva.—Tout y était en fermentation.—La cour et le roi gardés dans la capitale.—Condé mauvais politique.—Habileté de la reine régente.—Ses manœuvres pour ravoir son ministre.—La reine est soupçonnée à tort d'avoir voulu faire emprisonner le coadjuteur.—Condé quitte Paris, et se retire à Saint-Maur.—Les députés de la noblesse demandent la convocation des états généraux.—La reine et le parlement s'y opposent.—La reine régente travaille à diviser les partis.—La plupart des agents de toutes ces intrigues étaient des femmes.—Détails sur la princesse Palatine.—Mademoiselle de Chevreuse.—La duchesse de Lesdiguières.—Mademoiselle de Longueville.—Mademoiselle de Montpensier.—Madame de Rhodes.—La duchesse de Montbazon.—La duchesse de Châtillon.—La duchesse de Longueville.—Fêtes données dans la capitale.—Nouveautés théâtrales.—Mariages du duc de Mercœur et de mademoiselle de Mancini.—Brillant carnaval.—Madame de Sévigné passe son deuil dans la solitude.—Se dispose à retourner en Bretagne.—Scarron lui écrit pour se plaindre de ne l'avoir pas vue.—Elle lui promet d'aller lui rendre visite à son retour de Bretagne.
Quoique le marquis de Sévigné fût bien fait, d'une figure agréable; quoiqu'il ne manquât ni d'esprit ni d'amabilité, qu'il fût homme d'honneur, et ne fût ni méchant, ni trompeur, ni perfide, si ce n'est envers sa femme, ce qui comptait peu, même alors, cependant il ne fut point regretté416. Il s'était partout acquis la réputation d'un de ces hommes qu'on désignait par le nom de fâcheux, c'est-à-dire de ceux qui occupent sans cesse les autres d'eux-mêmes, et se rendent par là fatigants et importuns. De plus il était dissipateur; et les dissipateurs sont toujours besoigneux. Bien loin de pouvoir être utiles à leurs amis, ils leur sont souvent à charge; leur prodigalité ne s'exerce qu'au profit des usuriers, des parasites et des flatteurs, ou des femmes sans honneur, sans conscience et sans délicatesse. Il y a donc des défauts et un genre d'inconduite qui nuisent plus à un homme dans l'estime et dans l'affection des autres, que des vices reconnus, que certaines actions coupables; car on voit des hommes qui, malgré ce double cachet de réprobation, conservent encore dans l'adversité des amis sincères et dévoués. C'est qu'il est des vices qui peuvent s'allier avec de nombreuses et fortes vertus, et des torts graves qui n'excluent ni l'élévation de l'âme ni un cœur capable de sympathiser avec les autres. Au lieu que le double caractère de fâcheux et de dissipateur implique un égoïsme profond; et l'égoïsme repousse toutes les résolutions généreuses, ne tient aucun compte des autres, resserre et concentre toute l'existence dans le moi individuel. Il est l'opposé de l'amitié et de l'amour, qui ne connaissent de vie et de bonheur que par l'expansion des sentiments, la réciprocité des services, l'échange du dévouement, des affections et des jouissances.
Cependant il fallait bien que le marquis de Sévigné possédât quelques qualités aimables, puisqu'il fut aimé de sa femme. La douleur que madame de Sévigné ressentit de la perte de son mari fut sincère, violente et durable. Elle s'évanouit la première fois qu'elle revit, dans une assemblée, le chevalier d'Albret; et deux ans après le duel Tallemant la vit, dans un bal, pâlir et presque défaillir à la vue de Soyecour. En apercevant Lacger dans une allée de Saint-Cloud, où elle se promenait, elle dit: «Voilà l'homme du monde que je hais le plus, par le mal que m'ont fait ses indiscrétions.» Deux officiers aux gardes, qui se trouvaient près d'elle, lui offrirent de le fustiger devant elle: «Gardons-nous-en bien, dit-elle; il est avec plusieurs de mes parents, auxquels vous ne voudriez pas faire affront.» Et elle se détourna avec son cortége dans une autre allée du parc, pour éviter de rencontrer Lacger417.
Aussitôt que madame de Sévigné eut appris en Bretagne que son mari s'était battu en duel, elle revint en toute hâte à Paris; mais elle n'arriva point assez tôt pour lui rendre les derniers devoirs. Le bruit courut même que n'ayant de lui ni portrait ni cheveux, elle en avait fait la demande à madame de Gondran, qui y satisfit sur-le-champ. De son côté, madame de Sévigné renvoya à madame de Gondran toutes les lettres que celle-ci avait écrites au marquis de Sévigné. Tallemant dit que ces lettres étaient, pour le style et l'indécence des expressions, semblables à celles que, plus jeune, madame de Gondran avait autrefois adressées à la Roche-Giffart418.
Jamais Paris n'avait eu un aspect plus alarmant que lors du tragique événement qui força madame de Sévigné à y revenir; jamais le Palais de Justice, le Palais-Royal, le Luxembourg, l'archevêché, les hôtels des princes et des grands seigneurs, n'avaient présenté le spectacle de tant d'agitations tumultueuses, de tant de changements rapides, de passions ardentes, d'intrigues compliquées. Cette capitale se remplissait de gens de guerre, que les princes, le duc de Beaufort, le coadjuteur, le duc d'Orléans, y appelaient. Poursuivi par la haine de tous les partis, Mazarin avait été obligé de céder enfin à l'orage. Il s'était déterminé à fuir; et la crainte de voir s'échapper à sa suite le roi et la reine régente avait soulevé le peuple de Paris, et y avait fait prévaloir l'influence du duc d'Orléans et du coadjuteur, qui s'était rendu maître de l'esprit de ce prince. Toutes les portes étaient gardées; aucune femme même ne pouvait sortir du Palais-Royal sans ôter son masque et décliner son nom419. A toute heure du jour, et même de la nuit, des émissaires du duc d'Orléans, des officiers de la garde bourgeoise, pénétraient dans le palais pour s'assurer si le roi s'y trouvait; et ils forçaient la reine régente à le leur montrer. Le monarque enfant, par sa beauté, ses grâces, le calme de son sommeil, saisissait de respect et d'amour ceux qui étaient admis à le contempler. Ceux-ci rendaient compte au peuple de leur mission, en termes qui faisaient partager à la multitude attentive les sentiments que la vue du roi leur avait inspirés; et, au milieu de leurs actes les plus séditieux, ils portaient ainsi un remède à la sédition420.
La reine régente, dans le dessein de sortir de la captivité, avait été obligée de rendre la liberté au prince de Condé, ainsi qu'à son frère et à son beau-frère. Ils étaient rentrés dans Paris en vainqueurs, aux acclamations de tout le peuple, de la noblesse et du parlement. Mazarin, qui s'était rendu au Havre pour implorer la protection du prisonnier qu'il était venu délivrer, était sorti du royaume. On crut son autorité pour toujours anéantie; mais un petit nombre de courtisans, qui lisaient dans le cœur de la reine, en jugèrent autrement, et durent à la conduite habile qu'ils tinrent dans ces circonstances la haute fortune où ils s'élevèrent dans la suite.
Nul doute que dans le premier moment Condé n'eût pu enlever facilement la régence à la reine, dépourvue de son premier ministre et reconnue incapable de gouverner par elle-même; mais alors la direction des affaires appartenait de droit au duc d'Orléans, dont Condé était jaloux. Condé aima mieux conserver la régence à la reine, et, en ne se séparant ni du duc d'Orléans ni de la Fronde, se rendre redoutable au gouvernement et le forcer de compter avec lui421. Si cette union des princes entre eux et avec le parti de la Fronde avait subsisté, le rétablissement de l'autorité royale eût été impossible; et le commencement du règne de Louis XIV, qui, quoique âgé seulement de treize ans accomplis, allait, d'après une loi exceptionnelle, être déclaré majeur, aurait offert le spectacle, si fréquent dans nos annales, d'un État en proie aux déchirements des factions et aux horreurs de l'anarchie.
Mais, par bonheur pour la France et pour la reine régente, Condé était aussi mauvais politique que grand guerrier. Il ne tint aucune des promesses qu'il avait faites aux chefs de la Fronde, auteurs de sa délivrance422. Le mariage du prince de Conti et de mademoiselle de Chevreuse, qui avait été la base du traité, et entraînait d'autres engagements, fut rompu sans aucun égard423. La reine régente, pour parvenir au rappel de son ministre, eut l'habileté de déguiser sa marche, et choisit d'abord pour le remplacer Chavigny, ennemi personnel de Mazarin; puis elle négocia avec tout le monde, et opposa habilement la Fronde au prince de Condé, celui-ci au duc d'Orléans424, le parlement à l'assemblée de la noblesse, l'aversion contre Mazarin à la crainte qu'inspirait le coadjuteur425. L'autorité royale, tout affaiblie qu'elle était, devint pour elle un puissant moyen d'influence par les faveurs qu'elle avait à distribuer, par les espérances qu'elle faisait naître. Enfin la reine se prévalait aussi d'un commencement de popularité acquise par le renvoi de son ministre, et par sa fermeté, son calme, sa douceur au milieu des émeutes populaires426. Ses ministres, qu'elle abusait, n'avaient que les apparences du pouvoir; ce qu'il avait de réel, Mazarin le possédait tout entier. De Bruhl, le lieu de son exil, il gouvernait la France; la reine ne prenait aucune résolution sans qu'elle lui eût été inspirée par lui, ou sans qu'il l'eût approuvée. Condé, au contraire, ne faisait rien, ne résolvait rien qu'on n'eût prévu longtemps d'avance, et qui ne fût aussitôt divulgué par les indiscrétions de son parti, ou par les siennes. Il révoltait par son orgueil, et décourageait par ses indécisions et ses défiances. Effrayé de son isolement, déjà il était entré en négociation avec les Espagnols, et songeait à la guerre. On le sut, et les projets les plus violents furent proposés contre lui. D'Harcourt et d'Hocquincourt s'offrirent de le tuer. Le coadjuteur, dans ses Mémoires, insinue que la reine le désirait, et qu'il s'y opposa. Madame de Motteville, au contraire, prétend que le coadjuteur avait conçu le crime, et que la reine s'y refusa. Il y a calomnie de part et d'autre. Nous apprenons, par les Mémoires de Monglat, que Gondi et Anne d'Autriche rejetèrent également ce parti, proposé par de vils et ambitieux courtisans427. Mais si on ne voulut pas faire assassiner ce prince, on résolut de s'en défaire en le faisant arrêter de nouveau. Prévenu à temps par Chavigny428, Condé quitta Paris, et se retira à Saint-Maur, appelant autour de lui tous ses amis. C'était annoncer la guerre civile. Elle n'effrayait pas la reine régente, parce qu'elle rendait nécessaire le rappel de son ministre429.
Pour éviter d'en venir à cette extrémité, une pensée salutaire avait germé parmi les députés de la noblesse des provinces, réunis à Paris au nombre de plus de huit cents. Ils avaient adressé une requête à la reine régente, pour qu'elle convoquât les états généraux430. La reine promit qu'ils seraient assemblés à Tours, aussitôt après que la majorité du roi serait déclarée; et l'assemblée des nobles, satisfaite, se sépara. C'était tout ce qu'on désirait; cette réunion inquiétait l'autorité, et on était pressé d'y mettre un terme. Pour s'en délivrer, on lui fit une promesse qu'on n'avait pas intention de tenir. Il était facile de l'éluder: si on excepte cette masse d'hommes éclairés et sincères amis de leur pays, qui dans les temps de troubles ne forment point de factions, parce qu'ils se tiennent éloignés de toutes, personne ne voulait les états généraux. Tous les partis s'accordaient donc à rejeter cette mesure: le gouvernement, parce qu'elle aurait ajouté à ses embarras et restreint son autorité; le parlement, parce qu'elle lui aurait ôté ce grand privilége d'être le protecteur du peuple et le gardien des libertés publiques; les princes, parce qu'elle aurait diminué leur influence et mis des bornes à leur illégale puissance. Cependant le duc de La Rochefoucauld est forcé d'avouer qu'alors les états généraux eussent sauvé le royaume431. Cela était vrai; quoique, un siècle et demi plus tard, ils le plongèrent dans l'abîme des révolutions.
La reine régente, pour rompre les alliances qui s'étaient formées entre les partis, fut contrainte de prendre des engagements qu'elle aurait voulu rompre, et elle se vit entraînée à consentir à l'élévation de ses ennemis, ou plutôt des ennemis de Mazarin: par là elle les rendit plus redoutables432; et il fut plus difficile de prévoir quelle serait l'issue de la guerre civile, qu'on ne cherchait pus trop à éviter. Ainsi, Gondi parvint par la cour, et malgré la cour, au but où tendait depuis longtemps son ambition: il fut nommé cardinal. Condé, dont la reine aurait voulu atténuer l'influence, reçut le gouvernement de Guienne, qui conférait une autorité presque absolue sur une des plus vastes et des plus guerrières provinces de France. Il est remarquable que les agents principaux de toutes ces grandes intrigues furent des femmes; que ce furent elles qui les firent réussir, en préparèrent ou en précipitèrent les résultats, au gré de leurs passions ou de leurs intérêts particuliers. Ainsi, la reine régente, entourée des ennemis de Mazarin, forcée de dissimuler, et se défiant de ceux de sa propre maison qui détestaient ce ministre433, ou d'hommes timides, qui craignaient de se mettre à dos le gouvernement et les princes, montra souvent autant de résolution, de fermeté et de présence d'esprit que celui pour lequel elle se sacrifiait. Elle fut parfaitement secondée par la duchesse de Navailles, qui entretenait une correspondance active avec Mazarin434. Ce fut mademoiselle de Longueville qui détacha son père du parti des princes et le réconcilia avec la reine435. La princesse Palatine, après avoir si habilement manœuvré pour faire cesser la captivité des princes, se montra également adroite pour servir la reine, quand elle vit que Condé lui refusait son influence pour porter aux finances le marquis de la Vieuville, père de son amant436. La duchesse de Chevreuse, qui avait fait du mariage de sa fille avec Conti l'une des conditions de la liberté des princes, se tourna subitement du côté de la reine quand elle s'aperçut que Condé, après avoir recueilli les avantages d'une des deux clauses du traité, cherchait à éluder l'autre. C'est alors que, de concert avec la duchesse de Lesdiguières, qui était de la maison de Gondi437, elle forma entre le coadjuteur et la reine cette alliance dont le mystère fut pendant quelque temps d'autant plus impénétrable, que, pour conserver son influence et nuire plus efficacement au prince de Condé, il fut permis au coadjuteur de seconder, dans le parlement et dans la Fronde, les haines populaires contre Mazarin. Ainsi, pendant que Gondi était d'accord avec ce ministre, il agissait de manière à faire croire qu'il était son plus mortel ennemi438. MADEMOISELLE, fille du premier lit de Gaston d'Orléans, à qui sa naissance, ses grands biens, son caractère altier donnaient l'importance d'un personnage politique, s'offrait de servir la reine régente auprès de son père, ou contre son père; mais elle ne prétendait à rien moins, pour prix de son appui, que de se faire reine, et d'épouser le jeune monarque son cousin, dont l'âge était si fort au-dessous du sien. Elle s'agitait sans cesse pour parvenir à son but, mais sans avancer d'un pas; et, selon les alternatives de l'accroissement ou de la diminution de ses espérances, elle flottait continuellement entre le parti d'Orléans ou celui de la cour, sans en tromper aucun, mais sans se donner franchement et sans retour ni à l'un ni à l'autre439. Le duc d'Orléans était conseillé par sa femme Marguerite de Lorraine440 et par l'abbé de la Rivière. La duchesse de Bouillon avait pris un grand ascendant sur son mari, homme de tête et de mérite441. Madame de Rhodes gouvernait le garde des sceaux Châteauneuf442; madame de Montbazon, le duc de Beaufort443. La duchesse de Longueville, par haine pour la duchesse de Chevreuse et pour sa fille, brouillait le parti des princes avec la Fronde, et ménageait la reine régente, pour n'être pas forcée d'exécuter la promesse qu'elle avait faite à tous les siens d'aller en Normandie rejoindre son mari: elle poussait à la guerre civile, contre leur intention et leurs désirs, les princes de Condé et de Conti ses frères, le duc de Nemours, son amant, et le duc de La Rochefoucauld, qu'elle lui avait donné pour rival. En même temps elle entretenait des intelligences avec la princesse Palatine, et par elle avec la reine, dans le but de se rendre à la fois utile et redoutable au parti des princes comme à celui de la cour444.
Mazarin était instruit de toutes ces intrigues par sa correspondance, par la Gazette imprimée, par des gazettes à la main445; il savait en démêler les ressorts avec une admirable sagacité; il en informait la reine, et lui envoyait de longs mémoires pour l'éclairer sur les intentions de ceux qui dirigeaient ses conseils, et pour lui enseigner les moyens de faire concourir tous les partis à son rappel et au rétablissement de son autorité. Il y intéressait sa religion, et son affection pour lui: «Je vous conjure, lui disait-il dans sa lettre du 12 mai 1651, de bien considérer ce mémoire et la lettre qui l'accompagne au moins trois fois, quand ce ne serait qu'en trois jours. Vous le pouvez faire dans vos retraites; et croyez que cela importe au service de Dieu, du roi, au vôtre, et à celui du plus passionné pour la moindre de vos volontés.»
Il l'engageait à dissimuler avec tout le monde, à caresser tout le monde, à se servir de tout le monde, à se défier de tout le monde, à ne se faire aucun scrupule de se raccommoder avec des gens qui lui avaient fait du mal, et qu'elle avait juste sujet de haïr et de vouloir perdre; «car, dit-il, la règle de conduite des princes ne doit jamais être la passion de la haine ou de l'amour, mais l'intérêt et l'avantage de l'État et le soutien de leur autorité446.» On voit que la politique de la reine tendait à faire offrir son alliance à tous les partis, pour écraser le parti contraire; mais elle y mettait pour condition première de l'aider à effectuer le rappel de son ministre. Mazarin, par sa correspondance, paraît avoir été assez certain de la fidélité de Le Tellier; mais nous voyons, par une lettre et un mémoire envoyés à la reine, que Mazarin considérait Servien, de Lyonne et Chavigny comme les soutiens du prince de Condé. La princesse Palatine était l'âme du parti de madame de Longueville, qu'elle cherchait à entraîner du côté de celui de la reine et de Mazarin, avec lequel elle était en correspondance secrète. La duchesse d'Aiguillon, artificieuse et intéressée, se servait du respectable Vincent de Paul, de madame de Saujeon et de Le Tellier, pour faire agir le duc d'Orléans dans un sens contraire à Mazarin, et pour créer des obstacles au retour de ce ministre, qu'elle n'aimait pas447. Ce que Mazarin surtout s'attachait à démontrer à la reine, comme le plus grand danger pour l'autorité du roi, qui dans quatre mois devait être majeur, c'était de donner trop de puissance au prince de Condé448. Par cette raison, il ne voulait pas que l'on favorisât l'ambition des maréchaux du Dognon, Palluau, Gramont, qui, ainsi que Chavigny, Servien et de Lyonne, étaient du parti de ce prince449. Il écrivit cependant à de Lyonne; mais c'était pour lui adresser des reproches. Selon lui, le prince de Condé avait réduit le ministériat en république.
Ce qu'il y a surtout de remarquable dans les lettres que Mazarin pendant son exil écrivit à la reine, c'est la vive expression contenue dans quelques-unes de ses sentiments pour elle, qui laisse peu de doute sur la nature de leur liaison450. Il lui conseille de plier jusqu'à la majorité du jeune roi, qui dans quelques mois devait avoir treize ans accomplis451; et elle conforme sa conduite envers le duc d'Orléans, le parlement et Condé, à ce conseil; simulant et dissimulant toujours452.
Au milieu de toutes ces intrigues politiques et galantes, de ces ruptures et de ces coupables négociations avec les ennemis de l'État, de ces projets d'assassinats ou d'arrestations nouvelles; quand on craignait que le roi ne s'enfuit, quand on redoutait que les princes ne voulussent l'enlever, la capitale semblait plongée dans le délire de la joie, dans le tumulte des plaisirs. Jamais autant de bals et de fêtes; jamais autant de gaieté et d'insouciance apparente; jamais les promenades publiques aussi fréquentées, les théâtres aussi encombrés de spectateurs453. A Saint-Maur, la comédie, la chasse, la bonne chère, contribuaient à grossir le nombre de ceux qui se préparaient à la guerre civile454. Partout les visages paraissaient calmes, et tous les cœurs étaient agités. C'était au milieu d'une contredanse que Monglat apprenait la nouvelle de l'armement de Paris; c'était parmi les pompeuses réunions, les jeux et les divertissements de tous genres, que le prétendant d'Angleterre, le frivole Charles II, de retour de sa malheureuse expédition, oubliait l'échec qu'il venait d'éprouver, et son trône perdu, et la sauvage Écosse par lui abandonnée. C'était aussi au milieu des fêtes splendides dont elle gratifiait deux fois la semaine toute la haute société455, que MADEMOISELLE refusait la main de ce monarque dépossédé, plus courageux qu'heureux, plus aimable que grand. Enivrée des hommages dont elle était l'objet, elle s'imaginait déjà être reine de France, et prévoyait peu que celui qu'elle refusait dût régner un jour. Elle était bien loin de penser que, pour obtenir une couronne qu'on ne pensait pas à lui donner, elle en perdait une qui lui était offerte. Cependant, longtemps après, en écrivant ses Mémoires, malgré les regrets que le souvenir de ces temps devait lui faire éprouver, nous voyons qu'elle aimait à se rappeler le brillant et joyeux carnaval de cette année, comme une des plus riantes époques de sa vie.
Madame de Sévigné ne prit part ni à ces intrigues ni à ces plaisirs. Elle termina aussi promptement qu'elle put les affaires qui l'avaient amenée à Paris, et elle repartit aussitôt pour aller dans sa terre des Rochers se livrer à sa douleur, et passer dans la solitude les premiers temps d'un veuvage qui ne devait finir qu'avec sa vie. Scarron, ami de son mari, avait envoyé chez elle avant son départ, pour lui faire connaître combien il regrettait que ses souffrances et ses infirmités ne lui permissent pas d'aller lui faire en personne ses compliments de condoléance. Il s'affligeait de ce qu'il était forcé de laisser échapper, même dans cette triste occasion, le plaisir de la voir au moins une fois avant de mourir. Madame de Sévigné, touchée de ses regrets, et peut-être aussi flattée de ses louanges (car à cette époque le pauvre Scarron, à l'apogée de sa réputation, était aussi le célèbre Scarron), lui fit dire que puisqu'il ne pouvait venir chez elle, elle lui promettait qu'aussitôt après son retour elle irait lui rendre visite. C'est alors que Scarron la pria, dans le style burlesque qui lui était familier, d'exécuter avant son départ une si séduisante promesse, parce que plus tard il ne serait plus temps, attendu qu'il serait mort. Madame de Sévigné partit, mais après avoir écrit à Scarron de ne pas mourir avant son retour, et avant qu'elle l'eût vu. Cette plaisanterie était permise avec un homme qui avait résolu de ne prendre rien au sérieux, pas même la douleur, pas même la mort. Ce fut alors qu'il lui écrivit la lettre suivante:
LETTRE DE SCARRON A MADAME DE SÉVIGNÉ
«Madame,
«J'ai vécu de régime le mieux que j'ai pu, pour obéir au commandement que vous m'avez fait de ne mourir point que vous ne m'eussiez vu. Mais, madame, avec tout mon régime, je me sens tous les jours mourir d'impatience de vous voir. Si vous eussiez mieux mesuré vos forces et les miennes, cela ne serait pas arrivé. Vous autres dames de prodigieux mérite, vous vous imaginez qu'il n'y a qu'à commander: nous autres malades, nous ne disposons pas ainsi de notre vie. Contentez-vous de faire mourir ceux qui vous voient plus tôt qu'ils ne veulent, sans vouloir faire vivre ceux qui ne vous voient pas aussi longtemps que vous le voulez; et ne vous en prenez qu'à vous-même de ce que je ne puis obéir au premier commandement que vous m'avez jamais fait, puisque vous aurez hâté ma mort, qu'il y a grande apparence que pour vous plaire j'aurais de bon cœur reçue aussi bien qu'un autre. Mais ne pourriez-vous pas changer le genre de mort? Je ne vous en serais pas peu obligé. Toutes ces morts d'impatience et d'amour ne sont plus à mon usage, encore moins à mon gré; et si j'ai pleuré cent fois pour des personnes qui en sont mortes, encore que je ne les connusse point, songez à ce que je ferai pour moi-même, qui faisais état de mourir de ma belle mort. Mais on ne peut éviter sa destinée, et de près et de loin vous m'auriez toujours fait mourir. Ce qui me console, c'est que si je vous avais vue, j'en serais mort bien plus cruellement. On dit que vous êtes une dangereuse dame, et que ceux qui ne vous regardent pas assez sobrement en sont bien malades, et ne la font guère longue. Je me tiens donc à la mort qu'il vous a plu de me donner, et je vous la pardonne de bon cœur. Adieu, madame; je meurs votre très-humble serviteur; et je prie Dieu que les divertissements que vous aurez en Bretagne ne soient point troublés par le remords d'avoir fait mourir un homme qui ne vous avait jamais rien fait.
Et du moins souviens-toi, cruelle,
Si je meurs sans te voir,
Que ce n'est pas ma faute.
«La rime n'est pas trop bonne; mais à l'heure de la mort on songe à bien mourir, plutôt qu'à bien rimer456.»