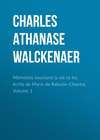Kitabı oku: «Mémoires touchant la vie et les écrits de Marie de Rabutin-Chantal, Volume 1», sayfa 16
CHAPITRE XIX.
1651
Des cause qui éteignent le patriotisme et produisent les émigrations.—État des partis en France.—Projet de former une colonie en Amérique.—Il s'établit une compagnie pour exploiter la Guyane et faire le commerce d'esclaves.—Scarron et Ninon sont au nombre de ceux qui veulent émigrer.—La crainte d'une nouvelle persécution avait déterminé Ninon à s'expatrier; cependant, ni elle ni Scarron ne s'embarquent.—Ninon quitte le marquis de Sévigné, qui est remplacé par Rambouillet de la Sablière.—Vassé succède à Rambouillet.—Citation des Mémoires de Tallemant.—Désintéressement de Ninon.—Elle refuse les dons du marquis de Sévigné.—L'abbé de Livry force madame de Sévigné à se séparer de biens de son mari.—Jugement que porte Tallemant sur celui-ci.—Madame de Sévigné s'engage pour son mari.—Remontrance de Ménage à ce sujet.—Repartie un peu libre de madame de Sévigné à Ménage.—Pourquoi les éditeurs de madame de Sévigné ont été obligés de changer dans ses lettres quelques expressions.
Quand le gouvernement est dans toute son intégrité, les peuples songent moins aux avantages qu'aux abus qu'entraîne l'exercice d'une puissance toujours trop faible pour protéger l'État contre les intérêts privés qui lui font sans cesse la guerre, toujours trop forte pour n'être pas tentée d'usurper sur les droits individuels et les libertés publiques. Mais lorsque, après un bouleversement d'État, la puissance gouvernementale se trouve incapable, par son affaiblissement, d'assurer le règne des lois; quand un pays est déchiré par les partis, qui suppriment tour à tour et exercent avec violence un pouvoir éphémère, alors les victimes de ces révolutions successives, et ceux qui ne partagèrent jamais les fureurs des factieux ni les bassesses des ambitieux, désespérant de voir une fin aux maux de leur patrie, s'en détachent, et cherchent souvent dans d'autres contrées une existence plus tranquille, ou du moins l'espérance d'un meilleur avenir; sentiment qui ne s'éteint jamais dans le cœur de l'homme, et qui est à la fois le mobile de ses efforts et l'appui de son courage.
Tels étaient les motifs qui agissaient sur les esprits au commencement de l'année 1651, et qui favorisèrent en France les projets d'une colonisation en Amérique. A cette époque, tous les partis s'étaient réunis contre celui qui voulait les dominer tous; ils désiraient tous également que l'on mît fin à la captivité des princes, parce que chacun d'eux espérait pouvoir se faire un appui de leur autorité, et un moyen de leur influence, pour anéantir leurs adversaires. Le parti de la cour même avait aussi cette espérance. Les princes furent donc mis en liberté. Mais cette réparation tardive d'une grande injustice affaiblissait encore l'autorité de la reine régente et de son ministre, qui s'en étaient rendus coupables; et l'on ne pouvait que prévoir des troubles plus grands encore que ceux qu'on avait vus, lorsque le parti des princes, longtemps opprimé, viendrait encore ajouter son action à la fermentation produite par le parti de la cour, celui du parlement et celui de la Fronde.
Des quatre nations bornées par la mer Atlantique, la nation française était la seule qui ne se fût point mise en mesure d'entrer dans le partage des richesses que promettait le Nouveau Monde. Cependant quelques aventuriers français, au commencement du dix-septième siècle, s'étaient fixés à Cayenne; et en 1643 des négociants de Rouen avaient en vain cherché à tirer parti de cet établissement.
En 1651 une compagnie se forma, qui obtint du gouvernement la concession de cette colonie, et réunit à Paris sept à huit cents individus disposés à s'y transporter. Les contrées qu'entouraient la mer et les grands fleuves Amazone et Orénoque, n'étaient pas alors, comme aujourd'hui, considérées comme des lieux d'exil et de mort, comme des pays humides et malsains, et souvent visités par des fièvres pestilentielles. Au contraire, on ajoutait foi aux brillantes descriptions qu'en avaient données ceux qui les premiers en firent la découverte, l'Espagnol Orellana et le célèbre Walter Ralegh390. On croyait, d'après leurs relations, qu'il existait dans l'intérieur une contrée qu'on désignait par le nom magnifique de el Dorado; qu'elle renfermait des mines d'or, et des pierreries plus riches que toutes celles du Pérou; et on se faisait l'idée la plus délicieuse de la beauté du pays, de la douceur et de la salubrité de son climat. Les belles fleurs, les oiseaux brillants, les animaux singuliers qu'on en tirait et qu'on transportait en Europe, semblaient ne laisser aucun doute sur la réalité de ces illusions. On citait des vieillards qui s'étaient guéris de la goutte par un voyage à l'île Martinique391; et il semblait qu'il suffisait de se transporter dans le Nouveau Monde pour se délivrer de tous les maux et pour y jouir du bonheur et de la santé. Un grand nombre de personnes notables de Paris, après avoir pris des actions dans la nouvelle compagnie, fatiguées du gouvernement comme des partis qui lui étaient opposés, avaient résolu de se joindre à la nouvelle colonie. Indépendamment des richesses qu'on espérait recueillir, on se croyait certain de faire une prompte et rapide fortune par l'achat et la vente des esclaves dont on avait besoin pour la culture des îles, genre de trafic que l'opinion publique ne proscrivait pas. Dans le nombre de ces émigrants se trouvait la femme d'un maréchal de France. L'infortuné Scarron avait placé une petite somme dans cette entreprise; et, entraîné comme malgré lui par les sollicitations de ses amis, qui le flattaient de pouvoir guérir ses infirmités par les bienfaits d'un meilleur climat, il se décida à s'embarquer392. Ninon prit aussi la même résolution. Un événement bien futile en apparence, mais qui eut des suites graves, l'avait forcée à cette étrange détermination. Plusieurs jeunes seigneurs dînaient chez elle un jour de carême; un des convives jeta par la fenêtre un os de poulet qui tomba dans la rue, sur l'épaule d'un prêtre de la paroisse de Saint-Sulpice. Le curé se plaignit à l'abbé de Saint-Germain des Prés. Avant l'édit de 1674, qui réunit les justices particulières au Châtelet de Paris, cet abbé avait droit de juridiction sur le faubourg Saint-Germain des Prés. Un fait bien simple en lui-même fut représenté comme une atteinte grave envers la religion, comme un dessein prémédité d'insulter à ses ministres393. La reine régente, irritée, voulait faire enfermer Ninon; mais on apaisa tout avec de l'argent. La résolution que Ninon prit alors de s'embarquer désarmait ses antagonistes; ils n'osèrent plus l'attaquer, et ils gardaient le silence en présence des clameurs occasionnées par l'annonce de son prochain départ. Ceux qui s'étaient accoutumés à la voir (et le nombre en était grand) ne pouvaient penser sans les plus vifs regrets qu'ils allaient être privés d'elle pour longtemps, et peut-être pour toujours: hommes puissants à la cour et dans la haute société, leurs plaintes bruyantes et amères retentissaient dans tous les cercles, et ils n'épargnaient ni ceux ni celles dont le rigorisme et l'intolérance amenaient de tels résultats.
Cependant la première embarcation pour la nouvelle colonie eut lieu; elle consistait en sept cents individus, tant hommes que femmes; Scarron et Ninon n'étaient point du nombre394. Il est probable que leur trajet dans le Nouveau Monde devait se faire sur un navire particulier. Quoi qu'il en soit, ce délai leur fut utile. Cette nouvelle tentative de colonisation fut encore plus malheureuse que les précédentes, et, de même que Scarron, Ninon ne partit point.
Il semblait que cette circonstance dût être fâcheuse pour madame de Sévigné, mais elle lui était indifférente. Déjà l'inconstance de Ninon, mieux que n'aurait pu faire son absence, avait cessé de la lui rendre redoutable; déjà Rambouillet de la Sablière, dont le nom a conservé quelque célébrité, plus par sa femme que par ses madrigaux, avait fait congédier Sévigné. Tallemant des Réaux395 était le beau-frère de Rambouillet. Ce fut lui qui l'introduisit chez Ninon. Après avoir parlé du voyage qu'elle fit à Lyon, et de sa liaison avec Sévigné, il ajoute: «M. de Rambouillet eut son tour; durant sa passion, personne ne la voyait que celui-là. Il allait bien d'autres gens chez elle, mais ce n'était que pour la conversation, et quelquefois pour souper; car elle avait un ordinaire assez raisonnable; sa maison était passablement meublée: elle avait une chaise [une voiture] fort propre. Elle écrivit en badinant à Rambouillet: «Je crois que je t'aimerai trois mois; c'est trois siècles pour moi.» Charleval ayant trouvé chez elle ce jouvenceau, qu'il n'y avait pas encore vu, s'approcha de l'oreille de la belle, et lui dit: «Ma chère, voilà qui a bien l'air d'être un de vos caprices396.»
Le règne de Rambouillet ne fut pas plus long que celui du marquis de Sévigné; il fut supplanté par Vassé, qui recueillit ainsi le fruit de sa longue persévérance. Comme Coulon et d'Aubijoux, Vassé, se plut à user de ses richesses pour satisfaire sa vanité, et à faire parade d'une conquête dont il était glorieux; et ce fut aussi la cause qui la lui fit perdre.
Tallemant remarque à ce sujet que Ninon ne voulut rien recevoir du marquis de Sévigné qu'une bague de peu de valeur: peut-être eût-il été à désirer pour madame de Sévigné que son mari eût conservé plus longtemps une maîtresse aussi désintéressée; il n'en continua pas moins, après l'avoir perdue, de donner en ce genre de nouveaux sujets de peine à sa femme. Les nouvelles liaisons qu'il contracta contribuèrent, ainsi que son défaut d'ordre, à déranger sa fortune. Ce fut alors que madame de Sévigné se sépara de biens d'avec lui; mais elle ne put s'y déterminer qu'après y avoir été en quelque sorte contrainte par les instances de l'abbé de Livry. Celui-ci ne put empêcher que, peu de temps après cette séparation, elle ne se rendît caution pour M. de Sévigné d'une somme de cinquante mille écus. Ménage, qui n'aimait pas le marquis, ne put se contenir quand il apprit ce nouvel engagement. Usant des droits d'une ancienne amitié, il gronda vivement madame de Sévigné de cette faiblesse, et lui dit: «Madame, une femme prudente ne doit jamais placer de si fortes sommes sur la tête d'un mari.—Pourvu que je ne mette que cela sur sa tête, que pourra-t-on me dire?» répondit-elle397.—Nous n'eussions pas reproduit cette grivoise repartie, si elle ne servait à faire ressortir une singularité du caractère de madame de Sévigné, dont nous avons déjà parlé: c'est que le besoin de gaieté qu'éprouvait cette femme spirituelle la rendait très-libre dans ses propos, et que son imagination n'était pas aussi chaste que sa raison et sa conscience.
«Sévigné, dit Tallemant, n'était point un honnête homme: il ruinait sa femme, qui est une des plus agréables de Paris. Elle chante, elle danse, elle a de l'esprit, elle est vive, et ne peut se tenir de dire ce qu'elle croit joli, quoique assez souvent ce soient des choses un peu gaillardes: même elle en affecte, et trouve moyen de les faire venir à propos398.»
Ce n'est pas seulement ceux qui ont eu occasion de voir madame de Sévigné et de s'entretenir avec elle qui confirment cette observation, mais ce sont ses lettres mêmes. Ceux qui les ont les premiers livrée à l'impression sous le règne de Louis XV, à l'époque de la plus grande dépravation des mœurs en France, ont cru nécessaire de changer quelques expressions, et d'adoucir certains passages, par trop libres, pour ne pas choquer la délicatesse du public de leur temps. Le plus savant et le plus exact éditeur de madame de Sévigné n'a pas osé rétablir dans son édition ces parties du texte telles qu'il les trouvait dans les lettres autographes qu'il a collationnées, et s'est déterminé à laisser subsister les changements que les précédents éditeurs y avaient faits; et il est telle repartie échappée à madame de Sévigné dans la vivacité du dialogue, citée par Tallemant, que nous ne voudrions pas reproduire dans ces Mémoires. Chose étrange, que nous soyons devenus plus scrupuleux et plus susceptibles qu'une précieuse formée à l'école de Rambouillet!
CHAPITRE XX.
1651
Sévigné conduit sa femme en Bretagne, et revient à Paris.—Il devient amoureux de madame de Gondran.—Détails sur madame de Gondran et sa famille.—Ses amours avec la Roche-Giffart, lorsqu'elle était demoiselle Bigot.—Ses autres amants lorsqu'elle fut mariée.—Sévigné obtient ses faveurs.—Il emprunte à mademoiselle de Chevreuse ses pendants d'oreilles, pour les prêter à madame de Gondran.—Comment l'abbé de Romilly s'y prend pour l'humilier.—Le bruit court que le marquis de Sévigné s'est battu en duel.—Alarme que cette nouvelle cause à madame de Sévigné.—Le chevalier d'Albret fait sa cour à madame de Gondran.—Il ne peut réussir.—Le bruit court que le marquis de Sévigné a fait des plaisanteries sur son compte.—Le chevalier d'Albret provoque Sévigné en duel.—Ils se battent.—Sévigné est blessé, et meurt.
Le marquis de Sévigné, pour se livrer avec moins de contrainte à sa vie licencieuse et désordonnée, avait conduit sa femme en Bretagne, à sa terre des Rochers; il l'y avait laissée, et était revenu à Paris. Après avoir été quitté par Ninon, il devint amoureux de madame de Gondran, qui s'était acquis à Paris une certaine célébrité par sa beauté et ses galanteries. Pour ce qui concerne sa beauté, je dois faire observer cependant que Tallemant, en parlant de cette nouvelle inclination de Sévigné, interrompt souvent son récit en disant: «Pour moi, j'eusse mieux aimé sa femme.» Et Bussy a fait la même réflexion sur toutes les maîtresses de Sévigné.
Madame de Gondran était la fille de Bigot de la Honville, secrétaire du roi, et contrôleur général des gabelles. Elle perdit sa mère fort jeune; et son père, ne jugeant pas à propos de la garder avec lui, la mit sous la tutelle de sa sœur aînée, mariée à Louvigny, secrétaire du roi399. Madame de Louvigny, femme modeste et retirée, vit tout à coup sa maison envahie par un grand nombre de jeunes gens de la cour et de la ville, qu'attiraient la beauté et plus encore les coquetteries de sa sœur400. Madame de Louvigny n'osa point faire refuser sa porte à des personnes qui par leur rang, beaucoup au-dessus du sien, commandaient des égards; et elle ne put empêcher sa sœur de se plaire dans leurs entretiens, et d'être l'objet de leurs attentions et de leurs civilités. Cependant le nombre s'en accroissait sans cesse, et il n'était bruit dans Paris, parmi les jeunes seigneurs coureurs des belles, que de la charmante Lolo. C'est par ce surnom, diminutif du nom de Charlotte, qui était le sien, qu'on avait pris l'habitude de désigner mademoiselle Bigot de la Honville. Son père, tous ses parents, et surtout sa sœur, pensèrent que, pour éviter les dangers des inclinations qu'elle manifestait, il fallait se hâter de la marier. Un parti se présentait: c'était de Gondran, un des fils de Galland, avocat célèbre401. Le fils aîné de Galland s'était aussi distingué dans la carrière du barreau, et soutenait dignement un nom que son père avait illustré. Quant à de Gondran, il était paresseux, glouton, ivrogne, brutal402. Aucune qualité personnelle ne le recommandait, mais il était riche. Il devint très-amoureux de la jeune Bigot. Elle n'avait pour lui ni affection ni estime. Aussi, malgré les avantages qu'il pouvait offrir sous le rapport de la fortune, le père et les parents de mademoiselle Bigot se refusaient à favoriser ses prétentions. Mais on s'aperçut bientôt que la jeune fille avait formé une liaison amoureuse avec la Roche-Giffart403, gentilhomme breton, et marié. On se hâta d'accepter les offres de Gondran, et on lui accorda mademoiselle Bigot. Moins épris et moins stupide, il eût été facile à de Gondran de prévoir le sort qui l'attendait. Conrart, qui nous fournit ces détails, décrit de la manière suivante les préliminaires de ce mariage: «Pendant que mademoiselle Bigot était accordée, nombre de galants étaient tous les jours chez sa sœur à lui en conter, se mettant à genoux devant elle, et faisant toutes les autres badineries que font les amoureux: le pauvre futur était en un coin de la chambre avec quelqu'un des parents à s'entretenir, sans oser presque approcher d'elle ni lui rien dire404.»
Mademoiselle Bigot, devenue madame de Gondran, n'en continua pas moins sa liaison avec la Roche-Giffart. Le secret de cette liaison fut longtemps bien gardé; mais la femme de la Roche-Giffart, ayant conçu quelque soupçon, força le secrétaire de son mari, et y trouva vingt lettres de madame de Gondran, toutes plus libres et plus passionnées les unes que les autres405. L'éclat que madame de la Roche-Giffart fit de cette aventure autorisa la belle-mère de madame de Gondran, chez laquelle cette derrière demeurait, à la surveiller de près. Elle l'empêcha de recevoir le chevalier de Guise, quoique son mari y consentît. Cependant, à l'abri de la soutane, elle laissa s'introduire auprès d'elle le jeune abbé d'Aumale, beau comme un ange, selon l'expression du cardinal de Retz406, et beaucoup plus dangereux que ne l'eût été le chevalier de Guise. Cet abbé fut nommé depuis archevêque de Reims; puis, après la mort de son aîné, qui fut tué en duel par le duc de Beaufort, il devint duc de Nemours, et épousa, au grand étonnement du monde, mademoiselle de Longueville407, dont nous avons parlé.
Le même motif qui avait protégé l'abbé d'Aumale contre les soupçons de la belle-mère de madame de Gondran, permit aussi à l'abbé de Romilly408 de fréquenter sa maison409. Cet abbé, impudent, débauché, sujet à l'ivresse, compromit la femme de Gondran par ses propos indiscrets. La belle-mère était âgée, prude et acariâtre; sa belle-fille, par ses complaisances, ses souplesses et ses flatteries, sut se la rendre favorable, et finit enfin par obtenir la liberté de recevoir tous ceux qui lui convenaient. Sévigné fut de ce nombre, et obtint ses faveurs; il plaisait aussi à son mari, qu'il menait partout avec lui; il le mettait de tous les festins, de tous les divertissements et de toutes les fêtes qu'il donnait à madame de Gondran. Pour elle il se montra plus prodigue qu'il n'avait jamais été. Elle désira, pendant le carnaval, pouvoir se parer des superbes pendants d'oreilles qu'elle avait vus à mademoiselle de Chevreuse. Le marquis de Sévigné eut, pour la satisfaire, la faiblesse d'aller chez mademoiselle de Chevreuse, et la pria de lui prêter ses pendants d'oreilles pour mademoiselle de La Vergne. Mademoiselle de Chevreuse les lui remit; il les porta sur-le-champ à sa maîtresse, qui se montra le même soir au bal avec ce riche ornement. Tout le monde reconnut aussitôt les pendants d'oreilles de mademoiselle de Chevreuse; et plusieurs personnes, le lendemain, lui témoignèrent leur étonnement qu'elle eût pu se décider à prêter cette parure à madame de Gondran. Le marquis de Sévigné, craignant les reproches de mademoiselle de Chevreuse, alla voir mademoiselle de La Vergne, lui avoua tout, et fit si bien par ses instances et ses prières, qu'il la décida à empêcher qu'on ne découvrît son honteux stratagème. Mademoiselle de La Vergne alla chez mademoiselle de Chevreuse pour lui faire ses remercîments, et mit en même temps sur son compte le prêt qui avait été fait à madame de Gondran410. Celle-ci ainsi que son mari se trouvaient, au moyen des dépenses du marquis de Sévigné, en communauté de plaisirs avec toute la jeune noblesse: le mari et la femme commencèrent bientôt à dédaigner la bourgeoisie, et même leurs anciens amis et leurs propres parents, qui appartenaient comme eux à cette classe; ils répétaient souvent qu'il n'y avait que les gens de cour qui fussent aimables. Cette ridicule vanité donna envie à plusieurs des amants de madame de Gondran de se venger d'elle. L'abbé de Romilly, dans un moment d'ivresse, tint sur son compte en présence de son mari les propos les plus grossiers et les plus insultants411. Un nommé Lacger412, qui fut secrétaire des commandements de la reine Christine, se plut à raconter dans un bal cette scène étrange. Tout fut redit au marquis de Sévigné, qui devint furieux. Pour punir l'outrage fait à sa maîtresse, il s'était proposé de donner des coups de canne à Lacger, dans une nombreuse assemblée où il croyait le rencontrer. Mais Lacger, averti à temps, n'y parut point. Ces circonstances, dénaturées et racontées diversement, firent dire que Sévigné s'était battu en duel, et avait reçu un coup d'épée. Cette fausse nouvelle courut les provinces, et parvint jusqu'en Bretagne. Madame de Sévigné, alarmée, écrivit à son mari une lettre pleine de tendres reproches et d'inquiétude sur sa santé. Cette lettre sur ce faux duel parvint au marquis quatre jours413 avant le duel véritable où il succomba, et qui nous reste à raconter.
Le chevalier d'Albret, frère cadet de Miossens, bien fait, aimable, spirituel, se mit à faire sa cour à madame de Gondran; mais il ne put parvenir à supplanter le marquis de Sévigné, qui par une constante assiduité, par des plaisirs variés et continuels, par l'or qu'il prodiguait pour elle, la retenait dans ses liens. D'Albret y renonça, après s'être vu quatre fois de suite refuser la porte. Il ne pouvait douter qu'en lui faisant cette espèce d'affront, madame de Gondran n'eût cédé aux désirs ou à la volonté de son amant. Il était donc déjà fort mal disposé envers Sévigné, lorsqu'on lui dit que celui-ci s'était permis avec sa maîtresse des railleries sur son compte, et qu'il avait tenu des propos tendant à le déprécier, sinon sous le rapport de l'honneur, du moins sous celui des femmes. C'était Lacger, qui, avec toute l'habileté et la perfidie de la haine et de la vengeance, avait inventé cette fable, et l'avait racontée au chevalier d'Albret, en lui donnant toutes les couleurs de la vraisemblance. Pour s'en éclaircir, le chevalier d'Albret pria le marquis de Soyecour, son ami, de demander à Sévigné lui-même s'il avait réellement tenu à son sujet le discours qu'on lui prêtait414. Sévigné dit à Soyecour qu'il n'avait jamais parlé au désavantage du chevalier d'Albret; en même temps, ne voulant pas avoir l'air de redouter un rival, il ajouta qu'il ne lui disait cela que pour rendre hommage à la vérité, mais nullement pour se justifier, parce qu'il ne le faisait jamais que l'épée à la main.
Sur cette réponse on se donna rendez-vous derrière le couvent de Picpus, le vendredi 3 février 1651, à midi. De part et d'autre on fut exact. Le marquis de Sévigné, qui avait fait porter les épées, dit d'abord au chevalier d'Albret qu'il n'avait jamais dit de lui ce qu'on lui avait rapporté, et qu'il était son serviteur. Les deux antagonistes s'embrassèrent. Le chevalier d'Albret dit ensuite qu'il ne fallait pas moins se battre. Sévigné répondit qu'il l'entendait bien ainsi, et qu'il ne s'était pas rendu en ce lieu pour s'en retourner sans rien faire. Aussitôt on s'écarte, et le combat commence. Sévigné porte trois ou quatre bottes à son adversaire, qui eut son haut-de-chausses percé, mais ne fut point blessé. Sévigné veut récidiver; il se découvre: Albret prend son temps et pare; Sévigné se précipite sur son adversaire, reçoit un coup d'épée qui lui traverse le corps, et tombe. On le ramène à Paris: dès que les chirurgiens eurent examiné sa blessure, ils déclarèrent qu'elle était mortelle. Il expira, en effet, le lendemain, regrettant de mourir à vingt-sept ans. Ses amis, ou plutôt ses compagnons de plaisir, étaient accourus auprès de lui. Parmi eux se trouvait Gondran, celui de tous qui était le plus sincèrement affligé de sa perte415.