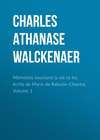Kitabı oku: «Mémoires touchant la vie et les écrits de Marie de Rabutin-Chantal, Volume 1», sayfa 19
CHAPITRE XXIII.
1651-1652
Réflexions sur le sentiment produit par un événement redouté et longtemps différé.—Surprise qu'occasionne la nouvelle de l'entrée de Mazarin en France.—Le parlement envoie des commissaires pour arrêter sa marche.—Conduite du duc d'Orléans.—Condé organise la guerre civile avec des moyens insuffisants.—Le parti des princes s'unit à la Fronde.—Intrigues de Gondi.—Il est en défiance au peuple.—Mazarin et la reine intriguent contre lui en cour de Rome.—Il les déjoue.—Efforts que font les ministres pour conserver leurs places.—Rôle que jouent les acteurs secondaires.—Détails sur Nemours, Beaufort, la duchesse de Châtillon, le prince de Conti, la duchesse de Longueville.—Le parti du duc d'Orléans, aussi divisé que celui de la Fronde.—Désastres et famine qui sont les résultats de la guerre civile.—Conférences pour la paix.
Il n'y a pas de sentiment plus élastique que l'espérance: le moindre véhicule suffit pour soulever le poids qui le comprime, et lui rendre toute son expansion. Lorsqu'une calamité que tout le monde considère comme inévitable et imminente se trouve seulement retardée, on se persuade aussitôt que les causes qui devaient l'amener s'affaiblissent ou ont disparu; on calcule toutes les chances qui lui sont contraires, on ferme les yeux sur celles qui la favorisent; tous les délais ajoutent à la confiance, et si ces délais se prolongent, on finit par se rassurer. On ne croit plus à un danger qui a inutilement et longtemps fatigué nos prévisions; on s'habitue à un orage qui gronde sans cesse, sans jamais éclater. On s'arrange comme si on n'avait plus rien à en craindre: et quand la foudre tombe et frappe, elle surprend et accable ceux-là même qui avaient le plus formellement annoncé sa prochaine détonation, et qui s'étaient prémunis contre les périls de sa chute.
Cette vérité se fit surtout sentir lorsque Mazarin rompit son ban, et entra en France, suivi d'une armée qu'il amenait, disait-il, au roi, pour l'aider à combattre les rebelles, mais qui était plutôt destinée à protéger la personne de son ministre496. On savait depuis longtemps que des lieux où la cour, sans cesse ambulante, faisait temporairement sa résidence, et de Bruhl, où s'était retiré Mazarin, partaient et arrivaient sans cesse des personnes qui avaient toute la confiance de la reine et du cardinal. Les noms de ces messagers même n'avaient pu être cachés; on n'ignorait pas qu'ils étaient au nombre de quatre: Bartet, Brachet, Milet et l'abbé Fouquet; et la singulière similitude des finales de leurs noms avait fait dire plaisamment au duc d'Orléans que désormais il fallait changer une des règles du rudiment de Despautère sur les genres, et mettre: «Omnia nomina terminata in et sunt mazarini generis.» (Tous les noms qui se terminent en et sont du genre mazarin.) L'intelligence de la reine avec le ministre proscrit n'était donc plus un mystère497. On se doutait qu'aucune mesure importante n'était résolue dans le conseil sans que la reine eût reçu l'avis du cardinal; on s'était aperçu que si l'on y prenait une résolution contraire à ses secrètes instructions, des ordres cachés en empêchaient l'exécution. Cependant, lorsque, après la déclaration de la majorité du roi, Condé eut levé l'étendard de la révolte, il se vit abandonné de presque toute la France498. Les mesures de Châteauneuf et de Villeroi furent si bien prises, que le cabinet acquit plus d'influence et d'autorité; le gouvernement du roi se raffermit; il marcha pour la première fois de concert avec le parlement. La reine parut se confier à ses ministres. On ne la vit plus avoir si souvent recours aux conseils du cardinal; elle dit même aux plus intimes amis de Mazarin, que celui-ci avait habilement placés près d'elle, qu'on ne pouvait pas penser encore à le rappeler, et que son retour devait être différé, au moins jusqu'à l'entière réduction de Condé et de son parti. Les ministres, qui s'appuyaient sur le besoin qu'on avait d'eux, mais dont aucun ne pouvait prétendre à la suprématie ou aux priviléges de la faveur, introduisirent dans le conseil le prince Thomas de Savoie, guerrier assez distingué, mais non heureux; d'un sens assez droit, mais borgne, sourd, et pesant: il ne pouvait donner aucun ombrage à ceux qui exerçaient le pouvoir499. Cousin germain de la reine, elle avait en lui toute confiance; et la présidence du conseil, que les ministres lui déféraient, convenait également à son rang, à sa naissance, à sa réputation d'intégrité, à sa position à la cour. Toutes les dépêches se signaient en sa présence; «et il fut, dit madame de Nemours, favori, et presque premier ministre, sans qu'il en eût seulement le moindre soupçon.»
Un tel état des choses rassurait tout le monde contre le retour, au moins prochain, du cardinal Mazarin. L'on espérait bien qu'après l'entière extinction de la révolte de Condé, le concours de tous les ordres de l'État, des princes et des ministres, empêcherait pour toujours ce retour, et qu'on ne reverrait jamais en France cet étranger proscrit par tous les parlements, devenu odieux à tous les partis.
Telle était à cet égard la disposition des esprits, lorsqu'on apprit tout à coup qu'il était rappelé; qu'il s'avançait dans l'intérieur du royaume, et que, de plus, un arrêt du conseil d'en haut (mot nouveau, et dont s'offensaient les défenseurs des libertés publiques) avait cassé l'arrêt que le parlement de Paris venait de rendre pour le repousser500.
Il suffit de connaître le caractère fougueux et emporté de la nation française pour concevoir quelle fut, à cette nouvelle si inattendue, la fureur générale. Tous les partis se reformèrent instantanément, et semblaient avoir acquis plus de violence. Les nobles, le peuple, le parlement, les partisans des princes, ceux de la Fronde, n'eurent plus qu'un seul sentiment, qu'un seul intérêt, qu'un seul cri, l'expulsion de Mazarin. La cour même et la plus grande partie des royalistes501 formaient en secret le même vœu; plusieurs le manifestaient hautement, se croyant certains que Mazarin ne pourrait jamais résister à cette unanimité de haine, à cet accord d'opposition de tous contre un seul502.
Mais ce torrent qui s'élançait avec tant d'impétuosité, et avec un fracas capable de faire croire à quiconque le considérait de loin qu'il allait tout submerger, se dispersait après sa chute dans un si grand nombre de lits différents, et se subdivisait en tant de petites rigoles, que vu de près il cessait de paraître redoutable.
C'est qu'aucun événement peut-être ne produisit une péripétie plus grande que celle qu'occasionna le retour de Mazarin en France. Tous les partis se trouvèrent par là placés dans des positions si bizarres et si monstrueuses; les intérêts particuliers, les passions, les haines des différents acteurs de ce grand drame firent éclore subitement une telle multitude d'intrigues, que, malgré les dépositions et les aveux de presque tous ceux qui y jouèrent les principaux rôles, et les minutieux détails où ils sont entrés dans leurs Mémoires, les historiens n'ont pas su les démêler toutes, et par conséquent n'ont pu les exposer avec clarté.
Le parlement rendait des arrêts503 et envoyait des commissaires pour arrêter Mazarin dans sa marche; mais en même temps, instruit par le passé et en garde contre les funestes résultats de ses emportements, redoutant les princes et leur domination, il ne voulait pas qu'aucune atteinte fût portée aux droits du roi. Il refusait d'autoriser la saisie des deniers publics504, et il interdisait toute levée de soldats qui n'était pas faite au nom du roi; ce qui était accorder au seul Mazarin la faculté de se recruter505; le parlement s'effrayait à la seule proposition d'un arrêt d'union avec les autres cours souveraines, croyant déjà voir par là renouveler les scènes tumultueuses de la première Fronde. Cependant il implorait en même temps l'appui du duc d'Orléans, et il acceptait le secours des troupes qui étaient à sa disposition. Pourtant Gaston, ayant cessé d'être lieutenant général, ne pouvait légalement lever des troupes et commander une armée sans le consentement du roi, devenu majeur. Le parlement proscrivait Condé et ses adhérents, qui s'étaient armés pour repousser Mazarin. Le duc d'Orléans, de son côté, aurait voulu s'unir intimement au parlement, et ne pas enfreindre les lois du royaume506: il faisait alliance avec Condé, et se compromettait pour lui, en prenant sous sa protection les troupes que Nemours avait été chercher en Flandre chez les Espagnols507. Tout en détestant l'étranger, il favorisait l'exécution du traité que Condé avait contracté avec lui; il s'en rendait complice. Il dissimulait avec les amis des lois, qui avaient mis en lui toutes leurs espérances, et ne répondait que par des subterfuges et des assertions mensongères aux discours éloquents du vertueux Talon. Il se trouvait entraîné dans toutes ces démarches par la nécessité de pourvoir au plus pressé, en repoussant Mazarin; mais comme il ne craignait rien tant que l'élévation de Condé en le secondant contre Mazarin, il cherchait à lui nuire dans le parlement, dans le peuple, et dans son propre parti.
Condé, entraîné à organiser la guerre civile avec des partisans divisés entre eux, d'une fidélité douteuse, fut obligé de combattre, avec des recrues à peine instruites, à peine enrégimentées, les meilleures troupes de l'Europe508, celles-là même qui avaient vaincu sous lui. Il lui fallut soutenir son parti par sa seule personne, faire taire toutes ses répugnances, changer toutes ses anciennes combinaisons, toutes ses habitudes. Il voulait dominer, et arracher des places et de l'argent pour une noblesse altière et avide qui se dévouait pour le servir; et tous les moyens lui semblaient bons, parce qu'il éprouvait le besoin d'avoir recours à tous. L'adversité le mettait dans la nécessité de faire violence à son caractère, naturellement impérieux, peu affable, impatient de toute contrainte509. Proscrit par le parlement de Paris, il cherchait à s'en faire un appui, en s'associant à lui dans sa haine contre Mazarin. Détesté de la reine, qu'il avait outragée, il négociait en secret avec elle; et pour la gagner, il consentait à la rentrée de Mazarin en France et à son maintien au ministère, mais avec de telles conditions, que si on les avait acceptées, le roi se serait trouvé sous sa domination. Ennemi personnel de Gondi, il concluait un traité avec le duc d'Orléans, par lequel il consentit que Gondi restât son conseil et conservât toute sa confiance. Plein de mépris pour toutes les influences populaires, il cherchait à se faire un parti dans la Fronde, et donnait à celui qui en était le chef, au duc de Beaufort, le commandement d'un de ses corps de troupes.
De son côté, la Fronde, ou les populations bourgeoises qui la formaient, se montraient également opposées à Mazarin et aux princes. Il faut cependant en excepter Bordeaux, où ces derniers s'étaient retires, et s'étaient formé un parti; mais ils n'étaient pas les maîtres de cette ville, et c'était plutôt la haine contre le duc d'Épernon, que leur inclination pour les princes, qui avait poussé les Bordelais à la révolte. Les autres principales villes du royaume eussent montré, si elles en avaient eu l'occasion, les mêmes dispositions que Paris et Orléans, qui toutes deux, en haine de Mazarin comme de Condé, refusèrent l'entrée de leurs remparts aux troupes du roi ainsi qu'à l'armée des princes. Cependant l'esprit d'opposition protestante qui dominait dans le midi fit beaucoup de partisans à Condé dans cette partie de la France; et Chavagnac nous apprend qu'il n'eut pas alors plus de peine à lever un régiment pour ce prince que si c'eût été pour le roi510. Il eût fallu au peuple des chefs puissants, pour qu'il pût intervenir entre ces ambitions rivales d'une manière utile pour lui; mais tous ceux qui auraient pu se mettre à sa tête, tels que le duc de Bouillon et Turenne, s'étaient rangés du côté de la cour. En général, presque tous les grands personnages politiques de cette époque avaient des intérêts différents de ceux des partis qu'ils avaient embrassés. Voilà pourquoi on ne peut démêler les fils de ce drame compliqué qu'en entrant dans les détails de la vie privée de chacun des principaux acteurs, et en s'instruisant des motifs qui les faisaient agir.
Gondi, dont la nomination au cardinalat n'était pas encore confirmée par le pape, agissait de manière à ce que la cour n'eût aucun prétexte pour la révoquer. Quoiqu'il n'eût point cessé de fréquenter l'hôtel de Chevreuse, il savait qu'il n'y était plus sur le même pied qu'auparavant; il n'ignorait pas que la duchesse de Chevreuse, entraînée par des nécessités de fortune dans le parti de Mazarin, ne se conduisait plus que par les conseils de l'abbé Fouquet; que sa fille, jalouse de la princesse Palatine511, et irritée des fréquentes visites qu'il lui avait faites, avait, par dépit et par vengeance, redit à la reine les plaisanteries qu'il s'était permises sur son compte. Ainsi Gondi, ayant dans Mazarin et dans Anne d'Autriche deux ennemis personnels, ne pouvait les empêcher de lui nuire qu'en continuant de se montrer pour la cour un allié fidèle, mais prêt à être un antagoniste redoutable si on l'y contraignait, en manquant aux promesses qui lui avaient été faites. C'est pourquoi il s'attachait à se rendre maître de l'esprit du duc d'Orléans, et qu'il le fit résoudre à armer contre Mazarin et à réunir ses troupes à celles de Condé512. Il aurait bien désiré exercer sur le parti dont celui-ci était le chef la même influence que sur celui d'Orléans; mais l'aversion que les dernières luttes avaient fait naître à son égard dans le cœur de Condé n'était pas le seul obstacle qui s'y opposait. La Rochefoucauld, Chavigny, la duchesse de Longueville, avaient tous trois l'ambition de diriger ce parti; et quoiqu'ils ne fussent pas toujours d'accord entre eux, ils l'eussent été pour empêcher que Gondi, qu'ils haïssaient et dont ils redoutaient les talents, pût entrer en partage de l'ascendant qu'ils avaient pris dans le conseil de Condé513. Aussi Gondi, quoiqu'il cherchât à rendre l'armée commandée par Condé assez forte pour repousser celle de Mazarin, s'efforçait d'un autre côté à ruiner le parti de ce prince dans le parlement et dans le peuple. Pour cet effet il s'était étroitement uni avec la princesse Palatine et avec madame de Rhodes: celle-ci avait fait nommer le maréchal de l'Hospital, son beau-père, au gouvernement de Paris; et Gondi disposait du prévôt des marchands, son ami intime514. Ainsi toutes les hautes autorités de la capitale étaient dévouées à la cour et à Gondi; mais les agents de Condé animaient le peuple contre Gondi515: de sorte qu'il n'osait plus sortir qu'entouré d'une escorte de gentils-hommes armés qui faisaient partie de sa maison ou qui s'étaient déclarés ses partisans516.
Ces divisions parmi les frondeurs occasionnaient des émeutes, où, selon sa coutume, la populace ne distinguait ni amis ni ennemis. Ainsi l'on se jeta sur le carrosse de la comtesse de Rieux, quoique son mari se fût déclaré contre Mazarin517; on attaqua celui du président Thoré518; le marquis de Tonquedec, ami de madame de Sévigné, fut dépouillé et outragé; on voulait piller l'hôtel de Nevers, qui appartenait à Duplessis-Guénégaud, bien connu pour être partisan de Mazarin519. Le peuple maltraitait les personnes qui par ruse cherchaient à sortir de Paris; il poursuivit pour ce motif deux filles de la reine, Ségur et Gourdon, leur enleva tout ce qu'elles emportaient avec elles, et voulait brûler la maison où elles s'étaient réfugiées520. Elles furent obligées de se faire reconduire au Luxembourg, chez le duc d'Orléans, qui leur donna les moyens d'aller rejoindre la cour. Les duchesses de Bouillon et d'Aiguillon coururent aussi les plus grands dangers en faisant une semblable tentative521. Dans le même temps la populace forçait les portes de la Conciergerie; et tandis que les prisonniers et les criminels étalent ainsi rendus à la liberté, Paris était devenu pour ses habitants les plus inoffensifs une vaste prison.
Des raisons d'étiquette et de préséance empêchaient Gondi de siéger au parlement jusqu'à ce que sa nomination au cardinalat eût été confirmée; mais sa double opposition contre Mazarin et contre Condé, l'affaiblissement de son crédit parmi le peuple, lui avaient fait regagner toute son influence sur cette puissante compagnie; et il l'exerçait par le moyen du duc d'Orléans, qui avait une grande facilité d'élocution, et dont il dirigeait toutes les démarches. Toutefois, l'ascendant que Gondi avait reconquis sur le parlement était accompagné de beaucoup de défiance. On redoutait les entraves que ses intérêts privés pouvaient apporter à la pacification générale, que l'on désirait vivement. Il fut sur le point de manquer le but qu'il se proposait par toutes ces manœuvres. Mazarin et la reine avaient fait écrire par le roi au pape pour révoquer sa nomination au cardinalat; et ils avaient, en envoyant cette dépêche au bailli de Vallançay, l'ambassadeur de France à Rome, autorisé celui-ci à solliciter le chapeau pour lui-même. Le ressentiment des obstacles que Gondi apportait à la réconciliation de Gaston avec la cour, et des conseils qu'il avait donnés à celui-ci, avait été la cause de cette nouvelle détermination de Mazarin et de la reine. On faisait valoir auprès du pape, pour la justifier, les liaisons de Gondi avec les jansénistes et la licence de ses mœurs: ces deux motifs publics et notoires semblaient ne devoir laisser aucun doute sur l'issue de cette affaire, car déjà les jansénistes, devenus assez puissants pour paraître redoutables, étaient détestés à Rome522. Cependant Innocent X, instruit secrètement du contenu de la dépêche de la cour de France avant qu'on ne la lui eût fait connaître officiellement, se hâta de tenir un conclave le 22 février 1652, et y préconisa Gondi au cardinalat; de sorte que la cour de France se vit forcée de considérer sa révocation comme non avenue, de supprimer la dépêche envoyée à son ambassadeur, et de paraître satisfaite de la confirmation de sa propre nomination523. Ce résultat fut produit par l'antipathie personnelle du pape contre Mazarin, qu'il avait connu à Rome avant son élévation; par l'opinion qu'on avait en Italie de la prochaine et inévitable chute de ce ministre; et encore plus peut-être par une révolution de palais qui substitua à l'influence qu'exerçait la princesse Olympie, celle de la princesse Rossane, qu'avait épousée le neveu du pape, et que Gondi avait su gagner par des présents. L'abbé Charrier, son agent principal à Rome, sut mettre habilement à profit tous ces moyens, et conduisit avec adresse cette négociation, dont le succès causa une surprise générale.
On ne peut s'empêcher de reconnaître que le cardinal de Retz déploya dans le cours de tous ces événements de prodigieux talents. On s'étonne de la multiplicité de ses combinaisons, mais on peut douter qu'elles fussent bien réfléchies et toutes propres à concourir au but. Il s'était aliéné la duchesse de Chevreuse et la princesse de Guémené, qui, aussi, s'était tournée du côté de la cour. Il avait offensé la reine, exaspéré Mazarin; il excitait la défiance du parlement; il ne satisfaisait pas les frondeurs, n'obtenait du duc d'Orléans, et avec des peines infinies, qu'une confiance imparfaite524; et enfin il s'était fait du vainqueur de Rocroi et de Lens un ennemi mortel525. Il semblait que Gondi ne se trouvât bien que dans les agitations et les intrigues, et qu'il se plût à les faire naître; semblable à ces gladiateurs qui appellent des adversaires au combat, et aiment à en voir accroître le nombre, afin de faire admirer plus longtemps leur adresse et leur énergie dans la lutte. Gondi, emporté par la fougue de ses passions, leur sacrifiait trop souvent ses intérêts; Mazarin, sans haine comme sans affection, ne se laissait jamais distraire des siens526.
Châteauneuf, aussitôt après l'arrivée de Mazarin à Poitiers, avait pris le parti de la retraite527; et depuis le retour du premier ministre on remarqua plus d'ensemble et plus de secret dans les résolutions du conseil; ses résolutions furent suivies d'une plus rapide exécution. Chavigny, à Paris, s'était fait l'agent du parti de Condé. Une ambition plus élevée que celle de la réussite de ce parti le faisait agir. Chavigny, formé aux affaires par Richelieu, et pour lequel ce grand homme avait une tendresse toute paternelle, ne pouvait oublier que Mazarin lui devait son élévation528. Appelé un instant au ministère par la politique d'Anne d'Autriche, Chavigny voulait y rentrer. Il était le plus redoutable ennemi de Gondi, et comme chef du parti de Condé, et comme lui disputant la confiance de Gaston, sur l'esprit duquel Chavigny avait de l'influence. De concert avec le duc de Rohan, la duchesse d'Aiguillon et Fabert, il forma le dessein d'un traité entre les princes et Mazarin; et au moyen de l'alliance que Condé avait formée avec les Espagnols, il voulait conclure ensuite la paix générale. Comme alors il eût été le principal négociateur de cette paix et le premier auteur d'un si grand bienfait, il espérait acquérir par là une autorité assez grande dans le cabinet et dans les conseils pour expulser Mazarin et prendre sa place. Mais Condé s'aperçut bientôt que Chavigny, dans ses conférences avec le premier ministre, ne se conformait pas à ses instructions; il lui retira sa confiance, et, sans l'en prévenir, il se servit pour ces négociations de Gourville, de La Rochefoucauld et de la duchesse de Châtillon529.
Les acteurs secondaires de ce grand drame n'offraient pas moins de diversité dans les motifs de leurs actions. Beaufort, qui commandait les troupes de Gaston, et Nemours celles du prince de Condé, quoique beaux-frères, affaiblissaient par leurs divisions une armée que leur concorde aurait pu rendre redoutable. La nécessité des opérations militaires exigeait qu'ils s'éloignassent de Paris; et ils aimaient au contraire à s'y montrer à leurs maîtresses revêtus de l'uniforme de général et munis du bâton de commandement530. Beaufort, comme chef de la Fronde, autrefois d'accord en tout avec Gondi, maintenant le contrariait dans toutes ses mesures. Le prince de Conti, auquel son frère n'avait pu se dispenser de donner une autorité au moins nominale, avait presque toujours été gouverné par sa sœur la duchesse de Longueville, au point de donner cours à des bruits et à des libelles outrageants pour tous deux531. La duchesse était sous l'influence du duc de La Rochefoucauld, son amant, et la plus forte tête du parti. Le prince de Conti se montrait jaloux de cette influence; son secrétaire, le poëte Sarrasin, était fort lié avec une demoiselle de la Verpillière, fille d'honneur de la duchesse de Longueville; et comme il arrive toujours que les subordonnés croient avancer leur fortune en servant les passions de leurs maîtres, Sarrasin et la Verpillière se concertèrent avec les marquis de Jarzé et de Saint-Romain pour donner un rival au duc de La Rochefoucauld. Ils introduisirent le beau duc de Nemours auprès de la duchesse de Longueville; et celle-ci, qui détestait la duchesse de Châtillon, crut triompher en lui enlevant cet amant. Le prince de Condé se vit avec satisfaction délivré par sa sœur des trop justes motifs de jalousie que lui inspirait le duc de Nemours; et ce dernier sacrifia son amour à son ambition. La Rochefoucauld dut regretter l'ascendant que lui donnait un illustre attachement, mais non pas la perte d'une maîtresse qui, si l'on en croit Bussy, négligeait par trop le soin de sa personne, et avait dans le commerce intime les fâcheux inconvénients qu'entraîne une telle négligence532. Mais on n'obtint pas de ces combinaisons, formées au profit de petits intérêts et de petites passions, les résultats qu'on s'était promis. Le prince de Conti et la duchesse de Longueville ne furent pas plus d'accord entre eux que lorsque La Rochefoucauld les divisait. A Bordeaux ils favorisèrent des partis contraires, et contribuèrent à augmenter les troubles et à affaiblir le parti des princes en le divisant. La duchesse de Longueville, lorsqu'elle ne fut plus dirigée par La Rochefoucauld, ne cessa de s'égarer dans des projets sans but, et de se compromettre dans des intrigues sans résultat533. Quand Nemours eut été blessé, sa femme se rendit à l'armée pour le soigner, et la duchesse de Châtillon, sous prétexte de visiter un de ses châteaux, l'accompagna jusqu'à Montargis: elle se rendit dans le couvent des Filles de Sainte-Marie, d'où, se croyant bien cachée, elle allait, sous divers déguisements, voir celui qu'elle n'avait pas cessé d'aimer. Ces mystérieuses visites ne furent bientôt plus un secret pour personne; et alors Condé et sa sœur purent se convaincre combien sont différents les sentiments que l'amour inspire et ceux que simulent l'intérêt et la vanité534. Le grand Condé, par son esprit et sa figure, avait tous les moyens de plaire aux femmes; mais il y réussissait peu. Si on excepte mademoiselle du Vigean, qui se fit carmélite ne pouvant l'épouser, il ne paraît pas qu'il ait pu contracter de véritables attachements de cœur. Il poussait plus loin encore que sa sœur la duchesse de Longueville le défaut de soins de sa personne. Dans l'habitude de la vie presque toujours mal vêtu, il n'était beau que sur un champ de bataille535. Aussi le duc de Nemours ne fut pas le seul rival que Condé eût à redouter auprès de cette beauté pour laquelle Louis XIV, dans ses jeux enfantins, avait montré une préférence qui a fourni la matière d'un élégant badinage à la muse spirituelle de Benserade536. Un abbé nommé Cambiac, au service de la maison de Condé, balança pendant quelque temps la passion que Nemours avait fait naître dans le cœur de la duchesse de Châtillon; et la jalousie de Nemours ne put faire expulser Cambiac. La duchesse ménageait en lui l'homme qui avait obtenu le plus d'empire sur sa parente, la princesse de Condé douairière. La condescendance de la duchesse de Châtillon envers cet homme intrigant et libertin lui valut, de la part de la princesse douairière, un legs de plus de cent mille écus en Bavière, et l'usufruit d'une terre de vingt mille livres de rentes. Cependant Cambiac se retira, lorsqu'il sut que Condé était son rival537. Mais le vainqueur de Rocroi était plus habile à livrer des batailles qu'à conduire une intrigue d'amour. Il eut la maladresse d'employer pour intermédiaire auprès de sa nouvelle maîtresse un certain gentilhomme nommé Vineuil538, qui était bien, il est vrai, un de ses plus habiles et fidèles serviteurs, mais que sa figure, son esprit plaisant et satirique, son caractère entreprenant, rendaient très-dangereux pour les femmes. Il s'était même acquis quelque célébrité par ses succès en ce genre. Madame de Montbazon, madame de Mouy et la princesse de Wurtemberg avaient successivement éprouvé les effets de ses séductions. Vineuil plut aussi à la duchesse de Châtillon; et il ne crut pas trahir son prince, ni manquer à la foi qu'il lui devait, en ne se refusant pas des plaisirs qui, goûtés en secret, ne pouvaient causer aucune peine à celui qui l'avait exposé à la tentation. En cela il se conformait aux mœurs de son siècle; il lavait même ainsi, par sa fraude, la honte des négociations dont on le chargeait. Condé seul avait tort; mais ce tort, il ne le connut jamais. Vineuil fut toujours en grande faveur auprès de lui539. Nemours excitait sa jalousie, et Nemours ne redoutait que Condé. Cependant alors, et au mois de mars de l'année 1652, le marquis de La Boulaye et le comte de Choisy, tous deux amoureux de la duchesse de Châtillon, voulurent se battre en duel à son sujet. Le bruit s'en répandit dans le monde. La duchesse de Châtillon l'apprit, et parut inopinément sur le lieu où les deux adversaires s'étaient donné rendez-vous; et au moment même où ils venaient de tirer l'épée elle les sépara, les prit par la main, et les conduisit chez le duc d'Orléans, qui chargea les maréchaux de France alors à Paris, L'Hospital, Schomberg et d'Étampes, d'arranger cette affaire et d'empêcher un combat. Ils y parvinrent540; mais ces rivalités, ces intrigues de femmes affaiblissaient beaucoup le parti de Condé, et empêchaient qu'il n'y eût ni secret ni ensemble dans l'exécution des projets arrêtés dans le conseil de son chef.
Le parti du duc d'Orléans n'offrait pas plus d'unité que celui de Condé. Il avait perdu dans Bouillon l'appui d'un prince puissant par ses richesses et par son habileté politique; dans Turenne, l'ascendant que donnent les talents militaires et l'amour des soldats. Les deux principaux conseils de Gaston, Gondi et Chavigny, étaient ennemis, et publiaient l'un contre l'autre des libelles anonymes541. Chefs dirigeants dans des partis contraires, ils poussaient dans des sens opposés, et dans des mesures contradictoires, un prince faible et irrésolu. Chacun des deux avait des partisans dans la famille même de ce prince. La duchesse d'Orléans appuyait Gondi. MADEMOISELLE, au contraire, s'était rangée du côté de Chavigny. Le prince de Condé, qui entretenait avec elle un commerce de lettres, avait su la gagner par ses flatteries, et lui avait promis, s'il restait le maître et parvenait à chasser Mazarin, de lui faire épouser le roi. Autant elle avait eu autrefois d'antipathie pour Condé, autant elle montrait d'enthousiasme pour sa gloire et de zèle pour ses intérêts542. Le courage et la présence d'esprit qu'elle déploya dans Orléans, où son père l'avait envoyée, achevèrent d'accroître son orgueil, et d'augmenter l'excessive confiance qu'elle avait en elle. Cette ville dont on lui avait refusé l'entrée, elle s'en rendit maîtresse en escaladant ses remparts, et en pénétrant seule et sans escorte par une brèche qu'avait faite pour elle le parti populaire. L'autorité qu'elle y avait exercée; ces troupes qui s'étaient rangées sous son commandement; ces conseils de guerriers présidés par elle; ses deux dames d'honneur, les comtesse de Fiesque et de Frontenac, proclamées à la tête de l'armée, au son des trompettes, ses maréchaux de camp; la popularité qu'elle s'était acquise en empêchant les troupes du roi de pénétrer dans la ville qui lui était soumise543; tout cela avait enivré son imagination, déjà exaltée par la lecture des romans544. Elle se passionna pour la gloire militaire; Condé fut son héros. Pourtant elle cherchait à persuader à la reine qu'il était de son intérêt de la marier avec le roi; et à ce prix, elle consentait à tout. Quant à son père, il ne pouvait rien pour elle, non plus que le parlement; et par cette raison elle se laissait souvent engager dans des démarches et des intrigues contraires au parti de Gaston, et surtout toujours en opposition avec la direction que Gondi s'efforçait de donner à ce parti.