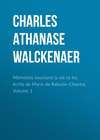Kitabı oku: «Mémoires touchant la vie et les écrits de Marie de Rabutin-Chantal, Volume 1», sayfa 20
D'un autre côté, la cour était abandonnée par ceux sur lesquels elle avait le droit de compter. Le chancelier, qui, comme chef de la justice, aurait dû donner l'exemple de l'obéissance aux ordres du roi, irrité d'avoir été éloigné du ministère, fit en sorte que le duc de Sully, son gendre, qui commandait à Nantes, permît le passage de cette ville aux troupes du duc de Nemours; et le duc de Rohan, que la reine avait nomme gouverneur d'Anjou, fit révolter Angers contre les troupes royales; mais ensuite il ne leur résista pas aussi longtemps qu'il aurait pu le faire dans l'intérêt du prince545. La cour, ainsi que les partis qui lui étaient opposés, ne se lassait pas, pour la réussite de ses projets, d'employer la fraude, la violence, la crainte, la séduction: tous les moyens lui étaient bons. Mazarin ne répugnait pas même aux plus honteux. Ainsi la maréchale de Guébriant, qu'il avait mise dans ses intérêts, ne se fit aucun scrupule d'abuser de la confiance de Charlevoix et des droits que la reconnaissance lui donnait sur un officier dont son mari avait été le bienfaiteur. Elle ne rougit pas d'employer le ministère d'une demoiselle bien faite et de facile composition, dit madame de Nemours, pour attirer ce commandant de Brissach hors de sa forteresse, le faire prisonnier, et se rendre maîtresse de la place qu'il était chargé de garder. Toutefois cette trahison ne réussit qu'à demi. La garnison, indignée, remit la place au comte d'Harcourt, qui n'était point contre le parti du roi, mais qui cependant était au nombre des mécontents, et peu favorable à Mazarin546.
Le plus nul, le plus insignifiant de tous les chefs de la première Fronde, le duc de Longueville, fut le seul d'entre eux qui dans ces nouvelles circonstances se conduisit avec sagesse et dignité, qui se montra un sujet fidèle, mais non servile. Il suivit un plan arrêté, conforme au bien public et à une bonne et saine politique. Retiré dans son gouvernement de Normandie, il fut sollicité par tous les partis, et ne se déclara d'abord pour aucun; enfin il fit connaître ses intentions de ne pas se séparer du roi547. Mais, sans prendre fait et cause pour son ministre, il se prononça de manière à faire craindre à la cour, s'il était contrarié par elle, de le voir se replacer de nouveau sous l'empire de sa femme et de son beau-frère, auquel il s'était soustrait. Ainsi par ses instigations le parlement de Rouen avait demandé l'éloignement de Mazarin, à l'exemple de celui de Paris, mais sans adhérer aux actes de proscription de ce dernier548. La déclaration parlementaire servit au duc de Longueville de prétexte pour se refuser à admettre les troupes royales dans sa province, où cependant il maintenait la levée des impôts au profit du roi. Par là il parvint à rester maître absolu dans son gouvernement, et il se fit chérir des habitants, qu'il protégeait contre tous les maux de la guerre civile549.
Les désastres qu'elle occasionnait étaient portés à leur comble, et encore accrus par le peu d'autorité que les chefs militaires avaient sur leurs subordonnés. Un seul fait suffira pour faire juger du degré d'anarchie où l'on était arrivé. Pendant que la cour était en marche, la petite écurie du roi fut pillée par le frère du comte de Broglie, qui cependant était du parti de la cour; et ce brigandage fut considéré comme une équipée plaisante, dont on s'amusa, et qui excita le rire. Les troupes de tous les partis, mal payées, mal nourries, pillaient, brûlaient, saisissaient les deniers publies, dévastaient les campagnes, rançonnaient les cultivateurs, et produisaient partout où elles séjournaient une misère extrême et une hideuse famine550. Des bandes de malheureux abandonnaient leurs habitations, et suivaient l'armée du roi en demandant du pain: la cour vit plusieurs fois sur son passage des hommes mourant de faim, et des enfants tétant encore sur le sein de leurs mères, qui venaient de rendre les derniers soupirs551. La reine, fortement émue d'un tel spectacle, disait que les princes et les parlements répondraient devant Dieu de tant de calamités, oubliant ainsi la part qu'elle y avait elle-même. Ce n'était pas tout. Les Espagnols s'avançaient sur nos frontières, et entraient en France comme alliés du prince de Condé, mais dans la réalité pour profiter de nos divisions. Turenne leur fit offrir de l'argent pour se retirer, et les menaça d'une bataille s'ils n'y consentaient. Ils prirent l'argent, et délivrèrent ainsi les troupes royales de la crainte d'avoir deux armées à combattre552.
Chaque parti se montrait jaloux de rejeter la cause des malheurs qu'on éprouvait sur les partis contraires; tous parlaient de paix et semblaient la désirer, et tous la voulaient en effet; mais chacun d'eux avait la volonté d'en régler seul les conditions. Toutefois, pour éloigner d'eux l'odieux de la continuation de la guerre civile, le parlement et les princes envoyèrent des députés à Saint-Germain, où la cour s'était retirée: ces députés étaient munis de pouvoirs pour négocier; mais ils avaient ordre de ne point voir Mazarin, et de ne pas communiquer avec lui directement ni indirectement. Lorsqu'ils furent introduits auprès de la reine, Mazarin était à côté d'elle. Les conférences s'engagèrent donc entre eux et le ministre proscrit. Alors ces députés perdirent la confiance de leurs partis, et augmentèrent beaucoup les divisions qui s'y trouvaient, par la crainte qu'ils firent naître que ceux qui semblaient parler avec plus de véhémence et d'acharnement contre Mazarin ne fussent déjà entrés en arrangement avec lui553.
CHAPITRE XXIV.
1651-1652
Situation de la capitale pendant le séjour qu'y fit madame de Sévigné.—Paris se ressentait peu des désastres des provinces.—Succès des théâtres.—Les malheurs publics ramenaient à la méditation et à la religion.—Le nombre des solitaires de Port-Royal augmente.—Leur influence sur les gens de lettres et sur certaines réunions.—Madame de Sévigné alors très-répandue dans le monde.—Courtisée par le duc de Rohan et le marquis de Tonquedec.—Ses liaisons intimes avec sa tante la marquise de La Troche; avec mademoiselle de La Vergne.—Détails sur cette dernière et sur mademoiselle de La Loupe, son amie.—Mademoiselle de La Loupe est promise en mariage au comte d'Olonne.—Le cardinal de Retz tente de la séduire.—Il est secondé dans cette intrigue par le duc de Brissac, amoureux de mademoiselle de La Vergne.—Récit que le cardinal de Retz fait lui-même de son aventure avec mademoiselle de La Loupe.—Celle-ci épouse le comte d'Olonne.—Sa visite au camp du duc de Lorraine, et commencement de son intrigue avec le comte de Beuvron.—Liaison du cardinal de Retz avec madame de Pommereul.
Nous avons exposé dans le chapitre précédent les intrigues et les événements dont Paris fut occupé, et qui fournissaient matière aux entretiens de tous les salons et de toutes les ruelles pendant l'hiver qu'y passa madame de Sévigné, c'est-à-dire depuis la mi-novembre 1651 jusqu'aux premiers jours d'avril 1652. Dans cet intervalle de temps, cette capitale jouissait d'une assez grande tranquillité, et se ressentait peu des malheurs qui affligeaient les provinces. Paris avait refusé d'ouvrir ses portes aux troupes de tous les partis, qui avaient successivement cherché à s'introduire dans son enceinte, et l'ordre y était maintenu par des régiments de gardes bourgeoises, dont les colonels étaient tous des membres du parlement, ou des personnages nobles, ou considérables par leur fortune et leur naissance. La Fronde y était peu active, les émeutes rares et promptement apaisées554. La guerre même avait contribué à faire affluer dans Paris un grand nombre de personnes qui, ne se trouvant pas en sûreté dans leurs châteaux ou dans les faubourgs de la ville, avaient été obligées de se mettre sous la protection de ses remparts. Cet accroissement de consommation et de richesses donnait une forte impulsion au commerce, et faisait prospérer les affaires d'une population de tout temps remarquable par l'activité de son industrie. Les bals ne discontinuaient pas; et MADEMOISELLE, de retour de son expédition d'Orléans, avait recommencé de nouveau à donner des fêtes brillantes, à réunir chez elle toute la haute société. La jeunesse de cette époque saisissait avec ardeur toutes les occasions de se divertir; elle aimait à mêler le plaisir aux intrigues, les jouissances de la mollesse aux périls des combats555.
Raymond Poisson, comme auteur et comme acteur, attirait alors la foule au théâtre de l'hôtel de Bourgogne, rue Mauconseil; et là aussi le grand Corneille produisait Nicomède, qui ne fut pas sa dernière tragédie, mais la dernière digne de lui. Ce chef-d'œuvre disputait la vogue au Don Japhet d'Arménie de Scarron, à la Folle gageure et aux Trois Orontes de l'abbé de Boisrobert, depuis si complétement oubliés. Mais ce qui faisait fureur et surpassait encore le succès de Nicomède et des autres pièces qui partageaient, avec celle de Corneille, l'attention publique, c'était une pastorale insipide, intitulée Amaryllis, originairement composée par Rotrou, refaite par Tristan, et augmentée de trois scènes qui ne tenaient pas à la pièce, mais dans laquelle jouait, déguisée en homme, une actrice qui excitait l'enthousiasme et attirait les applaudissements universels. L'engouement pour ce spectacle dura tout le temps du carnaval et une grande partie du carême556, et se renouvela dans l'été de l'année suivante. Ainsi, dans tous les temps, comme aujourd'hui, l'effet des représentations théâtrales est plus redevable au talent des acteurs, à l'habileté des danseurs, à l'excellence de la musique ou à la beauté des décorations, qu'au génie des auteurs dramatiques.
Au milieu de la licence de ces temps, de ces apparences de légèreté, on voyait cependant régner dans une partie de la société un penchant pour les méditations profondes, pour une vie sérieuse et appliquée. Les sciences et la religion faisaient de nombreuses conquêtes dans la haute société, les cœurs tendres, les imaginations vives et les intelligences fortes. La maréchale de Rantzau, encore pleine d'attraits, étonna par sa résolution à se faire religieuse; et, malgré les instances de ses parents et de ses amis, elle prononça ses vœux, et fut à jamais perdue pour un monde où elle brillait, et qui se montrait si désireux de la retenir557. D'autres jeunes personnes riches et belles prononcèrent des vœux à cette époque; et leurs noms, moins célèbres, ont cependant été recueillis par le gazetier Loret. Un grand nombre de femmes dans les rangs les plus élevés de la société se consacraient au soulagement des pauvres, et l'activité de leur zèle charitable semblait s'accroître en raison des misères publiques. Leurs largesses ne se restreignaient pas au peuple de la capitale: la duchesse d'Orléans vendit cet hiver une partie de son riche mobilier pour secourir les malheureux cultivateurs de la Champagne que la guerre avait ruinés558. Les solitaires de Port-Royal virent leur nombre s'accroître d'hommes illustrés dans diverses professions. Ils avaient accueilli dans leurs rangs des militaires, des avocats, des ingénieurs. Le duc de Luynes, qui avait été un des chefs les plus ardents de la Fronde, s'était réuni à eux, et faisait construire le château de Vaumurier, près de leur champêtre séjour. Ils l'avaient nommé général de la petite armée formée par eux avec les paysans de la vallée, pour se défendre contre les maraudeurs et les troupes du duc de Lorraine. A l'approche de ces troupes, les religieuses de Port-Royal s'étaient retirées dans leur maison de Paris; mais les solitaires étaient restés, déterminés à braver tous les dangers. Ils employèrent les ouvriers du château de Vaumurier à fortifier l'enceinte du couvent, à la munir de tourelles pour pouvoir s'y retrancher au besoin; ils s'adonnèrent tous aux exercices militaires et au maniement des armes. Cependant ils faisaient paraître en même temps des livres élémentaires supérieurs à tous ceux que l'on possédait, et des livres de controverse remarquables par la clarté, l'élégance et la rapidité du style. Le succès des premiers se mesurait sur les besoins qu'on en avait, et les seconds étaient lus avec empressement par un public avide de discussions sur les matières religieuses et politiques, qui lui paraissaient propres à embarrasser le pouvoir. Ainsi ces pieux solitaires semblaient se montrer jaloux d'étendre leur influence sur tous les âges, mais par la plus légitime et la moins contestable de toutes les autorités, celle des talents et des vertus. Les jésuites répandaient contre eux des écrits où l'on peignait sous de noires couleurs leurs projets pour l'avenir, et leurs intentions secrètes. Ils n'y répondaient point, et se contentaient de les faire flétrir par l'autorité épiscopale, comme des libelles injurieux et calomnieux. Ils étaient toujours intimement attachés au cardinal de Retz, auquel ils pardonnèrent ses mœurs relâchées, en faveur de l'appui qu'il leur prêtait. Ils avaient fait adopter leur doctrine par presque tout le clergé de la cathédrale et les curés de Paris559. Leurs ouvrages et leurs exemples avaient donné un caractère plus grave à ces réunions d'hommes de lettres, de savants et de gens du monde, qui, en l'absence de Montausier et de sa femme, et dans le deuil où était plongée toute la famille d'Angennes par la perte de son chef560, ne se tenaient plus à l'hôtel de Rambouillet, mais au petit Luxembourg, chez la duchesse d'Aiguillon, à qui, comme nièce du cardinal de Richelieu, ce glorieux patronage des noms célèbres et des hautes capacités convenait plus qu'à toute autre. Un fils de l'intendant de Rouen se montrait un des plus assidus à ces réunions; son père devait à la protection de la duchesse une partie de sa fortune et l'intendance dont il était pourvu. Ce jeune homme s'était acquis de la réputation par ses découvertes en physique, et on l'écoutait avec plus d'attention et de déférence qu'autrefois Voiture à l'hôtel de Rambouillet561. Le gazetier Loret, qui assista à une des réunions qui eurent lieu au petit Luxembourg dans le cours de cette année, nous dit qu'un grand nombre de ducs, de marquis, de cordons bleus et de belles dames, prirent un vif plaisir à entendre ce jeune homme expliquer des inventions mathématiques et des expériences de physique toutes nouvelles:
Il fit encor sur des fontaines
Des démonstrations si pleines
D'esprit et de subtilité,
Que l'on vit bien, en vérité,
Qu'un très-beau génie il possède;
Et l'on le traita d'Archimède562.
L'éloge était magnifique, mais il n'était nullement exagéré, car ce jeune homme était Pascal.
L'Esclache, dont les écrits sont moins célèbres, brillait alors autant que lui dans ces réunions, et peut servir à prouver combien le goût de l'instruction et des méditations profondes était en honneur dans les classes élevées et chez les personnes des deux sexes563. Loret dit que,
Dans ce même palais charmant
De la nièce du grand Armand,
il entendit un soir, en présence d'un cercle brillant de belles dames et de hauts personnages, M. L'Esclache faire un discours pour prouver l'immortalité de l'âme.
Mais quoique ce fût doctement,
Ce fut pourtant si nettement,
Et par des raisons si faciles,
Que les esprits les moins dociles
Comprenaient aisément le sens
De ses arguments ravissants564.
D'après ces détails sur l'esprit de la société de cette époque, il est facile de s'apercevoir que le temps de la jeunesse de madame de Sévigné ne ressemblait nullement à celui où nous reporte le commencement de sa correspondance avec sa fille, alors que Louis XIV interdisait à ses courtisans et aux dames de sa cour tout entretien sur les matières politiques et religieuses; lorsqu'on ne parlait que du roi, de ses fêtes, de ses ballets, de ses maîtresses, de sa gloire, de ses conquêtes, des vers faits à sa louange, des prodiges et des magnificences de Versailles, du nouveau spectacle de l'Opéra; des tragédies où Racine réduisait Melpomène à ne retracer que les enchantements de l'amour; des comédies où Molière frappait d'un ridicule ineffaçable toute femme qui affichait quelque prétention à une supériorité quelconque sur les personnes de son sexe, et où ce grand comique se complaisait à montrer les dames de haut parage inférieures à leurs servantes en esprit et en bon sens. On comprend pourquoi madame de Sévigné, dans ses entretiens épistolaires avec sa fille, manie des sujets que de nos jours une femme du monde n'oserait ou ne pourrait aborder; on devine aussi par quels motifs madame de Grignan fut soumise, dans le plan de son éducation, à des genres d'études plus fortes encore que celles de sa mère, et comment madame de La Sablière et elle s'étaient instruites dans les hautes sciences et comprenaient la philosophie de Descartes. Cela s'explique par la différence des âges, par l'époque de la jeunesse et des premiers développements de l'intelligence. Pour madame de Sévigné, cette époque appartenait aux réunions de l'hôtel de Rambouillet; pour madame de Grignan et madame de La Sablière, c'était celle dont les assemblées du petit Luxembourg avaient fourni le modèle.
C'est pendant cette dernière époque que madame de Sévigné, répandue dans tous les grands cercles de la capitale, dont elle était un des principaux ornements, se vit le plus exposée aux séductions de la jeune et brillante noblesse qui s'empressait autour d'elle; sa société particulière était aussi nombreuse que remarquable par les personnages qui la composaient. Elle avait retrouvé à Paris le grand prieur Hugues de Rabutin, qui n'avait point quitté le Temple. Mais les événements avaient éloigné d'elle le comte de Bussy-Rabutin565. Stationné dans le Nivernais avec les troupes du roi, Bussy ne pouvait même, par correspondance, communiquer avec elle. Les partis ne se faisaient pas scrupule d'arrêter les courriers, de leur enlever leurs paquets et de violer le secret des lettres566. Bussy laissait donc le champ libre à ses rivaux, et n'avait aucun moyen de prévenir ou de contrecarrer les progrès qu'ils pourraient faire dans le cœur de sa belle cousine. De tous ceux qu'il avait à craindre, le plus éminent par sa naissance et ses dignités était le duc de Rohan. La famille des Sévignés avait l'honneur d'être alliée à celle des Rohans; et en Bretagne, où madame de Sévigné faisait de longues résidences, le duc de Rohan tenait un des premiers rangs. Il avait même voulu disputer la présidence des états de cette province au duc de Vendôme567, et l'opposition qu'avait mise à cette prétention le maréchal de La Meilleraye fut un des motifs qui le porta à se jeter dans le parti de Condé. Après la prise d'Angers par les troupes du roi, Rohan s'était rendu à Paris. Il y revit madame de Sévigné; et quoiqu'il rencontrât chez elle les amis et les alliés du coadjuteur, et un grand nombre de personnages d'un parti contraire au sien, il ne put s'abstenir de la voir fréquemment. De son côté, elle le traitait avec les égards dus à son rang, et aussi avec cette bienveillance que la femme la moins coquette ne refuse jamais à celui qui se déclare un de ses admirateurs. Cependant, comme le duc de Rohan était marié, il était impossible que madame de Sévigné se méprît sur la nature des hommages qu'il lui adressait. Par cette raison, il ne pouvait être dangereux pour elle. Il n'en était pas de même du jeune comte du Lude, qui par sa constance s'était fait considérer comme son chevalier; mais un gentil-homme breton, le marquis de Tonquedec, cavalier accompli, par ses assiduités et ses attentions, balançait auprès d'elle le comte du Lude. Marigny et Ménage, les anciens amis de son jeune âge, et tous ceux qui formaient l'escorte du cardinal de Retz, Montmorency, Brissac, le président de Bellièvre, Montrésor, le comte de Châteaubriand, Caumartin, l'honnête et obligeant d'Hacqueville, de Château-Renauld, de Bussy-Lameth, d'Argenteuil, d'Humières, le marquis de Sablonière568, l'Écossais Montrose, et les officiers qu'il avait amenés avec lui après la mort de Charles Ier; enfin, Renaud de Sévigné, auquel l'unissaient des liens de parenté, tels étaient ceux qui composaient, en hommes, à madame de Sévigné une société aussi variée que choisie, aussi nombreuse qu'agréable569.
Son deuil venait de se terminer au commencement de cette année 1652, et elle se répandit dans le monde sans qu'aucun motif de bienséance pût y mettre obstacle.
Elle était recherchée par toutes les femmes qui aimaient à tenir chez elles des cercles brillants; mais celles chez lesquelles on la voyait le plus souvent étaient la duchesse de Lesdiguières et la princesse Palatine; cette dernière, quoique du parti de la cour, resta toujours attachée à Gondi, et le servit avec zèle et loyauté. Les amies les plus intimes de madame de Sévigné étaient sa tante maternelle, née Henriette de Coulanges, et sœur de François, marquis de La Trousse, conseiller au parlement de Rennes, et de la maison de La Savonnière en Anjou; madame de Lavardin, qu'elle loue comme une femme d'un bon et solide esprit570; madame Renaud de Sévigné, et sa fille mademoiselle de La Vergne, qui toutes deux habitaient pendant l'été leur terre près d'Angers, et se trouvaient liées avec le duc de Rohan, gouverneur d'Anjou, et avec la duchesse sa femme; avec de Fourilles, gouverneur de la ville d'Angers, avec l'évêque d'Angers, et surtout avec Lavardin, évêque du Mans, qui, semblable à Costar, son archidiacre, était plus renommé par la délicatesse et la joie de ses banquets, que pour la sainteté de sa vie571. Ainsi, tous les membres de cette société particulière de madame de Sévigné se trouvaient unis par des rapports de voisinage, de parenté, d'affection, communs à tous, et aussi par cette confiance mutuelle et ce charme constant que fait éprouver l'habitude de se voir, de se fréquenter et de correspondre continuellement les uns avec les autres.
Mademoiselle de La Vergne, qui avait été, par le veuvage et l'éloignement de madame de Sévigné, privée pendant quelque temps de sa meilleure amie, contracta une nouvelle liaison avec une jeune personne, qui par son enjouement, ses allures vives et dégagées, inspirait la joie dans toutes les sociétés où elle paraissait. Elle avait pour son âge un peu trop d'embonpoint; sa taille, un peu courte, manquait d'élégance; mais ses bras, ses mains et toute sa personne étaient admirablement modelés; ses cheveux étaient châtains, ses yeux brillants et vifs, son visage arrondi, ses traits délicats et mignards, sa bouche petite et gracieuse. Cette beauté était Catherine-Henriette d'Angennes, fille du baron de La Loupe, de la même famille que le marquis de Rambouillet. Elle était demandée par Louis de La Trémouille, comte d'Olonne; et ce mariage était même annoncé comme prochain dans la Gazette de Loret, du 3 mars 1652:
D'Olonne aspire à l'hyménée
De la belle Loupe l'aînée,
Et l'on croit que dans peu de jours
Ils jouiront de leurs amours.
Le gazetier ne se trompait pas, et c'est sous le nom de comtesse d'Olonne que l'amie de mademoiselle de La Vergne s'acquit depuis une si malheureuse célébrité par ses galanteries avec le marquis de Beuvron, le duc de Candale, Saint-Évremond, l'abbé de Villarceaux, le comte de Guiche, et tant d'autres572. Le cardinal de Retz en était devenu amoureux. Il avait quitté mademoiselle de Chevreuse, qui, selon le jugement qu'il en porte, avait plus de beauté que d'agrément, et était sotte jusqu'au ridicule573. Gondi, rompu aux intrigues galantes, devina le naturel et les penchants secrets de la jeune de La Loupe; mais il en présuma trop, ou plutôt il présuma trop de lui-même. Lorsqu'on songe aux périls qui le menaçaient alors, aux interminables devoirs auxquels il était assujetti par sa nouvelle dignité, aux événements importants qu'il cherchait à diriger ou à tourner à son profit, on est surpris de le voir si fortement préoccupé de cette nouvelle passion. Le duc de Brissac l'y encourageait; ce jeune duc était lui-même amoureux de mademoiselle de La Vergne, dont la maison était limitrophe de celle où demeuraient les demoiselles de La Loupe; et une communication avait été pratiquée entre les deux maisons, pour que les deux amies pussent se voir aussi souvent qu'il leur plairait. Le duc de Brissac, en se faisant le complaisant empressé des plaisirs du cardinal, avait acquis sur lui un assez grand ascendant, même pour les affaires sérieuses. Il se rendait donc tous les soirs avec Gondi chez mademoiselle de La Vergne, où ils étaient presque toujours certains d'y trouver mademoiselle de La Loupe. Là, chacun d'eux pouvait ainsi entretenir à loisir celle dont il était charmé. Gondi s'était fait faire pour ces visites nocturnes un habit élégant574. Sa position comme son humeur ne lui permettaient pas de longs préliminaires. Le mariage projeté était aussi pour lui un motif de se hâter. Ayant affaire à une jeune personne vive et coquette, sa vanité lui fit croire la chose assez avancée pour pouvoir brusquer une conclusion; mais il ne pouvait rien sans un tête-à-tête, et obtenir un rendez-vous d'une demoiselle presque fiancée, et par conséquent toujours entourée, paraissait impossible. Il y parvint cependant: pour connaître par quels moyens, laissons parler cet homme excessif dans le mal comme dans le bien, qui étonne par la franchise de ses aveux, et dont Bossuet a dit avec raison qu'on ne pouvait ni l'estimer, ni le craindre, ni le haïr à demi575. Ce récit, d'ailleurs, nous semble propre à jeter un jour vif sur la situation de Paris à cette époque, et sur les dangers où se trouvait exposée, au milieu d'un tel monde, une jeune veuve, riche, indépendante, et avec le caractère et les attraits de madame de Sévigné.
«Un jour que j'étais avec MONSIEUR dans son cabinet de livres, Bruneau y entra tout effaré, pour m'avertir qu'il y avait dans la cour une assemblée de deux ou trois cents de ces criailleurs qui disaient que je trahissais MONSIEUR, et qu'ils me tueraient. MONSIEUR me parut consterné à cette nouvelle, je le remarquai; et l'exemple du maréchal de Clermont, assommé entre les bras du dauphin576, qui tout au plus ne pouvait pas avoir eu plus de peur que j'en voyais à MONSIEUR, me revenant dans l'esprit, je pris le parti que je crus le plus sûr, quoiqu'il parût le plus hasardeux. Je descendis avec Château-Renauld et d'Hacqueville, qui étaient seuls avec moi, et j'allai droit à ces séditieux, en leur demandant qui était leur chef577. Un gueux d'entre eux, qui avait une vieille plume jaune à son chapeau, me répondit insolemment: «C'est moi.» Je me tournai du côté de la rue de Tournon, en disant: «Gardes de la porte, que l'on me pende ce coquin à ces grilles.» Il me fit une profonde révérence; il me dit qu'il n'avait pas cru manquer au respect qu'il me devait; qu'il était venu seulement avec ses camarades pour me dire que le bruit courait que je voulais mener MONSIEUR à la cour et le raccommoder avec le Mazarin; qu'ils ne le croyaient pas, qu'ils étaient mes serviteurs, et prêts à mourir pour mon service, pourvu que je leur promisse d'être toujours bon frondeur578.
«Ils m'offraient de m'accompagner; mais je n'avais pas besoin de cette escorte pour le voyage que j'avais résolu, comme vous l'allez voir. Il n'était pas au moins fort long; car madame de La Vergne, mère de madame de La Fayette, et qui avait épousé en secondes noces le chevalier de Sévigné, logeait où loge présentement madame sa fille. Cette madame de La Vergne était honnête femme dans le fond mais intéressée au dernier point, et plus susceptible de vanité pour toutes sortes d'intrigues sans exception, que femme que j'aie jamais connue. Celle dans laquelle je lui proposais ce jour-là de me rendre de bons offices était de nature à effaroucher d'abord une prude. J'assaisonnai mon discours de tant de protestations de bonnes intentions et d'honnêtetés, qu'il ne fut pas rebuté; mais aussi ne fut-il reçu que sous les promesses solennelles que je fis, de ne prétendre jamais qu'elle étendît les services que je lui demandais au delà de ceux que l'on peut rendre en conscience pour procurer une bonne, chaste, pure et sainte amitié. Je m'engageai à tout ce qu'on voulut. On prit mes paroles pour bonnes, et l'on se sut très-bon gré d'avoir trouvé une occasion toute propre à rompre dans la suite le commerce que j'avais avec madame de Pommereul, que l'on ne croyait pas si innocent.
«Celui dans lequel je demandai que l'on me servît ne devait être que tout spirituel et tout angélique, car c'était celui de mademoiselle de La Loupe, que vous avez vue depuis sous le nom de madame d'Olonne. Elle m'avait fort plu quelques jours auparavant, dans une petite assemblée qui s'était faite dans le cabinet de MADAME; elle était jolie, elle était belle, précieuse par son air et par sa modestie. Elle logeait tout proche de madame de La Vergne, elle était amie intime de mademoiselle sa fille; elle avait même percé une porte par laquelle elles se voyaient sans sortir du logis. L'attachement que M. le chevalier de Sévigné avait pour moi, l'habitude que j'avais dans sa maison, et ce que je savais de l'adresse de sa femme, contribuèrent beaucoup à mes espérances. Elles se trouvèrent vaines par l'événement; car, bien qu'on ne m'arrachât pas les yeux, bien que je m'aperçusse à certains airs que l'on n'était pas fâchée de voir la pourpre soumise, tout armée et tout éclatante qu'elle était, on se tint toujours sur un pied de sévérité, ou plutôt de modestie, qui me lia la langue, quoiqu'elle fût assez libertine: ce qui doit étonner ceux qui n'ont point connu mademoiselle de La Loupe et qui n'ont ouï parler que de madame d'Olonne. Cette historiette n'est pas trop, comme vous voyez, à l'honneur de ma galanterie579.»
Le mariage de mademoiselle de La Loupe avec le comte d'Olonne eut lieu quelques semaines après l'entrevue dont le cardinal de Retz nous a transmis le récit; et peu de mois après la comtesse d'Olonne s'était déjà séparée de son mari. Lorsque mademoiselle de Montpensier alla à cheval, avec son père le duc d'Orléans et le prince de Condé, au-devant du duc de Lorraine, campé près de Villeneuve-Saint-Georges, madame d'Olonne, sa sœur mademoiselle de La Loupe la jeune, la duchesse de Sully, et les comtesses de Fiesque et de Frontenac, faisaient partie de l'escadron des dames qui composaient le cortége de cette princesse. «On s'étonna, dit MADEMOISELLE, de la voir là, son mari étant auprès du roi, cornette de ses chevau-légers.» Il est probable que la liaison de la comtesse d'Olonne avec le marquis de Beuvron, la seule de toutes celles qu'elle forma qui fut quelque temps tenue secrète, était déjà commencée; peut-être même avait-elle précédé le mariage, et ce premier attachement a pu être l'obstacle inconnu qui fit échouer les projets de séduction du cardinal580. Une autre cause, plus probable, se trouve aussi dans la répugnance que, malgré sa pourpre, son haut rang, devait causer à une jeune beauté, plus frappée des agréments du corps que de ceux de l'esprit, un homme tel que Gondi. Si le portrait que nous trace Tallemant des Réaux, de ce héros de la Fronde, est fidèle, c'était «un petit homme noir, à vue très-basse, mal fait, laid, et maladroit de ses mains à toutes choses581.» Madame de Pommereul, dont il parle dans cette partie de ses Mémoires, et avec laquelle il avait vécu, était la femme d'un président au grand conseil, qui, mariée contre son gré, et en discorde avec son mari, s'était séparée de lui582: madame de Sévigné fut liée avec son fils et son petit-fils, qui occupèrent des charges importantes583.