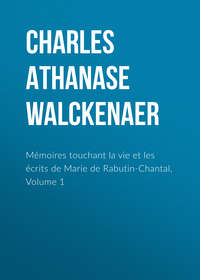Kitabı oku: «Mémoires touchant la vie et les écrits de Marie de Rabutin-Chantal, Volume 1», sayfa 28
Après la paix de Bordeaux, le marquis et la marquise de Montausier étaient revenus à Paris, et continuèrent à résider dans l'hôtel de Rambouillet; mais les brillantes assemblées et les réunions littéraires de cet hôtel avaient cessé, pour ne plus renaître, par suite de la guerre civile. Le marquis de Rambouillet venait de mourir; la cour absorbait déjà tous les moments des personnages les plus importants, parmi ceux qui formaient autrefois cette société. Monsieur et madame de Montausier étaient occupés à solliciter les justes récompenses des services qu'ils avaient rendus. Mazarin voulait les faire porter sur d'autres, dont le dévouement au roi, ne procédant pas des mêmes sentiments d'honneur qui avaient fait agir Montausier, lui paraissait devoir être acheté par des faveurs836. Les gens de lettres beaux esprits, ayant perdu leur grand centre de réunion, prirent l'habitude de se rassembler les uns chez les autres, mais plus particulièrement chez mademoiselle de Scudéry, dont la réputation était alors à son apogée, et chez madame la comtesse de La Suze, qui venait de se convertir à la religion catholique, sans s'affermir dans la foi, sans améliorer ses mœurs. C'est dans ces réunions d'une nature assez ambiguë que l'on commença à exagérer les manières et le langage des habitués de l'hôtel de Rambouillet; c'est dans ces nouveaux salons, c'est dans ces ruelles que se développèrent ces ridicules qui, par un coup de fortune pour le grand peintre comique, vinrent se placer sous son pinceau au début de sa carrière, et lui firent obtenir tout à coup, par le moyen d'une simple farce, mais admirable par l'à-propos des leçons qu'elle renfermait, une célébrité qu'il n'eût peut-être pas acquise si promptement par un des grands chefs-d'œuvre qui ont depuis illustré son nom.
Ce fut cette année (1653) que le libraire de Sercy publia les deux premiers volumes d'un recueil de poésies choisies837 qui renferme des pièces de plus de trente auteurs, c'est-à-dire de tous les faiseurs de vers alors en vogue. Ce recueil, qui eut une suite, devint le vrai patron de cette littérature froidement galante au grossièrement burlesque, semée de pointes, de jeux de mots ou de sentiments exagérés qui dominait alors dans la poésie fugitive, et qui ne cessa que lorsque La Fontaine et madame Deshoulières eurent les premiers donné des exemples du naturel et des grâces légères qui conviennent à ce genre de composition. Ce qui surprend lorsqu'on parcourt ce livre, c'est d'y trouver des pièces érotiques qui ne sont pas toujours exemptes d'obscénités, quoique le volume soit dédié à l'abbé de Saint-Germain, Beaupré, conseiller et aumônier du roi. Nous citerons de ce recueil des stances adressées par un auteur anonyme à mademoiselle de Lenclos, afin de faire connaître quelle était alors la célébrité que Ninon s'était acquise et les impressions quelle faisait naître:
Ah, Ninon! de qui la beauté
Méritait une antre aventure,
Et qui devais avoir été
Femme ou maîtresse d'Épicure,
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mon âme languit tout le jour:
J'admire ton luth et la grâce.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Je me sens touché jusqu'au vif,
Quand mon âme voluptueuse
Se pâme au mouvement lascif
De ta sarabande amoureuse.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Socrate, et tout sage et tout bon,
N'a rien dit qui tes dits égale;
Auprès de toi, le vieux barbon
N'entendait rien à la morale838.
Ces vers, d'ailleurs, suffisent pour justifier ce que nous avons dit du contraste des pièces de ce volume avec sa dédicace; nous devons prévenir qu'ils sont au nombre des plus modestes de ceux que nous aurions pu citer à l'appui de notre observation839.
C'est dans ce recueil que l'on trouve pour la première fois imprimé le quatrain que Montreuil fit pour madame de Sévigné, après l'avoir vue jouer à colin-maillard, et aussi les vers que Marigny lui envoya pour étrennes840. Immédiatement après ceux-ci, nous en trouvons d'autres, d'un ton plus sérieux et plus passionné, qui lui sont également adressés; il sont anonymes et sans date. Nous devons donc les rapporter à celle de la publication et leur donner place ici:
Ne trouver rien de beau que vous,
Sans cesse songer à vos charmes,
Être chagrin, être jaloux
Répandre quelquefois des larmes,
N'avoir point de repos, ni de nuit, ni de jour,
Est-ce de l'amitié, Philis, ou de l'amour841?
Si l'on considère que ces vers se trouvent placés immédiatement après ceux que Marigny a avoués, on doit présumer que l'auteur des derniers est le même que celui de ceux qui précèdent. Il n'est pas étonnant qu'en les faisant imprimer Marigny gardât l'anonyme; c'était déjà une assez forte indiscrétion que de les publier en désignant celle qui en était l'objet. Mais tout semblait permis aux poëtes; et une déclaration d'amour quand elle était en vers ne semblait qu'un jeu d'esprit, qui ne compromettait personne.
CHAPITRE XXXVII.
1653-1654
La société de madame de Sévigné devient de jour en jour plus nombreuse.—Bussy-Rabutin de retour à Paris.—Ce qu'il fit pendant la guerre civile.—Ses réclamations auprès du gouvernement.—Le Tellier le renvoie à Colbert, l'intendant de Mazarin.—Colbert prélude déjà à l'administration du royaume.—Bussy, ne pouvant quitter l'armée, envoie Corbinelli pour suivre ses affaires.—Quel était Corbinelli.—Corbinelli vient à Paris.—Il voit pour la première fois madame de Sévigné.—Il est fort goûté par elle.—Caractère de Corbinelli.—Origine de sa famille.—Ses liaisons avec madame de Sévigné.—Obstacles que rencontre Bussy pour le succès de ses demandes.—Ennemis qu'il s'était faits.—Il traite avec Palluau de sa charge de mestre de camp de la cavalerie légère.—Il recommence ses intrigues d'amour.—Laisse sa femme en Bourgogne.—Va à Launay.—Puis à Paris.—Se trouve au siége de Vervins.—Revient à Paris.—Loge au Temple.—Est aimé de son oncle.—Ne peut se contenter de ce que lui accorde madame de Sévigné.—Il se lie avec le comte de La Feuillade et le comte d'Arcy.—Tous trois promettent de se servir dans leurs amours.—Ils tirent aux dés les trois amies.—Madame de Précy échoit à Bussy.—Madame de Monglat à La Feuillade.—Bussy devient amoureux de madame de Monglat.—Portrait de cette dame.—Portrait qu'en fait l'auteur du Dictionnaire des Précieuses.—Comment Bussy, en trahissant La Feuillade, parvient à se faire aimer de madame de Monglat.—Bussy propose à madame de Sévigné de lui donner une fête.—Elle accepte.—Madame de Monglat était en secret le but de cette fête.—Madame de Précy s'aperçoit qu'elle est jouée.—Son ressentiment est partagé par la vicomtesse de Lisle.—Bussy part pour l'armée avec La Feuillade.
Madame de Sévigné voyait s'accroître chaque jour le nombre des personnes qui faisaient gloire d'être admises dans sa société. Son cousin Bussy contribuait à en augmenter les agréments. Il était revenu à Paris842, et se montrait assidu chez elle; il y jouissait de ces privautés qu'une étroite parenté et une longue intimité ne permettaient pas de lui refuser, lors même que par inclination madame de Sévigné n'eût pas été charmée de pouvoir les lui accorder sans blesser les convenances.
Bussy, pendant toute la durée de cette seconde guerre civile, avait passé son temps désagréablement, et avait joué un rôle assez obscur843. Il avait cependant rendu des services signalés à la cause royale. On l'avait chargé de garder la Charité et Nevers, deux passages importants sur la Loire, et de secourir le général Palluau, qui assiégeait Montrond. Il reçut des éloges pour la manière dont il avait exécuté les ordres du roi; mais on ne lui payait pas les sommes qui lui étaient dues pour les appointements de sa charge, pour sa pension, pour la solde de ses troupes, pour les subsistances qu'il avait fournies. Il avait demandé qu'on lui permît de prélever par lui-même, sur les tailles et les autres revenus du Nivernais, le montant de ce qu'il réclamait. Le ministre Le Tellier, que ce détail concernait, répondit qu'il fallait pour cela obtenir l'autorisation de M. de Colbert, intendant de monseigneur de Mazarin844. Ainsi Colbert, n'étant encore que l'intendant du cardinal, préludait déjà à l'administration du royaume.
Au lieu de répondre aux demandes de Bussy, on forma contre lui des plaintes sur les violences et les extorsions que ses troupes se permettaient et sur leur indiscipline845. Bussy, dans l'impossibilité où il se trouvait de quitter son poste, envoya pour se justifier et suivre l'effet de ses réclamations un gentil-homme qu'il avait pris à son service, nommé Corbinelli. Celui-ci mit beaucoup de zèle, d'activité et d'adresse à suivre les négociations dont Bussy l'avait chargé. Il ne se laissa rebuter ni par les délais, ni par les prétextes qu'on employait pour l'écarter; il ne cessa de solliciter et d'importuner les ministres846: obligé pour cela de suivre la cour, qui voyageait toujours à la suite de l'armée, il arriva ainsi avec elle devant Paris au commencement de juillet de l'année 1652, et il y entra quelques jours avant l'incendie et le massacre de l'hôtel de ville847.
C'est à cette époque que Corbinelli eut occasion de voir souvent madame de Sévigné et de faire connaissance avec elle: dès le premier abord elle fut prévenue en sa faveur par le caractère de loyauté et de franchise qu'elle lui reconnut, et en même temps charmée de son esprit, de son savoir et de son jugement. Depuis, elle n'a jamais cessé d'avoir avec lui des relations d'une solide amitié; et il fut toujours compris dans le nombre choisi de ceux dont la société lui était chère, et sur lesquels elle pouvait compter. La famille de Corbinelli était originaire de Florence. Son grand-père, allié de Catherine de Médicis, avait été chargé de l'éducation du duc d'Anjou (depuis roi de France sous le nom de Henri III); son père fut secrétaire de Marie de Médicis, et attaché au maréchal d'Ancre; sa fortune s'écroula avec celle de ce favori848. Corbinelli avait étudié à Rome sous les jésuites; il se trouvait encore en cette ville en 1644, près du pape Urbain VIII, son parent. La mort prématurée de ce pape le laissa sans fortune et sans état. C'est alors qu'il vint en France, et que Bussy, comme il le dit avec vérité, fut assez heureux pour se l'attacher849. Doué d'un esprit fin et pénétrant, d'un caractère égal et doux, d'un goût sûr et exercé, littérateur, musicien, et amateur éclairé de ces beaux-arts auxquels sa patrie primitive était redevable d'une si grande illustration, Corbinelli se faisait des amis de tous ceux qui le connaissaient, et des protecteurs de tous les grands, auxquels il plaisait. Dépourvu d'ambition, il faisait de temps à autre de faibles tentatives pour remédier à l'exiguïté de sa fortune; puis, quand il trouvait trop d'obstacles à vaincre, il retombait dans son insouciance habituelle, et ne paraissait nullement affecté de n'avoir pas réussi. Ses amis et ses protecteurs ne montraient pas alors à cet égard plus de sollicitude que lui-même. Aussi, malgré ses liaisons avec tant d'hommes riches et puissants, malgré sa capacité reconnue pour les affaires, toute sa vie se passa ainsi à essayer, sans pouvoir y parvenir, de sortir de la condition médiocre où le sort l'avait réduit. Cette vie n'en fut ni moins longue ni moins heureuse. Corbinelli vécut plus de cent ans, et mourut universellement regretté. Il avait, cédant à la mode de ce temps, tracé un portrait de madame de Sévigné, qui eut un grand succès parmi les beaux esprits et les précieuses. On ne le trouve malheureusement dans aucun des ouvrages, peu remarquables, qu'on a imprimés de lui, et qui, en partie composés d'extraits, sont aujourd'hui oubliés850. Dans son Dictionnaire des Précieuses, Somaize dit que Corbinelli s'était fait le lecteur de madame de Sévigné. Nous verrons qu'il fut aussi quelquefois par intervalles son secrétaire, et nous le retrouverons souvent dans le cours de ces Mémoires. Quand Corbinelli vint se fixer à Paris, il se logea dans le quartier du Marais du Temple, où demeurait aussi, comme nous l'avons déjà dit, madame de Sévigné851.
Bussy ne se contentait point des lettres flatteuses que Mazarin lui écrivait, ni de celle qu'il lui fit écrire par le roi lui-même. Il sollicita des faveurs plus solides et plus profitables, et eut beaucoup de peine à les obtenir. Ses indiscrétions lui avaient aliéné la princesse Palatine, dont l'influence était grande à la cour. Il fit agir l'abbé Fouquet, et son frère Nicolas Fouquet, procureur général au parlement de Paris, qui venait d'être nommé, avec Servien, surintendant des finances, après la mort de la Vieuville. Bussy était lié avec tous deux, et par leurs démarches et les siennes propres il obtint enfin la faculté de pouvoir traiter avec Palluau de la charge de mestre de camp de la cavalerie légère, lorsque Palluau eut été fait maréchal de France, en prenant le nom de Clérambault. Bussy a donné dans ses Mémoires l'histoire de cette charge de mestre de camp. Il l'acheta 270,000 livres, ce qui fait à peu près 540,000 francs de notre monnaie actuelle. Il la garda douze ans852.
Pendant qu'il la sollicitait, et avant qu'il fût en mesure d'en prendre possession et de se rendre à l'armée de Turenne pour commencer une nouvelle campagne853, Bussy, selon sa coutume, se livra avec beaucoup d'activité à ses intrigues d'amour. Il avait laissé sa femme dans sa terre de Bourgogne, après le siége de Montrond; et au retour du voyage qu'il avait fait à Sedan pour voir le cardinal Mazarin, il s'était rendu à Launay chez son oncle le grand prieur; puis il était revenu avec lui et avec toute la cour à Paris, au mois d'octobre 1652; il était ensuite reparti pour l'armée, et se trouva au siége de Vervins, qui fut pris en trois jours, pendant un froid rigoureux, en janvier 1653. Il rentra de nouveau dans Paris avec le cardinal de Mazarin le 2 février, et il résolut de ne point quitter la capitale qu'il n'eût obtenu la charge qu'il sollicitait854. Il logeait au Temple, chez son oncle le grand prieur, qui, à cause de ses goûts, très-analogues aux siens, l'avait pris dans une affection toute particulière.
Bussy se montrait vivement épris de sa cousine; mais le régime auquel elle assujettissait son amour ne s'accommodait pas avec ses inclinations. Toutefois, comme sa présomption lui faisait croire qu'il n'en serait pas toujours ainsi, il ne renonçait pas à ses instances. En attendant le moment heureux qu'il espérait, il fallait vivre, comme il le dit lui-même: c'est à quoi Bussy songeait, c'est ce dont il s'occupait, malgré qu'il eût une femme jeune et fidèle, et malgré ses déclarations d'amour à madame de Sévigné.
Il s'était lié intimement avec d'Arcy et avec La Feuillade, qui fut depuis fait duc et maréchal de France. Compagnons d'armes et de plaisir, on les voyait toujours, tous les trois ensemble, aux bals, aux spectacles, aux concerts, aux réunions qui eurent lieu pendant l'hiver. Ils y rencontrèrent fréquemment trois femmes jeunes, jolies, liées entre elles, qui ne se quittaient jamais, qu'on ne voyait jamais isolées. Cette parité de nombre, cette similitude de liaison, attira l'attention des trois amis, qui abordèrent fréquemment ce trio de belles, et les trouvèrent aimables. Voilà nos trois séducteurs qui voient dans cette singulière rencontre un coup heureux de la destinée; c'est un avertissement du dieu d'Amour, c'est une proie qu'il leur offre, et dont chacun d'eux peut avoir sa part sans envier celle de son ami. Ils forment donc une ligue pour attaquer de concert les trois belles, et ils promettent de s'entr'aider, de se servir mutuellement, pour que chacun puisse capter la sienne. Une de ces femmes était la marquise de Monglat, une autre la vicomtesse de Lisle, la troisième madame de Précy. La difficulté était de s'accorder sur les choix; ils crurent pouvoir y échapper en tirant au sort. Les trois noms furent mis dans une bourse. Madame de Monglat échut à La Feuillade, madame de Lisle à d'Arcy, et madame de Précy à Bussy de Rabutin.
Mais le sort avait fort mal arrangé cette affaire, du moins pour Bussy. Quoique chacune de ces trois femmes eût des agréments particuliers, madame de Monglat, si elle n'était pas la plus jolie, était la plus aimable, la plus spirituelle. Petite-fille du chancelier de Chiverny, son nom était Isabelle Hurault de Chiverny855. Elle avait épousé Paul-Clermont, marquis de Monglat, grand maître de la garde-robe, qui nous a laissé d'excellents Mémoires856. Madame de Monglat était une brune piquante, nez retroussé, yeux petits, mais vifs, traits fins et délicats, teint animé, de beaux cheveux, taille moyenne, avec un cou, des bras, des mains qui auraient pu servir de modèle aux sculpteurs. Enjouée, folâtre, étourdie, d'un esprit pénétrant, fécond en saillies, elle aimait les vers, la musique, les artistes et les gens de lettres, dont elle appréciait les productions avec goût, avec sagacité857. C'est pourquoi Somaize lui a donné une place dans son Dictionnaire des Précieuses, où il en parle sous le nom de Delphiniane. «Elle connaît, dit-il, tous les auteurs et leurs pièces, leur donne souvent des sujets pour les accommoder au théâtre; et par cette raison elle mérite non-seulement le nom de précieuse, mais de véritable.»
Bussy préférait beaucoup madame de Monglat à ses deux amies, et surtout à madame de Précy, qui était celle qu'il trouvait le moins à son gré858. La Feuillade fut forcé de s'absenter pour se rendre à l'armée; et Bussy, qui restait à Paris, fut chargé de ses intérêts auprès de madame de Monglat, qui semblait avoir l'intention d'agréer les propositions d'amour de La Feuillade. Bussy, tout en ayant l'air de servir son ami auprès de madame de Monglat, employa pour lui-même tous les moyens de séduction qu'une longue pratique et de nombreux succès auprès des femmes lui avaient donnés. Mais comme les promesses qu'il avait faites, et qui n'étaient point ignorées de madame de Monglat, pouvaient lui donner l'apparence d'un homme perfide, quand il s'aperçut qu'il lui plaisait il devint moins assidu auprès d'elle; et lorsqu'il eut la certitude d'être aimé, il cessa de la voir. Elle le fit venir, pour lui demander l'explication de sa conduite. Il lui dit qu'il avait trop tard reconnu le danger auquel La Feuillade l'avait exposé: que la violence de l'amour qu'elle lui avait inspiré ne lui permettait pas de remplir auprès d'elle les engagements qu'il avait pris envers son ami; qu'il allait lui écrire pour lui en faire l'aveu. Il écrivit en effet à La Feuillade qu'il allait s'abstenir de voir madame de Monglat, parce qu'il craignait d'en être trop bien accueilli et de nuire à un ami qu'il avait promis de servir. Soit orgueil, soit présomption, soit confiance, La Feuillade n'accepta point le refus de Bussy. Au contraire, il lui rappela ses promesses, et l'engagea à lui continuer ses soins. Il lui écrivit: «Quand on est aussi délicat que vous le paraissez, on est assurément incapable de trahir.» En même temps il lui envoya une lettre pour madame de Monglat, où il lui disait qu'il n'était point étonné qu'un honnête homme n'eût pu la voir sans en devenir amoureux; mais que ce n'était pas une raison à Bussy pour se retirer; qu'il était persuadé qu'il aurait assez de force pour résister, mais que dans le cas contraire il savait qu'elle ne donnerait jamais son cœur à un traître.
Bussy remit ces deux lettres à madame de Monglat, après en avoir fait disparaître les dernières phrases, qui avaient trait à la perfidie de sa conduite. Madame de Monglat, d'après l'aveu que Bussy avait fait à La Feuillade, ne vit que de l'indifférence dans les instances que ce dernier faisait à son rival pour continuer à la voir. Sa vanité blessée, d'accord avec ses inclinations, lui inspirèrent le désir de punir La Feuillade de son impertinente sécurité.
Bussy en était là de ses intrigues amoureuses, courtisant ouvertement madame de Sévigné et madame de Précy, et secrètement madame de Monglat. Il prévoyait que, sur le point d'obtenir sa charge de mestre de camp de cavalerie légère, il serait bientôt obligé de quitter Paris; il désirait laisser de lui, en partant, une impression favorable dans le cœur de sa cousine et s'assurer l'affection de madame de Monglat, auprès de laquelle il se voyait bien plus avancé, quoique leur liaison fût plus récente. Il proposa donc à madame de Sévigné de lui donner une fête au Temple. Elle accepta. Il ne manqua pas d'y inviter les trois amies, madame de Monglat, madame de Lisle, et madame de Précy. Madame de Sévigné ignorait alors les intrigues de son cousin, ou, si elle en soupçonnait quelque chose, elle s'en inquiétait peu. Elle avait même, par un billet écrit en italien, engagé à se rendre à cette fête une de ses amies qui (elle le savait) plaisait beaucoup à Bussy; c'était la marquise d'Uxelles, jolie, spirituelle et coquette859. Madame de Sévigné fit avec tant de grâce les honneurs de cette fête, elle y parut si aimable, que, malgré le grand nombre de beautés qui s'y trouvaient réunies, aucune ne parut plus qu'elle digne des hommages que Bussy lui rendait avec autant d'éclat que de magnificence.
Madame de Précy, à laquelle les assiduités de Bussy auprès de madame de Monglat n'avaient causé aucune jalousie, parce qu'elle les avait attribuées à son amitié pour La Feuillade, aux engagements qu'il avait contractés avec lui, crut aussi que Bussy s'était servi de sa cousine comme d'un moyen détourné pour lui donner une fête; que madame de Sévigné en était le prétexte, mais qu'elle en était l'objet véritable; et les discours de Bussy contribuaient à entretenir chez elle cette erreur. Elle admira une galanterie aussi fine, aussi respectueuse, qui témoignait un amour si vrai, si délicat, et tout à fait dans les manières et les habitudes du code galant que les précieuses de cette époque avaient mis à la mode.
Quant à madame de Monglat, qui était en secret prévenue de tout, elle s'abandonna sans plus de résistance aux enchantements dont l'environnait un amant qui lui paraissait si généreux, si persévérant, et elle ne lui laissa plus aucun doute sur la nature de ses sentiments. Mais laissons-le lui-même donner la description de cette fête.
«Quelques jours avant que de partir, je voulus adoucir le chagrin que me donnait la violence que je me faisais à cacher ma passion; et pour cet effet je donnai à madame de Sévigné une fête si belle et si extraordinaire, que vous serez bien aise que je vous en fasse la description. Premièrement, figurez-vous dans le jardin du Temple, que vous connaissez, un bois que deux allées croisent: à l'endroit où elles se rencontrent, il y avait un assez grand rond d'arbres, aux branches desquels on avait attaché cent chandeliers de cristal. Dans un des côtés de ce rond on avait dressé un théâtre magnifique, dont la décoration méritait bien d'être éclairée comme elle était; et l'éclat de mille bougies, que les feuilles des arbres empêchaient de s'échapper, rendait une lumière si vive en cet endroit, que le soleil ne l'eût pas éclairé davantage: aussi, par cette raison, les environs en étaient si obscurs, que les yeux ne servaient de rien. La nuit était la plus tranquille du monde. D'abord la comédie commença, qui fut trouvée fort plaisante. Après ce divertissement, vingt-quatre violons ayant joué des ritournelles, jouèrent des branles, des courantes et des petites danses. La compagnie n'était pas si grande qu'elle était bien choisie: les uns dansaient, les autres voyaient danser, et les autres, de qui les affaires étaient plus avancées, se promenaient avec leurs maîtresses dans des allées où l'on se touchait pour se voir860. Cela dura jusqu'au jour, et, comme si le ciel eût agi de concert avec moi, l'aurore parut quand les bougies cessèrent d'éclairer. Cette fête réussit si bien, qu'on en manda les particularités partout, et à l'heure qu'il est on en parle avec admiration861.»
Cependant madame de Précy s'aperçut qu'elle était jouée862. La vicomtesse de Lisle, jolie Bretonne, admirable danseuse, coquette et pleine de grâce, avait aussi été courtisée, puis délaissée par Bussy. Elle partagea le ressentiment de madame de Précy. Bussy, par ses manœuvres, parvint à brouiller entre elles les trois amies; puis il partit pour l'armée, mal avec La Feuillade, très-bien avec madame de Monglat, et toujours au même degré d'intimité et de bienveillance amicale avec madame de Sévigné.