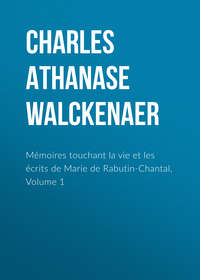Kitap dosya olarak indirilemez ancak uygulamamız üzerinden veya online olarak web sitemizden okunabilir.
Kitabı oku: «Mémoires touchant la vie et les écrits de Marie de Rabutin-Chantal, Volume 1», sayfa 27
CHAPITRE XXXV.
1653-1654
Madame de Sévigné ne partageait aucune des passions des partis.—Ses motifs pour rester à Paris.—Le retour de la cour y ramène plusieurs de ses amis.—Marigny resté à Paris, et obligé de se cacher, est sur le point d'être pris.—Il parvient à s'évader.—Audace des partisans de Condé.—Ils enlevaient des hommes riches, pour en tirer rançon.—Cruauté dans les deux partis.—Fin tragique du frère de Chavagnac à Sarlat.—Quatre bourgeois de Périgueux condamnés à être pendus par le duc de Candale, pour en obtenir rançon.—Gourville enlève Burin, directeur des postes, pour en tirer de l'argent.—La Rochefoucauld marie son fils avec une demoiselle de La Roche-Guyon, et se réconcilie avec le roi.—Rôle important que joue Gourville dans cette circonstance.—Il est gagné par le cardinal Mazarin.—Il se rend à Bordeaux pour y négocier la paix.—Il contribue plus à sa conclusion que les troupes du duc de Candale.—Le prince de Conti et la duchesse de Longueville se soumettent.—La duchesse de Longueville voit à Moulins madame de Montmorency, abbesse de Sainte-Marie, et devient pieuse.—Ses regrets, sa dévotion.—Sa correspondance avec l'abbesse de Sainte-Marie et les Carmélites de la rue Saint-Jacques.—Conti se réconcilie avec Mazarin, et épouse la fille de Martinozzi, nièce de ce ministre.—Cessation de la guerre civile.—Les intérêts des chefs, qui auraient pu la faire renaître, se trouvent ralliés à ceux du roi et de son ministre.
Aucune des passions qui dans les temps de partis corrompent le cœur et pervertissent le jugement n'avait de prise sur madame de Sévigné. Elle n'avait pour elle-même d'autre intérêt, d'autre ambition, d'autre pensée, que de remettre en ordre sa fortune, dérangée par les prodigalités de son mari, et de s'occuper de l'éducation de ses enfants. Ses liens de famille et de parenté, ses liaisons de société, son goût pour les plaisirs et les distractions, l'avaient conduite dans les cercles de la Fronde comme dans ceux de la cour, et lui avaient fait connaître tous les grands personnages de son temps, tous ceux qui jouèrent dans les affaires publiques un rôle important; mais elle ne s'était laissé entraîner dans aucune des intrigues de politique ou d'amour où ils se trouvaient tous engagés, par lesquelles ils étaient si fortement agités. Aussi, elle n'avait d'ennemis ni de rivales dans aucun parti; elle comptait dans tous des amis, des admirateurs, des courtisans, et par conséquent au besoin de chauds partisans, d'intrépides défenseurs. L'aventure de Tonquedec et de Rohan, que nous avons racontée, en a fourni la preuve.
Madame de Sévigné n'eut donc aucun motif qui la forçât de quitter Paris après que le roi y fut rentré. Elle en avait, au contraire, plusieurs pour y rester. L'hiver allait commencer. Les campagnes, par suite du mouvement continuel des armées, de la désorganisation du gouvernement, n'offraient plus de sécurité aux voyageurs, et les châteaux même n'étaient pas à l'abri des incursions et des dévastations des maraudeurs. Le séjour de la capitale garantissait madame de Sévigné de tous ces dangers, et ne lui promettait que des agréments. Si l'exil ou la fuite lui avaient enlevé plusieurs de ses connaissances et de ses amis, poursuivis par les rigueurs du pouvoir, la cour en ramenait un aussi grand nombre, qui peu de mois auparavant avaient été aussi forcés de s'exiler et de fuir, pour éviter de devenir victimes des factions. Ainsi, les chances alternatives de tous les partis étaient pour elle des motifs de douleur et de regret; elle sympathisait avec toutes les infortunes; plus que toute autre, elle ressentait le besoin de la concorde, et s'affligeait des divisions, des haines et des déchirements auxquels la France était en proie. Il résultait de cette position, où madame de Sévigné se trouvait placée par la modération de son caractère et la sensibilité de son cœur, que personne ne formait des souhaits plus conformes aux véritables intérêts de son pays et à ceux de l'humanité. Elle aurait voulu que la guerre civile cessât, que la paix s'établit d'une manière solide, et qu'une réconciliation générale et sincère s'opérât entre tous ceux qui se haïssaient ou se persécutaient mutuellement.
Mais on était loin d'être encore arrivé là. Tous ceux qui avaient agi et écrit contre Mazarin n'obtinrent pas la même indulgence que Scarron. Marigny, dont madame de Sévigné aimait tant l'esprit et la gaieté, était resté dans Paris. Il était un de ceux qui, par ses chansons et ses vers, auxquels Loret donne l'épithète de cruels792, avaient le plus contribué à ridiculiser le cardinal parmi le peuple. Agent actif du parti de Condé, il continuait à entretenir une correspondance avec ce prince. On le sut; et le lieutenant civil envoya des archers pour l'arrêter, ainsi que Breteval, marchand de dentelles dans la rue des Bourdonnais, chez lequel Marigny s'était caché. On saisit Breteval lorsqu'il était encore au lit. Marigny, qui entendit du bruit dans la maison à une heure indue, devina quelle en était la cause: aussitôt il se lève, et, sans se donner le temps de se couvrir d'aucun vêtement, il monte nu en chemise sur les toits, sans que personne puisse l'apercevoir; puis il pénètre jusqu'à une lucarne dans le grenier d'une maison voisine. Ne s'y croyant pas en sûreté, il descend dans la cave; mais le froid et l'humidité le gagnant, il se disposait à sortir de ce nouveau gîte, quand une jeune servante y vint pour chercher du vin. Elle jeta un cri en voyant un homme en chemise. Marigny calma sa frayeur, et lui dit qu'il était un marchand de Rouen poursuivi par ses créanciers, et ami de M. Breteval; il la supplia d'aller, sans en parler à son maître, avertir Dalancé, chirurgien, dont le logis était tout proche, et de lui dire de venir le joindre. La jeune fille exécuta fidèlement la commission qui lui avait été donnée. Dalancé, qui croyait son ami Marigny arrêté, reçut avec joie la messagère; il la récompensa généreusement, lui recommanda de garder sur cette aventure le plus profond secret, d'avoir bien soin de son prisonnier, et de l'assurer qu'il irait sur le soir le tirer de son cachot. En effet, il porta à Marigny des habits, et lui fournit des moyens de s'évader de Paris, et d'aller à Bruxelles rejoindre le prince de Condé793. Mais Croisy et plusieurs autres membres du parlement, qu'on savait être en correspondance avec Condé, moins heureux que Marigny, furent arrêtés à cette époque.
Mazarin se trouvait d'autant plus obligé de faire surveiller et saisir les partisans de Condé, qu'on appelait alors les princistes, qu'ils cherchaient à suppléer à leur petit nombre par leur activité et par leur audace; ils osaient surprendre et saisir de vive force des hommes connus par leurs richesses et leur dévouement au roi et à Mazarin, et ils les contraignaient à racheter leur vie et leur liberté par une forte rançon. Cachés sous toutes sortes de travestissements, ils exerçaient leurs brigandages jusque dans Paris même. Palluau, Vitry, Brancas, Sanguin, Genlis, mademoiselle de Guerchy, furent attaqués et dépouillés dans les rues de la capitale. Les délits de ce genre y devinrent si fréquents, qu'on forma une chambre de justice, c'est-à-dire qu'on créa un tribunal extraordinaire, pour juger ces délinquants: deux de leurs agents et complices furent condamnés à mort et exécutés794.
Ces attentats étaient communs à tous les partis, et celui du roi n'en avait pas été exempt. Ces guerres civiles, qu'on nous dépeint comme une lutte d'épigrammes et de chansons, n'ont produit que trop de scènes tragiques, que trop d'exemples de perfidie et de cruauté795; mais les historiens croient leur tâche remplie lorsqu'ils ont raconté les événements principaux, et dédaignent trop souvent de s'occuper des faits particuliers, qui les expliquent et en dévoilent les causes, en nous faisant connaître l'état du pays et les mœurs et les habitudes qui prévalaient aux époques où ils se sont passés. Lorsque le parti royaliste séduisit la garnison de Sarlat, où le frère de Chavagnac commandait pour Condé, sa femme, jeune et belle, accourant au secours de son mari, fut par les propres officiers de celui-ci tuée par une décharge de mousquets, ainsi que son enfant, qui l'accompagnait, et la nourrice qui le portait dans ses bras. Lui-même, après avoir échappé aux meurtriers de sa femme et de son fils, manqua d'être assassiné par un maître d'hôtel qui le servait depuis dix ans, et qu'il surprit occupé à vider son coffre-fort796. Gaspard de Chavagnac, quoique alors engagé dans le parti contraire à son frère, fut douloureusement affecté de ce malheur, et témoigna une juste horreur pour le crime qui le produisit. Cependant, il raconte sans manifester le moindre regret ni le plus petit remords comment, après la prise de Périgueux, lui et le duc de Candale condamnèrent quatre bourgeois des plus notables à être pendus, afin de forcer la ville à racheter leur vie pour une rançon de trois cent mille francs, qui leur fut payée797.
Gourville, l'honnête Gourville, si souvent loué par madame de Sévigné, et qui par sa fidélité et sa générosité envers ses amis, les agréments et la sûreté de son commerce, a mérité tous les éloges qu'elle en a faits798, rapporte dans ses Mémoires, non comme un fait qu'il se reproche, mais comme une prouesse dont il tire vanité, qu'étant désœuvré à Damvilliers, il eut l'idée d'enlever quelques personnes opulentes des environs de Paris, pour les mettre à rançon. Il en fit la proposition au marquis de Sillery, gouverneur de la ville, et à La Mothe, qui y était lieutenant du roi; ils l'agréèrent. Gourville, assisté des mêmes officiers et des mêmes cavaliers avec lesquels il avait en vain cherché à enlever le cardinal de Retz, réussit cette fois à s'emparer de Burin, directeur des postes, qu'il savait être riche en argent comptant. Burin fut conduit à Damvilliers. «Il arriva, dit Gourville, fatigué et désolé. Je feignis de le consoler, et, ayant traité de sa liberté, je convins à quarante mille livres. L'argent étant venu quelque temps après, il s'en alla799.»
Il est difficile de croire que le duc de La Rochefoucauld, dont Gourville était la créature, ait ignoré cet acte de brigandage. Après la retraite de Condé à Bruxelles, c'est à Damvilliers que La Rochefoucauld se retira et qu'il passa toute cette année 1653. Il désirait se réconcilier avec la cour, pour conclure le mariage de son fils, le prince de Marsillac, avec mademoiselle de La Roche-Guyon, l'unique héritière de Duplessis-Liancourt. Il chargea Gourville de se rendre auprès de Condé, à l'effet d'obtenir son consentement à ce mariage. Gourville, sous divers déguisements, fit pour cette affaire plusieurs voyages à Bruxelles, et Mazarin apprit qu'il était de retour et caché dans Paris; il jura qu'il n'en sortirait pas. Depuis longtemps il le faisait chercher pour le faire arrêter. Gourville comprit, en homme habile, qu'en allant au-devant du danger il parviendrait plus sûrement à l'éviter: il demanda au ministre qui le cherchait une audience, et il l'obtint. Possesseur d'importants secrets, porteur de paroles des princes et de plusieurs chefs de faction qui conservaient du pouvoir, parfaitement instruit des dispositions et des désirs de chacun d'eux, Gourville sut donner des conseils utiles, s'ils étaient suivis, à tous ceux dont il avait été jusque ici l'adroit et intrépide agent, mais plus utiles encore aux intérêts du roi et à ceux de son ministre. Mazarin, avec sa perspicacité ordinaire, devina dans cette entrevue tout le parti qu'il pouvait tirer d'un tel homme. Il lui fit des propositions qui furent acceptées, et il se l'attacha. Gourville réconcilia le duc de La Rochefoucauld avec la cour; puis, chargé de pleins pouvoirs de Mazarin, il se rendit à Bordeaux, et par l'argent, qu'il employa bien et à propos, par ses intrigues avec madame de Calvimont, maîtresse du prince de Conti, avec les membres influents du parlement de Bordeaux et les chefs des factions qui divisaient alors cette malheureuse ville, il fit plus que le duc de Candale avec toutes ses troupes pour la conclusion de la paix. Cette paix, signée le 24 juillet 1653, termina la guerre civile en France; et Gourville fut le premier qui porta cette heureuse nouvelle à Mazarin et à la cour800.
La princesse de Condé, avec son fils, alla rejoindre son mari dans les Pays-Bas. Conti se retira à sa terre des Granges près de Pézénas801, et la duchesse de Longueville à Moulins, chez sa parente l'abbesse des Filles de Sainte-Marie802, la veuve de ce duc de Montmorency que Richelieu avait fait décapiter. Ce fut là, et près du tombeau de son oncle, dont la mort lui avait fait répandre tant de larmes à l'âge de treize ans803, que la duchesse de Longueville commença ce long retour vers Dieu, qui, souvent traversé par les irrésolutions et les distractions du monde, ne fut cependant jamais interrompu, et se termina par des austérités que la foi la plus sincère et la plus vive peuvent seules suggérer.
De toutes les femmes qui avaient figuré avec éclat dans la Fronde, la duchesse de Longueville était celle que les événements avaient le plus maltraitée, et qui trouvait le plus de mécomptes par le rétablissement de la paix. Douloureusement affectée de la mort du duc de Nemours, qu'elle avait sincèrement aimé, elle avait vu Condé s'éloigner d'elle et entièrement livré à l'influence de la duchesse de Châtillon, son ennemie. Elle s'était brouillée avec Conti en s'opposant à ses volontés à Bordeaux et en assistant dans cette ville un parti qui lui était opposé. Elle était détestée de la cour, non-seulement pour avoir fomenté la guerre par ses intrigues, mais pour avoir mis, le plus longtemps qu'elle l'avait pu, des obstacles à la paix; enfin, elle était justement rejetée par son mari, dont elle avait méconnu les droits et l'autorité. Les seules consolations qui lui restassent, le seul baume versé sur les plaies de ce cœur agité et ulcéré par tant de passions, de douleurs, de regrets et de repentir, étaient les exhortations et les prières de l'illustre veuve de Montmorency et de la prieure des Carmélites de la rue Saint-Jacques à Paris. Ses velléités de piété et de réforme pendant son séjour à Bordeaux l'avaient fait entrer en correspondance avec cette dernière804; et cette correspondance devint plus active à mesure qu'elle faisait plus de progrès dans sa conversion. Les opinions peuvent varier, mais le caractère reste invariable. Madame de Longueville porta l'empreinte du sien jusque dans cette nouvelle carrière de piété où elle se trouvait engagée. Les disputes religieuses que les jansénistes avaient fait naître fournirent de nouveaux aliments à l'activité de son esprit et un nouvel emploi à son ardeur pour l'intrigue805.
Quant à Conti, ses conseillers, voyant le pouvoir de Mazarin désormais sans contrôle, le décidèrent à demander en mariage une des nièces de ce ministre, afin de rendre sa réconciliation complète et de rentrer en grâce à la cour. Conti, prince du sang, en prenant une femme dans la famille de Jules de Mazarin806, eut la liberté de choisir; et il choisit bien, car il préféra à toutes les autres nièces du cardinal la fille de Martinozzi, qui était belle et se montra vertueuse. Le duc de Candale, à qui elle avait été promise et qui jusque alors avait répugné à une telle mésalliance, arriva justement à Paris au moment où elle venait d'être accordée à Conti. Candale eut le chagrin de se voir refuser celle que Mazarin avait tenu à grand honneur de lui faire épouser. Conti, rentré en grâce auprès de la reine mère et du roi, reçut le commandement en chef de l'armée de Catalogne. On mit sous ses ordres le duc de Candale et un choix des meilleurs officiers807.
C'est ainsi qu'en ralliant les intérêts des chefs les plus puissants et les plus habiles aux intérêts du roi et du gouvernement, Mazarin non-seulement termina la guerre civile, mais mit Condé et ses partisans dans l'impossibilité de la faire renaître.
CHAPITRE XXXVI.
1653-1654
Condé prend Rocroi.—Turenne, Sainte-Menehould.—La cour et le conseil suivent l'armée.—Bons effets qui en résultent pour l'éducation du roi.—Fêtes et réjouissances au retour du roi.—Invention de la petite poste.—Nouveautés théâtrales.—Corneille donne Pertharite; traduit l'Imitation de J.-C.—Le Cid joué aux noces de la princesse de Schomberg.—Pièces de Cyrano de Bergerac et de Montauban.—Goût des spectacles très-vif parmi les grands.—Ils louaient les acteurs pour leurs châteaux.—Moyens de distraction que MADEMOISELLE employait dans son exil.—Trois troupes de comédiens parcouraient les provinces.—Troupe de Molière, qui va jouer chez le prince de Conti, à Pézénas.—Deux théâtres publics à Paris.—Ballets de la cour donnés sur le théâtre du Petit-Bourbon.—Mascarade de Cassandre, 1er ballet du roi.—Description de ce ballet.—Travestissement de MONSIEUR en femme.—Mauvaise influence de cette pratique.—Carême accompagné du jubilé.—Assiduité aux églises.—Retour du marquis et de la marquise de Montausier à l'hôtel de Rambouillet.—Assemblées chez mademoiselle de Scudéry et la comtesse de la Suze.—Ridicules des nouvelles précieuses.—Recueil de poésies choisies.—Vers à Ninon.—Madrigal adressé à madame de Sévigné.
Tout était pacifié dans l'intérieur; mais la guerre durait toujours avec les Espagnols, auxquels nos divisions avaient donné Condé, qui seul valait une armée. Cependant ce grand capitaine, contrarié dans ses plans de campagne par la jalousie de ceux-là même qui se servaient de lui, par les calculs égoïstes du duc de Lorraine808, se borna cette fois à la prise de Rocroi; et Turenne, réduit, à cause de son petit nombre de troupes, à éviter une action générale, se contenta de harceler sans cesse son ennemi, et de s'emparer de Sainte-Menehould809.
La reine régente, le ministre, le roi, suivirent l'armée pendant tout le temps de la campagne. Ainsi la cour se confondait avec l'état-major de Turenne, le conseil du cabinet avec le conseil de guerre. Les courtisans étaient les guerriers; l'exécution suivait les résolutions. Sous les yeux et par les exemples d'un habile ministre et d'un grand capitaine, le jeune roi apprenait à se battre et à régner.
Cependant la cour résida pendant tout l'hiver et une grande partie de cette année dans la capitale; et sa présence fut signalée par des fêtes et des réjouissances, qui dans les premiers temps du retour furent moins pompeuses et moins riches que celles de la Fronde, mais où se manifestait un accord de vœux et de sentiments qui n'avait pu exister au milieu de partis divisés de but et d'intérêt810. Nulle reine, nulle femme n'a jamais su aussi bien qu'Anne d'Autriche tenir un cercle; et Louis XIV parvenu au plus haut degré de sa puissance, alors qu'il mettait autant d'amour-propre à bien régir sa cour qu'à gouverner son royaume, a souvent regretté de ne trouver ni dans sa femme, ni dans celles auxquelles il en conféra les droits et les priviléges, cet art que possédait sa mère de faire régner parmi tant de personnes différentes de rang, de sexe et d'âge, les sévères lois de l'étiquette, et de les rendre pour toutes douces et légères, et quelquefois flatteuses; de maintenir au milieu de la plus nombreuse réunion l'ordre sans contrainte et la liberté sans confusion; d'y faire circuler la joie et respecter les convenances; de se montrer toujours attentive sans affectation, gracieuse avec bonté, et familière avec dignité811.
Quoique la pénurie des finances et la misère générale ne permissent pas d'étaler beaucoup de luxe, il y eut cependant cette année des repas donnés par la ville de Paris à Mazarin, et par Mazarin à MONSIEUR, au sujet des fiançailles de la princesse Louise de Savoie, fille du prince Thomas, avec le prince de Bade812; puis à l'occasion de la solennité de la Saint-Louis, des fêtes à l'hôtel de ville813, au Louvre et dans les places publiques, auxquelles prirent part la cour, la noblesse, les bourgeois et le peuple.
Le retour du roi dans Paris, en ramenant la sécurité, avait donné une impulsion plus rapide au commerce et rendu les communications entre les habitants de cette grande cité et ses différents quartiers plus fréquentes. Toujours un progrès dans la civilisation est signalé par quelque invention nouvelle, qui en est à la fois le résultat et l'indice. Cette activité inusitée imprimée cette année aux relations sociales dans Paris y donna lieu à l'établissement de la petite poste. C'est Loret qui nous apprend cette curieuse particularité. On mit, dit-il,
Des boîtes nombreuses et drues
Aux petites et grandes rues,
Où par soi-même, ou ses laquais,
Où pour ne porter des paquets,
Avis, billets, missive, ou lettres,
Que des gens commis pour cela
Iront chercher et prendre là,
Pour, d'une diligence habile,
Les porter partout par la ville814.
Le goût des représentations théâtrales s'accrut dès qu'on n'eut plus l'esprit préoccupé ou l'âme affligée par les événements de la guerre civile. La tragédie de Pertharite fut représentée cette année, et sa chute fut complète; Corneille la fit cependant imprimer, et, dans une préface chagrine, il témoigna combien ce revers inattendu lui avait été sensible: il y faisait ses adieux à la poésie dramatique, mais en se donnant à lui-même cet éloge815, «de laisser par ses travaux le théâtre français dans un meilleur état qu'il ne l'avait trouvé, et du côté de l'art, et du côté des mœurs». Ses contemporains ne lui ont pas contesté cette vérité, et ont parlé de lui comme la postérité. Mais il n'avait alors que quarante-sept ans, et déjà son génie avait faibli: sa muse, qui avait jeté un si grand éclat, ne pouvait plus chausser le cothurne tragique. C'est donc à tort qu'il se plaignait du public, qui ne voulait plus de ses pièces, parce que, dit-il, elles étaient passées de mode. Le public donnait un démenti à ce reproche en applaudissant avec enthousiasme toutes les fois qu'on donnait le Cid ou quelques-uns des chefs-d'œuvre de ce grand poëte816. Il se mit à traduire l'Imitation de Jésus-Christ, et le vide qu'il laissait au théâtre fut rempli tantôt par Cyrano de Bergerac, tantôt par un nommé Montauban. Ces auteurs, dont l'un est aujourd'hui si peu lu, et l'autre si peu connu, obtinrent des succès qui lui étaient refusés. Son frère Thomas, qui avait pris le nom de Corneille de Lisle, donna deux nouvelles pièces, qui réussirent. Un jeune homme dont Tristan avait fait son secrétaire, et que son esprit, son caractère et sa sociabilité lui avaient fait prendre en amitié, donna à la même époque, à l'hôtel de Bourgogne, sa première comédie, dont le succès fut complet817. Ce jeune homme, c'était Quinault, dont les vers de Boileau firent de son temps trop déchoir la réputation, et que les éloges de Voltaire ont trop exalté depuis. La destinée de Quinault fut toujours d'avoir plus de panégyristes que de lecteurs.
Aujourd'hui le goût des spectacles est devenu très-vif et très-général parmi les classes moyennes, et même parmi celles du peuple; il a, au contraire, beaucoup diminué dans les hautes classes: c'était l'inverse à l'époque dont nous nous occupons. Quoique ce goût commençât à se répandre plus généralement, cependant c'était dans les classes élevées qu'il était le plus prononcé; c'étaient elles qui faisaient vivre les comédiens, et donnaient de la réputation et de la vogue aux pièces de théâtre. Elles étaient alors une jouissance de l'esprit: les sens y avaient peu de part. Le prestige des décorations et la beauté des costumes, les sons harmonieux des instruments n'en avaient pas fait presque uniquement un plaisir des yeux et des oreilles. Le poëte, semblable à un magicien qui nous enlève à l'univers réel pour nous livrer aux fantômes qu'il lui plaît de faire comparaître, n'avait d'autre ressource que son art pour s'emparer de l'imagination des spectateurs, pour donner aux fictions l'apparence de la réalité. C'est à ces grandes différences dans l'art dramatique et dans le public pour lequel on l'exerçait que l'on doit attribuer, suivant nous, celles que l'on remarque entre les chefs-d'œuvre des deux derniers siècles et les compositions des auteurs de nos jours.
En raison de ce penchant prononcé des hautes classes pour les représentations théâtrales, on ne pouvait alors donner de grandes fêtes, pas même de grands repas818, sans le secours des comédiens; et lorsque les princes et les grands se trouvaient absents de la capitale et retirés dans leurs châteaux, ils y retenaient à leurs gages des troupes d'acteurs pour un temps plus ou moins long, ou ils les faisaient venir de la ville voisine.
MADEMOISELLE, qui dans son château de Saint-Fargeau819, qu'elle agrandissait, cherchait à se distraire des ennuis de son exil, avec sa vieille gouvernante, ses deux jeunes dames d'honneur820, sa naine821, ses perroquets, ses chiens, ses chevaux d'Angleterre, et la chasse, entretenait une troupe de comédiens. Forcée par son père d'aller le voir à Blois, elle se mit à voyager de château en château; et elle nous apprend dans ses Mémoires qu'elle eut à Tours un plaisir sensible de retrouver dans cette ville cette même troupe d'acteurs qu'elle avait eue à ses gages tout l'hiver. Elle fut si contente de leur jeu, qu'elle les rappela à Saint-Fargeau. Cependant, elle avait vu à son passage à Orléans une autre troupe, qu'elle avait trouvée très-bonne; c'était celle qui était restée à Poitiers avec la cour, et l'avait suivie à Saumur822.
Une troisième troupe, qui dans les années précédentes avait, à Bordeaux, été accueillie avec faveur par le duc d'Épernon, continuait à se faire voir dans le midi. Elle passa cette année à Lyon, et y obtint un très-grand succès par une comédie nouvelle en cinq actes, en vers, qu'avait composée un des acteurs de cette troupe. Cette même troupe, conduite par le jeune auteur-acteur qui la dirigeait, alla trouver à Pézénas le prince de Conti, qui la prit à ses gages pendant toute la tenue des états de Languedoc. La nouvelle comédie fut représentée devant le prince et les députés des états, et obtint autant de succès qu'à Lyon. Cette comédie était l'Étourdi, et le comédien-auteur, le sieur Poquelin de Molière. On voit que le prince de Conti n'était pas le plus mal partagé, et que sous ce rapport il n'avait rien à envier à la capitale823.
Paris n'avait alors que deux théâtres ouverts au public: celui de l'hôtel de Bourgogne, situé rue Mauconseil, qui était le plus fréquenté; et celui du Petit-Bourbon, construit dans une galerie, seul reste de l'hôtel du connétable de Bourbon, qu'on avait démoli824. Des acteurs italiens y étaient venus, pour la première fois, donner cette année des modèles de ce genre de comique trivial et bouffon qui fut depuis si goûté825.
Comme ce théâtre était voisin de l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, et touchait au Louvre, où le roi logeait, on en profita pour les fêtes de la cour. Tous les jeunes seigneurs et toutes les jeunes dames qui la composaient, et le jeune roi lui-même et son frère, exécutèrent sur ce théâtre ces fameux ballets dits royaux, où ils admirent à figurer avec eux les acteurs qui avaient par leurs leçons contribué à développer leurs talents pour le chant, la pantomime et la danse.
Benserade fut seul chargé de composer les vers de ces ballets826; et l'à-propos des allusions qu'il sut mettre dans ces compositions fut la source de sa réputation et de sa fortune. Flatter les grands en les amusant est pour eux un genre de mérite qu'aucun autre ne peut surpasser.
Le premier de ces ballets où le jeune roi figura fut joué au Palais-Royal; il était intitulé la Mascarade de Cassandre827. Mais le second, ayant pour titre la Nuit, fut exécuté sur le théâtre du Petit-Bourbon, vers la fin de février 1653828, avec des décorations et des costumes supérieurs par leur magnificence à tout ce qu'on avait vu jusqu'alors. Ce ballet, beaucoup plus long que le premier, était divisé en quatre parties ou quatre veilles. Tout ce qu'il y avait alors de personnes de distinction présentes à Paris, et madame de Sévigné dans le nombre, fut invité aux représentations de ce ballet. Le roi y paraissait à la fin, personnifié sous les traits d'un Soleil levant, et il y déclamait ou chantait les vers suivants:
Déjà seul je conduis mes chevaux lumineux,
Qui traînent la splendeur et l'éclat après eux.
Une divine main m'en a remis les rênes:
Une grande déesse a soutenu mes droits;
Nous avons même gloire: elle est l'astre des reines,
Je suis l'astre des rois.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quand j'aurai dissipé les ombres de la France,
Vers les climats lointains ma clarté paraissant
Ira, victorieuse, au milieu de Byzance
Effacer le croissant829.
C'est ainsi qu'on adulait ce monarque adolescent et qu'on fomentait en lui le goût des guerres et des conquêtes. Les poëtes n'étaient pas les seuls qui fissent des prédictions en sa faveur: les astrologues, qui conservaient encore un assez grand crédit, assuraient que dans les astres on découvrait des pronostics funestes à tous ceux qui s'opposeraient à son autorité830.
Louis remplissait encore d'autres rôles dans ce ballet de la Nuit, d'un genre plus gracieux et moins héroïque. Des stances, assez longues, qu'il avait à débiter sous la figure d'un des Jeux qui sont à la suite de Vénus se terminaient ainsi:
La jeunesse a mauvaise grâce
Quand, trop sérieuse, elle passe
Sans voir le palais d'Amour;
Il faut qu'elle entre; et pour le sage,
Si ce n'est pas son vrai séjour,
C'est un gîte sur son passage831.
Je remarque que dans cette pièce et dans celles du même genre qui suivirent on céda trop facilement aux inclinations que MONSIEUR avait pour les habillements de femme, et qu'il faisait partager à ceux qui l'entouraient. Dans ce ballet, le jeune marquis de Villeroy, fils de son gouverneur, élevé avec lui, fut habillé en femme, et représentait une coquette, tandis que MONSIEUR jouait le rôle de son galant832. Sans doute de tels travestissements n'avaient rien que de plaisant, rien que d'innocent entre deux enfants de douze à treize ans; mais la suite en fit voir les déplorables conséquences, et démontra combien l'influence des premières impressions est dangereuse833.
Le carême, qui fut cette année suivi d'un jubilé, mit fin aux ballets et aux divertissements. Le besoin de fuir le théâtre de la guerre et le désir de se montrer à la cour avaient attiré dans la capitale plusieurs évêques; ce qui donna plus de pompe aux cérémonies ecclésiastiques et contribua à augmenter l'assiduité avec laquelle on fréquentait les églises. Le jeune roi, qui n'était pas accoutumé à voir autour de lui tant de personnages revêtus des insignes de l'épiscopat, demanda quel en était le nombre; on lui dit qu'ils étaient trente. «Ce serait assez d'un seul,» répondit-il. Sur ce mot si judicieux, la plupart reçurent l'ordre de retourner dans leurs diocèses834. Au reste, on mit autant de ferveur dans les dévotions pendant toute la durée du carême, qu'on avait montré d'ardeur à se livrer aux plaisirs de tous genres pendant les mois précédents835; c'était là le caractère de l'époque.