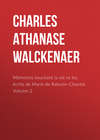Kitabı oku: «Mémoires touchant la vie et les écrits de Marie de Rabutin-Chantal, Volume 2», sayfa 18
Ce n'était pas le besoin de vaines distractions qui engageait Louis XIV à prodiguer des sommes considérables pour donner des fêtes splendides, à l'époque même où il cherchait, par une sévère économie, à mettre de l'ordre dans ses finances. Mais de même que ses désirs de gloire le portaient à violenter ses habitudes, à se condamner tous les jours à plusieurs heures de travail fastidieux, pour être puissant et redouté en Europe; de même l'amour l'excitait à se montrer généreux et galant, à déployer ses grâces et son adresse dans des exercices de corps; à se montrer vêtu avec goût et magnificence au milieu de son brillant cortége; à paraître toujours plus grand et plus aimable, pour être toujours plus admiré et plus aimé. Personne n'ignorait, depuis quelque temps, que ces fêtés multipliées, données sous divers prétextes aux reines ou à MADAME, avaient lieu principalement pour mademoiselle de La Vallière, dont la liaison avec le monarque n'était plus un mystère544. Divers emblèmes de ces fêtes, les vers qu'on y récitait, les airs qu'on y chantait, faisaient des allusions non déguisées aux inclinations amoureuses du roi, à celle qui en était l'objet, et à toutes les liaisons de même nature qui avaient lieu dans cette cour galante et voluptueuse. Si Benserade se les permettait, c'est qu'il savait que c'était un moyen de plaire au roi, qui, fier et orgueilleux de sa belle maîtresse et de l'amour qu'il lui inspirait545, croyait qu'il était au-dessous de sa dignité de feindre et de se cacher; qui éprouvait le besoin de faire connaître son bonheur, et d'y faire participer une cour jeune, indulgente et facile.
Anne d'Autriche, ne pouvant empêcher les écarts de son fils, avait voulu l'engager à sauver au moins les apparences. Mais tous ses efforts, et les vertueuses résistances ménagées ou appuyées par elle, ne servirent qu'à irriter le jeune monarque: il signala ses impérieuses volontés par d'éclatantes disgrâces, dans lesquelles Anne d'Autriche parut elle-même enveloppée. Mais alors elle tomba malade; et l'affection que son fils lui portait se manifesta par des actes touchants, qu'à tort on a cru peu dignes de la majesté de l'histoire. L'histoire, au contraire, ne doit rien laisser en oubli de tout cc qui peut contribuer à nous mieux faire connaître les personnages qui ont exercé une grande influence sur les destinées des hommes et des États.
Tant que Louis XIV put craindre de perdre sa mère, toutes les réjouissances furent suspendues. Les emportements de l'amour ne l'empêchèrent pas de consacrer à cette mère chérie tous les moments que les affaires de son royaume lui laissaient pendant le jour. La nuit, il couchait près d'elle tout habillé, sur un matelas qu'il faisait étendre au pied de son lit. Madame de Motteville, qui veilla seule plusieurs fois auprès d'Anne d'Autriche, vit dormir le roi dans cette situation. Son visage, qui brillait alors de tout l'éclat de la première jeunesse, acquérait, dit-elle, par le sommeil, plus de douceur, sans rien perdre de sa beauté et de sa majesté. Madame de Motteville montre dans tout ce qu'elle a écrit un jugement exquis et un rare discernement; mais elle avait cependant, comme toutes les femmes de son temps, la mémoire remplie de faits chevaleresques et des aventures amoureuses des héros de l'Arioste, d'Astrée, d'Amadis, des romans de La Calprenède et de mademoiselle de Scudéry. C'étaient les lectures favorites des femmes les plus spirituelles de cette époque. Madame de Motteville, d'un âge déjà mûr, avoue avec naïveté qu'en contemplant le jeune monarque ainsi endormi, oubliant la tristesse et les inquiétudes que lui causait l'état où se trouvait la reine mère, il lui est arrivé quelquefois, dans le silence de la nuit, de s'abandonner aux rêves de son imagination, et que, moitié éveillée moitié assoupie, elle croyait être une jeune princesse qui, après mille courses aventureuses, avait été transportée dans l'épaisseur d'un bois ou sur le rivage de la mer, où un beau guerrier, un héros illustre, accablé par la fatigue et plongé dans un profond sommeil, s'était offert à ses regards546. Puis, honteuse de ces folles pensées et de l'impression qu'elle en ressentait, elle se levait de dessus son fauteuil, et se mettait à genoux, priant Dieu avec ferveur pour celui qui les lui avait inspirées. Ce mélange d'émotions sensuelles ou profanes et de sensibilité religieuse caractérise surtout les personnages de ce temps, et se retrouve dans presque tous.
Louis XIV ne se reposait sur personne pour la surveillance des soins dont dépendaient les jours de sa mère. «Il l'assistait, dit madame de Motteville, avec une application incroyable; il aidait à la changer de lit, et la servait mieux et plus adroitement que toutes ses femmes547.» Ce témoignage rendu à la piété filiale de Louis XIV est d'autant moins suspect, que madame de Motteville, amie de madame de Navailles, ne jouissait pas de la faveur du roi; il attribuait à ses conseils la sévérité de sa mère à son égard, et il pensa un instant à la séparer d'elle en l'exilant.
Lorsque Anne d'Autriche fut convalescente, Louis XIV lui témoigna son repentir des chagrins qu'il lui avait causés; mais il ne se montra pas plus disposé à en tarir la source. Au contraire, son amour pour La Vallière continuant à prévaloir sur toute autre considération, il déclara que, sous peine d'encourir sa disgrâce, les dames de qualité devaient la suivre. Cette résolution du jeune monarque remplit pendant quelque temps la cour d'intrigues et de cabales; les résistances et les complaisances auxquelles elle donna lieu devinrent l'origine de l'abaissement des uns et de l'élévation des autres548.
CHAPITRE XXII.
1663-1664
Nouvelles fêtes à la cour.—Mademoiselle de Sévigné y paraît.—Mot du marquis de Tréville en la voyant.—Détails sur ce qui la concerne.—Comparée avec sa mère.—Éloge et reproche que lui adresse La Fontaine.—Elle danse dans le ballet du roi.—Vers de Benserade faits pour elle dans ce ballet.—Éloges qu'en fait Loret dans sa gazette.—Loret dit que La Vallière est digne d'avoir un balustre.—Usage du balustre.—Éloge que Loret fait de mademoiselle de Mortemart, devenue madame de Montespan.—La liberté dans le langage ne choquait point alors.—La semaine sainte interrompt les fêtes.—Diverses causes les font recommencer avec plus d'ardeur.—Mademoiselle de Sévigné reparaît dans le ballet des Amants déguisés.—Vers de Benserade pour elle dans ce ballet.—Éloge que Loret fait de ce ballet et de mademoiselle de Sévigné.—Divertissements de cette année, plus variés que de coutume.—Jeux de la ramasse.—Foire Saint-Germain.—Bal masqué donné par la reine.—Ballet des Amants déguisés.—Fêtes du mois de mai de 1664.—Il est probable que madame de Sévigné s'y est trouvée avec sa fille.—Elle se rend à sa terre de Bourbilly, et se retrouve avec Bussy.—Il y a tout lieu de croire que son départ de la capitale n'eut lieu qu'après celui de la cour.
Si on excepte le temps que dura la maladie de la reine mère, et les intervalles qui paraissaient bien longs du carême et de la semaine sainte, pendant lesquels le jeune abbé Bossuet faisait entendre des paroles fortes et sévères549, les années du nouveau règne s'écoulaient dans une suite presque continuelle de bals, de jeux, de spectacles et de divertissements. Durant cette année (1663), des mariages et des naissances dans la famille royale et dans d'autres grandes familles; la création de nouveaux ducs et pairs; les grâces du roi, répandues sur plusieurs de ses serviteurs; la présence du prince royal de Danemark et des envoyés de la confédération des Suisses à Paris; l'arrivée d'un légat du pape; le retour du prince et de la princesse de Conti dans la capitale, et plusieurs autres circonstances moins importantes, donnèrent encore plus d'activité aux fêtes, et les rendirent plus fréquentes550.
Ce fut dans ces fêtes que parut pour la première fois à la cour la fille de madame de Sévigné. Elle avait quinze ans: en la voyant, le marquis de Tréville, connu par son esprit et par ses bons mots, dit: «Cette beauté brûlera le monde.» Et en effet au teint éclatant d'une blonde mademoiselle de Sévigné joignait les traits les plus réguliers et une taille svelte, aux formes les plus gracieuses; elle montrait alors une intelligence prompte et facile. Sa mère sut mettre à profit ces dispositions naturelles, par l'éducation la plus complète et la mieux dirigée. Lorsque cette éducation fut terminée, mademoiselle de Sévigné écrivait non-seulement sa langue, mais encore la langue italienne, avec beaucoup de pureté; elle savait un peu de latin, et, selon la coutume de cette époque, parmi les femmes d'un certain rang, de ne point rester étrangères à tout ce qui faisait l'entretien des hommes, elle apprit la philosophie de Descartes, dont on s'occupait beaucoup alors. L'application qu'elle mettait aux études sérieuses n'avait point nui à l'acquisition des talents ni aux arts d'agrément. Elle excellait surtout dans la danse, et ce fut sans doute ce qui lui valut l'honneur d'être admise, si jeune, à danser avec le roi551. On ne peut disconvenir qu'en la laissant déployer toutes ses grâces et tous ses attraits aux yeux d'un monarque facile à enflammer, et en la produisant de si bonne heure au milieu d'une cour voluptueuse, madame de Sévigné ne s'abandonnât avec trop peu de prudence aux jouissances de l'orgueil maternel. Heureusement pour elle et pour sa fille, la prédiction du marquis de Tréville ne s'accomplit pas. Mademoiselle de Sévigné a donné une preuve de plus que la beauté et la supériorité du savoir et des talents ne suffisent pas seules pour faire naître les grandes passions; que l'admiration ne produit pas toujours la tendresse; et que l'esprit et les yeux peuvent être satisfaits sans que le cœur soit touché. Beaucoup plus belle que sa mère, plus savante peut-être, plus habile dans les arts d'agrément, mademoiselle de Sévigné, avec une riche dot, dans tout l'éclat de la jeunesse, eut de la peine à rencontrer un parti sortable, et ne fit jamais naître l'amour; tandis que tous les hommes qui voyaient madame de Sévigné se passionnaient pour elle, et qu'elle aurait pu, même après un veuvage déjà avancé, choisir un époux à son gré et contracter encore un mariage brillant, si sa tendresse pour ses enfants, et surtout pour sa fille, ne l'en eût empêchée. La cause de ceci nous est connue: mademoiselle de Sévigné était froide et réservée, et son premier abord avait quelque chose de dédaigneux; elle ne possédait pas la moindre étincelle de ce feu qui animait sa mère; elle n'avait rien de cette vivacité affectueuse, de cette sensibilité exquise, de cette verve spirituelle, qui charmait tant dans madame de Sévigné, et lui prêtaient des attraits souvent enivrants pour ceux à qui elle voulait plaire; et elle le voulait presque pour tous. Elle mettait son bonheur à être recherchée, admirée, louée, et surtout à être aimée. Il n'en était pas ainsi de mademoiselle de Sévigné: sa froideur était si connue, si généralement sentie, que La Fontaine lui en fait un reproche dans une fable qu'il lui a dédiée; mais, avec ce tact fin qui le caractérise, il déguise le blâme sous les termes ambigus d'un éloge:
Ainsi, selon La Fontaine, une femme ne pouvait être parfaitement belle si elle était indifférente. La Fontaine avait raison: la beauté froide est cette Galatée muette et immobile, cette statue de la fable, que le souffle divin n'a point animée, et qui ne peut inspirer d'amour qu'à celui dont elle fut l'ouvrage. Si, comme Pygmalion, madame de Sévigné eût pu transmettre son âme à celle qui lui devait la vie, à celle qu'elle s'était plu à former et à combler de tant de perfections, elle n'eût pas été la seule à la chérir, à s'occuper d'elle avec délices, à épuiser en sa faveur toutes les formes de l'éloge, toutes les expressions de la tendresse; et cette beauté, comme avait dit le marquis de Tréville, eût brûlé le monde. Mais celle qui était remarquable par ses attraits fut admirée; celle qui se montra sage dans sa conduite fut estimée, et ce fut tout. Tout…, je me trompe: celle qui ne chercha point à plaire déplut, celle qui mit trop peu de prix à paraître aimable ne fut point aimée. Dans le monde moral, comme dans le monde physique, toujours les conséquences sont conformes aux prémisses.
Au temps dont nous nous occupons, on cherchait à la voir, on aimait à la regarder comme un astre nouvellement levé sur l'horizon: on ne voulait point la juger. Au milieu de tant de beautés ravissantes, la jeune Sévigné apparaissait semblable à une des fleurs, à peine entr'ouverte, d'un buisson de roses, mais brillant par de si fraîches et de si vives couleurs, qu'elle fixe les regards de préférence à toutes les autres. Ce fut en janvier 1663, et dans le ballet des Arts, qu'elle dansa pour la première fois: la sensation qu'elle produisit fut grande; c'est ce que Benserade fait entendre dans les premiers vers récités dans ce ballet, à son sujet:
Déjà cette beauté fait craindre sa puissance;
Et, pour nous mettre en butte à d'extrêmes dangers,
Elle entre justement dans l'âge où l'on commence
A distinguer les loups d'avecque les bergers.
Dans ce même ballet, qui fut joué pendant tout l'hiver, le roi représentait un berger553, MADAME jouait le rôle de Pallas, et mademoiselle de Sévigné dansait avec elle, dans la septième entrée, avec mesdemoiselles de Mortemart, de Saint-Simon et de La Vallière. Toutes les quatre étaient vêtues en Amazones. Les vers chantés ou récités à cette occasion pour mademoiselle de Sévigné, démontrent tout ce qu'on permettait de licence à la muse de Benserade dans ces représentations théâtrales, où se trouvaient cependant deux reines, et où la plus jeune figurait comme actrice.
Pour mademoiselle de SÉVIGNY, Amazone
Belle et jeune guerrière, une preuve assez bonne
Qu'on suit d'une Amazone et la règle et les vœux,
C'est qu'on n'a qu'un teton: je crois, Dieu me pardonne,
Que vous en avez déjà deux554.
Loret, en rendant compte de la première représentation de ce ballet, dans sa Gazette du 20 janvier 1663, après avoir décrit l'entrée de MADAME et des demoiselles Saint-Simon, Mortemart et La Vallière, ajoute:
Sévigny, pour qui l'assemblée
Était de merveille comblée,
Chacun paraissant enchanté
De sa danse et de sa beauté.
Fille jeune, fille brillante,
Fille de mine ravissante,
Et dont les jolis agréments
Charment les cœurs à tous moments555.
Loret fait ensuite l'éloge du roi, qu'il appelle un brave porte-couronne. Le plaisir que Louis XIV prenait à ces danses et à ces divertissements était singulièrement augmenté par les éloges détournés et les allusions ingénieuses qu'ils suggéraient à Benserade dans la composition des vers de ces ballets.
On joua encore de nouveau, l'année suivante, le ballet des Arts: les mêmes personnages y figurèrent; et parmi les belles dont Loret fait l'éloge, au sujet de cette reprise, mademoiselle de Sévigné n'est pas oubliée:
Les autres beautés renommées,
Qu'ailleurs j'ai toutefois nommées,
C'était Saint-Simon, Sévigny
De mérite presque infini;
La Vallière, autre fille illustre,
Digne un jour d'avoir un balustre.
Ce dernier vers fait allusion à l'usage où l'on était d'entourer d'un balustre l'estrade sur laquelle le lit était élevé; ce qui n'avait lieu que pour les rois, les reines, et les personnages d'une haute distinction. Mademoiselle de Mortemart, qui figurait encore dans ce ballet avec mademoiselle de Sévigné, comme une des quatre Amazones, s'était mariée à Montespan depuis la première représentation; et c'est par cette raison que Loret la nomme la défunte Mortemart, car, dit-il,
On voit d'après cette citation, à laquelle je pourrais en joindre d'autres, que les gazettes de Loret, qui ne circulaient qu'à la cour et dans le beau monde, étaient écrites d'un style aussi libre que les ballets de Benserade. L'on doit, d'après cela, moins s'étonner de certaines expressions de Molière et des auteurs de ce temps, et par conséquent de celles qui se présentaient sous la plume de madame de Sévigné, ou qui lui échappaient dans la vivacité du dialogue. Quoiqu'elle eût passé sa première jeunesse parmi les précieuses, la mobilité de son imagination lui faisait facilement adopter les nouveaux usages qui étaient favorables à la gaieté de son caractère.
Le carême et la semaine sainte vinrent interrompre tout divertissement mondain, et ramenèrent le règne des prédicateurs et les somptueuses cérémonies ecclésiastiques. Dans celles-ci, la musique de La Barre, de Boisset, de Hottman, de Molière (j'entends le musicien, et non pas le poëte), et les belles voix des demoiselles Hilaire, Saint-Christophe et Cercamanans, faisaient, comme dans les fêtes profanes, les délices des assistants557. Les deux reines et les personnes pieuses joignaient, à leur exemple, aux actes de dévotion, qui étaient de rigueur, de fréquents voyages à l'ermitage du mont Valérien, alors occupé par des dominicains; ce pèlerinage était fort en vogue558.
Après ce temps de pénitence et de privations, les plaisirs recommencèrent par des festins, des bals donnés par le roi et les grands de la cour559, auxquels succédèrent des chasses brillantes à Versailles, à Vincennes et à Chantilly; puis, la foire Saint-Laurent, qui jamais n'avait eu tant d'éclat560.
Lorsque l'hiver survint, au commencement de l'année suivante, on monta un nouveau ballet, intitulé les Amours déguisés. Mademoiselle de Sévigné était un trop grand ornement de ces ballets, pour que le roi ne désirât pas qu'elle figurât dans tous. Elle était dans celui de l'année 1664 au nombre des Amours déguisés en Nymphes maritimes, avec mademoiselle d'Elbœuf, madame de Montespan et madame de Vibraye: Benserade termine les vers qu'il fit pour elle, à cette occasion, par un compliment à sa mère561:
Pour mademoiselle DE SÉVIGNY,
Amour déguisé en Nymphe maritime
Vous travestir ainsi, c'est bien être ingénu,
Amour! c'est comme si, pour n'être pas connu,
Avec une innocence extrême,
Vous vous déguisiez en vous-même.
Elle a vos traits, vos feux, et votre air engageant,
Et, de même que vous, sourit en égorgeant.
Enfin, qui fit l'une a fait l'autre,
Et, jusques à sa mère, elle est comme la vôtre.
Loret, dans sa gazette, a fait une description pompeuse de la première représentation de ce ballet, qui eut lieu dans le milieu de février 1664. On voit, par son récit, que les grands de la cour y figuraient avec les acteurs et les actrices les plus renommés, avec
L'excellent acter Floridor,
Qui vaut mieux que son pesant d'or,
et la célèbre Desœillets, et Montfleury et sa fille. Après avoir, selon son usage, commencé par l'éloge du roi, de MONSIEUR, des reines, des princesses, Loret en vient aux filles d'honneur, et termine tous ces éloges par celui de mademoiselle de Sévigné.
J'ai pensé faire une folie
En oubliant cette jolie,
Cette pucelle Sévigny,
Objet de mérite infini.
Certes, moi qui l'ai deux fois vue
De divers agréments pourvue,
Et d'une très-rare beauté,
Aux ballets de Sa Majesté,
Si quelqu'un s'en venait me dire,
Et fût-ce le roi notre sire:
As-tu rien vu de plus mignon?
Je lui dirais hardiment: Non562.
La reine mère, se ployant aux goûts et aux désirs de son fils, donna un bal masqué vers la fin du carnaval. A tous les plaisirs des années précédentes, la rigueur du froid en fit joindre un d'un genre tout nouveau: c'était le jeu qu'on appelle la ramasse, qui eut alors une grande vogue. Ce jeu consistait à se faire précipiter de haut en bas avec une grande rapidité, au moyen d'une machine qui devait ressembler à celle des montagnes russes, que nous avons vue de nos jours563. La foire Saint-Germain offrit aussi cette fois une richesse et une pompe extraordinaires; elle fut plus fréquentée, eut un aspect encore plus gai, plus animé que dans les années précédentes.
Mais toutes les fêtes de l'hiver furent surpassées par celles que Louis XIV donna au printemps, dans le parc de Versailles: elles commencèrent le 7 mai, et durèrent six jours. Le décorateur Vigarani donna pour titre à ces fêtes: les Plaisirs de l'île enchantée. Comme celles du Carrousel et des Tuileries, elles laissèrent un long souvenir. Benserade564 composa des sonnets, des madrigaux et des quatrains, contenant l'éloge de tous ceux qui y figuraient, à commencer par le roi. Molière, à cette occasion, composa la Princesse d'Élide et le Mariage forcé565. Nous ne pouvons douter que madame de Sévigné et sa fille n'aient assisté à ces fêtes, qui eurent lieu au commencement de mai, surtout si nous remarquons que mademoiselle de Sévigné participait à la représentation de l'Amour déguisé, qui fut donnée chez MONSIEUR, au Palais-Royal, à la fin de février. Cependant nous n'avons aucune preuve directe de leur présence à Versailles à cette époque; et nous savons que madame de Sévigné se rendit cette année dans sa terre de Bourbilly, en Bourgogne, où elle se retrouva dans la société de son cousin Bussy566; mais ses départs pour la province n'avaient ordinairement lieu que lorsque la cour quittait la capitale pour transporter son séjour à Saint-Germain, à Compiègne ou à Fontainebleau.