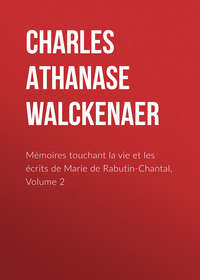Kitabı oku: «Mémoires touchant la vie et les écrits de Marie de Rabutin-Chantal, Volume 2», sayfa 3
CHAPITRE IV.
1655
Bussy, pour s'excuser, écrit à sa cousine qu'il avait passé la nuit chez le baigneur.—Explication sur ce mot.—Ce qu'étaient les hôtels garnis et les bains publics sous le siècle de Louis XIV.—Madame de Sévigné devine Bussy, ou est instruite de ses actions.—Lettre qu'elle lui écrit.—Bussy lui avoue tout.—Il lui demande réciprocité de confiance.—L'interroge sur l'amour qu'a pour elle le surintendant.—Réponse de madame de Sévigné.—Correspondance qui s'établit entre eux.—Nouvelle lettre de madame de Sévigné à Bussy.—Cette correspondance augmente l'inclination qu'ils avaient l'un pour l'autre.—Bussy se plaint de n'être pas assez aimé de sa cousine.—Comment madame de Sévigné se défend, et se justifie de désirer que Bussy reste à l'armée.—Bussy envoie un messager à Paris, avec des lettres pour ses deux maîtresses, sans écrire à madame de Sévigné.—Reproche que fait à Bussy madame de Sévigné.
Lorsque Bussy fut arrivé devant Landrecies, dont l'armée royale avait formé le siége, il n'eut rien de plus pressé que d'écrire à sa cousine pour s'excuser d'avoir manqué à lui faire ses adieux; et pour ne pas révéler le secret de ses amours, il lui dit que dans la nuit qui avait précédé son départ il avait été coucher chez le baigneur. Pour bien comprendre la réponse que lui fit madame de Sévigné, et avoir une idée exacte des mœurs et des habitudes de cette époque, il faut expliquer à nos lecteurs ce qu'on entendait par le baigneur, lors de la jeunesse de Louis XIV.
Il y avait alors à Paris, en plus grand nombre qu'aujourd'hui, des bains chauds nommés étuves pour la bourgeoisie, et même pour les gens de bas étage69. On comptait aussi dans cette ville une quantité d'auberges et d'hôtelleries pour toutes les conditions, puis quelques hôtels garnis magnifiquement meublés70, mais en très-petit nombre. Ces hôtels étaient principalement à l'usage de ceux de la haute noblesse qui ne faisaient pas partie de la cour, et qui n'avaient à Paris ni maison ni hôtel à eux. Pour ceux de cette classe qui en possédaient, pour les grands seigneurs et les gens de cour qui résidaient dans la capitale, il existait encore une ou deux maisons, un ou deux établissements d'un genre particulier, qu'il est difficile de définir, parce qu'il n'y en a plus de semblable: c'était bien un hôtel garni, où l'on se trouvait pourvu avec luxe de tous les besoins et de toutes les commodités de la vie, mais où l'on pouvait s'en procurer encore d'autres, qui n'existaient pas dans les meilleurs et les plus somptueux hôtels garnis.
Ces maisons étaient ordinairement tenues par des hommes experts dans tout ce qui concernait la toilette, et renommés par leur habileté à coiffer les hommes et les femmes. Les barbiers et les baigneurs ne formaient alors qu'une seule et même profession; ils étaient constitués en corporation, sous le titre de barbiers-étuvistes; mais le maître de l'établissement dont nous parlons, et qu'on nommait le baigneur par excellence, n'était point soumis aux règlements de cette corporation. Il exerçait son état par un privilége spécial émané du roi lui-même, ou d'un des officiers de sa maison.
On se rendait chez le baigneur par différents motifs. D'abord par raison de santé et de propreté: c'était là que l'on prenait les meilleurs bains, les bains épilatoires, les bains mêlés de parfums et de cosmétiques, par lesquels on donnait plus de vigueur au corps, plus de douceur à la peau, plus de souplesse aux membres. Cette maison était pourvue d'un grand nombre de domestiques soumis, réservés, discrets, adroits. On s'y enfermait la veille d'un départ, ou le jour même d'un retour, afin de se préparer aux fatigues qu'on allait éprouver, ou pour se remettre de celles qu'on avait essuyées. Voulait-on disparaître un instant du monde, fuir les importuns et les ennuyeux, échapper à l'œil curieux de ses gens, on allait chez le baigneur: on s'y trouvait chez soi, on était servi, choyé; on s'y procurait toutes les jouissances qui caractérisent le luxe ou la dépravation d'une grande ville. Le maître de l'établissement et tous ceux qui étaient sous ses ordres devinaient à vos gestes, à vos regards, si vous vouliez garder l'incognito; et tous ceux qui vous servaient, et dont vous étiez le mieux connu, paraissaient ignorer jusqu'à votre nom. Votre entrée et votre séjour dans cette maison étaient pour eux comme un secret d'État, qu'ils ne révélaient jamais. Aussi c'était chez le baigneur que les femmes qui ne pouvaient autrement échapper aux yeux qui les surveillaient se rendaient déguisées, le visage masqué, seules, ou conduites par leurs amants. Enfin de jeunes seigneurs, amis des plaisirs sans contrainte, ou d'une vie peu réglée, faisaient la partie de se rendre ensemble chez le baigneur, et y séjournaient quelquefois plusieurs jours, afin de se livrer plus facilement et plus secrètement à leur goût pour le jeu, le vin et la débauche. Pourtant cette maison était tellement grande et si bien distribuée en corps de logis séparés, que les personnes sages, tranquilles ou infirmes, que des motifs de santé ou les aisances qu'on y trouvait y avaient conduites, n'étaient nullement troublées par ces hôtes bruyants et dissolus: elles ne pouvaient même soupçonner leur présence dans un lien où régnaient toujours pour elles l'ordre, la décence et un calme profond.
La faculté de tenir un établissement de ce genre était une sorte de privilége exclusif, qui ne pouvait s'exercer qu'au moyen d'un haut patronage. C'était donc pour ceux qui y étaient propres, et qui n'y répugnaient pas, un moyen assuré de faire fortune. Ils étaient nécessairement les intermédiaires de beaucoup d'intrigues, les confidents de plusieurs grands personnages, les dépositaires d'importants secrets. Aussi les écrits du temps, qui se taisent sur plusieurs faits historiques, nous ont fait connaître le nom du plus fameux baigneur de cette époque: ce fut Prudhomme71, auquel succéda plus tard La Vienne, chez lequel le roi lui-même, dans le temps de ses premières amours, allait se baigner et se parfumer. La Vienne devint par la suite son premier valet de chambre72.
Nos lecteurs, qui savent actuellement ce que c'était que le baigneur, comprendront mieux la réponse que fit à Bussy madame de Sévigné. Elle ne fut pas dupe de la feinte de son cousin, ou elle fut instruite de quelle manière il avait passé la nuit la veille de son départ. La lettre de Bussy lui était parvenue à Livry, et c'est de ce lieu que sa réponse est datée, le 26 juin:
«Je me doutais bien que tôt ou tard vous me diriez adieu, et que si ce n'était chez moi, ce serait du camp devant Landrecies. Comme je ne suis pas une femme de cérémonie, je me contente de celui-ci, et je n'ai pas songé à me fâcher que vous eussiez manqué à l'autre. Je m'étais déjà dit vos raisons, avant que vous me les eussiez écrites; et je suis trop raisonnable pour trouver étrange que la veille d'un départ on couche chez le baigneur. Je suis d'une grande commodité pour la liberté publique; et pourvu que les bains ne soient pas chez moi, je suis contente: mon zèle ne me porte pas à trouver mauvais qu'il y en ait dans la ville73.»
Bussy s'aperçut que madame de Sévigné avait tout appris ou tout deviné, et il chercha à se faire tout pardonner, en l'amusant par le récit de son entrevue et de ses adieux. Il le fait avec beaucoup d'esprit et de gaieté, et parvient à tout dire, en conservant les convenances et une grande décence d'expression. Mais il voudrait ne pas faire à sa cousine, avec abandon, confidence de tout ce qui le concerne, sans obtenir d'elle la même réciprocité.
«Mandez-moi, lui dit-il, je vous prie, des nouvelles de l'amour du surintendant; vous n'obligerez pas un ingrat. Je vais vous dire, à la pareille, des nouvelles du mien pour ma Chimène: il me semble que je vous fais un honnête parti, quand je vous offre de vous dire un secret pour des bagatelles.»
En terminant, Bussy insiste encore pour que sa cousine lui mande l'histoire de l'amour du surintendant, quelle qu'elle soit. Elle lui répond sur cet article dans une lettre datée de Paris le 19 juillet, écrite au retour du voyage qu'elle avait fait à Saint-Fargeau, et dont elle fait mention dans cette lettre. Ce qu'elle dit nous prouve combien Fouquet mettait d'insistance dans le désir qu'il avait de la séduire, et nous éclaire sur la conduite qu'elle tenait à son égard, et sur son plan de défense.
«Quoiqu'il n'y ait rien de plus galant que ce que vous me dites sur toute votre affaire, je ne me sens point tentée de vous faire une pareille confidence sur ce qui se passe entre le surintendant et moi; et je serais au désespoir de pouvoir vous mander quelque chose d'approchant. J'ai toujours avec lui les mêmes précautions et les mêmes craintes; de sorte que cela retarde notablement les progrès qu'il voudrait faire. Je crois qu'il se lassera enfin de vouloir recommencer toujours la même chose. Je ne l'ai vu que deux fois depuis six semaines, à cause d'un voyage que j'ai fait. Voilà ce que je puis vous en dire et ce qui en est. Usez aussi bien de mon secret que j'userai du vôtre; vous avez autant d'intérêt que moi de le cacher74.»
Dans la correspondance qui s'établit pendant cette campagne entre madame de Sévigné et Bussy, dont ce dernier a enrichi ses Mémoires, on les voit tous deux mutuellement charmés de leur esprit, et fiers de s'appartenir. Madame de Sévigné éprouve une joie sensible lorsqu'elle reçoit la nouvelle que son cousin s'est distingué à Landrecies75, qu'il a reçu les éloges de Turenne; que Mazarin, le roi et toute la cour ont dit du bien de lui. Et Bussy, de son côté, tout amoureux qu'il est de sa cousine, et fort disposé à s'en montrer jaloux, apprend cependant toujours avec plaisir l'effet produit par ses charmes sur quelques personnages importants.
«Il y a deux ou trois jours qu'en causant, lui dit-il, avec M. de Turenne, je vins à vous nommer. Il me demanda si je vous voyais: je lui dis que oui, et qu'étant cousins germains et de même maison, je ne voyais pas une femme plus souvent que vous. Il me dit qu'il vous connaissait, et qu'il avait été vingt fois chez vous sans vous rencontrer; qu'il vous estimait fort, et qu'une marque de cela était l'envie qu'il avait de vous voir, lui qui ne voyait aucune femme. Je lui dis que vous m'aviez parlé de lui, que vous aviez su l'honneur qu'il vous avait fait, et que vous m'aviez témoigné lui en être obligée. A propos de cela, madame, il faut que je vous dise que je ne pense pas qu'il y ait au monde une personne si généralement estimée que vous. Vous êtes les délices du genre humain; l'antiquité vous aurait dressé des autels, et vous auriez assurément été déesse de quelque chose. Dans notre siècle, où l'on n'est pas si prodigue d'encens, et surtout pour le mérite vivant, on se contente de dire qu'il n'y a point de femme à votre âge plus vertueuse ni plus aimable que vous. Je connais des princes du sang, des princes étrangers, des grands seigneurs façon de princes, des grands capitaines, des gentils-hommes, des ministres d'État, des magistrats et des philosophes, qui fileraient pour vous si vous les laissiez faire. En pouvez-vous demander davantage? A moins que d'en vouloir à la liberté des cloîtres, vous ne sauriez aller plus loin76.»
On ne peut donner à une femme des éloges plus satisfaisants pour son orgueil; et ce qui devait les rendre plus acceptables, c'est qu'ils étaient l'expression de la vérité, et non celle d'une fade adulation ou d'un sot enthousiasme. Madame de Sévigné ne montre pas pour son cousin la même admiration qu'il témoigne pour elle; cependant elle loue son esprit avec une sincère effusion. «Je ne crois pas, lui écrit-elle, avoir jamais rien lu de plus agréable que la description que vous me faites de l'adieu de votre maîtresse. Ce que vous dites, que l'Amour est un vrai recommenceur, est tellement joli et tellement vrai, que je suis étonnée que, l'ayant pensé mille fois, je n'aie pas eu l'esprit de le dire77.»
Bussy se plaint que sa cousine montre trop peu de tendresse pour lui, en paraissant si préoccupée de sa gloire et de son avancement. «Quand on aime bien les gens qui vont à l'armée, dit-il avec justesse, on a plus de crainte pour les dangers de leur personne que de joie dans l'espérance de l'honneur qu'ils vont acquérir78.» Cependant, comme en même temps Bussy devine qu'il y a plus de dépit dans ce que sa cousine a écrit sur ce sujet, que d'absence de sentiment, et qu'il a la fatuité de le lui dire, elle lui répond de manière à tâcher de le convaincre que c'est bien véritablement qu'elle mérite le reproche qu'il lui adresse, et qu'elle ne désire pas qu'il en soit autrement. Ayant appris qu'il sollicitait la permission de rester à l'armée pendant tout l'hiver, elle lui dit: «Comme vous savez, mon pauvre Comte, que je vous aime un peu rustaudement, je voudrais qu'on vous l'accordât; car on dit qu'il n'y a rien qui avance tant les gens, et vous ne doutez pas de la passion que j'ai pour votre fortune79.»
Cependant la lettre dont Bussy se plaignait montrait bien évidemment que sa cousine conservait de la rancune pour la manière dont il avait agi à l'époque de son départ pour l'armée. Elle était piquée d'avoir été sacrifiée alors au désir de passer quelques heures de plus avec une maîtresse. Bussy avait raison d'avoir cette pensée; mais il avait tort de la manifester.
«Je serais, lui avait-elle dit, une indigne cousine d'un si brave cousin si j'étais fâchée de vous voir cette campagne à la tête du plus beau corps qui soit en France, et dans un poste aussi glorieux que celui que vous tenez. Je crois que vous désavoueriez des sentiments moins nobles que ceux-là. Je laisse aux baigneurs d'en avoir de plus tendres et de plus faibles. Chacun aime à sa mode: pour moi, je fais profession d'être brave aussi bien que vous. Voilà les sentiments dont je veux faire parade80.»
Dans une autre occasion, l'empressement qu'elle met à écrire à son cousin, lorsqu'il la néglige, nous prouve avec quel soin elle cherchait à écarter d'elle tout soupçon de dépit ou de sentiment jaloux, quoiqu'elle ne puisse s'empêcher d'en laisser toujours percer quelque chose. Bussy avait envoyé à Paris un messager avec des lettres pour ses deux maîtresses, et il ne lui avait rien remis pour madame de Sévigné. Celle-ci profita cependant de ce même messager pour écrire à son cousin, afin de le féliciter sur les succès qu'il avait obtenus à la guerre, et dont la renommée l'avait instruite. Dans une autre lettre, où elle avait besoin de rappeler toutes celles qu'elle lui avait adressées depuis quelque temps, elle dit: «Je vous ai encore écrit par un laquais que vous avez envoyé ici, lequel était chargé de plusieurs lettres pour de belles dames. Je ne me suis pas amusée à vous chicaner de ce qu'il n'y en avait pas pour moi, et je vous fis une petite lettre en galoppant81.»
Voici en quels termes elle avait écrit à Bussy sur ce point délicat, dans cette petite lettre faite en galoppant:
«Je me trouvai hier chez madame de Monglat, qui avait reçu une de vos lettres, et madame de Gouville aussi: je croyais en avoir une chez moi, mais je me suis trompée dans mon attente, et je jugeai que vous n'aviez pas voulu confondre tant de rares merveilles. J'en suis bien aise, et je prétends avoir un de ces jours une voiture à part.»
L'allusion qu'elle fait ici à la haute renommée de Voiture comme épistolographe, et à la double signification de son nom, qui ne serait dans toute autre occasion qu'un simple calembour, devient dans cette circonstance un éloge flatteur, et un reproche aimable, empreint du sentiment d'une noble et juste fierté.
CHAPITRE V.
1655
Madame de Gouville donne une fête peu de jours après l'avanie faite à Bartet, son amant.—Détails sur Bartet.—Il est employé pendant la Fronde à d'importantes négociations.—Aventures de sa jeunesse, et comment il était parvenu.—Sa présomption et sa vanité.—Ressentiments qu'elles excitent.—Il obtient les faveurs de la marquise de Gouville.—Il tient un propos outrageant sur le duc de Candale.—Le duc de Candale s'en venge en lui faisant une avanie.—Pourquoi Mazarin abandonne Bartet dans cette circonstance.—Tout le monde rit de l'aventure de Bartet.—Épigramme à ce sujet.—Bussy mande à madame de Sévigné la querelle entre le marquis d'Humières, le comte de Nogent et la Châtre.—Détails sur Bautru, comte de Nogent.—Plaisanteries qu'il se permet au sujet de Roquelaure.—Passage d'une des lettres de madame de Sévigné sur la duchesse de Roquelaure.—Querelle entre le prince d'Harcourt et la Feuillade.—Madame de Sévigné trouve plaisante la captivité de la duchesse de Châtillon chez Fouquet.—Réflexions à ce sujet.—Bussy se rend à Compiègne.—Il sollicite de Mazarin de servir pendant l'hiver, et n'obtient rien.—Revient à Paris.—Y séjourne.—Repart pour se rendre à l'armée de Turenne.
Le même jour que madame de Sévigné écrivit la lettre que nous venons de citer, la marquise de Gouville donnait dans son hôtel, à Paris, une fête dont le récit remplit une page entière de la Gazette de Loret82: il décrit le ballet, les scènes grotesques, les danses, le concert, et la collation. Cependant, lorsque la marquise de Gouville donnait cette fête, l'avanie qu'à cause d'elle avait éprouvée Bartet, un de ses amants, venait d'avoir lieu, et était l'objet des conversations générales. Madame de Sévigné en parle dans une lettre écrite à Bussy trois jours après celle dont nous avons fait mention en dernier, c'est-à-dire le 19 juillet83; mais elle en parle brièvement et en passant, afin de ne pas blesser son cousin. Pour bien la comprendre, il faut suppléer aux détails qu'elle n'a pas eu besoin de donner en écrivant à Bussy, qui était parfaitement instruit sur ce qui concernait celui qui faisait l'objet de cette aventure.
Quand Mazarin était exilé et proscrit par des arrêts du parlement, du consentement du roi, c'est-à-dire de la reine régente, qui parlait en son nom, il n'en continuait pas moins, des bords du Rhin ou de la solitude des Ardennes, où il s'était réfugié, à diriger les affaires. Le gouvernement n'était pas dans le cabinet des ministres, dans la salle du conseil, dans les actes authentiques publiés au nom du roi, mais dans les résolutions et les déterminations prises par la reine régente dans les conciliabules qui avaient lieu dans la chambre de l'exilé ou dans l'oratoire de la reine. Il était alors nécessaire que la reine et son ministre pussent communiquer entre eux continuellement, et de manière à ce qu'il ne restât aucune trace de ces communications; que le secret le plus profond et le plus impénétrable fût gardé sur leur but et sur leur résultat. De là naquit l'importance des courriers de cabinet, et l'influence que ces personnages subalternes prirent à cette époque. Comme ils auraient pu être arrêtés par les partisans de la Fronde ou des princes, jugés et condamnés par les parlements, à cause de leur correspondance avec un banni déclaré ennemi de l'État, ils n'étaient chargés d'aucune dépêche, d'aucune note, d'aucun papier; mais dépositaires des pensées et des intentions secrètes du cardinal et de la reine, ils allaient et venaient continuellement, portaient les paroles de l'un et de l'autre, et prenaient à l'égard des tiers des engagements en leurs noms. On voit que durant ces temps de troubles ces courriers de cabinet n'étaient pas seulement des porteurs de dépêches, mais de véritables négociateurs. A une époque aussi agitée, lorsque les intérêts variaient sans cesse et si rapidement, lorsqu'il y avait tant d'intrigues différentes, et qu'il fallait pour les conduire tant de dissimulation et d'audace; lorsque les troupes des différents partis envahissaient le pays, et empêchaient qu'on ne pût faire le plus petit trajet sans travestissement, ce rôle de courrier de cabinet donnait à tous ceux qui l'exerçaient une réputation de capacité, de courage, de prudence et de fidélité, qui ennoblissait leurs fonctions, et les faisait jouir d'une considération supérieure à celle de la charge dont ils étaient revêtus. Bartet fut un de ceux que la reine et Mazarin employèrent en cette qualité le plus souvent et avec le plus de succès.
Il était fils d'un paysan du Béarn. Son père lui ayant donné de l'éducation, il devint avocat au parlement de Navarre. Il séduisit la femme de chambre de l'épouse d'un conseiller de ce parlement. On voulut le forcer à épouser cette fille, très-chérie de sa maîtresse: il s'y refusa, quitta le pays, s'en alla à Rome, et, recommandé par des jésuites, il s'attacha au duc de Bouillon, puis ensuite au prince Casimir, frère du roi de Pologne, et qui lui succéda au trône. Celui-ci, lorsqu'il fut roi, nomma Bartet son résident en France. Bartet se fit ainsi connaître de Mazarin et des autres ministres de la reine, et il obtint, par l'entremise de la princesse Palatine, d'être nommé secrétaire du cabinet84. Bientôt il eut toute la confiance de la reine et de son ministre, et fut initié aux plus importants secrets d'État85. Fier de ses succès, il se fit de nombreux ennemis par sa suffisance, sa fatuité, son ton et ses manières, qui auprès des personnages élevés auxquels il avait affaire contrastaient si fort avec son humble origine. La manifestation de notre propre supériorité choque l'orgueil naturel d'autrui, lors même qu'elle semble justifiée par la prééminence du talent, de la naissance ou de la fortune; mais l'insolence d'un parvenu semble une atteinte portée à tous les droits acquis: elle blesse comme une usurpation, et révolte comme une ingratitude. Tels étaient les sentiments que faisait naître Bartet, dont la causticité d'ailleurs n'épargnait personne, pas même ses amis et ses bienfaiteurs. Bartet devint amoureux de la marquise de Gouville. Cette femme séduisante était en même temps courtisée par le duc de Candale, dont la vie fut si courte et les aventures si nombreuses86. Bartet, si inférieur au duc de Candale pour la figure et la tournure, l'emportait sur lui par certains avantages auxquels la marquise de Gouville se montrait fort sensible. Au lieu de jouir en secret d'un bonheur qui pouvait lui faire un ennemi puissant, Bartet eut l'impudence de faire parade de sa conquête d'une manière injurieuse pour son rival. En présence d'un grand nombre de personnes, dont quelques-unes faisaient l'éloge du duc de Candale comme du plus bel homme de l'époque et le plus propre à plaire aux femmes, Bartet dit, avec un ton dédaigneux, «que si on ôtait à ce beau duc ses grands cheveux, ses grands canons, ses grandes manchettes et ses grosses touffes de galants, il ne serait plus qu'un squelette et un atome.» Candale, outré de l'insolence de Bartet, et regardant comme au-dessous de lui de se mesurer avec un tel homme, se vengea en grand seigneur, ou, si l'on veut, en vrai brigand. Laval, son écuyer, à la tête de onze hommes à cheval, arrête en plein jour, dans la rue Saint-Thomas du Louvre, la voiture de Bartet. Deux des cavaliers se saisissent des chevaux, deux autres portent le pistolet à la gorge du cocher, deux autres mettent pied à terre, et entrent dans le carrosse le poignard à la main; ils se précipitent sur Bartet, lui coupent avec des ciseaux les cheveux d'un côté, et une moustache de l'autre; ils lui arrachent son rabat, ses canons et ses manchettes; et, après lui avoir appris que cette opération a lieu par ordre de monseigneur le duc de Candale, ils le laissent aller87.
Sous Richelieu, le personnage, quelque élevé qu'il fût, qui aurait ainsi traité le plus obscur et le plus infime de ses affidés, eût été obligé de fuir, et aurait eu à supporter le poids d'une procédure criminelle. Mazarin, auquel Bartet se plaignit, lui promit justice, fit même commencer quelques procédures, mais n'osa pas les faire continuer. Candale avait rendu de grands services à Mazarin, qui s'était donné des torts envers lui, en ne réalisant pas la promesse qu'il avait faite de lui faire épouser sa nièce Martinozzi, mariée au prince de Conti. Mazarin ne fut donc pas fâché d'avoir occasion de montrer des égards pour ce seigneur, afin de le retenir dans son parti. D'ailleurs, Bartet avait été le protégé de la reine plus encore que celui de Mazarin, qui, dans sa correspondance écrite avec Anne d'Autriche, avait cherché à la prémunir contre les défauts du caractère de ce confident, et l'avait engagée à ne se fier à lui qu'avec précaution88. Toute la haute noblesse était indignée de l'insolence de Bartet, et applaudissait à l'avanie qui lui était faite. Chavagnac, en racontant cette aventure, dit qu'elle fit plus de bruit qu'elle ne méritait89. Madame de Sévigné n'en parle qu'en plaisantant, et la trouve tout à fait bien imaginée; elle ne doute pas que son cousin ne s'en soit fort diverti90. On rit beaucoup aux dépens de Bartet, et l'on fit sur lui le couplet suivant, qui courut tout Paris:
Comme un autre homme
Vous étiez fait, monsieur Bartet:
Mais quand vous iriez chez Prudhomme,
De six mois vous ne seriez fait
Comme un autre homme91.
Non-seulement Bartet n'obtint aucune réparation de l'affront qu'il avait éprouvé, mais plus tard on le força de s'exiler de la cour, lorsque le duc de Candale s'y trouvait92. Ainsi la différence des rangs était alors si fortement marquée, que ceux qui osaient s'en prévaloir pour conserver leurs priviléges d'insolence et de domination pouvaient encore faire violence à la justice et braver la faveur.
Bussy et madame de Sévigné se faisaient part mutuellement dans leurs lettres des nouvelles qui pouvaient les intéresser: lui, celles de l'armée; elle, celles de la cour. Bussy, dans sa lettre du 17 octobre93, entretient sa cousine de la querelle qui s'est élevée entre le marquis d'Humières et le comte de Nogent, querelle si peu honorable pour ce dernier. Il avait été provoqué en duel par la Châtre, beau-frère d'Humières, et il avait refusé de se battre. D'Humières, toujours bien auprès du roi et des ministres, devint depuis maréchal de France. Le luxe du grand seigneur le suivait même à l'armée. Il fut le premier qui s'y fit servir en vaisselle d'argent, et avec les mêmes recherches et la même variété de mets que dans son hôtel. Comme la guerre continua, et se régularisa en quelque sorte, ce genre de luxe fut imité par tous les officiers généraux, et même par les simples colonels et les mestres de camp94. La Châtre nous est connu pas ses liaisons avec Ninon95. Armand, comte de Nogent, qui se noya depuis au fameux passage du Rhin96, était le fils de Nicolas de Bautru, modèle du courtisan fin, spirituel et bouffon. Celui-ci, arrivé à la cour d'Anne d'Autriche avec huit cents livres de rente, en avait cent cinquante mille lorsqu'il mourut. Sa femme se fit connaître par des désordres honteux. Il en demanda vengeance à la justice, et fit condamner un de ses valets, qui fut mis aux galères97. Il se rendait un jour chez la reine, lorsque cette affaire était encore récente; et la cynique plaisanterie qu'il se permit pour faire rejaillir sur le duc de Roquelaure le ridicule dont celui-ci avait voulu le couvrir en présence de toute la cour, prouve qu'une partie du secret de la mystérieuse intrigue de la duchesse de Roquelaure n'avait pas échappé aux regards scrutateurs des jeunes courtisans98. Cet indécent quolibet, qui fit rougir la reine, sert en même temps à expliquer le passage suivant de la lettre que madame de Sévigné écrivit à Bussy le 25 novembre99.
«Madame de Roquelaure est revenue tellement belle, qu'elle défit hier le Louvre à plate couture100: ce qui donne une si terrible jalousie aux belles qui y sont, que par dépit on a résolu qu'elle ne serait pas des après-soupers, qui sont gais et galants comme vous savez. Madame de Fiennes voulut l'y faire demeurer hier; mais on comprit par la réponse de la reine qu'elle pouvait s'en retourner.»
Madame de Sévigné paraît avoir ignoré le véritable motif de l'exclusion de la duchesse de Roquelaure des après-soupers; mais la duchesse de Roquelaure a dû le connaître ou le deviner. Les chagrins causés par des humiliations de cette nature, et par les remords de les avoir mérités, ont pu contribuer, autant que les infidélités de Vardes, à précipiter dans la tombe cette intéressante victime d'un premier amour. Une autre raison devait encore déterminer à ne pas admettre la duchesse de Roquelaure dans ces réunions familières. Le jeune duc d'Anjou manifestait du penchant pour elle; et le chagrin qu'il témoigna lorsqu'il apprit sa mort montra quelle était déjà la violence de sa passion101.
Madame de Sévigné, qui ne veut rien laisser ignorer à Bussy de ce qui se passe dans le monde, raconte aussi dans la même lettre une querelle assez ridicule, mais qui n'eut aucune suite, entre le prince d'Harcourt, la Feuillade, qui fut depuis maréchal de France, et le chevalier de Gramont, si connu par l'histoire que le spirituel Hamilton nous a donnée de ses aventures galantes. La chose se passa chez Jannin de Castille, financier, assez bel homme, peu spirituel, et fort riche. Bussy a fait lui-même connaître les liaisons de ce personnage avec la comtesse d'Olonne102, et Sauval a révélé celles qu'il eut avec mademoiselle de Guerchy, une des filles d'honneur de la reine103. Mademoiselle de Guerchy fut depuis la maîtresse du duc de Vitry, et périt victime des moyens qu'employa pour la faire avorter une sage-femme nommée Constantin, qui fut pendue pour ce crime. Le comte Gaspard de Chavagnac, qui, pour obliger Vitry, son ami, avait conduit l'infortunée Guerchy chez la Constantin, fut mis en cause, et subit même une condamnation, qui ne fut pas capitale. Lui, qui était la bravoure même, raconte naïvement dans ses Mémoires la frayeur qu'il éprouva «quand il vit les mêmes juges avec lesquels il faisait tous les jours la débauche l'interroger avec un visage si sévère104».
Madame de Sévigné apprit, sans en connaître la cause, que la duchesse de Châtillon se trouvait captive chez l'abbé Fouquet; et, dans sa lettre du 5 novembre, elle mande cette nouvelle à son cousin en une seule ligne, en ajoutant: «Cela paraît fort plaisant à tout le monde105.» Singulière époque que celle où l'on trouvait plaisant qu'une femme de ce rang, de cette naissance, qu'une Montmorency, que la veuve d'un Gaspard de Coligny, duc de Châtillon, fût retenue d'autorité en chartre privée, chez un abbé, son amant! Cependant la chose paraîtra moins étrange lorsque l'on saura que l'abbé Fouquet avait avec lui sa mère, qui était la vertu même106.