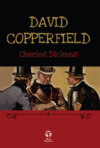Kitabı oku: «David Copperfield – Tome II», sayfa 11
Tout cela n'était pas très-consolant, mais miss Mills ne voulait pas encourager des espérances mensongères. Elle me renvoya bien plus malheureux que je n'étais en arrivant, ce qui ne m'empêcha pas de lui dire (et ce qu'il y a de plus fort, c'est que je le pensais) que je lui avais une profonde reconnaissance et que je voyais bien qu'elle était véritablement notre amie. Il fut résolu que le lendemain matin elle irait trouver Dora, et qu'elle inventerait quelque moyen de l'assurer, soit par un mot, soit par un regard, de toute mon affection et de mon désespoir. Nous nous séparâmes accablés de douleur; comme miss Mills devait être satisfaite!
En arrivant chez ma tante, je lui confiai tout; et, en dépit de ce qu'elle put me dire, je me couchai au désespoir. Je me levai au désespoir, et je sortis au désespoir. C'était le samedi matin, je me rendis immédiatement à mon bureau. Je fus surpris, en y arrivant, de voir les garçons de caisse devant la porte et causant entre eux; quelques passants regardaient les fenêtres qui étaient toutes fermées. Je pressai le pas, et, surpris de ce que je voyais, j'entrai en toute hâte.
Les employés étaient à leur poste, mais personne ne travaillait. Le vieux Tiffey était assis, peut-être pour la première fois de sa vie, sur la chaise d'un de ses collègues, et il n'avait pas même accroché son chapeau.
«Quel affreux malheur, monsieur Copperfield! me dit-il, au moment où j'entrais.
– Quoi donc? m'écriai-je. Qu'est-ce qu'il y a?
– Vous ne savez donc pas? cria Tiffey, et tout le monde m'entoura.
– Non! dis-je en les regardant tous l'un après l'autre.
– M. Spenlow, dit Tiffey.
– Eh bien?
– Il est mort!»
Je crus que la terre me croulait sous les pieds; je chancelai, un des commis me soutint dans ses bras. On me fit asseoir, on dénoua ma cravate, on me donna un verre d'eau. Je n'ai aucune idée du temps que tout cela dura.
«Mort? répétai-je.
– Il a dîné en ville hier, et il conduisait lui-même son phaéton, dit Tiffey. Il avait renvoyé son groom par la diligence, comme il faisait quelquefois, vous savez…
– Eh bien!
– Le phaéton est arrivé vide. Les chevaux se sont arrêtés à la porte de l'écurie. Le palfrenier est accouru avec une lanterne. Il n'y avait personne dans la voiture.
– Est-ce que les chevaux s'étaient emportés?
– Ils n'avaient pas chaud, dit Tiffey en mettant ses lunettes, pas plus chaud, dit-on, qu'à l'ordinaire quand ils rentrent. Les guides étaient brisées, mais elles avaient évidemment traîné par terre. Toute la maison a été aussitôt sur pied; trois domestiques ont parcouru la route qu'ils avaient suivie. On l'a retrouvé à un mille de la maison.
– À plus d'un mille, monsieur Tiffey, insinua un jeune employé.
– Croyez-vous? Vous avez peut-être raison dit Tiffey, à plus d'un mille, pas loin de l'église: il était étendu, le visage contre terre; une partie de son corps reposait sur la grande route, une autre sur la contre-allée. Personne ne sait s'il a eu une attaque qui l'a fait tomber de voiture, ou s'il en est descendu, parce qu'il se sentait indisposé; on ne sait même pas s'il était tout à fait mort quand on l'a retrouvé: ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il était parfaitement insensible. Peut-être respirait-il encore, mais il n'a pas prononcé une seule parole. On s'est procuré des médecins aussitôt qu'on a pu, mais tout a été inutile.»
Comment dépeindre ma situation d'esprit à cette nouvelle! Tout le monde comprend assez mon trouble, en apprenant un tel événement, et si subit, dont la victime était précisément l'homme avec lequel je venais d'avoir une discussion. Ce vide soudain qu'il laissait dans sa chambre encore occupée la veille, où sa chaise et sa table avaient l'air de l'attendre: ces lignes tracées par lui de sa main et laissées sur son bureau comme les dernières traces du spectre disparu: l'impossibilité de le séparer dans notre pensée du lieu où nous étions, au point que, quand la porte s'ouvrait, on s'attendait à le voir entrer; le silence morne et le désoeuvrement de ses bureaux, l'insatiable avidité de nos gens à en parler et celle des gens du dehors qui ne faisaient qu'entrer et sortir toute la journée pour se gorger de quelques détails nouveaux: quel spectacle navrant! Mais ce que je ne saurais décrire, c'est comment, dans les replis cachés de mon coeur, je ressentais une secrète jalousie de la mort même; comment je lui reprochais de me refouler au second plan dans les pensées de Dora; comment l'humeur injuste et tyrannique qui me possédait me rendait envieux même de son chagrin; comment je souffrais de la pensée que d'autres pourraient la consoler, qu'elle pleurerait loin de moi; enfin comment j'étais dominé par un désir avare et égoïste de la séparer du monde entier, à mon profit, pour être, moi seul, tout pour elle, dans ce moment si mal choisi pour ne songer qu'à moi.
Dans le trouble de cette situation d'esprit (j'espère que je ne suis pas le seul à l'avoir ressentie, et que d'autres pourront le comprendre), je me rendis le soir même à Norwood: j'appris par un domestique que miss Mills était arrivée; je lui écrivis une lettre dont je fis mettre l'adresse par ma tante. Je déplorais de tout mon coeur la mort si inattendue de M. Spenlow, et en écrivant je versai des larmes. Je la suppliais de dire à Dora, si elle était en état de l'entendre, qu'il m'avait traité avec une bonté et une bienveillance infinies, et n'avait prononcé le nom de sa fille qu'avec la plus grande tendresse, sans l'ombre d'un reproche. Je sais bien que c'était encore pur égoïsme de ma part. C'était un moyen de faire parvenir mon nom jusqu'à elle; mais je cherchais à me faire accroire que c'était un acte de justice envers sa mémoire. Et peut-être l'ai-je cru.
Ma tante reçut le lendemain quelques lignes en réponse; l'adresse était pour elle; mais la lettre était pour moi. Dora était accablée de douleur, et quand son amie lui avait demandé s'il fallait m'envoyer ses tendresses, elle s'était écriée en pleurant, car elle pleurait sans interruption: «Oh! mon cher papa, mon pauvre papa!» Mais elle n'avait pas dit non, ce qui me fit le plus grand plaisir.
M. Jorkins vint au bureau quelques jours après: il était resté à Norwood depuis l'événement. Tiffey et lui restèrent enfermés ensemble quelque temps, puis Tiffey ouvrit la porte, et me fit signe d'entrer.
«Oh! dit M. Jorkins, monsieur Copperfield, nous allons, monsieur Tiffey et moi, examiner le pupitre, les tiroirs et tous les papiers du défunt, pour mettre les scellés sur ses papiers personnels, et chercher son testament. Nous n'en trouvons de trace nulle part. Soyez assez bon pour nous aider.»
J'étais, depuis l'événement, dans des transes mortelles pour savoir dans quelle situation se trouverait ma Dora, quel serait son tuteur, etc., etc., et la proposition de M. Jorkins me donnait l'occasion de dissiper mes doutes. Nous nous mîmes tout de suite à l'oeuvre; M. Jorkins ouvrait les pupitres et les tiroirs, et nous en sortions tous les papiers. Nous placions d'un côté tous ceux du bureau, de l'autre tous ceux qui étaient personnels au défunt, et ils n'étaient pas nombreux. Tout se passait avec la plus grande gravité; et quand nous trouvions un cachet ou un porte-crayon, ou une bague, ou les autres menus objets à son usage personnel, nous baissions instinctivement la voix.
Nous avions déjà scellé plusieurs paquets, et nous continuions au milieu du silence et de la poussière, quand M. Jorkins me dit en se servant exactement des termes dans lesquels son associé, M. Spenlow, nous avait jadis parlé de lui:
«M. Spenlow n'était pas homme à se laisser facilement détourner des traditions et des sentiers battus. Vous le connaissiez. Eh bien! je suis porté à croire qu'il n'avait pas fait de testament.
– Oh, je suis sûr du contraire!» dis-je.
Tous deux s'arrêtèrent pour me regarder.
«Le jour où je l'ai vu pour la dernière fois, repris-je, il m'a dit qu'il avait fait un testament, et qu'il avait depuis longtemps mis ordre à ses affaires.»
M. Jorkins et le vieux Tiffey secouèrent la tête d'un commun accord.
«Cela ne promet rien de bon, dit Tiffey.
– Rien de bon du tout, dit M. Jorkins.
– Vous ne doutez pourtant pas? repartis-je.
– Mon bon monsieur Copperfield, me dit Tiffey, et il posa la main sur mon bras, tout en fermant les yeux et en secouant la tête; si vous aviez été aussi longtemps que moi dans cette étude, vous sauriez qu'il n'y a point de sujet sur lequel les hommes soient aussi imprévoyants, et pour lequel on doive moins les croire sur parole.
– Mais, en vérité, ce sont ses propres expressions! répliquai-je avec instance.
– Voilà qui est décisif, reprit Tiffey. Mon opinion alors, c'est… qu'il n'y a pas de testament.»
Cela me parut d'abord la chose du monde la plus bizarre, mais le fait est qu'il n'y avait pas de testament. Les papiers ne fournissaient pas le moindre indice qu'il eût voulu jamais en faire un; on ne trouva ni le moindre projet, ni le moindre mémorandum qui annonçât qu'il en eût jamais eu l'intention. Ce qui m'étonna presque autant, c'est que ses affaires étaient dans le plus grand désordre. On ne pouvait se rendre compte ni de ce qu'il devait, ni de ce qu'il avait payé, ni de ce qu'il possédait. Il était très-probable que, depuis des années, il ne s'en faisait pas lui-même la moindre idée. Peu à peu on découvrit que, poussé par le désir de briller parmi les procureurs des Doctors'-Commons, il avait dépensé plus que le revenu de son étude qui ne s'élevait pas bien haut, et qu'il avait fait une brèche importante à ses ressources personnelles qui probablement n'avaient jamais été bien considérables. On fit une vente de tout le mobilier de Norwood: on sous-loua la maison, et Tiffey me dit, sans savoir tout l'intérêt que je prenais à la chose, qu'une fois les dettes du défunt payées, et déduction faite de la part de ses associés dans l'étude, il ne donnerait pas de tout le reste mille livres sterling. Je n'appris tout cela qu'au bout de six semaines. J'avais été à la torture pendant tout ce temps-là, et j'étais sur le point de mettre un terme à mes jours, chaque fois que miss Mills m'apprenait que ma pauvre petite Dora ne répondait, lorsqu'on parlait de moi, qu'en s'écriant: «Oh, mon pauvre papa! Oh, mon cher papa!» Elle me dit aussi que Dora n'avait d'autres parents que deux tantes, soeurs de M. Spenlow, qui n'étaient pas mariées, et qui vivaient à Putney. Depuis longues années elles n'avaient que de rares communications avec leur frère. Ils n'avaient pourtant jamais eu rien ensemble; mais M. Spenlow les ayant invitées seulement à prendre le thé, le jour du baptême de Dora, au lieu de les inviter au dîner, comme elles avaient la prétention d'en être, elles lui avaient répondu par écrit, que, «dans l'intérêt des deux parties, elles croyaient devoir rester chez elles.» Depuis ce jour leur frère et elles avaient vécu chacun de leur côté.
Ces deux dames sortirent pourtant de leur retraite, pour venir proposer à Dora d'aller demeurer avec elles à Putney. Dora se suspendit à leur cou, en pleurant et en souriant. «Oh oui, mes bonnes tantes; je vous en prie, emmenez-moi à Putney, avec Julia Mills et Jip!» Elles s'en retournèrent donc ensemble, peu de temps après l'enterrement.
Je ne sais comment je trouvai le temps d'aller rôder du côté de Putney, mais le fait est que, d'une manière ou de l'autre, je me faufilai très-souvent dans le voisinage. Miss Mills, pour mieux remplir tous les devoirs de l'amitié, tenait un journal de ce qui se passait chaque jour; souvent elle venait me trouver, dans la campagne, pour me le lire, ou me le prêter, quand elle n'avait pas le temps de me le lire. Avec quel bonheur je parcourais les divers articles de ce registre consciencieux, dont voici un échantillon!
«Lundi. – Ma chère Dora est toujours très-abattue. – Violent mal de tête. – J'appelle son attention sur la beauté du poil de Jip. D. caresse J. – Associations d'idées qui ouvrent les écluses de la douleur. – Torrent de larmes. (Les larmes ne sont-elles pas la rosée du coeur? J. M.)
«Mardi. – Dora faible et agitée. – Belle dans sa pâleur. (Même remarque à faire pour la lune. J. M.) D. J. M. et J. sortent en voiture. J. met le nez hors de la portière, il aboie violemment contre un balayeur. – Un léger sourire paraît sur les lèvres de D. – (Voilà bien les faibles anneaux dont se compose la chaîne de la vie! J. M.)
«Mercredi. – D. gaie en comparaison des jours précédents. – Je lui ai chanté une mélodie touchante, Les cloches du soir, qui ne l'ont point calmée, bien au contraire. – D. émue au dernier point. – Je l'ai trouvée plus tard qui pleurait dans sa chambre; je lui ai cité des vers où je la comparais à une jeune gazelle. – Résultat médiocre. – Fait allusion à l'image de la patience sur un tombeau. (Question. Pourquoi sur un tombeau? J. M.)
«Jeudi. – D. mieux certainement. – Meilleure nuit. – Légère teinte rosée sur les joues. – Je me suis décidée à prononcer le nom de D. C. – Ce nom est encore insinué avec précaution, pendant la promenade. – D. immédiatement bouleversée. «Oh! chère, chère Julia! Oh! j'ai été un enfant désobéissant!» – Je l'apaise par mes caresses. – Je fais un tableau idéal de D. C. aux portes du tombeau. – D. de nouveau bouleversée. «Oh! que faire? que faire? Emmenez-moi quelque part!» – Grande alarme! – Évanouissement de D. – Verre d'eau apporté d'un café. (Ressemblance poétique. Une enseigne bigarrée sur la porte du café. La vie humaine aussi est bigarrée. Hélas! J. M.)
«Vendredi. – Jour plein d'événements. – Un homme se présente à la cuisine, porteur d'un sac bleu: il demande les brodequins qu'une dame a laissés pour qu'on les raccommode. La cuisinière répond qu'elle n'a pas reçu d'ordres. L'homme insiste. La cuisinière se retire pour demander ce qu'il en est; elle laisse l'homme seul avec Jip. Au retour de la cuisinière, l'homme insiste encore, puis il se retire. J. a disparu; D. est au désespoir. On fait avertir la police. L'homme a un gros nez, et les jambes en cerceau, comme les arches d'un pont. On cherche dans toutes les directions. Pas de J. – D. pleure amèrement; elle est inconsolable. – Nouvelle allusion à une jeune gazelle, à propos, mais sans effet. – Vers le soir, un jeune garçon inconnu se présente. On le fait entrer au salon. Il a un gros nez, mais pas les jambes en cerceau. Il demande une guinée, pour un chien qu'il a trouvé. Il refuse de s'expliquer plus clairement. D. lui donne la guinée; il emmène la cuisinière dans une petite maison, où elle trouva J. attaché au pied de la table. – Joie de D. qui danse tout autour de J. pendant qu'il mange son souper. – Enhardie par cet heureux changement, je parle de D. C. quand nous sommes au premier étage. D. se remet à sangloter. «Oh, non, non. C'est si mal de penser à autre chose qu'à mon papa!» Elle embrasse J. et s'endort en pleurant. (D. C. ne doit-il pas se confier aux vastes ailes du temps? J. M.)»
Miss Mills et son journal étaient alors ma seule consolation. Je n'avais d'autre ressource dans mon chagrin, que de la voir, elle qui venait de quitter Dora, de retrouver la lettre initiale du nom de Dora, à chaque ligne de ces pages pleines de sympathies, et d'augmenter encore par là ma douleur. Il me semblait que jusqu'alors j'avais vécu dans un château de cartes qui venait de s'écrouler, nous laissant miss Mills et moi au milieu des ruines! Il me semblait qu'un affreux magicien avait entouré la divinité de mon coeur d'un cercle magique, que les ailes du temps, ces ailes qui transportent si loin tant de créatures humaines, pourraient seules m'aider à franchir.
CHAPITRE IX
Wickfield-et-Heep
Ma tante commençant, je suppose, à s'inquiéter sérieusement de mon abattement prolongé, imagina de m'envoyer à Douvres, sous prétexte de voir si tout se passait bien dans son cottage qu'elle avait loué, et dans le but de renouveler le bail avec le locataire actuel. Jeannette était entrée au service de mistress Strong, où je la voyais tous les jours. Elle avait été indécise en quittant Douvres, si elle confirmerait ou renierait une bonne fois ce renoncement dédaigneux au sexe masculin, qui faisait le fond de son éducation. Il s'agissait pour elle d'épouser un pilote. Mais, ma foi! elle ne voulut pas s'y risquer, moins, pour l'honneur du principe en lui-même, je suppose, que parce que le pilote n'était pas de son goût.
Bien qu'il m'en coûtât de quitter miss Mills, j'entrai assez volontiers dans les intentions de ma tante; cela me permettait de passer quelques heures paisibles auprès d'Agnès. Je consultai le bon docteur pour savoir si je pouvais faire une absence de trois jours; il me conseilla de la prolonger un peu, mais j'avais le coeur trop à l'ouvrage pour prendre un si long congé. Enfin je me décidai à partir.
Quant à mon bureau des Doctors'-Commons, je n'avais pas grande raison de m'inquiéter de ce que je pouvais y avoir à faire. À vrai dire, nous n'étions pas en odeur de sainteté parmi les procureurs de première volée, et nous étions même tombés dans une position équivoque. Les affaires n'avaient pas été brillantes du temps de M. Jorkins, avant M. Spenlow, et bien qu'elles eussent été plus animées depuis que cet associé avait renouvelé, par une infusion de jeune sang, la vieille routine de l'étude, et qu'il lui eût donné quelque éclat par le train qu'il menait, cependant elle ne reposait pas sur des bases assez solides, pour que la mort soudaine de son principal directeur ne vint pas l'ébranler. Les affaires diminuèrent sensiblement. M. Jorkins, en dépit de la réputation qu'on lui faisait chez nous, était un homme faible et incapable, et sa réputation au dehors n'était pas de nature à relever son crédit. J'étais placé auprès de lui, depuis la mort de M. Spenlow, et chaque fois que je lui voyais prendre sa prise de tabac, et laisser là son travail, je regrettais plus que jamais les mille livres sterling de ma tante.
Ce n'était pas encore là le plus grand mal. Il y avait dans les Doctors'-Commons une quantité d'oisifs et de coulissiers qui, sans être procureurs eux-mêmes, s'emparaient d'une partie des affaires, pour les faire exécuter ensuite par de véritables procureurs disposés à prêter leurs noms en échange d'une part dans la curée. Comme il nous fallait des affaires à tout prix, nous nous associâmes à cette noble corporation de procureurs marrons, et nous cherchâmes à attirer chez nous les oisifs et les coulissiers. Ce que nous demandions surtout, parce que cela nous rapportait plus que le reste, c'étaient les autorisations de mariage ou les actes probatoires pour valider un testament; mais chacun voulait les avoir, et la concurrence était si grande, qu'on mettait en planton, à l'entrée de toutes les avenues qui conduisaient aux Commons, des forbans et des corsaires chargés d'amener à leurs bureaux respectifs toutes les personnes en deuil ou tous les jeunes gens qui avaient l'air embarrassés de leur personne. Ces instructions étaient si fidèlement exécutées, qu'il m'arriva par deux fois, avant que je fusse bien connu, d'être enlevé moi-même pour l'étude de notre rival le plus redoutable. Les intérêts contraires de ces recruteurs d'un nouveau genre étant de nature à mettre en jeu leur sensibilité, cela finissait souvent par des combats corps à corps, et notre principal agent, qui avait commencé par le commerce des vins en détail, avant de passer au brocantage judiciaire, donna même à la Cour le scandaleux spectacle, pendant quelques jours, d'un oeil au beurre noir. Ces vertueux personnages ne se faisaient pas le moindre scrupule quand ils offraient la main, pour descendre de sa voiture, à quelque vieille dame en noir, de tuer sur le coup le procureur qu'elle demandait, représentant leur patron comme le légitime successeur du défunt, et de lui amener en triomphe la vieille dame, souvent encore très-émue de la triste nouvelle qu'elle venait d'apprendre. C'est ainsi qu'on m'amena à moi-même bien des prisonniers. Quant aux autorisations de mariage, la concurrence était si formidable, qu'un pauvre monsieur timide, qui venait dans ce but de notre côté, n'avait rien de mieux à faire que de s'abandonner au premier agent qui venait à le happer, s'il ne voulait pas devenir le théâtre de la guerre et la proie du vainqueur. Un de nos commis, employé à cette spécialité, ne quittait jamais son chapeau quand il était assis, afin d'être toujours prêt à s'élancer sur les victimes qui se montraient à l'horizon. Ce système de persécution est encore en vigueur, à ce que je crois. La dernière fois que je me rendis aux Commons, un homme très-poli, revêtu d'un tablier blanc, me sauta dessus tout à coup, murmurant à mon oreille les mots sacramentels: «Une autorisation de mariage?» et ce fut à grand'peine que je l'empêchai de m'emporter à bras jusque dans une étude de procureur.
Mais après cette digression passons à Douvres.
Je trouvai tout dans un état très-satisfaisant, et je pus flatter les passions de ma tante en lui racontant que son locataire avait hérité de ses antipathies et faisait aux ânes une guerre acharnée. Je passai une nuit à Douvres pour terminer quelques petites affaires, puis je me rendis le lendemain matin de bonne heure à Canterbury. Nous étions en hiver; le temps frais et le vent piquant ranimèrent un peu mes esprits.
J'errai lentement au milieu des rues antiques de Canterbury avec un plaisir tranquille, qui me soulagea le coeur. J'y revoyais les enseignes, les noms, les figures que j'avais connus jadis. Il me semblait qu'il y avait si longtemps que j'avais été en pension dans cette ville, que je n'aurais pu comprendre qu'elle eût subi si peu de changements, si je n'avais songé que j'avais bien peu changé moi-même. Ce qui est étrange, c'est que l'influence douce et paisible qu'exerçait sur moi la pensée d'Agnès, semblait se répandre sur le lieu même qu'elle habitait. Je trouvais à toutes choses un air de sérénité, une apparence calme et pensive aux tours de la vénérable cathédrale comme aux vieux corbeaux dont les cris lugubres semblaient donner à ces bâtiments antiques quelque chose de plus solitaire que n'aurait pu le faire un silence absolu; aux portes en ruines, jadis décorées de statues, aujourd'hui renversées et réduites en poussière avec les pèlerins respectueux qui leur rendaient hommage, comme aux niches silencieuses où le lierre centenaire rampait jusqu'au toit le long des murailles pendantes aux vieilles maisons, comme au paysage champêtre; au verger comme au jardin: tout semblait porter en soi, comme Agnès, l'esprit de calme innocent, baume souverain d'une âme agitée.
Arrivé à la porte de M. Wickfield, je trouvai M. Micawber qui faisait courir sa plume avec la plus grande activité dans la petite pièce du rez-de-chaussée, où se tenait autrefois Uriah Heep. Il était tout de noir habillé, et sa massive personne remplissait complètement le petit bureau où il travaillait.
M. Micawber parut à la fois charmé et un peu embarrassé de me voir. Il voulait me mener immédiatement chez Uriah, mais je m'y refusai.
«Je connais cette maison de vieille date, lui dis-je, je saurai bien trouver mon chemin. Eh bien! qu'est-ce que vous dites du droit, M. Micawber?
– Mon cher Copperfield, me répondit-il, pour un homme doué d'une imagination transcendante, les études de droit ont un très-mauvais côté: elles le noient dans les détails. Même dans notre correspondance d'affaires, dit M. Micawber en jetant les yeux sur des lettres qu'il écrivait, l'esprit n'est pas libre de prendre un essor d'expression sublime qui puisse le satisfaire. Malgré ça, c'est un grand travail! un grand travail!»
Il me dit ensuite qu'il était devenu locataire de la vieille maison d'Uriah Heep, et que mistress Micawber serait ravie de me recevoir encore une fois sous son toit.
«C'est une humble demeure, dit M. Micawber, pour me servir d'une expression favorite de mon ami Heep; mais, peut être nous servira- t-elle de marchepied pour nous élever à des agencements domiciliaires plus ambitieux.»
Je lui demandai s'il était satisfait de la façon dont le traitait son ami Heep. Il commenta par s'assurer si la porte était bien fermée, puis il me répondit à voix basse:
«Mon cher Copperfield, quand on est sous le coup d'embarras pécuniaires, on est, vis-à-vis de la plupart des gens, dans une position très-fâcheuse, et ce qui n'améliore pas cette situation, c'est lorsque ces embarras pécuniaires vous obligent à demander vos émoluments avant leur échéance légale. Tout ce que je puis vous dire, c'est que mon ami Heep a répondu à des appels auxquels je ne veux pas faire plus ample allusion, d'une façon qui fait également honneur et à sa tête et à son coeur.
– Je ne le supposais pas si prodigue de son argent! remarquai-je.
– Pardonnez-moi! dit M. Micawber d'un air contraint, j'en parle par expérience.
– Je suis charmé que l'expérience vous ait si bien réussi, répondis-je.
– Vous êtes bien bon, mon cher Copperfield, dit M. Micawber, et il se mit à fredonner un air.
– Voyez-vous souvent M. Wickfield? demandai-je pour changer de sujet.
– Pas très-souvent, dit M. Micawber d'un air méprisant; M. Wickfield est à coup sûr rempli des meilleures intentions, mais… mais… Bref, il n'est plus bon à rien.
– J'ai peur que son associé ne fasse tout ce qu'il faut pour cela.
– Mon cher Copperfield! reprit M. Micawber après plusieurs évolutions qu'il exécutait sur son escabeau d'un air embarrassé. Permettez-moi de vous faire une observation. Je suis ici sur un pied d'intimité: j'occupe un poste de confiance; mes fonctions ne sauraient me permettre de discuter certains sujets, pas même avec mistress Micawber (elle qui a été si longtemps la compagne des vicissitudes de ma vie, et qui est une femme d'une lucidité d'intelligence remarquable). Je prendrai donc la liberté de vous faire observer que, dans nos rapports amicaux qui ne seront jamais troublés, j'espère, je désire faire deux parts. D'un côté, dit M. Micawber en traçant une ligne sur son pupitre, nous placerons tout ce que peut atteindre l'intelligence humaine, avec une seule petite exception; de l'autre, se trouvera cette seule exception, c'est-à-dire les affaires de MM. Wickfield-et-Heep et tout ce qui y a trait. J'ai la confiance que je n'offense pas le compagnon de ma jeunesse, en faisant à son jugement éclairé et discret une semblable proposition.»
Je voyais bien que M. Micawber avait changé d'allures; il semblait que ses nouveaux devoirs lui imposassent une gêne pénible, mais cependant je n'avais pas le droit de me sentir offensé. Il en parut soulagé et me tendit la main.
«Je suis enchanté de miss Wickfield, Copperfield, je vous le jure, dit M. Micawber. C'est une charmante jeune personne, pleine de charmes, de grâce et de vertu. Sur mon honneur, dit M. Micawber en faisant le salut le plus galant, comme pour envoyer un baiser, je rends hommage à miss Wickfield! Hum!
– J'en suis charmé, lui dis-je.
– Si vous ne nous aviez pas assuré, mon cher Copperfield, le jour où nous avons eu le plaisir de passer la matinée avec vous, que le D était votre lettre de prédilection, j'aurais été convaincu que c'était l'A que vous préfériez.»
Il y a des moments, tout le monde a passé par là, où ce que nous disons, ce que nous faisons, nous croyons l'avoir déjà dit, l'avoir déjà fait à une époque éloignée, il y a bien, bien longtemps; où nous nous rappelons que nous ayons été, il y a des siècles, entourés des mêmes personnes, des mêmes objets, des mêmes incidents; où nous savons parfaitement d'avance ce qu'on va nous dire après, comme si nous nous en souvenions tout à coup! Jamais je n'avais éprouvé plus vivement ce sentiment mystérieux, qu'avant d'entendre ces paroles de la bouche de M. Micawber.
Je le quittai bientôt en le priant de transmettre tous mes souvenirs à sa famille. Il reprit sa place et sa plume, se frotta le front comme pour se remettre à son travail; je voyais bien qu'il y avait dans ses nouvelles fonctions quelque chose qui nous empêcherait d'être désormais aussi intimes que par le passé.
Il n'y avait personne dans le vieux salon, mais mistress Heep y avait laissé des traces de son passage. J'ouvris la porte de la chambre d'Agnès: elle était assise près du feu et écrivait devant son vieux pupitre en bois sculpté.
Elle leva la tête pour voir qui venait d'entrer. Quel plaisir pour moi d'observer l'air joyeux que prit à ma vue ce visage réfléchi, et d'être reçu avec tant de bonté et d'affection!
«Ah! lui dis-je, Agnès, quand nous fumes assis à côté l'un de l'autre, vous m'avez bien manqué depuis quelque temps!
– Vraiment? répondit-elle. Il n'y a pourtant pas longtemps que vous nous avez quittés!»
Je secouai la tête.
«Je ne sais pas comment cela se fait, Agnès; mais il me manque évidemment quelque faculté que je voudrais avoir. Vous m'aviez si bien habitué à vous laisser penser pour moi dans le bon vieux temps; je venais si naturellement m'inspirer de vos conseils et chercher votre aide, que je crains vraiment d'avoir perdu l'usage d'une faculté dont je n'avais pas besoin près de vous.
– Mais qu'est-ce donc? dit gaiement Agnès.
– Je ne sais pas quel nom lui donner, répondis-je, je crois que je suis sérieux et persévérant!
– J'en suis sûre, dit Agnès.
– Et patient, Agnès? repris-je avec un peu d'hésitation.
– Oui, dit Agnès en riant, assez patient!
– Et cependant, dis-je, je suis quelquefois si malheureux et si agité, je suis si irrésolu et si incapable de prendre un parti, qu'évidemment il me manque, comment donc dire?.. qu'il me manque un point d'appui!
– Soit, dit Agnès.
– Tenez! repris-je, vous n'avez qu'à voir vous-même. Vous venez à Londres, je me laisse guider par vous; aussitôt je trouve un but et une direction. Ce but m'échappe, je viens ici, et en un instant je suis un autre homme. Les circonstances qui m'affligeaient n'ont pas changé, depuis que je suis entré dans cette chambre: mais, dans ce court espace de temps, j'ai subi une influence qui me transforme, qui me rend meilleur! Qu'est-ce donc, Agnès, quel est votre secret?»
Elle avait la tête penchée, les yeux fixés vers le feu.
«C'est toujours ma vieille histoire,» lui dis-je. Ne riez pas si je vous dis que c'est maintenant pour les grandes choses, comme c'était jadis pour les petites. Mes chagrins d'autrefois étaient des enfantillages, aujourd'hui ils sont sérieux; mais toutes les fois que j'ai quitté ma soeur adoptive…