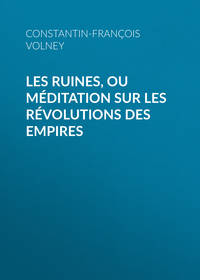Kitap dosya olarak indirilemez ancak uygulamamız üzerinden veya online olarak web sitemizden okunabilir.
Kitabı oku: «Les Ruines, ou méditation sur les révolutions des empires», sayfa 17
CHAPITRE VI.
De la tempérance
D. Qu'est-ce que la tempérance?
R. C'est un usage réglé de nos facultés, qui fait que nous n'excédons jamais, dans nos sensations, le but de la nature à nous conserver; c'est la modération des passions.
D. Quel est le vice contraire à la tempérance?
R. C'est le déréglement des passions, l'avidité de toutes les jouissances, en un mot: la cupidité.
D. Quelles sont les branches principales de la tempérance?
R. Ce sont la sobriété, la continence ou la chasteté.
D. Comment la loi naturelle prescrit-elle la sobriété?
R. Par son influence puissante sur notre santé. L'homme sobre digère avec bien-être; il n'est point accablé du poids des aliments; ses idées sont claires et faciles, il remplit bien toutes ses fonctions; il vaque avec intelligence à ses affaires; il vieillit exempt de maladies; il ne perd point son argent en remèdes, et il jouit avec allégresse des biens que le sort et sa prudence lui ont procurés. Ainsi, d'une seule vertu la nature généreuse tire mille récompenses.
D. Comment prohibe-t-elle la gourmandise?
R. Par les maux nombreux qui y sont attachés. Le gourmand, oppressé d'aliments, digère avec anxiété; sa tête troublée par les fumées de la digestion ne conçoit point d'idées nettes et claires; il se livre avec violence à des mouvements déréglés de luxure et de colère qui nuisent à sa santé; son corps devient gras, pesant et impropre au travail; il essuie des maladies douloureuses et dispendieuses; il vit rarement vieux, et sa vieillesse est remplie de dégoûts et d'infirmités.
D. Doit-on considérer l'abstinence et le jeûne comme des actions vertueuses?
R. Oui, lorsque l'on a trop mangé; car alors l'abstinence et le jeûne sont des remèdes efficaces et simples; mais lorsque le corps a besoin d'aliments, les lui refuser et le laisser souffrir de soif ou de faim, c'est un délire et un véritable péché contre la loi naturelle.
D. Comment cette loi considère-t-elle l'ivrognerie?
R. Comme le vice le plus vil et le plus pernicieux. L'ivrogne, privé du sens et de la raison que Dieu nous a donnés, profane le bienfait de la Divinité; il se ravale à la condition des brutes; incapable de guider même ses pas, il chancelle et tombe comme l'épileptique; il se blesse et peut même se tuer; sa faiblesse dans cet état le rend le jouet et le mépris de tout ce qui l'environne; il contracte dans l'ivresse des marchés ruineux, et il perd ses affaires; il lui échappe des propos outrageux qui lui suscitent des ennemis, des repentirs; il remplit sa maison de troubles, de chagrins, et finit par une mort précoce ou par une vieillesse cacochyme.
D. La loi naturelle interdit-elle absolument l'usage du vin?
R. Non: elle en défend seulement l'abus; mais comme de l'usage à l'abus le passage est facile et prompt pour le vulgaire, peut-être les législateurs qui ont proscrit l'usage du vin ont-ils rendu service à l'humanité.
D. La loi naturelle défend-elle l'usage de certaines viandes, de certains végétaux, à certains jours, dans certaines saisons?
R. Non: elle ne défend absolument que ce qui nuit à la santé; ses préceptes varient à cet égard comme les personnes, et ils composent même une science très-délicate et très-importante; car la qualité, la quantité, la combinaison des aliments, ont la plus grande influence, non-seulement sur les affections momentanées de l'ame, mais encore sur ses dispositions habituelles. Un homme n'est point, à jeun le même qu'après un repas, fût-il sobre. Un verre de liqueur, une tasse de café donnent des degrés divers de vivacité, de mobilité, de disposition à la colère, la tristesse ou à la gaieté; tel mets, parce qu'il pèse à l'estomac, rend morose et chagrin; et tel autre, parce qu'il se digère bien, donne de l'allégresse, du penchant à obliger, à aimer. L'usage des végétaux, parce qu'ils nourrissent peu, rend le corps faible, et porte vers le repos, la paresse, la douceur; l'usage des viandes, parce qu'elles nourrissent beaucoup, et des spiritueux, parce qu'ils stimulent les nerfs, donne de la vivacité, de l'inquiétude, de l'audace. Or de ces habitudes d'aliments résultent des habitudes de constitution et d'organes qui forment ensuite les tempéraments marqués chacun de leur caractère. Et voilà pourquoi, surtout dans les pays chauds, les législateurs ont fait des lois de régime. De longues expériences avaient appris aux anciens que la science diététique composait une grande partie de la science morale; chez les Égyptiens, chez les anciens Perses, chez les Grecs même, à l'aréopage, on ne traitait les affaires graves qu'à jeun; et l'on a remarqué que chez les peuples où l'on délibère dans la chaleur des repas ou dans les fumées de la digestion, les délibérations étaient fougueuses, turbulentes, et leurs résultats fréquemment déraisonnables et perturbateurs.
CHAPITRE VII.
De la continence
D. La loi naturelle prescrit-elle la continence?
R. Oui: parce que la modération dans l'usage de la plus vive de nos sensations est non-seulement utile, mais indispensable au maintien des forces et de la santé; et parce qu'un calcul simple prouve que, pour quelques minutes de privation, l'on se procure de longues journées de vigueur d'esprit et de corps.
D. Comment défend-elle le libertinage?
R. Par les maux nombreux qui en résultent pour l'existence physique et morale. L'homme qui s'y livre s'énerve, s'allanguit; il ne peut plus vaquer à ses études ou à ses travaux; il contracte des habitudes oiseuses, dispendieuses, qui portent atteinte à ses moyens de vivre, à sa considération publique, à son crédit: ses intrigues lui causent des embarras, des soucis, des querelles, des procès; sans compter les maladies graves et profondes, la perte de ses forces par un poison intérieur et lent, l'hébétude de son esprit par l'épuisement du genre nerveux, et enfin une vieillesse prématurée et infirme.
D. La loi naturelle considère-t-elle comme vertu cette chasteté absolue si recommandée dans les institutions monastiques?
R. Non; car cette chasteté n'est utile ni à la société où elle a lieu, ni à l'individu qui la pratique: elle est même nuisible à l'un et à l'autre. D'abord elle nuit à la société en ce qu'elle la prive de la population, qui est un de ses principaux moyens de richesse et de puissance; et de plus, en ce que les célibataires, bornant toutes leurs vues et leur affections au temps de leur vie, ont en général un égoïsme peu favorable aux intérêts généraux de la société.
En second lieu, elle nuit aux individus qui la pratiquent, par cela même qu'elle les dépouille d'une foule d'affections et de relations qui sont la source de la plupart des vertus domestiques et sociales; et de plus, il arrive souvent, par des circonstances d'âge, de régime, de tempérament, que la continence absolue nuit à la santé et cause de graves maladies, parce qu'elle contrarie les lois physiques sur lesquelles la nature a fondé le système de la reproduction des êtres: et ceux qui vantent si fort la chasteté, même en supposant qu'ils soient de bonne foi, sont en contradiction avec leur propre doctrine, qui consacre la loi de la nature par le commandement si connu: Croissez et multipliez.
D. Pourquoi la chasteté est-elle plus considérée comme vertu dans les femmes que dans les hommes?
R. Parce que le défaut de chasteté dans les femmes a des inconvénients bien plus graves et bien plus dangereux pour elles et pour la société; car, sans compter les chagrins et les maladies qui leur sont communs avec les hommes, elles sont encore exposées à toutes les incommodités qui précèdent, accompagnent et suivent l'état de maternité dont elles courent les risques. Que si cet état leur arrive hors des cas de la loi, elles deviennent un objet de scandale et de mépris public, et remplissent d'amertume et de trouble le reste de leur vie. De plus, elles demeurent chargées des frais d'entretien et d'éducation d'enfants dénués de pères; frais qui les appauvrissent et nuisent de toute manière à leur existence physique et morale. Dans cette situation, privées de la fraîcheur et de la santé qui font leurs appas, portant avec elles une surcharge étrangère et coûteuse, elles ne sont plus recherchées par les hommes, elles ne trouvent point d'établissement solide, elles tombent dans la pauvreté, la misère, l'avilissement, et traînent avec peine une vie malheureuse.
D. La loi naturelle descend-elle jusqu'au scrupule des désirs et des pensées?
R. Oui, parce que dans les lois physiques du corps humain, les pensées et les désirs allument les sens, et provoquent bientôt les actions: de plus, par une autre loi de la nature dans l'organisation de notre corps, ces actions deviennent un besoin machinal qui se répète par périodes de jours ou de semaines, en sorte qu'à telle époque renaît le besoin de telle action, de telle sécrétion; si cette action, cette sécrétion, sont nuisibles à la santé, leur habitude devient destructive de la vie même. Ainsi les désirs et les pensées ont une véritable importance naturelle.
D. Doit-on considérer la pudeur comme une vertu?
R. Oui, parce que la pudeur, n'étant que la honte de certaines actions, maintient l'ame et le corps dans toutes les habitudes utiles au bon ordre et à la conservation de soi-même. La femme pudique est estimée, recherchée, établie avec des avantages de fortune qui assurent son existence et la lui rendent agréable, tandis que l'impudente et la prostituée sont méprisées, repoussées et abandonnées à la misère et à l'avilissement.
CHAPITRE VIII.
Du courage et de l'activité
D. Le courage et la force de corps et d'esprit sont-ils des vertus dans la loi naturelle?
R. Oui, et des vertus très-importantes; car elles sont des moyens efficaces et indispensables de pourvoir à notre conservation et à notre bien-être. L'homme courageux et fort repousse l'oppression, défend sa vie, sa liberté, sa propriété; par son travail il se procure une subsistance abondante, et il en jouit avec tranquillité et paix d'ame. Que s'il lui arrive des malheurs dont n'ait pu le garantir sa prudence, il les supporte avec fermeté et résignation; et voilà pourquoi les anciens moralistes avaient compté la force et le courage au rang des quatre vertus principales.
D. Doit-on considérer la faiblesse et la lâcheté comme des vices?
R. Oui, puisqu'il est vrai qu'elles portent avec elles mille calamités. L'homme faible ou lâche vit dans des soucis, dans des angoisses perpétuelles; il mine sa santé par la terreur, souvent mal fondée d'attaques et de dangers; et cette terreur, qui est un mal, n'est pas un remède; elle le rend au contraire l'esclave de quiconque veut l'opprimer; par la servitude et l'avilissement de toutes ses facultés, elle dégrade et détériore ses moyens d'existence, jusqu'à voir dépendre sa vie des volontés et des caprices d'un autre homme.
D. Mais, d'après ce que vous avez dit de l'influence des aliments, le courage et la force, ainsi que plusieurs autres vertus, ne sont-ils pas en grande partie l'effet de notre constitution physique, de notre tempérament?
R. Oui, cela est vrai; à tel point que ces qualités se transmettent par la génération et le sang, avec les éléments dont elles dépendent: les faits les plus répétés et les plus constants prouvent que dans les races des animaux de toute espèce, l'on voit certaines qualités physiques et morales attachées à tous les individus de ces races, s'accroître ou diminuer selon les combinaisons et les mélanges qu'elles en font avec d'autres races.
D. Mais alors que notre volonté ne suffit plus à nous procurer ces qualités, est-ce un crime d'en être privés?
R. Non; ce n'est point un crime, c'est un malheur; c'est ce que les anciens appelaient une fatalité funeste; mais alors même, il dépend encore de nous de les acquérir; car, du moment que nous connaissons sur quels éléments physiques se fonde telle ou telle qualité, nous pouvons en préparer la naissance, en exciter les développements par un maniement habile de ces éléments; et voilà ce que fait la science de l'éducation, qui, selon qu'elle est dirigée, perfectionne ou détériore les individus ou les races, au point d'en changer totalement la nature et les inclinations; et c'est ce qui rend si importante la connaissance des lois naturelles par lesquelles se font avec certitude et nécessité ces opérations et ces changements.
D. Pourquoi dites-vous que l'activité est une vertu selon la loi naturelle?
R. Parce que l'homme qui travaille et emploie utilement son temps, en retire mille avantages précieux pour son existence. Est-il né pauvre, son travail fournit à sa subsistance; et si de plus il est sobre, continent, prudent, il acquiert bientôt de l'aisance, et il jouit des douceurs de la vie: son travail même lui donne ces vertus; car, tandis qu'il occupe son esprit et son corps, il n'est point affecté de désirs déréglés, il ne s'ennuie point, il contracte de douces habitudes, il augmente ses forces, sa santé, et parvient à une vieillesse paisible et heureuse.
D. La paresse et l'oisiveté sont donc des vices dans la loi naturelle?
R. Oui, et les plus pernicieux de tous les vices; car elles conduisent à tous les autres. Par la paresse et l'oisiveté, l'homme reste ignorant et perd même la science qu'il avait acquise: il tombe dans tous les malheurs qui accompagnent l'ignorance et la sottise; par la paresse et l'oisiveté, l'homme, dévoré d'ennuis, se livre, pour les dissiper, à tous les désirs de ses sens, qui, prenant de jour en jour plus d'empire, le rendent intempérant, gourmand, luxurieux, énervé, lâche, vil et méprisable. Par l'effet certain de tous ces vices, il ruine sa fortune, consume sa santé, et termine sa vie dans toutes les angoisses des maladies et de la pauvreté.
D. À vous entendre, il semblerait que la pauvreté fût un vice?
R. Non: elle n'est pas un vice, mais elle est encore moins une vertu; car elle est bien plus près de nuire que d'être utile: elle est même communément le résultat du vice, ou son commencement; car tous les vices individuels ont l'effet de conduire à l'indigence, à la privation des besoins de la vie; et quand un homme manque du nécessaire, il est bien près de se le procurer par des moyens vicieux, c'est-à-dire nuisibles à la société. Toutes les vertus individuelles, au contraire, tendent à procurer à l'homme une subsistance abondante; et quand il a plus qu'il ne consomme, il lui est bien plus facile de donner aux autres, et de pratiquer les actions utiles à la société.
D. Est-ce que vous regardez la richesse comme une vertu?
R. Non; mais elle est encore moins un vice; c'est son usage que l'on peut appeler vertueux ou vicieux, selon qu'il est utile ou nuisible à l'homme et à la société. La richesse est un instrument dont l'usage seul et l'emploi déterminent la vertu ou le vice.
CHAPITRE IX.
De la propreté
D. Pourquoi comptez-vous la propreté au rang des vertus?
R. Parce qu'elle en est réellement une des plus importantes, en ce qu'elle influe puissamment sur la santé du corps et sur sa conservation. La propreté, tant dans les vêtements que dans la maison, empêche les effets pernicieux de l'humidité, des mauvaises odeurs, des miasmes contagieux qui s'élèvent de toutes les choses abandonnées à la putréfaction: la propreté entretient la libre transpiration; elle renouvelle l'air, rafraîchit le sang, et porte l'allégresse même dans l'esprit.
Aussi voit-on que les personnes soigneuses de la propreté de leur corps et de leur habitation, sont en général plus saines, moins exposées aux maladies que celles qui vivent dans la crasse et dans l'ordure; et l'on remarque de plus, que la propreté entraîne avec elle, dans tout le régime domestique, des habitudes d'ordre et d'arrangement, qui sont l'un des premiers moyens et des premiers éléments du bonheur.
D. La malpropreté ou saleté est donc un vice véritable?
R. Oui, aussi véritable que l'ivrognerie, ou que l'oisiveté dont elle dérive en grande partie. La malpropreté est la cause seconde et souvent première d'une foule d'incommodités, même de maladies graves; il est constaté en médecine qu'elle n'engendre pas moins les dartres, la gale, la teigne, la lèpre, que l'usage des aliments corrompus ou âcres; qu'elle favorise les influences contagieuses de la peste, des fièvres malignes; qu'elle les suscite même dans les hôpitaux et dans les prisons; qu'elle occasione des rhumatismes en encroûtant la peau de crasse et s'opposant à la transpiration, sans compter la honteuse incommodité d'être dévoré d'insectes, qui sont l'apanage immonde de la misère et de l'avilissement.
Aussi la plupart des anciens législateurs avaient-ils fait de la propreté, sous le nom de pureté, l'un des dogmes essentiels de leurs religions: voilà pourquoi ils chassaient de la société et punissaient même corporellement ceux qui se laissaient atteindre des maladies qu'engendre la malpropreté; pourquoi ils avaient institué et consacré des cérémonies d'ablutions, de bains, de baptêmes, de purifications même par la flamme et par les fumées aromatiques de l'encens, de la myrrhe, du benjoin, etc; en sorte que tout le système des souillures, tous ces rites des choses mondes ou immondes, dégénérés depuis en abus et en préjugés, n'étaient fondés dans l'origine que sur l'observation judicieuse que des hommes sages et instruits avaient faite de l'extrême influence que la propreté du corps, dans les vêtements et l'habitation, exerce sur sa santé, et par une conséquence immédiate, sur celle de l'esprit et des facultés morales.
Ainsi, toutes les vertus individuelles ont pour but plus ou moins direct, plus ou moins prochain, la conservation de l'homme qui les pratique; et par la conservation de chaque homme, elles tendent à celle de la famille et de la société, qui se composent de la somme réunie des individus.
CHAPITRE X.
Des vertus domestiques
D. Qu'entendez-vous par vertus domestiques?
R. J'entends la pratique des actions utiles à la famille, censée vivre dans une même maison34.
D. Quelles sont ces vertus?
R. Ce sont l'économie, l'amour paternel, l'amour conjugal, l'amour filial, l'amour fraternel, et l'accomplissement des devoirs de maître et de serviteur.
D. Qu'est-ce que l'économie?
R. C'est, selon le sens le plus étendu du mot35, la bonne administration de tout ce qui concerne l'existence de la famille ou de la maison; et comme la subsistance y tient le premier rang, on a resserré le nom d'économie à l'emploi de l'argent aux premiers besoins de la vie.
D. Pourquoi l'économie est-elle une vertu?
R. Parce que l'homme qui ne fait aucune dépense inutile se trouve avoir un surabondant qui est la vraie richesse, et au moyen duquel il procure à lui et à sa famille tout ce qui est véritablement commode et utile; sans compter que par-là il s'assure des ressources contre les pertes accidentelles et imprévues, en sorte que lui et sa famille vivent dans une douce aisance, qui est la base de la félicité humaine.
D. La dissipation et la prodigalité sont donc des vices.
R. Oui; car par elles l'homme finit par manquer du nécessaire; il tombe dans la pauvreté, la misère, l'avilissement; et ses amis mêmes, craignant d'être obligés de lui restituer ce qu'il a dépensé avec eux ou pour eux, le fuient comme le débiteur fuit son créancier, et il reste abandonné de tout le monde.
D. Qu'est-ce que l'amour paternel?
R. C'est le soin assidu que prennent les parents, de faire contracter à leurs enfants l'habitude de toutes les actions utiles à eux et à la société.
D. En quoi la tendresse paternelle est-elle une vertu pour les parents?
R. En ce que les parents qui élèvent leurs enfants dans ces habitudes, se procurent pendant le cours de leur vie des jouissances et des secours qui se font sentir à chaque instant, et qu'ils assurent à leur vieillesse des appuis et des consolations contre les besoins et les calamités de tout genre qui assiègent cet âge.
D. L'amour paternel est-il une vertu commune?
R. Non; malgré que tous les parents en fassent ostentation, c'est une vertu rare; ils n'aiment pas leurs enfants, ils les caressent, et ils les gâtent; ce qu'ils aiment en eux, ce sont les agents de leurs volontés, les instruments de leur pouvoir, les trophées de leur vanité, les hochets de leur oisiveté: ce n'est pas tant l'utilité des enfants qu'ils se proposent, que leur soumission, leur obéissance; et si parmi les enfants on compte tant de bienfaités ingrats, c'est que parmi les parents il y a autant de bienfaiteurs despotes et ignorants.
D. Pourquoi dites-vous que l'amour conjugal est une vertu?
R. Parce que la concorde et l'union qui résultent de l'amour des époux établissent au sein de la famille une foule d'habitudes utiles à sa prospérité et à sa conservation. Les époux unis aiment leur maison, et ne la quittent que peu; ils en surveillent tous les détails et l'administration; ils s'appliquent à l'éducation de leurs enfants; ils maintiennent le respect et la fidélité des domestiques; ils empêchent tout désordre, toute dissipation; et, par toute leur bonne conduite, ils vivent dans l'aisance et la considération; tandis que les époux qui ne s'aiment point remplissent leur maison de querelles et de troubles, suscitent la guerre parmi les enfants et les domestiques; livrent les uns et les autres à toute espèce d'habitudes vicieuses: chacun dans la maison dissipe, pille, dérobe de son côté; les revenus s'absorbent sans fruit; les dettes surviennent; les époux mécontents se fuient, se font des procès; et toute cette famille tombe dans le désordre, la ruine, l'avilissement et le manque du nécessaire.
D. L'adultère est-il un délit dans la loi naturelle?
R. Oui; car il traîne avec lui une foule d'habitudes nuisibles aux époux et à la famille. La femme ou le mari, épris d'affections étrangères, négligent leur maison, la fuient, en détournent autant qu'ils peuvent les revenus pour les dépenser avec l'objet de leurs affections: de là les querelles, les scandales, les procès, le mépris des enfants et des domestiques, le pillage et la ruine finale de toute la maison; sans compter que la femme adultère commet un vol très-grave, en donnant à son mari des héritiers d'un sang étranger, qui frustrent de leur légitime portion les véritables enfants.
D. Qu'est-ce que l'amour filial?
R. C'est, de la part des enfants, la pratique des actions utiles à eux et à leurs parents.
D. Comment la loi naturelle prescrit-elle l'amour filial?
R. Par trois motifs principaux: 1º par sentiment, car les soins affectueux des parents inspirent dès le bas âge de douces habitudes d'attachement; 2º par justice, car les enfants doivent à leurs parents le retour et l'indemnité des soins et même des dépenses qu'ils leur ont causés; 3º par intérêt personnel, car s'ils les traitent mal, ils donnent à leurs propres enfants des exemples de révolte et d'ingratitude, qui les autorisent un jour à leur rendre la pareille.
D. Doit-on entendre par amour filial une soumission passive et aveugle?
R. Non, mais une soumission raisonnable, et fondée sur la connaissance des droits et des devoirs mutuels des pères et des enfants; droits et devoirs sans l'observation desquels leur conduite mutuelle n'est que désordre.
D. Pourquoi l'amour fraternel est-il une vertu?
R. Parce que la concordé et l'union, qui résultent de l'amour des frères, établissent la force, la sûreté, la conservation de la famille: les frères unis se défendent mutuellement de toute oppression; ils s'aident dans leurs besoins, se secourent dans leurs infortunes, et assurent ainsi leur commune existence; tandis que les frères désunis, abandonnés chacun à leurs forces personnelles, tombent dans tous les inconvénients de l'isolement et de la faiblesse individuelle. C'est ce qu'exprimait ingénieusement ce roi scythe, qui, au lit de la mort, ayant appelé ses enfants, leur ordonna de rompre un faisceau de flèches: les jeunes gens, quoique nerveux, ne l'ayant pu, il le prit à son tour, et l'ayant délié, il brisa du bout des doigts chaque flèche séparée. «Voilà, leur dit-il, les effets de l'union: unis en faisceau, vous serez invincibles; pris séparément, vous serez brisés comme des roseaux.»
D. Quels sont les devoirs réciproques des maîtres et des serviteurs?
R. C'est la pratique des actions qui leur sont respectivement et justement utiles; et là commencent les rapports de la société; car la règle et la mesure de ces actions respectives est l'équilibre ou l'égalité entre le service et la récompense, entre ce que l'un rend et ce que l'autre donne; ce qui est la base fondamentale de toute société.
Ainsi, toutes les vertus domestiques et individuelles se rapportent plus ou moins médiatement, mais toujours avec certitude, à l'objet physique de l'amélioration et de la conservation de l'homme, et sont par-là des préceptes résultants de la loi fondamentale de la nature dans sa formation.