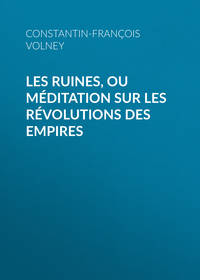Kitap dosya olarak indirilemez ancak uygulamamız üzerinden veya online olarak web sitemizden okunabilir.
Kitabı oku: «Les Ruines, ou méditation sur les révolutions des empires», sayfa 16
CHAPITRE II
Caractères de la loi naturelle
D. Quels sont les caractères de la loi naturelle?
R. On en peut compter dix principaux.
D. Quel est le premier?
R. C'est d'être inhérente à l'existence des choses, par conséquent, d'être primitive et antérieure à toute autre loi; en sorte que toutes celles qu'ont reçues les hommes n'en sont que des imitations, dont la perfection se mesure sur leur ressemblance avec ce modèle primordial.
D. Quel est le second?
R. C'est de venir immédiatement de Dieu, d'être présentée par lui à chaque homme, tandis que les autres ne nous sont présentées que par des hommes qui peuvent être trompés ou trompeurs.
D. Quel est le troisième?
R. C'est d'être commune à tous les temps, à tous les pays, c'est-à-dire, d'être une et universelle.
D. Est-ce qu'aucune autre loi n'est universelle?
R. Non, car aucune ne convient, aucune n'est applicable à tous les peuples de la terre; toutes sont locales et accidentelles, nées par des circonstances de lieux et de personnes; en sorte que si tel homme, tel événement n'eût pas existé, telle loi n'existerait pas.
D. Quel est le quatrième caractère?
R. C'est d'être uniforme et invariable.
D. Est-ce qu'aucune autre n'est uniforme et invariable?
R. Non; car ce qui est bien et vertu selon l'une, est mal et vice selon l'autre; et ce qu'une même loi approuve dans un temps, elle le condamne souvent dans un autre.
D. Quel est le cinquième caractère?
R. D'être évidente et palpable, parce qu'elle consiste tout entière en faits sans cesse présents aux sens et à la démonstration.
D. Est-ce que les autres lois ne sont pas évidentes?
R. Non; car elles se fondent sur des faits passés et douteux, sur des témoignages équivoques et suspects, et sur des preuves inaccessibles aux sens.
D. Quel est le sixième caractère?
R. D'être raisonnable, parce que ses préceptes et toute sa doctrine sont conformes à la raison et à l'entendement humain.
D. Est-ce qu'aucune autre loi n'est raisonnable?
R. Non; car toutes contrarient la raison et l'entendement de l'homme, et lui imposent avec tyrannie une croyance aveugle et impraticable.
D. Quel est le septième caractère?
R. D'être juste, parce que dans cette loi les peines sont proportionnées aux infractions.
D. Est-ce que les autres lois ne sont pas justes?
R. Non; car elles attachent souvent aux mérites ou aux délits des peines ou des récompenses démesurées, et elles imputent à mérite ou à délit des actions nulles ou indifférentes.
D. Quel est le huitième caractère?
R. D'être pacifique et tolérante, parce que, dans la loi naturelle, tous les hommes étant frères et égaux en droits, elle ne leur conseille à tous que paix et tolérance, même pour leurs erreurs.
D. Est-ce que les autres lois ne sont pas pacifiques?
R. Non; car toutes prêchent la dissension, la discorde, la guerre, et divisent les hommes par des prétentions exclusives de vérité et de domination.
D. Quel est le neuvième caractère?
R. D'être également bienfaisante pour tous les hommes, en leur enseignant à tous les véritables moyens d'être meilleurs et plus heureux.
D. Est-ce que les autres ne sont pas aussi bienfaisantes?
R. Non; car aucune n'enseigne les véritables moyens du bonheur: toutes se réduisent à des pratiques pernicieuses ou futiles, et les faits le prouvent, puisque après tant de lois, tant de religions, de législateurs et de prophètes, les hommes sont encore aussi malheureux et aussi ignorants qu'il y a six mille ans.
D. Quel est le dernier caractère de la loi naturelle?
R. C'est de suffire seule à rendre les hommes plus heureux et meilleurs, parce qu'elle embrasse tout ce que les autres lois civiles ou religieuses ont de bon ou d'utile, c'est-à-dire qu'elle en est essentiellement la partie morale; de manière que, si les autres lois étaient dépouillées, elles se trouveraient réduites à des opinions chimériques et imaginaires, sans aucune utilité pratique.
D. Résumez-moi tous ces caractères.
R. J'ai dit que la loi naturelle est,

Et telle est la puissance de tous ces attributs de perfection et de vérité, que, lorsqu'en leurs disputes les théologiens ne peuvent s'accorder sur aucun point de croyance, ils ont recours à la loi naturelle, dont l'oubli, disent-ils, a forcé Dieu d'envoyer de temps en temps des prophètes publier des lois nouvelles: comme si Dieu faisait des lois de circonstance, à la manière des hommes, surtout quand la première subsiste avec tant de force, qu'on peut dire qu'en tout temps et en tout pays, elle n'a cessé d'être la loi de conscience de tout homme raisonnable et sensé.
D. Si, comme vous le dites, elle émane immédiatement de Dieu, enseigne-t-elle son existence?
R. Oui, très-positivement; car pour tout homme qui observe avec réflexion le spectacle étonnant de l'univers, plus il médite sur les propriétés et les attributs de chaque être, sur l'ordre admirable et l'harmonie de leurs mouvements, plus il lui est démontré qu'il existe un agent suprême, un moteur universel et identique, désigné par le nom de Dieu; et il est si vrai que la loi naturelle suffit pour élever à la connaissance de Dieu, que tout ce que les hommes ont prétendu en connaître par des moyens étrangers, s'est constamment trouvé ridicule, absurde, et qu'ils ont été obligés d'en revenir aux immuables notions de la raison naturelle.
D. Il n'est donc pas vrai que les sectateurs de la loi naturelle soient athées?
R. Non, cela n'est pas vrai; au contraire, ils ont de la Divinité des idées plus fortes et plus nobles que la plupart des autres hommes; car ils ne la souillent point du mélange de toutes les faiblesses et de toutes les passions de l'humanité.
D. Quel est le culte qu'ils lui rendent?
R. Un culte tout entier d'action: la pratique et l'observation de toutes les règles que la suprême sagesse a imposées aux mouvements de chaque être; règles éternelles et inaltérables, par lesquelles elle maintient l'ordre et l'harmonie de l'univers, et qui, dans leurs rapports avec l'homme, composent la loi naturelle.
D. A-t-on connu avant ce jour la loi naturelle?
R. On en a de tout temps parlé: la plupart des législateurs ont dit la prendre pour base de leurs lois; mais ils n'en ont cité que quelques préceptes, et ils n'ont eu de sa totalité que des idées vagues.
D. Pourquoi cela?
R. Parce que, quoique simple dans ses bases, elle forme, dans ses développements et ses conséquences, un ensemble compliqué qui exige la connaissance de beaucoup de faits, et toute la sagacité du raisonnement.
D. Est-ce que l'instinct seul n'indique pas la loi naturelle?
R. Non; car par instinct l'on n'entend que ce sentiment aveugle qui porte indistinctement vers tout ce qui flatte les sens.
D. Pourquoi dit-on donc que la loi naturelle est gravée dans le cœur de tous les hommes?
R. On le dit par deux raisons: 1º parce que l'on a remarqué qu'il y avait des actes et des sentiments communs à tous les hommes, ce qui vient de leur commune organisation; 2º parce que les premiers philosophes ont cru que les hommes naissaient avec des idées déja formées, ce qui est maintenant démontré une erreur.
D. Les philosophes se trompent donc?
R. Oui, cela leur arrive.
D. Pourquoi cela?
R. Iº Parce qu'ils sont hommes; 2º parce que les ignorants appellent philosophes tous ceux qui raisonnent bien ou mal; 3º parce que ceux qui raisonnent sur beaucoup de choses, et qui en raisonnent les premiers, sont sujets à se tromper.
D. Si la loi naturelle n'est pas écrite, ne devient-elle pas une chose arbitraire et idéale?
R. Non; parce qu'elle consiste tout entière en faits dont la démonstration peut sans cesse se renouveler aux sens, et composer une science aussi précise et aussi exacte que la géométrie et les mathématiques; et c'est par la raison même que la loi naturelle forme une science exacte, que les hommes, nés ignorants et vivant distraits, ne l'ont connue, jusqu'à nos jours, que superficiellement.
CHAPITRE III.
Principes de la loi naturelle par rapport à l'homme
D. Développez-moi les principes de la loi naturelle par rapport à l'homme?
R. Ils sont simples; ils se réduisent à un précepte fondamental et unique.
D. Quel est ce précepte?
R. C'est la conservation de soi-même.
D. Est-ce que le bonheur n'est pas aussi un précepte de la loi naturelle?
R. Oui; mais comme le bonheur est un état accidentel qui n'a lieu que dans le développement des facultés de l'homme et du système social, il n'est point le but immédiat et direct de la nature; c'est, pour ainsi dire, un objet de luxe, surajouté à l'objet nécessaire et fondamental de la conservation.
D. Comment la nature ordonne-t-elle à l'homme de se conserver?
R. Par deux sensations puissantes et involontaires, qu'elle a attachées comme deux guides, deux génies gardiens à toutes ses actions: l'une, sensation de douleur, par laquelle elle l'avertit et le détourne de tout ce qui tend à le détruire; l'autre, sensation de plaisir, par laquelle elle l'attire et le porte vers tout ce qui tend à conserver et à développer son existence.
D. Le plaisir n'est donc pas un mal, un péché, comme le prétendent les casuistes?
R. Non: il ne l'est qu'autant qu'il tend à détruire la vie et la santé, qui, du propre aveu de ces casuistes, nous viennent de Dieu même.
D. Le plaisir est-il l'objet principal de notre existence, comme l'on dit quelques philosophes?
R. Non: il ne l'est pas plus que la douleur; le plaisir est un encouragement à vivre, comme la douleur est un repoussement à mourir.
D. Comment prouvez-vous cette assertion?
R. Par deux faits palpables: l'un, que le plaisir, s'il est pris au delà du besoin, conduit à la destruction; par exemple, un homme qui abuse du plaisir de manger ou de boire, attaque sa santé et nuit à sa vie. L'autre, que la douleur conduit quelquefois à la conservation; par exemple, un homme qui se fait couper un membre gangrené souffre de la douleur, et c'est afin de ne pas périr tout entier.
D. Mais cela même ne prouve-t-il pas que nos sensations peuvent nous tromper sur le but de notre conservation?
R. Oui: elles le peuvent momentanément.
D. Comment nos sensations nous trompent-elles?
R. De deux manières: par ignorance, et par passion.
D. Quand nous trompent-elles par ignorance?
R. Lorsque nous agissons sans connaître l'action et l'effet des objets sur nos sens; par exemple, lorsqu'un homme touche des orties sans connaître leur qualité piquante, ou lorsqu'il mâche de l'opium dont il ignore la qualité endormante.
D. Quand nous trompent-elles par passion?
R. Lorsque, connaissant l'action nuisible des objets, nous nous livrons cependant à la fougue de nos désirs et de nos appétits; par exemple, lorsqu'un homme qui sait que le vin enivre en boit avec excès.
D. Que résulte-t-il de là?
R. Il en résulte que l'ignorance dans laquelle nous naissons, et que les appétits déréglés auxquels nous nous livrons, sont contraires à notre conservation; que par conséquent l'instruction de notre esprit et la modération de nos passions sont deux obligations, deux lois qui dérivent immédiatement de la première loi de la conservation.
D. Mais si nous naissons ignorants, l'ignorance n'est-elle pas une loi naturelle?
R. Pas davantage que de rester enfants, nus et faibles. Loin d'être pour l'homme une loi de la nature, l'ignorance est un obstacle à la pratique de toutes ses lois. C'est le véritable péché originel.
D. Pourquoi donc s'est-il trouvé des moralistes qui l'ont regardée comme une vertu et une perfection?
R. Parce que par bizarrerie d'esprit, ou par misanthropie, ils ont confondu l'abus des connaissances avec les connaissances mêmes: comme si, parce que les hommes abusent de la parole, il fallait leur couper la langue: comme si la perfection et la vertu consistaient dans la nullité, et non dans le développement et le bon emploi de nos facultés.
D. L'instruction est donc une nécessité indispensable à l'existence de l'homme?
R. Oui: tellement indispensable, que sans elle il est à chaque instant frappé, et blessé par tous les êtres qui l'environnent; car, s'il ne connaît pas les effets du feu, il se brûle; ceux de l'eau, il se noie; ceux de l'opium, il s'empoisonne: si dans l'état sauvage il ne connaît pas les ruses des animaux et l'art de saisir le gibier, il périt de faim; si dans l'état social il ne connaît pas la marche des saisons, il ne peut ni labourer, ni s'alimenter; ainsi de toutes ses actions dans tous les besoins de sa conservation.
D. Mais toutes ces notions nécessaires à son existence et au développement de ses facultés, l'homme isolé peut-il se les procurer?
R. Non: il ne le peut qu'avec l'aide de ses semblables, que vivant en société.
D. Mais la société n'est-elle pas pour l'homme un état contre nature?
R. Non: elle est au contraire un besoin, une loi que la nature lui impose par le propre fait de son organisation; car, 1º la nature a tellement constitué l'être humain, qu'il ne voit point son semblable d'un autre sexe sans éprouver des émotions et un attrait dont les suites le conduisent à vivre en famille, qui déja est un état de société; 2º en le formant sensible, elle l'a organisé de manière que les sensations d'autrui se réfléchissent en lui-même, et y excitent des co-sentiments de plaisir, de douleur, qui sont un attrait et un lien indissoluble de la société, 3º enfin l'état de société, fondé sur les besoins de l'homme, n'est qu'un moyen de plus de remplir la loi de se conserver; et dire que cet état est hors de nature parce qu'il est plus parfait, c'est dire qu'un fruit amer et sauvage dans les bois, n'est plus le produit de la nature, alors qu'il est devenu doux et délicieux dans les jardins où on l'a cultivé.
D. Pourquoi donc les philosophes ont-ils appelé la vie sauvage l'état de perfection?
R. Parce que, comme je vous l'ai dit, le vulgaire a souvent donné le nom de philosophes à des esprits bizarres, qui, par morosité, par vanité blessée, par dégoût des vices de la société, se sont fait de l'état sauvage des idées chimériques, contradictoires à leur propre système de l'homme parfait.
D. Quel est le vrai sens de ce mot philosophe?
R. Le mot philosophe signifie amant de la sagesse: or, comme la sagesse consiste dans la pratique des lois naturelles, le vrai philosophe est celui qui connaît ces lois avec étendue et justesse, et qui y conforme toute sa conduite.
D. Qu'est-ce que l'homme dans l'état sauvage?
R. C'est un animal brut, ignorant, une bête méchante et féroce, à la manière des ours et des orang-outangs.
D. Est-il heureux dans cet état?
R. Non; car il n'a que les sensations du moment; et ces sensations sont habituellement celles de besoins violents qu'il ne peut remplir, attendu qu'il est ignorant par nature et faible par son isolement.
D. Est-il libre?
R. Non: il est le plus esclave des êtres; car sa vie dépend de tout ce qui l'entoure; il n'est pas libre de manger quand il a faim, de se reposer quand il est las, de se réchauffer quand il a froid; il court risque à chaque instant de périr: aussi la nature n'a-t-elle présenté que par hasard de tels individus; et l'on voit que tous les efforts de l'espèce humaine depuis son origine n'ont tendu qu'à sortir de cet état violent, par le besoin pressant de sa conservation.
D. Mais ce besoin de conservation ne produit-il pas dans les individus l'égoïsme, c'est-à-dire l'amour de soi? et l'égoïsme n'est-il pas contraire à l'état social?
R. Non; car, si par égoïsme vous entendez le penchant à nuire à autrui, ce n'est plus l'amour de soi, c'est la haine des autres. L'amour de soi, pris dans son vrai sens, non-seulement n'est pas contraire à la société, il en est le plus ferme appui, par la nécessité de ne pas nuire à autrui, de peur qu'en retour autrui ne nous nuise.
Ainsi la conversation de l'homme, et le développement de ses facultés dirigé vers ce but, sont la véritable loi de la nature dans la production de l'être humain; et c'est de ce principe simple et fécond que dérivent, c'est à lui que se rapportent, c'est sur lui que se mesurent toutes les idées de bien et de mal, de vice et de vertu, de juste ou d'injuste, de vérité ou d'erreur, de permis ou de défendu, qui fondent la morale de l'homme individu, ou de l'homme social.
CHAPITRE IV.
Bases de la morale; du bien, du mal, du péché, du crime, du vice et de la vertu
D. Qu'est-ce que le bien selon la loi naturelle?
R. C'est tout ce qui tend à conserver et perfectionner l'homme.
D. Qu'est-ce que le mal?
R. C'est tout ce qui tend à détruire et détériorer l'homme.
D. Qu'entend-on par mal et bien physique, mal et bien moral?
R. On entend par ce mot physique, tout ce qui agit immédiatement sur le corps. La santé est un bien physique; la maladie est un mal physique. Par moral, on entend ce qui n'agit que par des conséquences plus ou moins prochaines. La calomnie est un mal moral; la bonne réputation est un bien moral, parce que l'une et l'autre occasionent à notre égard des dispositions et des habitudes33 de la part des autres hommes, qui sont utiles ou nuisibles à notre conservation, et qui attaquent ou favorisent nos moyens d'existence.
D. Tout ce qui tend à conserver ou à produire est donc un bien?
R. Oui: et voilà pourquoi certains législateurs ont placé au rang des ouvres agréables à Dieu, la culture d'un champ et la fécondité d'une femme.
D. Tout ce qui tend à donner la mort est donc un mal?
R. Oui: et voilà pourquoi des législateurs ont étendu l'idée du mal et du péché jusque sur le meurtre des animaux.
D. Le meurtre d'un homme est donc un crime dans la loi naturelle?
R. Oui: et le plus grand que l'on puisse commettre; car tout autre mal peut se réparer, mais le meurtre ne se répare point.
D. Qu'est-ce qu'un péché dans la loi naturelle?
R. C'est tout ce qui tend à troubler l'ordre établi par la nature, pour la conservation et la perfection de l'homme et de la société.
D. L'intention peut-elle être un mérite ou un crime?
R. Non; car ce n'est qu'une idée sans réalité; mais elle est un commencement de péché et de mal, par la tendance qu'elle donne vers l'action.
D. Qu'est-ce que la vertu selon la loi naturelle?
R. C'est la pratique des actions utiles à l'individu et à la société.
D. Que signifie ce mot individu?
R. Il signifie un homme considéré isolement de tout autre.
D. Qu'est-ce que le vice selon la loi naturelle?
R. C'est la pratique des actions nuisibles à l'individu et à la société.
D. Est-ce que la vertu et le vice n'ont pas un objet purement spirituel et abstrait des sens?
R. Non: c'est toujours à un but physique qu'ils se rapportent en dernière analyse, et ce but est toujours de détruire ou de conserver le corps.
D. Le vice et la vertu ont-ils des degrés de force et d'intensité?
R. Oui: selon l'importance des facultés qu'ils attaquent ou qu'ils favorisent, et selon le nombre d'individus en qui ces facultés sont favorisées ou lésées.
D. Donnez-m'en des exemples?
R. L'action de sauver la vie d'un homme est plus vertueuse que celle de sauver son bien; l'action de sauver la vie de dix hommes l'est plus que de sauver la vie d'un seul; et l'action utile à tout le genre humain est plus vertueuse que l'action utile à une seule nation.
D. Comment la loi naturelle prescrit-elle la pratique du bien et de la vertu, et défend-elle celle du mal et du vice?
R. Par les avantages mêmes qui résultent de la pratique du bien et de la vertu pour la conservation de notre corps, et par les dommages qui résultent, pour notre existence, de la pratique du mal et du vice.
D. Ses préceptes sont donc dans l'action?
R. Oui: ils sont l'action même considérée dans son effet présent et dans ses conséquences futures.
D. Comment divisez-vous les vertus?
R. Nous les divisons en trois classes: 1º vertus individuelles ou relatives à l'homme seul; 2º vertus domestiques ou relatives à la famille; 3º et vertus sociales ou relatives à la société.
CHAPITRE V.
Des vertus individuelles
D. Quelles sont les vertus individuelles?
R. Elles sont au nombre de cinq principales, savoir:
1º La science, qui comprend la prudence et la sagesse;
2º La tempérance, qui comprend la sobriété et la chasteté;
3º Le courage, ou la force du corps et de l'ame;
4º L'activité, c'est-à-dire l'amour du travail et l'emploi du temps;
5º Enfin la propreté, ou pureté du corps, tant dans les vêtements que dans l'habitation.
D. Comment la loi naturelle prescrit-elle la science?
R. Par la raison que l'homme qui connaît les causes et les effets des choses, pourvoit d'une manière étendue et certaine à sa conservation et au développement de ses facultés. La science est pour lui l'œil et la lumière, qui lui font discerner avec justesse et clarté tous les objets au milieu desquels il se meut; et voilà pourquoi l'on dit un homme éclairé, pour désigner un homme savant et instruit. Avec la science et l'instruction on a sans cesse des ressources et des moyens de subsister; et voilà pourquoi un philosophe, qui avait fait naufrage, disait au milieu de ses compagnons qui se désolaient de la perte de leurs fonds: Pour moi, je porte tous mes fonds en moi.
D. Quel est le vice contraire à la science?
R. C'est l'ignorance.
D. Comment la loi naturelle défend-elle l'ignorance?
R. Par les graves détriments qui en résultent pour notre existence; car l'ignorant, qui ne connaît ni les causes ni les effets, commet à chaque instant les erreurs les plus pernicieuses à lui et aux autres; c'est un aveugle qui marche à tâtons, et qui, à chaque pas, est heurté ou heurte ses associés.
D. Quelle différence y a-t-il entre un ignorant et un sot?
R. La même différence qu'entre un aveugle de bonne foi et un aveugle qui prétend voir clair: la sottise est la réalité de l'ignorance, plus la vanité du savoir.
D. L'ignorance et la sottise sont-elles communes?
R. Oui, très-communes; ce sont les maladies habituelles et générales du genre humain: il y a trois mille ans que le plus sage des hommes disait: Le nombre des sots est infini; et le monde n'a point changé.
D. Pourquoi cela?
R. Parce que, pour être instruit, il faut beaucoup de travail et de temps, et que les hommes, nés ignorants et craignant la peine, trouvent plus commode de rester aveugles et de prétendre voir clair.
D. Quelle différence y a-t-il du savant au sage?
R. Le savant connaît, et le sage pratique.
D. Qu'est-ce que la prudence?
R. C'est la vue anticipée, la prévoyance des effets et des conséquences de chaque chose; prévoyance au moyen de laquelle l'homme évite les dangers qui le menacent, saisit et suscite les occasions qui lui sont favorables: d'où il résulte qu'il pourvoit à sa conservation pour le présent et pour l'avenir d'une manière étendue et sûre, tandis que l'imprudent qui ne calcule ni ses pas, ni sa conduite, ni les efforts, ni les résistances, tombe à chaque instant dans mille embarras, mille périls, qui détruisent plus ou moins lentement ses facultés et son existence.
D. Lorsque l'Évangile appelle bienheureux les pauvres d'esprit, entend-il parler des ignorants et des imprudents?
D. Non; car, en même temps qu'il conseille la simplicité des colombes, il ajoute la prudente finesse des serpents. Par simplicité d'esprit on entend la droiture, et le précepte de l'Évangile n'est que celui de la nature.