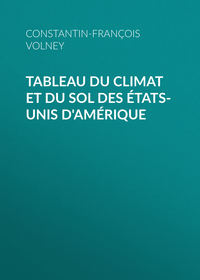Kitap dosya olarak indirilemez ancak uygulamamız üzerinden veya online olarak web sitemizden okunabilir.
Kitabı oku: «Tableau du climat et du sol des États-Unis d'Amérique», sayfa 19
ARTICLE V. OBSERVATIONS GÉNÉRALES SUR LES INDIENS 160 OU SAUVAGES DE L’AMÉRIQUE-NORD,
Suivies d’un vocabulaire de la langue des Miâmis, tribu établie sur la Wabash.
MON séjour au Poste-Vincennes me fournit l’occasion d’observer les Sauvages, que j’y trouvai rassemblés pour vendre le produit de leur chasse rouge161; on portait leur nombre à quatre ou cinq cents têtes de tout âge, de tout sexe, et de diverses nations ou tribus, telles que les Ouyas, les Péouryas, les Sakis, les Piankichas, les Miâmis, etc., tous vivant sur la haute Wabash. C’était la première fois que je voyais à loisir cette espèce d’hommes déja devenue rare à l’est des Alleghanys: leur aspect fut pour moi un spectacle nouveau et bizarre. Imaginez des corps presque nus, bronzés par le soleil et le grand air, reluisants de graisse et de fumée; la tête nue, de gros cheveux noirs, lisses, droits et plats; le visage masqué de noir, de bleu et de rouge, par compartimens ronds, carrés, losanges; une narine percée pour porter un gros anneau de cuivre ou d’argent; des pendeloques à trois étages tombant des oreilles sur les épaules, par des trous à passer le doigt; un petit tablier carré couvrant le pubis, un autre couvrant le coccyx, tous deux attachés par une ceinture de ruban ou de corde; les cuisses et les jambes tantôt nues, tantôt garnies d’une longue guêtre d’étoffe162; un chausson de peau fumée aux pieds; dans certains cas, une chemise à manches larges et courtes, bariolée ou chinée de bleu, de blanc, flottante sur les cuisses; par dessus elle une couverture de laine ou un morceau de drap carré jeté sur une épaule, et noué sous le menton ou sous l’autre aisselle: s’il y a prétention de parure pour guerre ou pour fête, les cheveux sont tressés, et les tresses garnies de plumes, d’herbes, de fleurs, même d’osselets: les guerriers portent autour de l’avant-bras de larges colliers de cuivre ou d’argent, ressemblants aux colliers de nos chiens, et autour de la tête des diadèmes formés de boucles d’argent et de verroterie: à la main, la pipe ou le couteau, ou le casse-tête, et le petit miroir de toilette dont tout sauvage use avec plus de coquetterie pour admirer tant de charmes, que la plus coquette petite-maîtresse de Paris. Les femmes, un peu plus couvertes sur les hanches, diffèrent encore des hommes, en ce qu’elles portent, presque sans cesse, un ou deux enfants sur le dos, dans une espèce de sac, dont les bouts se nouent sur leur front. Qui a vu des bohémiennes et des bohémiens a des idées très-rapprochées de cet attirail.
Telle est l’esquisse du tableau, et je le montre du beau côté. Car si l’on veut le voir tout entier, il faut que j’ajoute que, dès le matin, hommes et femmes vaguaient dans les rues avec le but unique de se procurer de l’eau-de-vie; que vendant d’abord les peaux de leur chasse, puis leurs bijoux, puis leurs vêtements, ils quêtaient ensuite comme des mendiants, ne cessant de boire jusqu’à perte absolue de facultés. Tantôt c’étaient des scènes burlesques, comme de tenir la tasse à deux mains pour y boire à la manière des singes; puis de relever la tête avec des éclats de joie, et de se gargariser de la liqueur délicieuse et funeste; de se passer le vase de l’un à l’autre avec de bruyantes invitations; de s’appeler à tue tête, quoiqu’à trois pas seulement de distance; de prendre leurs femmes par la tête et de leur verser de l’eau-de-vie dans la gorge avec de grossières caresses, et tous les gestes ridicules de nos ivrognes de place. Tantôt succédaient des scènes affligeantes, comme de perdre finalement tout sens, toute raison; de devenir furieux et stupides, de tomber ivres-morts dans la poussière ou dans la boue, pour y dormir jusqu’au lendemain. Je ne sortais pas le matin sans les trouver par douzaines dans les rues et chemins autour du village, vautrés littéralement avec les porcs. Heureux si, chaque jour, il n’arrivait pas des querelles et des batteries à coups de couteaux ou de casse-têtes qui, année commune, produisent dix meurtres. Le 9 août, quatre heures du soir, à vingt pas de moi, un sauvage poignarda sa femme de quatre coups de couteau. Quinze jours auparavant, même accident était arrivé, et cinq semblables l’année précédente. De là des vengeances immédiates ou dissimulées des parents et de la famille, causes renaissantes d’assassinats et de guet-apens. J’avais d’abord eu l’intention d’aller vivre quelques mois avec eux et chez eux pour les étudier, comme je l’ai pratiqué envers les Arabes bedouins; mais lorsque j’eus vu ces échantillons de leurs mœurs domestiques; lorsque divers habitants du Poste, qui leur servent d’aubergistes, et vont traiter parmi eux, m’eurent attesté que le droit d’hospitalité n’existait point chez eux comme chez les Arabes; qu’ils n’avaient ni subordination ni gouvernement; que le plus grand chef de guerre ne pouvait, même en campagne, frapper ni punir un guerrier, et qu’au village il n’était pas obéi par un autre enfant que le sien; que dans ces villages ils vivaient isolés, pleins de méfiances, de jalousies, d’embûches secrètes, de vindettes implacables; qu’en un mot leur état social était celui de l’anarchie et d’une nature féroce et brute, où le besoin et la force constituent le droit et la loi; que d’ailleurs, ne faisant point de provisions, un étranger était exposé à manquer de tout nécessaire, de toute ressource; je sentis la nécessité de renoncer à mon projet. Mon plus vif regret fut de ne pas acquérir quelques notions sur leur langage, et de n’en pouvoir obtenir un vocabulaire; livre dont j’ai indiqué ailleurs163 l’importance chez les peuples qui n’ont pas d’autres monumens. Le missionnaire dont j’ai parlé, M. l’abbé R...., ne me laissa aucun espoir à cet égard. Lui-même avait fait des tentatives et avait rencontré des obstacles insurmontables: encore que plusieurs habitants du Poste entendissent la langue de quelques tribus, leur prononciation était si défectueuse, ils avaient si peu d’idées d’aucune règle de grammaire, qu’il lui fut impossible d’en tirer parti. Il m’en convainquit dans une conférence que voulut avoir avec moi un chef des Ouyas, ancien et constant ami des Français. Nous ne pûmes jamais astreindre l’interprète canadien à traduire littéralement, et phrase à phrase.—Il résulta, de toutes mes informations sur cette matière, que la personne la plus capable et presque la seule capable de remplir mes vues était un Américain nommé M. Wels, qui, enlevé par les sauvages à l’âge de treize ans, et adopté par eux, avait appris plusieurs de leurs dialectes avec les moyens que lui donnait une bonne éducation assez avancée. Depuis que les sauvages avaient été battus et soumis par le général Wayne (août 1794), M. Wels avait eu la faculté de rentrer dans son pays natal: il servait dans ce moment d’interprète au général Wayne, qui concluait, au fort Détroit, un traité définitif avec plus de sept cents sauvages réunis en grand conseil. Tout cela s’accordait fort bien avec mon projet de me rendre par le lac Érié à Niagara: je retournai donc sur mes pas à Louisville, traversai le Kentucky par Francfort, sa capitale, par Lexington, qui n’avait pas une maison en 1782, et qui en a près de cinq cents, la plupart en briques, bien bâties; de là je me rendis à Cincinnati, où, profitant d’un convoi d’argent qui se rendait à Détroit, je pus commodément, grâce au major Swan, suivre la route militaire que venait de tracer l’armée du général Wayne à travers une forêt de cent lieues, où nous ne trouvâmes de gîtes que cinq forts palissadés nouvellement construits. L’accueil que me fit ce général me donna lieu de croire que j’avais atteint mon but au delà de mon espoir; mais le tribut que je payai aux fièvres du pays et de la saison me priva de tous mes avantages. Il fallut me résoudre à profiter d’un vaisseau unique pour passer le lac avant l’hiver, et revenir à Philadelphie. La fortune capricieuse m’y attendait pour m’y satisfaire à moins de frais: elle y amena, l’hiver suivant (1797-98), M. Wels, accompagnant un chef de guerre des Miâmis, célèbre chez les sauvages sous son nom de Michikinakoua, et chez les Anglo-Américains sous celui de Petite-Tortue, qui en est la traduction. Il fut l’un de ceux qui contribuèrent le plus à la défaite du général Saint-Clair en 1791; et si l’on eût suivi son plan de ne combattre le général Wayne qu’en interceptant ses convois, il eût également détruit cette armée, ainsi que je l’ai entendu exprimer à des officiers d’un mérite et d’un grade distingués. Après avoir été un ennemi redoutable aux États-Unis, Petite-Tortue, convaincu de l’impuissance finale de leur résister, a eu le bon esprit de porter sa tribu à une capitulation raisonnable: par un degré d’intelligence plus remarquable, il a senti la nécessité de la faire vivre d’agriculture au lieu de chasse et de pêche comme vivent les sauvages. C’était dans ce dessein qu’il venait à Philadelphie solliciter le congrès et la bienfaisante société des Amis164, de lui procurer les moyens d’exécuter cette louable entreprise. Il avait d’ailleurs été inoculé de la petite-vérole dès son arrivée, et il demandait à la médecine, contre la goutte et les rhumatismes dont il était attaqué, des secours que le gouvernement s’empressa de lui procurer. Cet incident me présenta une occasion plus heureuse que je ne l’avais espérée, en m’offrant non-seulement une bouche interprète pour communiquer mes idées, mais encore une bouche indigène pour me fournir les sons dans toute leur pureté. Je me fis donc introduire auprès de M. Wels et du chef sauvage; je leur expliquai mon plan avec ses motifs; et ayant obtenu leur agrément, j’employai neuf à dix séances, dont je pus jouir dans les mois de janvier et de février 1798, à dresser le vocabulaire que je publie: il fut la base de mon travail; mais par épisodes de conversation, il s’y mêla beaucoup de notes curieuses que je recueillis avec d’autant plus de soin, que les faits, venant sans préparation, étaient par cela même moins suspects d’altération, et que l’habitude de me voir, jointe à ma qualité de Français, diminua dans Petite-Tortue cet esprit de méfiance et de soupçon que portent les sauvages dans tous leurs discours. Chaque jour, après notre séance, j’écrivis ce qui m’avait paru le plus intéressant; et ce sont ces observations qui, réunies à celles que dans mes voyages j’avais recueillies des témoins les plus judicieux, forment aujourd’hui le texte que j’ai mis en ordre. Mon dessein n’est pas et n’a pu être de traiter généralement des sauvages: un tel plan serait d’une trop vaste étendue, puisqu’il existe une très-grande différence de genre de vie, d’habitudes et de mœurs, entre les sauvages de divers climats, des pays chauds ou des pays froids, boisés ou découverts, féconds ou stériles, arides ou baignés d’eau. Je me borne uniquement aux sauvages de l’Amérique du nord, avec l’intention de fournir, dans cette question obscurcie par des paradoxes, le contingent de mon témoignage sur ce que j’y ai vu et reconnu de plus certain et de mieux prouvé en faits. Je suppose même que mon lecteur n’est point novice en cette matière, et qu’il a lu les relations des voyageurs qui, depuis quarante ans, ont visité et décrit ces contrées165.
Notre premier entretien débuta par des renseignements sur le climat et le sol des Miâmis. M. Wels me dit que cette tribu vivait sur les branches nord de la Wabash, que son langage se parlait chez toutes les peuplades répandues le long de cette rivière jusque vers le lac de Michigan; telles que les Ouyas, Péouryas, Piankichas, Poteouatamis, Kaskaskias, et les Indiens de la longue île; qu’il a beaucoup d’affinité avec celui des Chipéwas, des Outaouas, des Chaûnis, qui ne diffèrent que comme dialectes; mais il est tout-à-fait distinct du Delaouaise; le son nasal est fréquent dans le Miâmi, et je crus à la première fois entendre du turc. M. Wels m’ajouta que leur pays était partie boisé, partie en prairies, et sensiblement plus froid que le Poste-Vincennes. Ayant quitté ce dernier lieu après un dégel complet, il avait retrouvé la même neige 50 lieues plus nord, sans avoir remarqué d’élévation montueuse dans le terrain. L’air à Philadelphie lui semblait moins piquant. Les vents régnants aux Miâmis sont presque les mêmes qu’à la côte atlantique; en hiver nord-ouest rapide, clair et tranchant; rare et doux en été. Alors domine le sud-ouest chaud, nuageux, quelquefois orageux. Le sud est le grand pluvieux; le nord, le grand neigeux en hiver, mais en été clair et doux. Le sud est rare; le nord encore plus. Le sol est fertile, le maïs plus beau, la chasse plus abondante que sur toute la côte atlantique. Aussi les naturels, surtout les Poteouatamis, sont-ils une race grande et belle (et moi-même j’en puis dire autant des Chaûnis du fort Miâmi, dont les femmes m’ont étonné par leur taille, mais nullement par leur beauté).
Pendant ce temps j’avais observé Petite-Tortue, qui faute d’entendre l’anglais ne prenait point part à l’entretien; il se promenait en s’épilant les poils de la barbe, et même des sourcils; il était vêtu à l’américaine, en habit bleu, pantalon, et chapeau rond. Je lui fis demander comment il se trouvait de cet habillement si différent au sien: «L’on est d’abord gêné, dit-il; puis l’habitude vient, et comme cela garantit du froid et du chaud, on le trouve bon.» Il avait retroussé ses manches; je fus frappé de la blancheur de sa peau entre le pli du coude et le poignet. J’y comparai la mienne; elle n’en différait point. Le hâle avait bruni le dessus de mes mains autant que les siennes, et nous paraissions tous deux avoir une paire de gants. Je trouvai sa peau très-douce au toucher; en tout, la peau d’un Parisien. Alors s’engagea entre nous une longue discussion sur la couleur des sauvages; cette couleur dite de cuivre rouge, que l’on prétend leur être innée comme le noir aux Africains, et les constituer une race distincte. Les faits résultants de cette discussion furent «que les sauvages se désignent eux-mêmes par le nom d’hommes rouges; qu’ils estiment, comme de raison, leur couleur plus que le blanc; que cependant ils naissent blancs comme nous166; que dans l’enfance ils sont tels167 jusqu’à ce qu’ils aient été brunis par le soleil et par les graisses et les sucs d’herbes dont ils s’oignent; que les femmes même ont toujours blanche la portion de la ceinture, des hanches et des cuisses qui ne cesse pas d’être couverte de vêtements; en un mot, qu’il est radicalement faux que cette couleur, prétendue cuivrée, soit innée, ni qu’elle soit la même pour tous les indigènes de l’Amérique du nord; qu’au contraire elle varie de nation à nation, et qu’elle est un de leurs moyens de se reconnaître.»
J’observai que M. Wels, qui vit depuis quinze années chez eux et comme eux, avait leur teint et non celui des Américains; et quant à la vraie nuance de ce teint, elle m’a paru couleur de suie ou de jambon fumé, nettoyé et luisant, parfaitement semblable au teint de nos paysans de la Loire et du Bas-Poitou, qui, comme les sauvages, vivent d’un air chaud et un peu marécageux; semblable encore au teint des Espagnols andalous. Sur cette remarque que je communiquai, Petite-Tortue répondit: «J’ai vu des Espagnols de Louisiane, et n’ai trouvé entre eux et moi aucune différence de couleur; pourquoi y en aurait-il? Chez eux comme chez nous, elle est l’ouvrage du père des couleurs, le soleil qui nous brûle. Vous mêmes, blancs, comparez la peau de votre visage à celle de votre corps.» Et cela me rappela qu’au retour de Turkie, quand je quittai le turban, une moitié de mon front au-dessus des sourcils était presque bronzée, tandis que l’autre près des cheveux était blanche comme le papier. Si, comme la physique le démontre, il n’y a de couleur que par la lumière, il est évident que les diverses couleurs des peuples ne sont dues qu’à diverses modifications de ce fluide avec d’autres éléments qui agissent sur notre peau, et qui même la composent. Tôt ou tard il sera démontré que le noir des Africains n’a pas d’autre origine168.
Les traits de Petite-Tortue me frappèrent par leur ressemblance avec ceux de cinq Tartares chinois qui étaient venus à Philadelphie, à la suite de l’ex-ambassadeur hollandais Vanbraam. Cette ressemblance des Tartares avec les sauvages de l’Amérique du nord a frappé tous ceux qui ont vu les uns et les autres; mais peut-être s’est-on trop pressé d’en induire que ceux-ci sont originaires d’Asie. Comme les sauvages ont des idées de géographie, je communiquai à Petite-Tortue nos systèmes sur cette question; et pour les lui faire mieux entendre, je lui portai une mappemonde comprenant la partie orientale d’Asie et le nord-ouest d’Amérique. Il reconnut fort bien les lacs du Canada, Michigan, supérieur, et les fleuves Ohio, Wabash, Mississipi, etc.; il examina le reste avec une curiosité qui me prouva la nouveauté du sujet pour lui. Mais l’astuce d’un sauvage est de ne jamais marquer de surprise. Quand je lui eus expliqué les moyens de communication par le détroit de Baring et par les îles Aléutiennes, «Pourquoi, me dit-il, ces Tartares qui nous ressemblent ne seraient-ils pas venus d’Amérique? y a-t-il des preuves du contraire? ou bien pourquoi ne serions-nous pas nés chacun chez nous?» Et en effet, ils se donnent une épithète qui signifie né du sol169 (Metoktheniaké). Je n’y vois pas d’objection, lui dis-je; mais nos robes noires ne veulent-pas le permettre170. Il y a seulement la difficulté d’imaginer comment les races quelconques ont commencé. Il me semble, dit-il en souriant, que c’est tout aussi obscur pour les robes noires que pour nous.
J’ai dit que ces sauvages d’Amérique ressemblent aux Tartares; mais pour que cette assertion ait toute sa précision, il est nécessaire d’y faire une exception; car les Eskimaux qui habitent le nord vers la mer Glaciale, ne sont point Tartares; et la race d’hommes aux yeux gris qui peuplent l’archipel de Noutka-Sund et tous les rivages adjacents, sont également une race distincte. C’est à celle qui habite le reste du continent et qui forme l’immense majorité, qu’appartient le caractère tartare; et ici je mets encore les Kalmouks à part, car les sauvages n’ont pas, comme eux, le nez écrasé, ni toute la face aplatie. En général, leurs traits sont, un visage triangulaire par le bas et presque carré par le haut; le front bien pris; les yeux très-noirs, enfoncés, vifs, plutôt petits que grands; les pommes des joues un peu saillantes; le nez droit; les lèvres plutôt fines qu’épaisses; les cheveux noirs-jais, lisses, plats, sans aucun exemple d’un blond; le regard soupçonneux et décelant un fonds de férocité. Telle est en général leur physionomie, qui se modifie ensuite selon les peuplades et les individus. Au Poste-Vincennes et au Détroit, je remarquai beaucoup de leurs figures, qui me rappelèrent celles des Fellahs d’Égypte, et même de plusieurs Bedouins: outre la couleur de la peau, la qualité des cheveux et plusieurs autres traits, ils ont cela de commun avec les uns et les autres, que la bouche est taillée en requin, c’est-à-dire, les côtés plus abaissés que le devant, et que les dents, petites, blanches, et très-bien rangées, sont aiguës et tranchantes comme celles des chats et des tigres171. La raison naturelle de ces formes ne serait-elle pas leur habitude de mordre à plein morceau, sans jamais user de couteau? Cette habitude donne évidemment aux muscles une attitude qu’ils finissent par retenir, et cette attitude finit aussi par modifier les solides. En partant de cette idée, la ressemblance des traits entre des peuples, surtout sauvages, très-distants, n’est pas une preuve d’origine ou de parenté, aussi certaine qu’on veut le dire; car il pourrait très-bien arriver que ce fût l’analogie des influences du climat, du sol, des aliments, des habitudes, en un mot, de tout le régime qui fût la cause de la ressemblance des corps et des physionomies. Je ne dis rien de leurs femmes, parce que leurs traits ne m’ont point paru différents. Je ne m’oppose point d’ailleurs à ce qu’il y en ait de jolies, comme le prétendent quelques voyageurs. En voyage, l’appétit donne souvent du goût à des mets que l’on trouverait insipides ailleurs. Je dirai très-peu de chose aussi de l’usage qu’a la tribu des Chactâs, de donner au crâne des enfants nouvellement nés la forme d’une pyramide tronquée, en pressant leur tête encore molle avec un moule fait de petites planchettes: cette bizarre pratique est si efficace, que la nation entière est reconnue à sa tête plate, qui est devenue son épithète.
Quelques écrivains même de mérite ont prétendu que tous les sauvages se ressemblaient si fort, que l’on avait peine à les distinguer les uns des autres. Sûrement ces écrivains diraient aussi que tous les nègres et tous les moutons se ressemblent; mais cela prouve seulement qu’ils n’y ont pas regardé de si près que le berger et le marchand d’esclaves. «De nation à nation, me dit Petite-Tortue, nous nous reconnaissons au premier coup-d’œil: le visage, la couleur, la taille, les genoux, les jambes, les pieds sont pour nous des indices certains; la piste distingue non-seulement les hommes, les femmes et les enfants, mais encore les peuplades. Vous autres blancs, vous êtes frappants avec vos pieds en dehors: nous les portons tout droits pour trouver moins d’obstacles dans les broussailles. Quelques peuples les portent plus en dedans, ont le pied plus large, plus court, appuient plus du talon, ou de l’orteil, etc».
Ce sont sans doute les mêmes écrivains, ou de semblables, qui ont accrédité dans le monde l’erreur que les sauvages n’ont point de barbe: il est vrai qu’ils n’en montrent point; mais c’est parce qu’ils prennent un soin particulier, continuel, presque superstitieux, de se l’arracher et de s’épiler tout le corps. C’est le témoignage unanime de tous les voyageurs qui les ont bien observés, tels que Bernard Romans, Carver, Jean Long, Umfreville, etc.: l’auteur du British-Empire qui, en 1707, écrivait sur la foi des meilleurs témoignages, Oldmixon dit, tom. I, pag. 286: «Les Indiens n’ont point de barbe, parce que pour l’extirper ils usent de certaines recettes qu’ils ne veulent pas communiquer.» L’expérience a fait connaître que ces recettes étaient de petites coquilles avec lesquelles ils la pincent: depuis qu’ils ont connu les métaux, ils ont imaginé de rouler un fil de laiton sur un bois rond, de la grosseur du doigt, et d’en faire une spirale ou boudin à ressort, qui saisit entre ses plis et arrache une quantité de poils à la fois. Il est inconcevable que le baron Lahontan chez nous, et lord Kaims chez les Anglais, aient ignoré ou nié un fait si général; mais il est tout simple que le paradoxal docteur Paw se soit emparé de cette anomalie pour en étayer l’édifice de ses rêveries. Petite-Tortue et M. Wels ne me laissèrent aucun doute sur cette question: le premier s’amusait sans cesse à s’arracher même les poils des sourcils, comme les Turks s’amusent à rouler leur barbe. Il ne serait pas étonnant que cet exercice, continué sur plusieurs générations, affaiblît les racines de la barbe. Quant aux poils du corps, j’ai vu moi-même à plusieurs sauvages, ceux des aisselles longs et droits à m’étonner. Serait-ce parce qu’étant exposés à l’air, ils croissent plus en liberté? cette idée d’arracher la barbe a-t-elle eu pour cause première l’intention d’ôter à l’ennemi une prise dangereuse sur la figure? Cela me semble probable.
L’on vante, avec raison, la taille des sauvages: elle est, en général, svelte et bien prise, plus grande, plus forte chez ceux qui ont un sol arrosé et fertile comme ceux de la Wabash; plus mince, plus courte chez ceux qui ont un mauvais sol, comme tous ceux du Nord, passé le 45°. Mais si l’on ne voit jamais parmi eux ni boiteux, ni manchot, ni bossu, ni aveugle, avant d’en tirer des inductions trop favorables pour leur genre de vie, il est bon d’observer que tout sujet né faible périt nécessairement de bonne heure par l’effet des fatigues il arrive même que les parents délaissent ou détruisent l’enfant mal conformé qui leur serait à charge. Ainsi, la loi de Lycurgue à Sparte se trouve en activité chez les sauvages, non par transmission ou communication, mais par identité de circonstances; parce que chez les peuples pauvres, faibles et toujours en guerre, il n’y a pas de superflu pour nourrir des bras inutiles. C’est par la suite de cette pauvreté que chez beaucoup de sauvages, particulièrement au nord du Lac supérieur, quand les vieillards deviennent à charge, on les envoie vivre dans l’autre climat; c’est-à-dire qu’on les tue, comme il se pratiquait chez des sauvages de la mer Caspienne et de la Scythie, selon le récit d’Hérodote. Et pour prouver combien est misérable la vie sauvage, c’est eux-mêmes ordinairement qui demandent à cesser d’exister. Si par accident de maladie ou de guerre un sauvage est mutilé, c’est un homme perdu. Comment un invalide pourrait-il résister à un ennemi muni de tous ses membres? comment pourrait-il chasser, pêcher, se procurer une subsistance quelconque, que personne, à défaut de lui-même, ne lui donnera? Car chez eux personne n’a et ne peut avoir de réserves, et dans ce genre de vie, chacun est réduit à ses propres moyens casuels et variables. Par ces mêmes motifs, l’on ne voit chez eux ni hernies, ni maladies chroniques; «Sois fort ou meurs,» semble leur dire la nature sauvage qui les environne, et qui dans sa dureté ne laisse pas même l’égalité du choix, puisqu’elle-même souvent rend les obstacles plus grands que la force.
L’on a aussi vanté la santé robuste des sauvages: sans doute l’habitude de toute intempérie donne à leur constitution une vigueur que l’on n’attend pas de la vie efféminée des cités; mais pour apprécier leurs avantages à cet égard, il faut observer que leur manière de vivre les soumet à des irrégularités et à des excès incompatibles avec une santé constante et un tempérament vraiment robuste. Haïssant la vie agricole, sédentaire et captive, préférant la vie vagabonde et aventurière de la chasse et de la pêche, ils n’ont et ne peuvent avoir de magasins ni de provisions durables: par conséquent ils sont exposés à de dures alternatives de famine et de satiété: quand le gibier abonde, quand ils peuvent chasser sans crainte de surprise, c’est un temps de jouissance et de gloutonnerie; mais lorsque le gibier manque plusieurs jours de suite, comme il arrive chaque hiver, ou qu’ils n’osent s’écarter de crainte de l’ennemi, alors ils sont souvent réduits à vivre comme des loups, d’écorces d’arbres ou de bulbes terrestres. Ils ont bien imaginé, et je crois depuis peu de temps, de sécher les viandes et de les réduire en poudre très-fine; mais jamais ces secours ne sont capables de durer toute une saison. Qu’après de violents jeûnes, il leur tombe une proie, un daim, un ours, un bison, ils s’asseyent dessus comme des vautours, et ne cessent de dépiécer et de dévorer le cadavre, jusqu’à ce qu’ils tombent suffoqués d’aliments. Cet usage en fait des guides intraitables dans tout voyage régulier. Ce qu’en de telles occasions leur estomac engloutit, serait une chose incroyable, si des témoignages authentiques et nombreux n’excluaient tout doute: il est notoire sur toutes les frontières que deux sauvages affamés feront aisément, en un seul repas, disparaître un daim tout entier, et ne seront pas encore rassasiés. Cela rappelle ces héros de la guerre de Troie, qui dévoraient des agneaux et des moitiés de veaux; et cela nous prouve que ces héros n’étaient que des sauvages vivant dans des circonstances semblables. Or, de tels excès ne peuvent manquer de produire des désordres de santé: aussi est-il maintenant constaté que les sauvages sont sujets aux maux d’estomac, aux fièvres bilieuses, aux intermittentes, aux phthisies et aux pleurésies. Les fractures et les luxations ne sont pas rares chez eux, mais ils les remettent assez bien. Les rhumatismes les fatigueraient davantage s’ils n’avaient pas l’usage des fumigations, au moyen des cailloux ardents. L’on sait les ravages qu’exerce la petite vérole, sans doute par l’obstacle qu’oppose à l’éruption une peau endurcie. M. Jefferson leur procurera un bienfait immense en leur faisant enseigner l’art de la vaccine, ainsi que l’ont publié les journaux. Depuis quelques années, des missionnaires quakers et moraves, qui ont succédé aux jésuites, nous ont appris que les tribus converties par ceux-ci étaient devenues plus robustes, portaient de plus lourds fardeaux, étaient moins souvent malades; et ils ont très-bien vu que la raison en était le régime plus régulier, la nourriture plus égale, auxquels on les avait assujettis. Un autre fait également notoire, est que tout Européen qui s’est adonné à la vie sauvage est devenu plus fort, en a mieux supporté tous les excès que les sauvages mêmes. La supériorité des Virginiens et des Kentockois sur eux, a été constatée, non-seulement de troupe à troupe, mais d’homme à homme dans toutes les guerres. Je ne citerai pas, en preuve de faiblesse, le battement du pouls que M. le docteur Rush prétend être plus lent chez les sauvages: car dans le même temps et sur les mêmes individus, M. le docteur Barton n’observait rien de semblable, et le pouls de Petite-Tortue m’a paru tout-à-fait semblable au mien. Je ne citerai pas non plus la faiblesse de leurs appétits vénériens, parce qu’elle tient à une cause tout-à-fait différente. C’est par principe, par nécessité de conservation, que le sauvage est continent et presque chaste: la moindre perte de ses forces par la débauche, pourrait lui coûter la vie dès le lendemain, en diminuant ses moyens de défense ou de résistance dans une attaque de la part des hommes ou de la nature.
En traitant des inconvénients de la vie sauvage, je demandai à M. Wels s’il était vrai que beaucoup de blancs la préférassent, et pourquoi ils la préféraient à la vie que nous appelons civilisée. Sa réponse, qui fut longue et détaillée, s’accorda avec tout ce que j’ai appris en Kentucky, au Poste-Vincennes et à Détroit, de personnes sensées et expérimentées. Le résultat unanime des faits est que «les Canadiens, c’est-à-dire le sang français, fournissent plus de ces sujets que les Américains, c’est-à-dire que le sang allemand et anglais. Ces derniers ont pour les sauvages une antipathie naturelle, que les cruautés des Indiens sur les prisonniers ont encore exaltée. Les Anglo-Américains répugnent à mêler leur sang avec les Sauvagesses, tandis que pour les Canadiens c’est une friandise de libertinage. Néanmoins, le goût de la vie sauvage a moins lieu chez les hommes faits que chez les jeunes gens au-dessous de 18 ans: parmi les Américains, ceux-là seulement s’y attachent, qui ont été enlevés prisonniers en bas âge; parce que l’excessive liberté qu’elle leur procure pour s’amuser, jouer et courir, plaît bien plus aux enfants que la contrainte des écoles dans les bourgs, et que les punitions que l’on y inflige à leur paresse. L’enfance, comme l’on sait, ne respire que dissipation et désœuvrement. Il faut des années pour lui faire contracter l’habitude du travail et de l’étude; il ne faut que quelques jours de congé pour lui donner celle de l’indépendance et de l’oisiveté. Il paraît que ce sont là les deux penchants naturels de l’homme auxquels il revient machinalement. Quant aux adultes, surtout Américains, pris et adoptés par les sauvages, presque aucun ne peut s’habituer à leur vie: moi-même, dit M. Wels, quoique emmené à l’âge de 13 ans (il m’a paru en avoir 32), puis adopté, bien traité, jamais je n’ai pu perdre le souvenir des jouissances sociales que j’avais déja goûtées. A l’égard de ceux qui de plein gré passent chez les sauvages, et la plupart sont des Canadiens, ce sont en général de mauvais sujets, libertins, paresseux, de tempérament violent ou de peu d’intelligence. L’espèce de crédit qu’ils acquièrent chez les sauvages, flatte leur amour-propre, en même temps qu’une vie licencieuse avec les sqaws ou sauvagesses séduit la passion dominante de leur fougueuse jeunesse; mais lorsqu’ils vieillissent, réduits à l’extrême misère, ils ne manquent presque jamais de se rapatrier, déplorant trop tard leurs écarts. Parmi nous, dit M. Wels, pour peu que l’on ait d’industrie, l’on se procure au présent une vie commode, et l’on se prépare pour l’avenir, des douceurs dont la vieillesse fait sentir tout le prix. On crée une ferme, on élève des enfants qui, lorsqu’on est impotent, vous closent doucement les yeux. Dans l’état sauvage, au contraire, toute jouissance se borne à boire, à manger (encore pas toujours), à chasser; toute carrière d’ambition se réduit à être un grand guerrier, célèbre chez cinq ou six cents hommes. L’âge vient, les forces baissent, la considération décline, et l’on finit par les infirmités, le mépris, l’extrême misère, et la nécessité ou le besoin de se faire tuer. L’Indien n’en peut jamais employer un autre à son service: chez eux, obéir et servir, même de bon gré, est une sorte d’opprobre réservé aux femmes. Un grand guerrier ne doit rien faire que combattre et chasser. Les femmes portent tout le fardeau du ménage, du labourage, s’il y en a, et en voyage du transport des enfants et des ustensiles. Ce sont littéralement des bêtes de somme. Elles n’héritent pas même des maris: que demain Petite-Tortue retourne chez lui et meure; tous les présents qu’il a reçus, habits, chapeaux, colliers, seront partagés, presque pillés; rien ne passera à ses enfants. C’est un usage de sa tribu, commun à bien d’autres: vivants, ils ont la propriété de leurs meubles, armes et bijoux; mais comme à leur mort leurs couteaux, leurs pipes même ne passent point aux enfants, l’on peut dire qu’ils n’en ont que l’usufruit. Encore moins connaissent-ils de propriété foncière en maisons et en terres: ainsi, toute l’ambition du sauvage est concentrée dans un petit cercle de besoins, plutôt défensifs qu’extenseurs de son existence. Cette existence sans cesse menacée, est elle-même concentrée au présent. La possibilité de périr à tout instant est la plus constante, la plus radicale des pensées du sauvage; il use de la vie comme d’un meuble prêt à se briser à toute heure par la foule des accidents qui l’entourent. Familiarisé dès l’enfance avec cette idée, il n’en est point affecté: c’est la nécessité, il s’y résigne ou il la brave. Mais par une conséquence naturelle, il n’est attaché à rien au monde qu’à ses armes, et peut-être à un compagnon ou ami, qui est pour lui un moyen additionnel de défense et de conservation. Il caresse ses enfants, comme tout animal caresse ses petits. Quand il les a ballottés, embrassés, il les quitte pour aller à la chasse ou à la guerre sans y plus penser; il s’expose au péril sans s’inquiéter de ce qu’ils deviendront: ils lutteront contre le sort, contre la nature; ils mourront jeunes ou vieux, peu importe, puisqu’il faut qu’ils meurent. Aussi le suicide n’est-il point rare parmi eux; ils se tuent par dégoût de la vie, quelquefois par dépit amoureux, par colère contre un grand affront qu’ils ne peuvent repousser. Ils vivent tout en sensations, peu en souvenirs, point en espérances. S’ils sont bien portants, ils folâtrent, dansent et chantent: s’ils sont malades ou fatigués, ils se couchent, fument et dorment; mais comme très-souvent leur repos et leurs aliments ne sont point à leur disposition, il est difficile de voir là de la liberté et du bonheur.»
Un second voyageur est Jean Long, Anglais, commis et facteur pendant vingt ans dans la traite des pelleteries du Canada: il a publié ses voyages in-4º en 1791: ils ont été traduits et publiés in-8º en 1793. Il est fâcheux que le traducteur se soit permis de supprimer les vocabulaires pour quelque économie de librairie. Cet ouvrage mérite réimpression avec corrections, car il est le plus fidèle tableau que je connaisse de la vie et des mœurs des sauvages et des trafiquants canadiens.
Un troisième est Bernard Romans, dont j’ai assez parlé.
Un quatrième est Umfreville que j’ai fait connaître. Je ne parle point du livre d’Adair sur les Creeks et les Chérokis, parce que, à quelques faits vrais, il a mêlé une foule de faits altérés ou faux, dans l’intention de prouver que les sauvages descendent des juifs. Cette extravagante idée, qui d’ailleurs, lui est commune avec plusieurs missionnaires, ne l’a conduit qu’à faire envisager sous un faux jour tout ce qui appartient aux sauvages. Ce n’est qu’avec de saines notions sur la nature de l’entendement humain, sur sa marche, et sur tous les principes qui gouvernent et modifient l’homme de la nature, que l’on peut bien étudier et suivre l’histoire des nations.