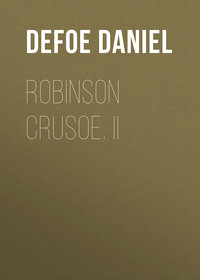Kitap dosya olarak indirilemez ancak uygulamamız üzerinden veya online olarak web sitemizden okunabilir.
Kitabı oku: «Robinson Crusoe. II», sayfa 29
LE FILS DU PRINCE MOSCOVITE
Là-dessus je fus réduit au silence, et je compris, qu'ils étaient dans une prison tout aussi sûre que s'ils eussent été renfermés dans le château de Moscou. Cependant il me vint la pensée que je pourrais fort bien devenir l'instrument de la délivrance de cet excellent homme, et qu'il me serait très-aisé de l'emmener, puisque dans le pays on n'exerçait point sur lui de surveillance. Après avoir roulé cette idée dans ma tête quelques instants, je lui dis que, comme je n'allais pas à Moscou mais à Archangel, et que je voyageais à la manière des caravanes, ce qui me permettait de ne pas coucher dans les stations militaires du désert, et de camper chaque nuit où je voulais, nous pourrions facilement gagner sans malencontre cette ville où je le mettrais immédiatement en sûreté à bord d'un vaisseau anglais ou hollandais qui nous transporterait touts deux à bon port. – «Quant à votre subsistance et aux autres détails, ajoutai-je, je m'en chargerai jusqu'à ce que vous puissiez faire mieux vous-même.»
Il m'écouta très-attentivement et me regarda fixement tout le temps que je parlai; je pus même voir sur son visage que mes paroles jetaient son esprit dans une grande émotion. Sa couleur changeait à tout moment, ses yeux s'enflammaient, toute sa contenance trahissait l'agitation de son cœur. Il ne put me répliquer immédiatement quand j'eus fini. On eût dit qu'il attendait ce qu'il devait répondre. Enfin, après un moment de silence, il m'embrassa en s'écriant: – «Malheureux que nous sommes, infortunées créatures, il faut donc que même les plus grands actes de l'amitié soient pour nous des occasions de chute, il faut donc que nous soyons les tentateurs l'un de l'autre! Mon cher ami, continua-t-il, votre offre est si honnête, si désintéressée, si bienveillante pour moi, qu'il faudrait que j'eusse une bien faible connaissance du monde si, tout à la fois, je ne m'en étonnais pas et ne reconnaissais pas l'obligation que je vous en ai. Mais croyez-vous que j'aie été sincère dans ce que je vous ai si souvent dit de mon mépris pour le monde? Croyez-vous que je vous aie parlé du fond de l'âme, et qu'en cet exil je sois réellement parvenu à ce degré de félicité qui m'a placé au-dessus du tout ce que le monde pouvait me donner et pouvait faire pour moi? Croyez-vous que j'étais franc quand je vous ai dit que je ne voudrais pas m'en retourner, fussé-je rappelé pour redevenir tout ce que j'étais autrefois à la Cour, et pour rentrer dans la faveur du Czar mon maître? Croyez-vous, mon ami, que je sois un honnête homme, ou pensez-vous que je sois un orgueilleux hypocrite?» – Ici il s'arrêta comme pour écouter ce que je répondrais; mais je reconnus bientôt que c'était l'effet de la vive émotion de ses esprits: son cœur était plein, il ne pouvait poursuivre. Je fus, je l'avoue, aussi frappé de ces sentiments qu'étonné de trouver un tel homme, et j'essayai de quelques arguments pour le pousser à recouvrer sa liberté. Je lui représentai qu'il devait considérer ceci comme une porte que lui ouvrait le Ciel pour sa délivrance, comme une sommation que lui faisait la Providence, qui dans sa sollicitude dispose touts les évènements, pour qu'il eût à améliorer son état et à se rendre utile dans le monde.
Ayant eu le temps de se remettre, – «Que savez-vous, Sir, me dit-il vivement, si au lieu d'une injonction de la part du Ciel, ce n'est pas une instigation de toute autre part me représentant sous des couleurs attrayantes, comme une grande félicité, une délivrance qui peut être en elle-même un piége pour m'entraîner à ma ruine? Ici je ne suis point en proie à la tentation de retourner à mon ancienne misérable grandeur ailleurs je ne suis pas sûr que toutes les semences d'orgueil, d'ambition, d'avarice et de luxure que je sais au fond de mon cœur ne puissent se raviver, prendre racine, en un mot m'accabler derechef, et alors l'heureux prisonnier que vous voyez maintenant maître de la liberté de son âme deviendrait, en pleine possession de toute liberté personnelle, le misérable esclave de ses sens. Généreux ami, laissez-moi dans cette heureuse captivité, éloigné de toute occasion de chute, plutôt que de m'exciter à pourchasser une ombre de liberté aux dépens de la liberté de ma raison et aux dépens du bonheur futur que j'ai aujourd'hui en perspective, et qu'alors, j'en ai peur, je perdrais totalement de vue, car je suis de chair, car je suis un homme, rien qu'un homme, car je ne suis pas plus qu'un autre à l'abri des passions. Oh! ne soyez pas à la fois mon ami et mon tentateur.»
Si j'avais été surpris d'abord, je devins alors tout-à-fait muet, et je restai là à le contempler dans le silence et l'admiration. Le combat que soutenait son âme était si grand que, malgré le froid excessif, il était tout en sueur. Je vis que son esprit avait besoin de retrouver du calme; aussi je lui dis en deux mots que je le laissais réfléchir, que je reviendrais le voir; et je regagnai mon logis.
Environ deux heures après, j'entendis quelqu'un à la porte de la chambre, et je me levais pour aller ouvrir quand il l'ouvrit lui-même et entra. – «Mon cher ami, me dit-il, vous m'aviez presque vaincu, mais je suis revenu à moi. Ne trouvez pas mauvais que je me défende de votre offre. Je vous assure que ce n'est pas que je ne sois pénétré de votre bonté; je viens pour vous exprimer la plus sincère reconnaissance; mais j'espère avoir remporté une victoire sur moi-même.»
– «Mylord, lui répondis-je, j'aime à croire que vous êtes pleinement assuré que vous ne résistez pas à la voix du Ciel. – «Sir, reprit-il, si c'eût été de la part du Ciel, la même influence céleste m'eût poussé à l'accepter, mais j'espère, mais je demeure bien convaincu que c'est de par le Ciel que je m'en excuse, et quand nous nous séparerons ce ne sera pas une petite satisfaction pour moi de penser que vous m'aurez laissé honnête homme, sinon homme libre.»
Je ne pouvais plus qu'acquiescer et lui protester que dans tout cela mon unique but avait été de le servir. Il m'embrassa très-affectueusement en m'assurant qu'il en était convaincu et qu'il en serait toujours reconnaissant; puis il m'offrit un très-beau présent de zibelines, trop magnifique vraiment pour que je pusse l'accepter d'un homme dans sa position, et que j'aurais refusé s'il ne s'y fût opposé.
Le lendemain matin j'envoyai à sa seigneurie mon serviteur avec un petit présent de thé, deux pièces de damas chinois, et quatre petits lingots d'or japonais, qui touts ensemble ne pesaient pas plus de six onces ou environ; mais ce cadeau n'approchait pas de la valeur des zibelines, dont je trouvai vraiment, à mon arrivée en Angleterre, près de 200 livres sterling. Il accepta le thé, une des pièces de damas et une des pièces d'or au coin japonais, portant une belle empreinte, qu'il garda, je pense, pour sa rareté; mais il ne voulut rien prendre de plus, et me fit savoir par mon serviteur qu'il désirait me parler.
Quand je me fus rendu auprès de lui, il me dit que je savais ce qui s'était passé entre nous, et qu'il espérait que je ne chercherais plus à l'émouvoir; mais puisque je lui avais fait une si généreuse offre, qu'il me demandait si j'aurais assez de bonté pour la transporter à une autre personne qu'il me nommerait, et à laquelle il s'intéressait beaucoup. Je lui répondis que je ne pouvais dire que je fusse porté à faire autant pour un autre que pour lui pour qui j'avais conçu une estime toute particulière, et que j'aurais été ravi de délivrer; cependant, s'il lui plaisait de me nommer la personne que je lui rendrais réponse, et que j'espérais qu'il ne m'en voudrait pas si elle ne lui était point agréable. Sur ce il me dit qu'il s'agissait de son fils unique, qui, bien que je ne l'eusse pas vu, se trouvait dans la même situation que lui, environ à deux cents milles plus loin, de l'autre côté de l'Oby, et que si j'accueillais sa demande, il l'enverrait chercher.
Je lui répondis sans balancer que j'y consentais. Je fis toutefois quelques cérémonies pour lui donner à entendre que c'était entièrement à sa considération, et parce que, ne pouvant l'entraîner, je voulais lui prouver ma déférence par mon zèle pour son fils. Mais ces choses sont trop fastidieuses pour que je les répète ici. Il envoya le lendemain chercher son fils, qui, au bout de vingt jours, arriva avec le messager, amenant six ou sept chevaux chargés de très-riches pelleteries d'une valeur considérable.
Les valets firent entrer les chevaux dans la ville, mais ils laissèrent leur jeune seigneur à quelque distance. À la nuit, il se rendit incognito dans notre appartement, et son père me le présenta. Sur-le-champ nous concertâmes notre voyage, et nous en réglâmes touts les préparatifs.
J'achetai une grande quantité de zibelines, de peaux de renards noirs, de belles hermines, et d'autres riches pelleteries, je les troquai, veux-je dire, dans cette ville, contre quelques-unes, des marchandises que j'avais apportées de Chine, particulièrement contre des clous de girofle, des noix muscades dont je vendis là une grande partie, et le reste plus tard à Archangel, beaucoup plus avantageusement que je ne l'eusse fait à Londres; aussi mon partner, qui était fort sensible aux profits et pour qui le négoce était chose plus importante que pour moi, fut-il excessivement satisfait de notre séjour en ce lieu à cause du trafic que nous y fîmes.
Ce fut au commencement de juin que je quittai cette place reculée; cette ville dont, je crois, on entend peu parler dans le monde; elle est, par le fait, si éloignée de toutes les routes du commerce, que je ne vois pas pourquoi on s'en entretiendrait beaucoup. Nous ne formions plus alors qu'une très-petite caravane, composée seulement de trente-deux chevaux et chameaux. Touts passaient pour être à moi, quoique onze d'entre eux appartinssent à mon nouvel hôte. Il était donc très-naturel après cela que je m'attachasse un plus grand nombre de domestiques. Le jeune seigneur passa pour mon intendant; pour quel grand personnage passai-je moi-même? je ne sais; je ne pris pas la peine de m'en informer. Nous eûmes ici à traverser le plus détestable et le plus grand désert que nous eussions rencontré dans tout le voyage; je dis le plus détestable parce que le chemin était creux en quelques endroits et très-inégal dans d'autres. Nous nous consolions en pensant que nous n'avions à redouter ni troupes de Tartares, ni brigands, que jamais ils ne venaient sur ce côté de l'Oby, ou du moins très-rarement; mais nous nous mécomptions.
Mon jeune seigneur avait avec lui un fidèle valet moscovite ou plutôt sibérien qui connaissait parfaitement le pays, et qui nous conduisit par des chemins détournés pour que nous évitassions d'entrer dans les principale villes échelonnées sur la grande route, telles que Tumen, Soloy-Kamaskoy et plusieurs autres, parce que les garnisons moscovites qui s'y trouvent examinent scrupuleusement les voyageurs, de peur que quelque exilé de marque parvienne à rentrer en Moscovie. Mais si, par ce moyen, nous évitions toutes recherches, en revanche nous faisions tout notre voyage dans le désert, et nous étions obligés de camper et de coucher sous nos tentes, tandis que nous pouvions avoir de bons logements dans les villes de la route. Le jeune seigneur le sentait si bien qu'il ne voulait pas nous permettre de coucher dehors, quand nous venions à rencontrer quelque bourg sur notre chemin. Il se retirait seul avec son domestique et passait la nuit en plein air dans les bois, puis le lendemain il nous rejoignait au rendez-vous.
Nous entrâmes en Europe en passant le fleuve Kama, qui, dans cette région, sépare l'Europe de l'Asie. La première ville sur le côté européen s'appelle Soloy-Kamaskoy, ce qui veut dire la grande ville sur le fleuve Kama. Nous nous étions imaginé qu'arrivés là nous verrions quelque changement notable chez les habitants, dans leurs mœurs, leur costume, leur religion, mais nous nous étions trompés, nous avions encore à traverser un vaste désert qui, à ce qu'on rapporte, a près de sept cents milles de long en quelques endroits, bien qu'il n'en ait pas plus de deux cents milles au lieu où nous le passâmes, et jusqu'à ce que nous fûmes sortis de cette horrible solitude nous trouvâmes très-peu de différence entre cette contrée et la Tartarie-Mongole.
DERNIÈRE AFFAIRE
Nous trouvâmes les habitants pour la plupart payens et ne valant guère mieux que les Sauvages de l'Amérique. Leurs maisons et leurs villages sont pleins d'idoles, et leurs mœurs sont tout-à-fait barbares, excepté dans les villes et dans les villages qui les avoisinent, où ces pauvres gens se prétendent Chrétiens de l'Église grecque, mais vraiment leur religion est encore mêlée à tant de restes de superstitions que c'est à peine si l'on peut en quelques endroits la distinguer d'avec la sorcellerie et la magie.
En traversant ce steppe, lorsque nous avions banni toute idée de danger de notre esprit, comme je l'ai déjà insinué, nous pensâmes être pillés et détroussés, et peut-être assassinés par une troupe de brigands. Étaient-ils de ce pays, étaient-ce des bandes roulantes d'Ostiaks (espèce de Tartares ou de peuple sauvage du bord de l'Oby) qui rôdaient ainsi au loin, ou étaient-ce des chasseurs de zibelines de Sibérie, je suis encore à le savoir, mais ce que je sais bien, par exemple, c'est qu'ils étaient touts à cheval, qu'ils portaient des arcs et des flèches et que nous les rencontrâmes d'abord au nombre de quarante-cinq environ. Ils approchèrent de nous jusqu'à deux portées de mousquet, et sans autre préambule, ils nous environnèrent avec leurs chevaux et nous examinèrent à deux reprise très-attentivement. Enfin ils se postèrent juste dans notre chemin, sur quoi nous nous rangeâmes en ligne devant nos chameaux, nous n'étions pourtant que seize hommes en tout, et ainsi rangés nous fîmes halte et dépêchâmes le valet sibérien au service du jeune seigneur, pour voir quelle engeance c'était. Son maître le laissa aller d'autant plus volontiers qu'il avait une vive appréhension que ce ne fût une troupe de Sibériens envoyés à sa poursuite. Cet homme s'avança vers eux avec un drapeau parlementaire et les interpella. Mais quoiqu'il sût plusieurs de leurs langues ou plutôt de leurs dialectes, il ne put comprendre un mot de ce qu'ils répondaient. Toutefois à quelques signes ayant cru reconnaître qu'ils le menaçaient de lui tirer dessus s'il s'approchait, ce garçon s'en revint comme il était parti. Seulement il nous dit qu'il présumait, à leur costume, que ces Tartares devaient appartenir à quelque horde calmoucke ou circassienne, et qu'ils devaient se trouver en bien plus grand nombre dans le désert, quoiqu'il n'eût jamais entendu dire qu'auparavant ils eussent été vus si loin vers le Nord.
C'était peu consolant pour nous, mais il n'y avait point de remède. – À main gauche, à environ un quart de mille de distance, se trouvait un petit bocage, un petit bouquet d'arbres très-serrés, et fort près de la route. Sur-le-champ je décidai qu'il nous fallait avancer jusqu'à ces arbres et nous y fortifier de notre mieux, envisageant d'abord que leur feuillage nous mettrait en grande partie à couvert des flèches de nos ennemis, et, en second lieu, qu'ils ne pourraient venir nous y charger en masse: ce fut, à vrai dire, mon vieux pilote, qui en fit la proposition. Ce brave avait cette précieuse qualité, qui ne l'abandonnait jamais, d'être toujours le plus prompt et plus apte à nous diriger et à nous encourager dans les occasions périlleuses. Nous avançâmes donc immédiatement, et nous gagnâmes en toute hâte ce petit bois, sans que les Tartares ou les brigands, car nous ne savions comment les appeler, eussent fait le moindre mouvement pour nous en empêcher. Quand nous fûmes arrivés, nous trouvâmes, à notre grande satisfaction, que c'était un terrain marécageux et plein de fondrières d'où, sur le côté, s'échappait une fontaine, formant un ruisseau, joint à quelque distance de là par un autre petit courant. En un mot c'était la source d'une rivière considérable appelée plus loin Wirtska. Les arbres qui croissaient autour de cette source n'étaient pas en tout plus de deux cents, mais ils étaient très-gros et plantés fort épais. Aussi dès que nous eûmes pénétré dans ce bocage vîmes-nous que nous y serions parfaitement à l'abri de l'ennemi, à moins qu'il ne mît pied à terre pour nous attaquer.
Mais afin de rendre cette attaque même difficile, notre vieux Portugais, avec une patience incroyable, s'avisa de couper à demi de grandes branches d'arbres et de les laisser pendre d'un tronc à l'autre pour former une espèce de palissade tout autour de nous.
Nous attendions là depuis quelques heures que nos ennemis exécutassent un mouvement sans nous être apperçus qu'ils eussent fait mine de bouger, quand environ deux heures avant la nuit ils s'avancèrent droit sur nous. Quoique nous ne l'eussions point remarqué, nous vîmes alors qu'ils avaient été rejoints par quelques gens de leur espèce, de sorte qu'ils étaient bien quatre-vingts cavaliers parmi lesquels nous crûmes distinguer quelques femmes. Lorsqu'ils furent à demi-portée de mousquet de notre petit bois, nous tirâmes un coup à poudre et leur adressâmes la parole en langue russienne pour savoir ce qu'ils voulaient et leur enjoindre de se tenir à distance; mais comme ils ne comprenaient rien à ce que nous leur disions ce coup ne fit que redoubler leur fureur, et ils se précipitèrent du côté du bois ne s'imaginant pas que nous y étions si bien barricadés qu'il leur serait impossible d'y pénétrer. Notre vieux pilote, qui avait été notre ingénieur, fut aussi notre capitaine. Il nous pria de ne point faire feu dessus qu'ils ne fussent à portée de pistolet, afin de pouvoir être sûrs de leur faire mordre la poussière, et de ne point tirer que nous ne fussions sûrs d'avoir bien ajusté. Nous nous en remîmes à son commandement, mais il différa si long-temps le signal que quelques-uns de nos adversaires n'étaient pas éloignés de nous de la longueur de deux piques quand nous leur envoyâmes notre décharge.
Nous visâmes si juste, ou la Providence dirigea si sûrement nos coups, que de cette première salve nous en tuâmes quatorze et en blessâmes plusieurs autres, cavaliers et chevaux; car nous avions touts chargé nos armes de deux ou trois balles au moins.
Ils furent terriblement surpris de notre feu, et se retirèrent immédiatement à environ une centaine de verges. Ayant profité de ce moment pour recharger nos armes, et voyant qu'ils se tenaient à cette distance, nous fîmes une sortie et nous attrapâmes quatre ou cinq de leurs chevaux dont nous supposâmes que les cavaliers avaient été tués. Aux corps restés sur la place nous reconnûmes de suite que ces gens étaient des Tartares; mais à quel pays appartenaient-ils, mais comment en étaient-ils venus faire une excursion si longue, c'est ce que nous ne pûmes savoir.
Environ une heure après ils firent un second mouvement pour nous attaquer, et galopèrent autour de notre petit bois pour voir s'ils pourraient y pénétrer par quelque autre point; mais nous trouvant toujours prêts à leur faire face ils se retirèrent de nouveau: sur quoi nous résolûmes de ne pas bouger de là pour cette nuit.
Nous dormîmes peu, soyez sûr. Nous passâmes la plus grande partie de la nuit à fortifier notre assiette, et barricader toutes les percées du bois; puis faisant une garde sévère, nous attendîmes le jour. Mais, quand il parut, il nous fit faire une fâcheuse découverte; car l'ennemi que nous pensions découragé par la réception de la veille, s'était renforcé de plus de deux cents hommes et avait dressé onze ou douze huttes comme s'il était déterminé à nous assiéger. Ce petit camp était planté en pleine campagne à trois quarts de mille de nous environ. Nous fûmes tout de bon grandement surpris à cette découverte; et j'avoue que je me tins alors pour perdu, moi et tout ce que j'avais. La perte de mes effets, bien qu'ils fussent considérables, me touchait moins que la pensée de tomber entre les mains de pareils barbares, tout à la fin de mon voyage, après avoir traversé tant d'obstacles et de hasards, et même en vue du port où nous espérions sûreté et délivrance. Quant à mon partner il enrageait; il protestait que la perte de ses marchandises serait sa ruine, qu'il aimait mieux mourir que d'être réduit à la misère et qu'il voulait combattre jusqu'à la dernière goutte de son sang.
Le jeune seigneur, brave au possible, voulait aussi combattre jusqu'au dernier soupir, et mon vieux pilote avait pour opinion que nous pouvions résister à nos ennemis, postés comme nous l'étions. Toute la journée se passa ainsi en discussions sur ce que nous devions faire, mais vers le soir nous nous apperçûmes que le nombre de nos ennemis s'était encore accru. Comme ils rôdaient en plusieurs bandes à la recherche de quelque proie, peut-être la première bande avait-elle envoyé des exprès pour demander du secours et donner avis aux autres du butin qu'elle avait découvert, et rien ne nous disait que le lendemain ils ne seraient pas encore en plus grand nombre; aussi commençai-je à m'enquérir auprès des gens que nous avions amenés de Tobolsk s'il n'y avait pas d'autres chemins des chemins plus détournés par lesquels nous pussions échapper à ces drôles pendant la nuit, puis nous réfugier dans quelque ville, ou nous procurer une escorte pour nous protéger dans le désert.
Le Sibérien, domestique du jeune seigneur, nous dit que si nous avions le dessein de nous retirer et non pas de combattre, il se chargerait à la nuit de nous faire prendre un chemin conduisant au Nord vers la rivière Petraz, par lequel nous pourrions indubitablement nous évader sans que les Tartares y vissent goutte; mais il ajouta que son seigneur lui avait dit qu'il ne voulait pas s'enfuir, qu'il aimait mieux combattre. Je lui répondis qu'il se méprenait sur son seigneur qui était un homme trop sage pour vouloir se battre pour le plaisir de se battre; que son seigneur avait déjà donné des preuves de sa bravoure, et que je le tenais pour brave, mais que son seigneur avait trop de sens pour désirer mettre aux prises dix-sept ou dix-huit hommes avec cinq cents, à moins d'une nécessité inévitable. – «Si vous pensez réellement, ajoutai-je, qu'il nous soit possible de nous échapper cette nuit, noue n'avons rien de mieux à faire.» – «Que mon seigneur m'en donne l'ordre, répliqua-t-il, et ma vie est à vous si je ne l'accomplis pas.» Nous amenâmes bientôt son maître à donner cet ordre, secrètement toutefois, et nous nous préparâmes immédiatement à le mettre à exécution.
Et d'abord, aussitôt qu'il commença à faire sombre, nous allumâmes un feu dans notre petit camp, que nous entretînmes et que nous disposâmes de manière à ce qu'il pût brûler toute la nuit, afin de faire croire aux Tartares que nous étions toujours là; puis, dès qu'il fit noir, c'est-à-dire dès que nous pûmes voir les étoiles (car notre guide ne voulut pas bouger auparavant), touts nos chevaux et nos chameaux se trouvant prêts et chargés, nous suivîmes notre nouveau guide, qui, je ne tardai pas à m'en appercevoir, se guidait lui-même sur l'étoile polaire, tout le pays ne formant jusqu'au loin qu'une vaste plaine.
Quand nous eûmes marché rudement pendant deux heures, le ciel, non pas qu'il eût été bien sombre jusque-là, commença à s'éclaircir, la lune se leva, et bref il fit plus clair que nous ne l'aurions souhaité. Vers six heures du matin nous avions fait près de quarante milles, à vrai dire nous avions éreinté nos chevaux. Nous trouvâmes alors un village russien nommé Kirmazinskoy où nous nous arrêtâmes tout le jour. N'ayant pas eu de nouvelles de nos Tartares Calmoucks, environ deux heures avant la nuit nous nous remîmes en route et marchâmes jusqu'à huit heures du matin, moins vite toutefois que la nuit précédente. Sur les sept heures nous passâmes une petite rivière appelée Kirtza et nous atteignîmes une bonne et grande ville habitée par les Russiens et très-peuplée, nommée Osomoys. Nous y apprîmes que plusieurs troupes ou hordes de Calmoucks s'étaient répandues dans le désert, mais que nous n'en avions plus rien à craindre, ce qui fut pour nous une grande satisfaction, je vous l'assure. Nous fûmes obligés de nous procurer quelques chevaux frais en ce lieu, et comme nous avions grand besoin de repos, nous y demeurâmes cinq jours; et mon partner et moi nous convînmes de donner à l'honnête Sibérien qui nous y avait conduits, la valeur de dix pistoles pour sa peine.
Après une nouvelle marche de cinq jours nous atteignîmes Veussima, sur la rivière Witzogda qui se jette dans la Dvina: nous touchions alors au terme heureux de nos voyages par terre, car ce fleuve, en sept jours de navigation, pouvait nous conduire à Archangel. De Veussima nous nous rendîmes à Laurenskoy, au confluent de la rivière, le 3 juillet, où nous nous procurâmes deux bateaux de transport, et une barge pour notre propre commodité. Nous nous embarquâmes le 7, et nous arrivâmes touts sains et saufs à Archangel le 18, après avoir été un an cinq mois et trois jours en voyage, y compris notre station de huit mois et quelques jours à Tobolsk.
Nous fûmes obligés d'y attendre six semaines l'arrivée des navires, et nous eussions attendu plus long-temps si un navire hambourgeois n'eût devancé de plus d'un mois touts les vaisseaux anglais. Considérant alors que nous pourrions nous défaire de nos marchandises aussi avantageusement à Hambourg qu'à Londres, nous prîmes touts passage sur ce bâtiment. Une fois nos effets à bord, pour en avoir soin, rien ne fut plus naturel que d'y placer mon intendant, le jeune seigneur, qui, par ce moyen, put se tenir caché parfaitement. Tout le temps que nous séjournâmes encore il ne remit plus le pied à terre, craignant de se montrer dans la ville, où quelques-uns des marchands moscovites l'eussent certainement vu et reconnu.
Nous quittâmes Archangel le 20 août de la même année, et, après un voyage pas trop mauvais, nous entrâmes dans l'Elbe le 13 septembre. Là, mon partner et moi nous trouvâmes un très-bon débit de nos marchandises chinoises, ainsi que de nos zibelines et autres pelleteries de Sibérie. Nous fîmes alors le partage de nos bénéfices, et ma part montait à 3,475 livres sterling 17 shillings et 3 pence, malgré toutes les pertes que nous avions essuyées et les frais que nous avions eus; seulement, je me souviens que j'y avais compris la valeur d'environ 600 livres sterling pour les diamants que j'avais achetés au Bengale.
Le jeune seigneur prit alors congé de nous, et s'embarqua sur l'Elbe, dans le dessein de se rendre à la Cour de Vienne, où il avait résolu de chercher protection et d'où il pourrait correspondre avec ceux des amis de son père qui vivaient encore. Il ne se sépara pas de moi sans me témoigner toute sa gratitude pour le service que je lui avais rendu, et sans se montrer pénétré de mes bontés pour le prince son père.
Pour conclusion, après être demeuré près de quatre mois à Hambourg, je me rendis par terre à La Haye, où je m'embarquai sur le paquebot, et j'arrivai à Londres le 10 janvier 1705. Il y avait dix ans et neuf mois que j'étais absent d'Angleterre.
Enfin, bien résolu à ne pas me harasser davantage, je suis en train de me préparer pour un plus long voyage que touts ceux-ci, ayant passé soixante-douze ans d'une vie d'une variété infinie, ayant appris suffisamment à connaître le prix de la retraite et le bonheur qu'il y a à finir ses jours en paix.