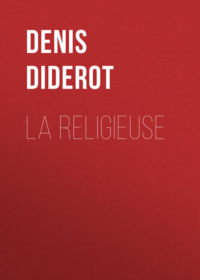Kitap dosya olarak indirilemez ancak uygulamamız üzerinden veya online olarak web sitemizden okunabilir.
Kitabı oku: «La religieuse», sayfa 9
– Madame, quand vous l'ordonnerez.
– Je t'en prierais tout à l'heure, si nous en avions le temps. Quelle heure est-il?..»
Sœur Thérèse répondit: «Madame, il est cinq heures, et les vêpres vont sonner.
– Qu'elle commence toujours.
– Mais, madame, vous m'aviez promis un moment de consolation avant vêpres. J'ai des pensées qui m'inquiètent; je voudrais bien ouvrir mon cœur à maman. Si je vais à l'office sans cela, je ne pourrai prier, je serai distraite.
– Non, non, dit la supérieure, tu es folle avec tes idées. Je gage que je sais ce que c'est; nous en parlerons demain.
– Ah! chère mère, dit sœur Thérèse, en se jetant aux pieds de la supérieure et en fondant en larmes, que ce soit tout à l'heure.
– Madame, dis-je à la supérieure, en me levant de sur ses genoux où j'étais restée, accordez à ma sœur ce qu'elle vous demande; ne laissez pas durer sa peine; je vais me retirer; j'aurai toujours le temps de satisfaire l'intérêt que vous voulez bien prendre à moi; et quand vous aurez entendu ma sœur Thérèse, elle ne souffrira plus…»
Je fis un mouvement vers la porte pour sortir; la supérieure me retenait d'une main; sœur Thérèse, à genoux, s'était emparée de l'autre, la baisait et pleurait; et la supérieure lui disait:
«En vérité, Sainte-Thérèse, tu es bien incommode avec tes inquiétudes; je te l'ai déjà dit, cela me déplaît, cela me gêne; je ne veux pas être gênée.
– Je le sais, mais je ne suis pas maîtresse de mes sentiments, je voudrais et je ne saurais…»
Cependant je m'étais retirée, et j'avais laissé avec la supérieure la jeune sœur. Je ne pus m'empêcher de la regarder à l'église; il lui restait de l'abattement et de la tristesse; nos yeux se rencontrèrent plusieurs fois; et il me sembla qu'elle avait de la peine à soutenir mon regard. Pour la supérieure, elle s'était assoupie dans sa stalle.
L'office fut dépêché en un clin d'œil: le chœur n'était pas, à ce qu'il me parut, l'endroit de la maison où l'on se plaisait le plus. On en sortit avec la vitesse et le babil d'une troupe d'oiseaux qui s'échapperaient de leur volière; et les sœurs se répandirent les unes chez les autres, en courant, en riant, en parlant; la supérieure se renferma dans sa cellule, et la sœur Thérèse s'arrêta sur la porte de la sienne, m'épiant comme si elle eût été curieuse de savoir ce que je deviendrais. Je rentrai chez moi, et la porte de la cellule de la sœur Thérèse ne se referma que quelque temps après, et se referma doucement. Il me vint en idée que cette jeune fille était jalouse de moi, et qu'elle craignait que je ne lui ravisse la place qu'elle occupait dans les bonnes grâces et l'intimité de la supérieure. Je l'observai plusieurs jours de suite; et lorsque je me crus suffisamment assurée de mon soupçon par ses petites colères, ses puériles alarmes, sa persévérance à me suivre à la piste, à m'examiner, à se trouver entre la supérieure et moi, à briser nos entretiens, à déprimer mes qualités, à faire sortir mes défauts; plus encore à sa pâleur, à sa douleur, à ses pleurs, au dérangement de sa santé, et même de son esprit, je l'allai trouver et je lui dis: «Chère amie, qu'avez-vous?»
Elle ne me répondit pas; ma visite la surprit et l'embarrassa; elle ne savait ni que dire, ni que faire.
«Vous ne me rendez pas assez de justice; parlez-moi vrai, vous craignez que je n'abuse du goût que notre mère a pris pour moi; que je ne vous éloigne de son cœur. Rassurez-vous; cela n'est pas dans mon caractère: si j'étais jamais assez heureuse pour obtenir quelque empire sur son esprit…
– Vous aurez tout celui qu'il vous plaira; elle vous aime; elle fait aujourd'hui pour vous précisément ce qu'elle a fait pour moi dans les commencements.
– Eh bien! soyez sûre que je ne me servirai de la confiance qu'elle m'accordera, que pour vous rendre plus chérie.
– Et cela dépendra-t-il de vous?
– Et pourquoi cela n'en dépendrait-il pas?»
Au lieu de me répondre, elle se jeta à mon cou, et elle me dit en soupirant: «Ce n'est pas votre faute, je le sais bien, je me le dis à tout moment; mais promettez-moi…
– Que voulez-vous que je vous promette?
– Que…
– Achevez; je ferai tout ce qui dépendra de moi.»
Elle hésita, se couvrit les yeux de ses mains, et me dit d'une voix si basse qu'à peine je l'entendais: «Que vous la verrez le moins souvent que vous pourrez…»
Cette demande me parut si étrange, que je ne pus m'empêcher de lui répondre: «Et que vous importe que je voie souvent ou rarement notre supérieure? Je ne suis point fâchée que vous la voyiez sans cesse, moi. Vous ne devez pas être plus fâchée que j'en fasse autant; ne suffit-il pas que je vous proteste que je ne vous nuirai auprès d'elle, ni à vous, ni à personne?»
Elle ne me répondit que par ces mots qu'elle prononça d'une manière douloureuse, en se séparant de moi, et en se jetant sur son lit: «Je suis perdue!
– Perdue! Et pourquoi? Mais il faut que vous me croyiez la plus méchante créature qui soit au monde!»
Nous en étions là lorsque la supérieure entra. Elle avait passé à ma cellule; elle ne m'y avait point trouvée; elle avait parcouru presque toute la maison inutilement; il ne lui vint pas en pensée que j'étais chez sœur Sainte-Thérèse. Lorsqu'elle l'eut appris par celles qu'elle avait envoyées à ma découverte, elle accourut. Elle avait un peu de trouble dans le regard et sur son visage; mais toute sa personne était si rarement ensemble! Sainte-Thérèse était en silence, assise sur son lit, moi debout. Je lui dis: «Ma chère mère, je vous demande pardon d'être venue ici sans votre permission.
– Il est vrai, me répondit-elle, qu'il eût été mieux de la demander.
– Mais cette chère sœur m'a fait compassion; j'ai vu qu'elle était en peine.
– Et de quoi?
– Vous le dirai-je? Et pourquoi ne vous le dirais-je pas? C'est une délicatesse qui fait tant d'honneur à son âme, et qui marque si vivement son attachement pour vous. Les témoignages de bonté que vous m'avez donnés, ont alarmé sa tendresse; elle a craint que je n'obtinsse dans votre cœur la préférence sur elle; ce sentiment de jalousie, si honnête d'ailleurs, si naturel et si flatteur pour vous, chère mère, était, à ce qu'il m'a semblé, devenu cruel pour ma sœur, et je la rassurais.»
La supérieure, après m'avoir écoutée, prit un air sévère et imposant, et lui dit:
«Sœur Thérèse, je vous ai aimée, et je vous aime encore; je n'ai point à me plaindre de vous, et vous n'aurez point à vous plaindre de moi; mais je ne saurais souffrir ces prétentions exclusives. Défaites-vous-en, si vous craignez d'éteindre ce qui me reste d'attachement pour vous, et si vous vous rappelez le sort de la sœur Agathe…» Puis, se tournant vers moi, elle me dit: «C'est cette grande brune que vous voyez au chœur vis-à-vis de moi.» (Car je me répandais si peu; il y avait si peu de temps que j'étais à la maison; j'étais si nouvelle, que je ne savais pas encore tous les noms de mes compagnes.) Elle ajouta: «Je l'aimais, lorsque sœur Thérèse entra ici, et que je commençai à la chérir. Elle eut les mêmes inquiétudes; elle fit les mêmes folies: je l'en avertis; elle ne se corrigea point, et je fus obligée d'en venir à des voies sévères qui ont duré trop longtemps, et qui sont très-contraires à mon caractère; car elles vous diront toutes que je suis bonne, et que je ne punis jamais qu'à contre-cœur…»
Puis s'adressant à Sainte-Thérèse, elle ajouta: «Mon enfant, je ne veux point être gênée, je vous l'ai déjà dit; vous me connaissez; ne me faites point sortir de mon caractère…» Ensuite elle me dit, en s'appuyant d'une main sur mon épaule: «Venez, Sainte-Suzanne; reconduisez-moi.»
Nous sortîmes. Sœur Thérèse voulut nous suivre; mais la supérieure détournant la tête négligemment par-dessus mon épaule, lui dit d'un ton de despotisme: «Rentrez dans votre cellule, et n'en sortez pas que je ne vous le permette…» Elle obéit, ferma sa porte avec violence, et s'échappa en quelques discours qui firent frémir la supérieure; je ne sais pourquoi, car ils n'avaient pas de sens; je vis sa colère, et je lui dis: «Chère mère, si vous avez quelque bonté pour moi, pardonnez à ma sœur Thérèse; elle a la tête perdue, elle ne sait ce qu'elle dit, elle ne sait ce qu'elle fait.
– Que je lui pardonne! Je le veux bien; mais que me donnerez-vous?
– Ah! chère mère, serais-je assez heureuse pour avoir quelque chose qui vous plût et qui vous apaisât?»
Elle baissa les yeux, rougit et soupira; en vérité, c'était comme un amant. Elle me dit ensuite, en se rejetant nonchalamment sur moi, comme si elle eût défailli: «Approchez votre front, que je le baise…» Je me penchai, et elle me baisa le front. Depuis ce temps, sitôt qu'une religieuse avait fait quelque faute, j'intercédais pour elle, et j'étais sûre d'obtenir sa grâce par quelque faveur innocente; c'était toujours un baiser ou sur le front ou sur le cou, ou sur les yeux, ou sur les joues, ou sur la bouche, ou sur les mains, ou sur la gorge, ou sur les bras, mais plus souvent sur la bouche; elle trouvait que j'avais l'haleine pure, les dents blanches, et les lèvres fraîches et vermeilles.
En vérité je serais bien belle, si je méritais la plus petite partie des éloges qu'elle me donnait: si c'était mon front, il était blanc, uni et d'une forme charmante; si c'étaient mes yeux, ils étaient brillants; si c'étaient mes joues, elles étaient vermeilles et douces; si c'étaient mes mains, elles étaient petites et potelées; si c'était ma gorge, elle était d'une fermeté de pierre et d'une forme admirable; si c'étaient mes bras, il était impossible de les avoir mieux tournés et plus ronds; si c'était mon cou, aucune des sœurs ne l'avait mieux fait et d'une beauté plus exquise et plus rare: que sais-je tout ce qu'elle me disait! Il y avait bien quelque chose de vrai dans ses louanges; j'en rabattais beaucoup, mais non pas tout. Quelquefois, en me regardant de la tête aux pieds, avec un air de complaisance que je n'ai jamais vu à aucune autre femme, elle me disait: «Non, c'est le plus grand bonheur que Dieu l'ait appelée dans la retraite; avec cette figure-là, dans le monde, elle aurait damné autant d'hommes qu'elle en aurait vu, et elle se serait damnée avec eux. Dieu fait bien tout ce qu'il fait.»
Cependant nous nous avancions vers sa cellule; je me disposais à la quitter; mais elle me prit par la main et me dit: «Il est trop tard pour commencer votre histoire de Sainte-Marie et de Longchamp; mais entrez, vous me donnerez une petite leçon de clavecin.»
Je la suivis. En un moment elle eut ouvert le clavecin, préparé un livre, approché une chaise; car elle était vive. Je m'assis. Elle pensa que je pourrais avoir froid; elle détacha de dessus les chaises un coussin qu'elle posa devant moi, se baissa et me prit les deux pieds, qu'elle mit dessus; ensuite je jouai quelques pièces de Couperin, de Rameau, de Scarlatti: cependant elle avait levé un coin de mon linge de cou, sa main était placée sur mon épaule nue, et l'extrémité de ses doigts posée sur ma gorge. Elle soupirait; elle paraissait oppressée, son haleine s'embarrassait; la main qu'elle tenait sur mon épaule d'abord la pressait fortement, puis elle ne la pressait plus du tout, comme si elle eût été sans force et sans vie; et sa tête tombait sur la mienne. En vérité cette folle-là était d'une sensibilité incroyable, et avait le goût le plus vif pour la musique; je n'ai jamais connu personne sur qui elle eût produit des effets aussi singuliers.
Nous nous amusions ainsi d'une manière aussi simple que douce, lorsque tout à coup la porte s'ouvrit avec violence; j'en eus frayeur, et la supérieure aussi: c'était cette extravagante de Sainte-Thérèse: son vêtement était en désordre, ses yeux étaient troublés; elle nous parcourait l'une et l'autre avec l'attention la plus bizarre; les lèvres lui tremblaient, elle ne pouvait parler. Cependant elle revint à elle, et se jeta aux pieds de la supérieure; je joignis ma prière à la sienne, et j'obtins encore son pardon; mais la supérieure lui protesta, de la manière la plus ferme, que ce serait le dernier, du moins pour des fautes de cette nature, et nous sortîmes toutes deux ensemble.
En retournant dans nos cellules, je lui dis: «Chère sœur, prenez garde, vous indisposerez notre mère; je ne vous abandonnerai pas; mais vous userez mon crédit auprès d'elle; et je serai désespérée de ne pouvoir plus rien ni pour vous ni pour aucune autre. Mais quelles sont vos idées?»
Point de réponse.
«Que craignez-vous de moi?»
Point de réponse.
«Est-ce que notre mère ne peut pas nous aimer également toutes deux?
– Non, non, me répondit-elle avec violence, cela ne se peut; bientôt je lui répugnerai, et j'en mourrai de douleur. Ah! pourquoi êtes-vous venue ici? vous n'y serez pas heureuse longtemps, j'en suis sûre; et je serai malheureuse pour toujours.
– Mais, lui dis-je, c'est un grand malheur, je le sais, que d'avoir perdu la bienveillance de sa supérieure; mais j'en connais un plus grand, c'est de l'avoir mérité: vous n'avez rien à vous reprocher.
– Ah! plût à Dieu!
– Si vous vous accusez en vous-même de quelque faute, il faut la réparer; et le moyen le plus sûr, c'est d'en supporter patiemment la peine.
– Je ne saurais; je ne saurais; et puis, est-ce à elle à m'en punir!
– À elle, sœur Thérèse, à elle! Est-ce qu'on parle ainsi d'une supérieure? Cela n'est pas bien; vous vous oubliez. Je suis sûre que cette faute est plus grave qu'aucune de celles que vous vous reprochez.
– Ah! plût à Dieu! me dit-elle encore, plût à Dieu!..» et nous nous séparâmes; elle pour aller se désoler dans sa cellule, moi pour aller rêver dans la mienne à la bizarrerie des têtes de femmes.
Voilà l'effet de la retraite. L'homme est né pour la société; séparez-le, isolez-le, ses idées se désuniront, son caractère se tournera, mille affections ridicules s'élèveront dans son cœur; des pensées extravagantes germeront dans son esprit, comme les ronces dans une terre sauvage. Placez un homme dans une forêt, il y deviendra féroce; dans un cloître, où l'idée de nécessité se joint à celle de servitude, c'est pis encore. On sort d'une forêt, on ne sort plus d'un cloître; on est libre dans la forêt, on est esclave dans le cloître. Il faut peut-être plus de force d'âme encore pour résister à la solitude qu'à la misère; la misère avilit, la retraite déprave. Vaut-il mieux vivre dans l'abjection que dans la folie? C'est ce que je n'oserais décider; mais il faut éviter l'une et l'autre.
Je voyais croître de jour en jour la tendresse que la supérieure avait conçue pour moi. J'étais sans cesse dans sa cellule, ou elle était dans la mienne: pour la moindre indisposition, elle m'ordonnait l'infirmerie, elle me dispensait des offices, elle m'envoyait coucher de bonne heure, ou m'interdisait l'oraison du matin. Au chœur, au réfectoire, à la récréation, elle trouvait moyen de me donner des marques d'amitié; au chœur s'il se rencontrait un verset qui contînt quelque sentiment affectueux et tendre, elle le chantait en me l'adressant, ou elle me regardait s'il était chanté par une autre; au réfectoire, elle m'envoyait toujours quelque chose de ce qu'on lui servait d'exquis; à la récréation, elle m'embrassait par le milieu du corps, elle me disait les choses les plus douces et les plus obligeantes; on ne lui faisait aucun présent que je ne le partageasse: chocolat, sucre, café, liqueurs, tabac, linge, mouchoirs, quoi que ce fût; elle avait déparé sa cellule d'estampes, d'ustensiles, de meubles et d'une infinité de choses agréables ou commodes, pour en orner la mienne; je ne pouvais presque pas m'en absenter un moment, qu'à mon retour je ne me trouvasse enrichie de quelques dons. J'allais l'en remercier chez elle, et elle en ressentait une joie qui ne peut s'exprimer; elle m'embrassait, me caressait, me prenait sur ses genoux, m'entretenait des choses les plus secrètes de la maison, et se promettait, si je l'aimais, une vie mille fois plus heureuse que celle qu'elle aurait passée dans le monde. Après cela elle s'arrêtait, me regardait avec des yeux attendris, et me disait: «Sœur Suzanne, m'aimez-vous?
– Et comment ferais-je pour ne pas vous aimer? Il faudrait que j'eusse l'âme bien ingrate.
– Cela est vrai.
– Vous avez tant de bonté.
– Dites de goût pour vous…»
Et en prononçant ces mots, elle baissait les yeux; la main dont elle me tenait embrassée me serrait plus fortement; celle qu'elle avait appuyée sur mon genou pressait davantage; elle m'attirait sur elle; mon visage se trouvait placé sur le sien, elle soupirait, elle se renversait sur sa chaise, elle tremblait; on eût dit qu'elle avait à me confier quelque chose, et qu'elle n'osait, elle versait des larmes, et puis elle me disait: «Ah! sœur Suzanne, vous ne m'aimez pas!
– Je ne vous aime pas, chère mère!
– Non.
– Et dites-moi ce qu'il faut que je fasse pour vous le prouver.
– Il faudrait que vous le devinassiez.
– Je cherche, je ne devine rien.»
Cependant elle avait levé son linge de cou, et avait mis une de mes mains sur sa gorge; elle se taisait, je me taisais aussi; elle paraissait goûter le plus grand plaisir. Elle m'invitait à lui baiser le front, les joues, les yeux et la bouche; et je lui obéissais: je ne crois pas qu'il y eût du mal à cela; cependant son plaisir s'accroissait; et comme je ne demandais pas mieux que d'ajouter à son bonheur d'une manière innocente, je lui baisais encore le front, les joues, les yeux et la bouche. La main qu'elle avait posée sur mon genou se promenait sur tous mes vêtements, depuis l'extrémité de mes pieds jusqu'à ma ceinture, me pressant tantôt dans un endroit, tantôt dans un autre; elle m'exhortait en bégayant, et d'une voix altérée et basse, à redoubler mes caresses, je les redoublais; enfin il vint un moment, je ne sais si ce fut de plaisir ou de peine, où elle devint pâle comme la mort; ses yeux se fermèrent, tout son corps se tendit avec violence, ses lèvres se pressèrent d'abord, elles étaient humectées comme d'une mousse légère; puis sa bouche s'entr'ouvrit, et elle me parut mourir en poussant un profond soupir. Je me levai brusquement; je crus qu'elle se trouvait mal; je voulais sortir, appeler. Elle entr'ouvrit faiblement les yeux, et me dit d'une voix éteinte: «Innocente! ce n'est rien; qu'allez-vous faire? arrêtez…» Je la regardai avec des yeux hébétés, incertaine si je resterais ou si je sortirais. Elle rouvrit encore les yeux; elle ne pouvait plus parler du tout; elle me fit signe d'approcher et de me replacer sur ses genoux. Je ne sais ce qui se passait en moi; je craignais, je tremblais, le cœur me palpitait, j'avais de la peine à respirer, je me sentais troublée, oppressée, agitée, j'avais peur; il me semblait que les forces m'abandonnaient et que j'allais défaillir; cependant je ne saurais dire que ce fût de la peine que je ressentisse. J'allais près d'elle; elle me fit signe encore de la main de m'asseoir sur ses genoux; je m'assis; elle était comme morte, et moi comme si j'allais mourir. Nous demeurâmes assez longtemps l'une et l'autre dans cet état singulier. Si quelque religieuse fût survenue, en vérité elle eût été bien effrayée; elle aurait imaginé, ou que nous nous étions trouvées mal, ou que nous nous étions endormies. Cependant cette bonne supérieure, car il est impossible d'être si sensible et de n'être pas bonne, me parut revenir à elle. Elle était toujours renversée sur sa chaise; ses yeux étaient toujours fermés, mais son visage s'était animé des plus belles couleurs: elle prenait une de mes mains qu'elle baisait, et moi je lui disais: «Ah! chère mère, vous m'avez bien fait peur…» Elle sourit doucement, sans ouvrir les yeux. «Mais est-ce que vous n'avez pas souffert?
– Non.
– Je l'ai cru.
– L'innocente! ah! la chère innocente! qu'elle me plaît!»
En disant ces mots, elle se releva, se remit sur sa chaise, me prit à brasse-corps et me baisa sur les joues avec beaucoup de force, puis elle me dit: «Quel âge avez-vous?
– Je n'ai pas encore vingt ans.
– Cela ne se conçoit pas.
– Chère mère, rien n'est plus vrai.
– Je veux savoir toute votre vie; vous me la direz?
– Oui, chère mère.
– Toute?
– Toute.
– Mais on pourrait venir; allons nous mettre au clavecin: vous me donnerez leçon.»
Nous y allâmes; mais je ne sais comment cela se fit; les mains me tremblaient, le papier ne me montrait qu'un amas confus de notes; je ne pus jamais jouer. Je le lui dis, elle se mit à rire, elle prit ma place, mais ce fut pis encore; à peine pouvait-elle soutenir ses bras.
«Mon enfant, me dit-elle, je vois que tu n'es guère en état de me montrer ni moi d'apprendre; je suis un peu fatiguée, il faut que je me repose, adieu. Demain, sans plus tarder, je veux savoir tout ce qui s'est passé dans cette chère petite âme-là; adieu…»
Les autres fois, quand je sortais, elle m'accompagnait jusqu'à sa porte, elle me suivait des yeux tout le long du corridor jusqu'à la mienne; elle me jetait un baiser avec les mains, et ne rentrait chez elle que quand j'étais rentrée chez moi; cette fois-ci, à peine se leva-t-elle; ce fut tout ce qu'elle put faire que de gagner le fauteuil qui était à côté de son lit; elle s'assit, pencha la tête sur son oreiller, me jeta le baiser avec les mains; ses yeux se fermèrent, et je m'en allai.
Ma cellule était presque vis-à-vis la cellule de Sainte-Thérèse; la sienne était ouverte; elle m'attendait, elle m'arrêta et me dit:
«Ah! Sainte-Suzanne, vous venez de chez notre mère?
– Oui, lui dis-je.
– Vous y êtes demeurée longtemps?
– Autant qu'elle l'a voulu.
– Ce n'est pas là ce que vous m'aviez promis.
– Je ne vous ai rien promis.
– Oseriez-vous me dire ce que vous y avez fait?..»
Quoique ma conscience ne me reprochât rien, je vous avouerai cependant, monsieur le marquis, que sa question me troubla; elle s'en aperçut, elle insista, et je lui répondis: «Chère sœur, peut-être ne m'en croiriez-vous pas; mais vous en croirez peut-être notre chère mère, et je la prierai de vous en instruire.
– Ma chère Sainte-Suzanne, me dit-elle avec vivacité, gardez-vous-en bien; vous ne voulez pas me rendre malheureuse; elle ne me le pardonnerait jamais; vous ne la connaissez pas: elle est capable de passer de la plus grande sensibilité jusqu'à la férocité; je ne sais pas ce que je deviendrais. Promettez-moi de ne lui rien dire.
– Vous le voulez?
– Je vous le demande à genoux. Je suis désespérée, je vois bien qu'il faut me résoudre; je me résoudrai. Promettez-moi de ne lui rien dire…»
Je la relevai, je lui donnai ma parole; elle y compta, elle eut raison; et nous nous renfermâmes, elle dans sa cellule, moi dans la mienne.
Rentrée chez moi, je me trouvai rêveuse; je voulus prier, et je ne le pus pas; je cherchai à m'occuper; je commençai un ouvrage que je quittai pour un autre, que je quittai pour un autre encore; mes mains s'arrêtaient d'elles-mêmes, et j'étais comme imbécile; jamais je n'avais rien éprouvé de pareil. Mes yeux se fermèrent d'eux-mêmes; je fis un petit sommeil, quoique je ne dorme jamais le jour. Réveillée, je m'interrogeai sur ce qui s'était passé entre la supérieure et moi, je m'examinai; je crus entrevoir en examinant encore… mais c'était des idées si vagues, si folles, si ridicules, que je les rejetai loin de moi. Le résultat de mes réflexions, c'est que c'était peut-être une maladie à laquelle elle était sujette; puis il m'en vint une autre, c'est que peut-être cette maladie se gagnait, que Sainte-Thérèse l'avait prise, et que je la prendrais aussi.
Le lendemain, après l'office du matin, notre supérieure me dit: «Sainte-Suzanne, c'est aujourd'hui que j'espère savoir tout ce qui vous est arrivé; venez…»
J'allai. Elle me fit asseoir dans son fauteuil à côté de son lit, et elle se mit sur une chaise un peu plus basse; je la dominais un peu, parce que je suis plus grande, et que j'étais plus élevée. Elle était si proche de moi, que mes deux genoux étaient entrelacés dans les siens, et elle était accoudée sur son lit. Après un petit moment de silence, je lui dis:
«Quoique je sois bien jeune, j'ai bien eu de la peine; il y aura bientôt vingt ans que je suis au monde, et vingt ans que je souffre. Je ne sais si je pourrai vous dire tout, et si vous aurez le cœur de l'entendre; peines chez mes parents, peines au couvent de Sainte-Marie, peines au couvent de Longchamp, peines partout; chère mère, par où voulez-vous que je commence?
– Par les premières.
– Mais, lui dis-je, chère mère, cela sera bien long et bien triste, et je ne voudrais pas vous attrister si longtemps.
– Ne crains rien; j'aime à pleurer: c'est un état délicieux pour une âme tendre, que celui de verser des larmes. Tu dois aimer à pleurer aussi; tu essuieras mes larmes, j'essuierai les tiennes, et peut-être nous serons heureuses au milieu du récit de tes souffrances; qui sait jusqu'où l'attendrissement peut nous mener?..» Et en prononçant ces derniers mots, elle me regarda de bas en haut avec des yeux déjà humides; elle me prit les deux mains; elle s'approcha de moi plus près encore, en sorte qu'elle me touchait et que je la touchais.
«Raconte, mon enfant, dit-elle; j'attends, je me sens les dispositions les plus pressantes à m'attendrir; je ne pense pas avoir eu de ma vie un jour plus compatissant et plus affectueux…»
Je commençai donc mon récit à peu près comme je viens de vous l'écrire. Je ne saurais vous dire l'effet qu'il produisit sur elle, les soupirs qu'elle poussa, les pleurs qu'elle versa, les marques d'indignation qu'elle donna contre mes cruels parents, contre les filles affreuses de Sainte-Marie, contre celles de Longchamp; je serais bien fâchée qu'il leur arrivât la plus petite partie des maux qu'elle leur souhaita; je ne voudrais pas avoir arraché un cheveu de la tête de mon plus cruel ennemi. De temps en temps elle m'interrompait, elle se levait, elle se promenait, puis elle se rasseyait à sa place; d'autres fois elle levait les mains et les yeux au ciel, et puis elle se cachait la tête entre mes genoux. Quand je lui parlai de ma scène du cachot, de celle de mon exorcisme, de mon amende honorable, elle poussa presque des cris; quand je fus à la fin, je me tus, et elle resta pendant quelque temps le corps penché sur son lit, le visage caché dans sa couverture et les bras étendus au-dessus de sa tête; et moi, je lui disais: «Chère mère, je vous demande pardon de la peine que je vous ai causée; je vous en avais prévenue, mais c'est vous qui l'avez voulu…» Et elle ne me répondait que par ces mots:
«Les méchantes créatures! les horribles créatures! Il n'y a que dans les couvents où l'humanité puisse s'éteindre à ce point. Lorsque la haine vient à s'unir à la mauvaise humeur habituelle, on ne sait plus où les choses seront portées. Heureusement je suis douce; j'aime toutes mes religieuses; elles ont pris, les unes plus, les autres moins de mon caractère, et toutes elles s'aiment entre elles. Mais comment cette faible santé a-t-elle pu résister à tant de tourments? Comment tous ces petits membres n'ont-ils pas été brisés? Comment toute cette machine délicate n'a-t-elle pas été détruite? Comment l'éclat de ces yeux ne s'est-il pas éteint dans les larmes? Les cruelles! serrer ces bras avec des cordes!..» Et elle me prenait les bras, et elle les baisait. «Noyer de larmes ces yeux!..» Et elle les baisait. «Arracher la plainte et le gémissement de cette bouche!..» Et elle la baisait. «Condamner ce visage charmant et serein à se couvrir sans cesse des nuages de la tristesse!..» Et elle le baisait. «Faner les roses de ces joues!..» Et elle les flattait de la main et les baisait. «Déparer cette tête! arracher ces cheveux! charger ce front de souci!..» Et elle baisait ma tête, mon front, mes cheveux… «Oser entourer ce cou d'une corde, et déchirer ces épaules avec des pointes aiguës!..» Et elle écartait mon linge de cou et de tête; elle entr'ouvrait le haut de ma robe; mes cheveux tombaient épars sur mes épaules découvertes; ma poitrine était à demi nue, et ses baisers se répandaient sur mon cou, sur mes épaules découvertes et sur ma poitrine à demi nue.
Je m'aperçus alors, au tremblement qui la saisissait, au trouble de son discours, à l'égarement de ses yeux et de ses mains, à son genou qui se pressait entre les miens, à l'ardeur dont elle me serrait et à la violence dont ses bras m'enlaçaient, que sa maladie ne tarderait pas à la prendre. Je ne sais ce qui se passait en moi; mais j'étais saisie d'une frayeur, d'un tremblement et d'une défaillance qui me vérifiaient le soupçon que j'avais eu que son mal était contagieux.
Je lui dis: «Chère mère, voyez dans quel désordre vous m'avez mise! si l'on venait…
– Reste, reste, me dit-elle d'une voix oppressée; on ne viendra pas…»
Cependant je faisais effort pour me lever et m'arracher d'elle, et je lui disais: «Chère mère, prenez garde, voilà votre mal qui va vous prendre. Souffrez que je m'éloigne…»
Je voulais m'éloigner; je le voulais, cela est sûr; mais je ne le pouvais pas. Je ne me sentais aucune force, mes genoux se dérobaient sous moi. Elle était assise, j'étais debout, elle m'attirait, je craignis de tomber sur elle et de la blesser; je m'assis sur le bord de son lit et je lui dis:
«Chère mère, je ne sais ce que j'ai, je me trouve mal.
– Et moi aussi, me dit-elle; mais repose-toi un moment, cela passera, ce ne sera rien…»
En effet, ma supérieure reprit du calme, et moi aussi. Nous étions l'une et l'autre abattues; moi, la tête penchée sur son oreiller; elle, la tête posée sur un de mes genoux, le front placé sur une de mes mains. Nous restâmes quelques moments dans cet état; je ne sais ce qu'elle pensait; pour moi, je ne pensais à rien, je ne le pouvais, j'étais d'une faiblesse qui m'occupait tout entière. Nous gardions le silence, lorsque la supérieure le rompit la première; elle me dit: «Suzanne, il m'a paru par ce que vous m'avez dit de votre première supérieure qu'elle vous était fort chère.
– Beaucoup.
– Elle ne vous aimait pas mieux que moi, mais elle était mieux aimée de vous… Vous ne me répondez pas?
– J'étais malheureuse, elle adoucissait mes peines.
– Mais d'où vient votre répugnance pour la vie religieuse? Suzanne, vous ne m'avez pas tout dit.
– Pardonnez-moi, madame.
– Quoi! il n'est pas possible, aimable comme vous l'êtes, car, mon enfant, vous l'êtes beaucoup, vous ne savez pas combien, que personne ne vous l'ait dit.