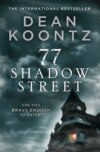Kitabı oku: «La vie infernale», sayfa 12
Mais elle, secouant la tête:
– Mieux vaut finir, fit-elle, après je n’aurais plus la courage de reprendre.
Et elle continua:
– Un tel voyage, pour moi qui n’étais jamais allée plus loin que Versailles, eût dû être un long enchantement…
Notre wagon, le wagon de M. de Chalusse, était une de ces dispendieuses fantaisies que peu de millionnaires se permettent… Il se composait d’un salon, qui était un chef-d’œuvre de goût et de luxe, et de deux compartiments, un à chaque bout, formant deux chambres avec leurs lits de repos…
Et tout cela, le comte ne se lassait pas de me le répéter, était à moi, à moi seule…
C’est appuyée sur des coussins de velours que je regardais par la portière surgir et s’évanouir aussitôt les paysages… Penché près de moi, M. de Chalusse me nommait toutes les villes et les moindres villages que nous traversions: Brunoy, Melun, Fontainebleau, Villeneuve, Sens, Laroche…
Et à toutes les stations, dès qu’il y avait cinq minutes d’arrêt, les domestiques qui voyageaient dans la berline accouraient nous demander nos ordres…
A Lyon, au milieu de la nuit, un souper nous attendait, qu’on servit dès que nous descendîmes de wagon… puis on nous avertit de remonter, et le train repartit…
Quels émerveillements pour une pauvre petite ouvrière de quinze ans, qui, la veille encore, bornait ses plus hautes ambitions à un gain de cinq francs par jour!.. Quel foudroyant changement!.. Le comte m’avait fait me retirer dans une des chambres du wagon, et là, le sommeil me gagnant, je finissais par perdre l’exacte notion de moi, ne sachant plus distinguer la réalité du rêve.
Cependant, une inquiétude m’obsédait, dominant l’étourdissement: l’incertitude de ce qui m’attendait au bout de cette longue route.
M. de Chalusse restait bon et affectueux avec moi; mais il avait repris son flegme habituel, et mon bon sens me disait qu’à le questionner je perdrais mes peines.
Enfin, le lendemain, après trente heures de chemin de fer, nous remontâmes dans la berline attelée de chevaux de poste, et peu après M. de Chalusse me dit:
– Voici Cannes… Nous sommes arrivés.
Dans cette ville, une des plus charmantes qui se mirent aux flots bleus de la Méditerranée, le comte possédait un véritable palais, au milieu d’un bois d’orangers, à deux pas de la mer, en face de ces deux corbeilles de myrtes et de lauriers roses, qu’on appelle les îles Sainte-Marguerite.
Il se proposait d’y passer quelques mois, le temps qu’il faudrait à mon apprentissage du luxe.
C’est que, dans ma situation nouvelle, j’étais incroyablement gauche et sauvage, d’une timidité extraordinaire, que redoublait mon orgueil, et si dépaysée que j’en étais à ne plus savoir, pour ainsi dire, me servir de mes mains, ni marcher, ni me tenir. Tout m’embarrassait et m’effarouchait. Et, pour comble, j’avais conscience de mon étrangeté, je voyais mes maladresses et que je manquais à tous les usages, je comprenais que je ne parlais même pas la langue des gens qui m’entouraient.
Et cependant, le souvenir de cette petite ville de Cannes me sera toujours cher.
C’est là que j’ai entrevu pour la première fois celui qui maintenant est mon unique ami en ce monde. Il ne m’avait pas adressé la parole, mais à la commotion que je ressentis là, dans la poitrine, quand nos yeux se rencontrèrent, je compris qu’il aurait sur ma vie une influence décisive.
L’événement m’a prouvé que je ne m’étais pas trompée.
Dans le moment, cependant, je ne sus rien de lui. Pour rien au monde je n’eusse questionné. Et c’est par hasard que j’appris qu’il habitait Paris, qu’il était avocat, qu’il se nommait Pascal, et qu’il était venu dans le Midi pour accompagner un de ses amis malade…
D’un seul mot, à cette époque, le comte de Chalusse pouvait assurer le bonheur de ma vie et de la sienne… ce mot, il ne le prononça pas.
Il fut pour moi le meilleur et le plus indulgent des pères, et souvent j’ai été touchée jusqu’aux larmes de son ingénieuse tendresse.
Mais s’il était à genoux devant le moindre de mes désirs, il ne m’accordait pas sa confiance.
Il y avait entre nous un secret qui était comme un mur de glace.
Je m’accoutumais cependant à ma nouvelle vie, et mon esprit reprenait son équilibre, quand un soir, le comte rentra plus bouleversé, s’il est possible, que le jour de ma sortie de l’hospice.
Il appela son valet de chambre, et d’un ton qui n’admettait pas de réplique:
– Je veux partir, dit-il, je veux être parti avant une heure, procurez-vous des chevaux de poste à l’instant.
Et comme mes yeux, à défaut de ma bouche, interrogeaient:
– Il le faut, ajouta-t-il, hésiter serait folie, chaque minute ajoute pour ainsi dire au péril qui nous menace.
J’étais bien jeune, monsieur, inexpérimentée, toute ignorante de la vie; mais la souffrance, l’isolement, la certitude de n’avoir à compter que sur moi avaient donné à mon intelligence cette maturité précoce qui est le lot des enfants des pauvres.
Prévenue, aussitôt admise près de M. de Chalusse, qu’il me faisait mystère d’une certaine chose, je m’étais mise à l’étudier avec cette patiente sagacité de l’enfant, redoutable parce qu’on ne la soupçonne pas, et j’en étais arrivée à cette conviction qu’une perpétuelle terreur troublait sa vie.
Était-ce donc pour lui qu’il tremblait, ce grand seigneur que son titre, ses relations et sa fortune faisaient si puissant? Évidemment non. C’était donc pour moi? Sans doute! Mais pourquoi?..
Bientôt il me fut prouvé qu’il me cachait, ou que du moins il empêchait par tous les moyens en son pouvoir, que ma présence près de lui ne fût connue hors d’un cercle très-restreint.
Notre brusque départ de Cannes devait justifier toutes mes conjectures.
Ce fut à proprement parler une fuite.
Nous nous mîmes en route à onze heures du soir, par une pluie battante, avec les premiers chevaux qu’on pût se procurer.
Le seul valet de chambre de M. de Chalusse nous accompagnait; non Casimir, celui qui m’accusait, il n’y a qu’un instant, mais un autre, un vieux et digne serviteur, mort depuis, malheureusement, et qui avait toute la confiance de son maître.
Les autres domestiques, congédiés avec une gratification princière, devaient se disperser le lendemain.
Nous ne revenions pas sur Paris; nous nous dirigions vers la frontière italienne.
Il faisait encore nuit noire quand nous arrivâmes à Nice, devenue depuis peu une ville française. Notre voiture s’arrêta sur le port, le postillon détela ses chevaux, et nous restâmes là…
Le valet de chambre s’était éloigné en courant. Il ne reparut que deux heures plus tard, annonçant qu’il avait eu bien de la peine à se procurer ce que souhaitait M. le comte, mais qu’enfin, en prodiguant l’argent il avait levé toutes les difficultés.
Ce que voulait M. de Chalusse, c’était un navire prêt à prendre la mer. Bientôt celui qu’avait arrêté le valet de chambre vint se ranger le long du quai. Notre berline fut hissée sur le pont et nous mîmes à la voile… le jour se levait.
Le surlendemain, nous étions à Gênes, cachés sous un faux nom dans une hôtellerie du dernier ordre.
Depuis l’instant où le comte avait senti la mer sous ses pieds, il m’avait paru moins violemment agité, mais il était loin d’être calme. Il tremblait d’être poursuivi et rejoint, les précautions dont il s’entourait le prouvaient. Un malfaiteur ne prend pas plus de peine pour dépister la police lancée sur ses traces.
Un fait positif aussi, c’est que, seule, je causais les transes incessantes de M. de Chalusse. Même, une fois je l’entendis délibérer avec son valet de chambre si on ne m’habillerait pas en homme. La difficulté de se procurer un costume empêcha surtout l’exécution de ce projet.
Pour ne négliger aucune circonstance, je dois dire que le domestique ne partageait pas les inquiétudes de son maître.
A trois ou quatre reprises, je l’entendis qui disait:
– M. le comte est trop bon de se faire ainsi du mauvais sang… Elle ne nous rattrapera pas… Nous a-t-elle seulement suivis?.. Sait-elle même quelque chose?.. Et, à tout mettre au pis, que peut-elle?..
Elle!.. qui, elle?.. Voilà ce que je m’épuisais à chercher.
Je dois, du reste, vous l’avouer, monsieur: positive de ma nature et peu accessible aux imaginations romanesques, je finissais par me persuader que le péril existait surtout dans l’esprit du comte, et qu’il se l’exagérait singulièrement s’il ne le créait pas.
Il n’en souffrait pas moins, et la preuve c’est que le mois qui suivit fut employé en courses haletantes d’un bout à l’autre de l’Italie.
Le mois de mai finissait quand M. de Chalusse crut pouvoir rentrer en France. Nous rentrâmes par le Mont-Cenis, et tout d’une traite nous allâmes jusqu’à Lyon.
C’est là qu’après un séjour de quarante-huit heures employées en courses, le comte m’apprit que nous allions nous séparer pour un temps, que la prudence exigeait ce sacrifice…
Et aussitôt, sans me laisser placer une parole, il entreprit de me démontrer les avantages de ce parti.
J’étais d’une ignorance extrême, et il comptait que je profiterais de notre séparation pour hausser mon éducation au niveau de ma position sociale.
Il avait donc arrangé, me dit-il, que j’entrerais comme pensionnaire aux dames de Sainte-Marthe, une maison d’éducation qui a dans le Rhône la célébrité du couvent des Oiseaux à Paris.
Il ajouta que par prudence encore il se priverait de me venir visiter. Il me fit jurer de ne jamais prononcer son nom. Je devais envoyer les lettres que je lui écrirais à une adresse qu’il me donna, et lui-même signerait d’un nom supposé celles qu’il m’adresserait. Enfin, il me dit encore que la directrice de Sainte-Marthe avait son secret, et que je pouvais me fier à elle…
Il était si inquiet, si agité, si visiblement désespéré le jour où cette grave détermination fut prise, que véritablement je le crus… fou.
N’importe, je répondis que j’obéirais, et la vérité est que j’étais loin d’être affligée.
L’existence, près de M. de Chalusse, était d’une tristesse mortelle. Je dépérissais d’ennui, moi toujours accoutumée au travail, au mouvement, au bruit. Et je me sentais tout émue de joie, à l’idée que j’allais me trouver au milieu de jeunes filles de mon âge que j’aimerais et qui m’aimeraient.
Malheureusement, M. de Chalusse, qui prévoyait tout, avait oublié une circonstance qui devait faire des deux années que j’ai passées à Sainte-Marthe, une lente et cruelle agonie.
Je fus d’abord amicalement accueillie de mes compagnes… Une «nouvelle» qui rompt la monotonie est toujours bien venue. Mais on ne tarda pas à me demander comment je m’appelais, et je n’avais d’autre nom à donner que celui de Marguerite… On s’étonna, on voulut savoir ce que faisaient mes parents… je ne sais pas mentir, j’avouai que je ne connaissais ni mon père ni ma mère…
Dès lors, «la bâtarde,» on m’avait surnommée ainsi, fut reléguée à l’écart… On s’éloigna de moi pendant les récréations… Ce fut à qui ne serait pas placée près de moi à l’étude… à la leçon de piano, celle qui devait jouer après moi affectait d’essuyer soigneusement le clavier.
Bravement, j’essayai de lutter contre cette réprobation injuste, et de la vaincre. Inutiles efforts!.. J’étais trop différente de toutes ces jeunes filles… D’ailleurs, j’avais commis une imprudence énorme… J’avais été assez simple pour laisser voir à mes compagnes les magnifiques bijoux dont M. de Chalusse m’avait comblée, et que je ne portais jamais… En deux occasions, j’avais prouvé que je disposais à moi seule de plus d’argent que toutes les élèves ensemble…
Pauvre, on m’eût peut-être fait l’aumône d’une hypocrite pitié… Riche, je devins l’ennemie… Ce fut la guerre, et une de ces guerres sans merci comme il s’en voit parfois au fond des couvents…
Je vous épouvanterais, monsieur, si je vous disais quels raffinements de cruauté inventèrent ces filles de hobereaux pour satisfaire la haine que leur inspirait l’intruse…
Je pouvais me plaindre… je jugeais cela au-dessous de moi…
Comme autrefois, je renfermai en moi le secret de mes souffrances, et je mis mon orgueil à ne montrer jamais qu’un visage placide et souriant, disant à mes ennemies que mon cœur planait si haut au-dessus d’elles, que je les défiais de l’atteindre.
Le travail fut mon refuge et ma consolation; je m’y jetai avec l’âpreté du désespoir.
Cependant je serais sans doute morte à Sainte-Marthe sans une circonstance futile.
Un jour de composition, j’eus une discussion avec ma plus implacable ennemie: elle se nommait Anaïs de Rochecote.
J’avais mille fois raison, je ne voulais pas céder, la directrice n’osait pas me donner tort.
Furieuse, Anaïs écrivit à sa mère je ne sais quels mensonges. Mme de Rochecote intéressa les mères de cinq ou six élèves à la querelle de sa fille, et un soir, ces dames vinrent toutes ensemble, noblement et courageusement demander l’expulsion de «la bâtarde.» Il était inqualifiable, disaient-elles, inouï, monstrueux, qu’on osât admettre dans la maison d’éducation de leurs enfants, une fille comme moi, sans nom, issue on ne savait d’où, et qui, pour comble, humiliait les autres de ses richesses suspectes.
La directrice voulut prendre mon parti; ces dames déclarèrent que si je n’étais pas renvoyée elles retireraient leurs filles… C’était à prendre ou à laisser…
Je ne pouvais pas n’être pas sacrifiée…
Prévenu par le télégraphe, M. de Chalusse accourut, et le lendemain même, je quittais Sainte-Marthe au milieu des huées!..
X
Déjà, le matin même, le juge de paix avait pu voir de quelle virile énergie le malheur avait trempé Mlle Marguerite, cette belle jeune fille si timide et si fière.
Il n’en fut pas moins surpris de l’explosion soudaine de sa haine.
Car elle haïssait. Le seul frémissement de sa voix, en prononçant le nom d’Anaïs de Rochecote, disait bien qu’elle était de ces âmes altières qui ne sauraient oublier une offense.
Nulle trace ne restait de sa fatigue si grande: elle s’était redressée, et le souvenir de l’odieux et lâche affront dont elle avait été victime, empourprait sa joue et allumait des éclairs au fond de ses grands yeux noirs.
– Cette atroce humiliation n’a guère plus d’un an de date, monsieur, reprit-elle, et maintenant il me reste peu de chose à vous apprendre.
Mon expulsion de Sainte-Marthe transporta d’indignation M. de Chalusse. Il savait une chose que j’ignorais, c’est que Mme de Rochecote, cette femme si sévère et si intraitable, était absolument décriée pour ses mœurs…
La première inspiration du comte fut de lutter et de se venger, car, avec ses apparences glaciales, il était la violence même. J’eus toutes les peines du monde à l’empêcher d’aller provoquer le général de Rochecote, qui vivait encore à cette époque.
Cependant il importait de prendre un parti pour moi.
M. de Chalusse me proposa de me chercher une autre maison d’éducation, me promettant, instruit qu’il était par une désolante expérience, de prendre assez de précautions pour assurer mon repos.
Mais je l’interrompis, dès les premiers mots, pour lui dire que je rentrerais à mon atelier de reliure plutôt que de hasarder une nouvelle épreuve.
Et ce que je disais, je le pensais.
Un subterfuge indigne de moi – une supposition de nom, par exemple – pouvait seul me mettre à l’abri des avanies de Sainte-Marthe. Or, je me savais incapable de soutenir un mensonge… je sentais qu’au premier soupçon je confesserais tout.
Ma fermeté eut cet avantage de rendre quelque résolution à M. de Chalusse.
Il s’écria, en jurant – ce qui ne lui arrivait presque jamais – que j’avais mille fois raison, qu’il était las, à la fin, de trembler et de se cacher, et qu’il allait prendre ses mesures pour me garder près de lui.
– Ainsi, conclut-il en m’embrassant, le sort en est jeté, et il arrivera ce qui pourra!..
Mais ces mesures dont il parlait exigeaient un certain délai, et en attendant il décida qu’il m’établirait à Paris, la seule ville où on puisse échapper aux indiscrétions.
Il acheta donc pour moi, non loin du Luxembourg, une maison petite et commode, avec un jardinet sur le devant, et il m’y installa avec deux vieilles bonnes et un domestique de confiance.
Comme il me fallait, en outre, un chaperon, il se mit en quête et m’amena Mme Léon.
Le juge de paix, à ce nom, releva un peu la tête, enveloppant Mlle Marguerite d’un regard perspicace.
Il espérait que quelque chose en elle lui apprendrait ce qu’elle pensait au juste de la femme de charge, et quel degré de confiance elle lui accordait.
Mais elle fut impénétrable.
– Après tant de traverses, poursuivit-elle, j’ai pu croire un instant que la destinée se lassait.
Oui, je l’ai cru, et quoi qu’il advienne, les mois que j’ai passés dans cette chère maison seront les plus heureux de ma vie…
Je m’y plus tout d’abord; j’y trouvais la solitude et la paix…
Mais quelle ne fut pas ma stupeur, le lendemain même de mon installation, lorsque descendant à mon petit jardin, j’aperçus debout, arrêté devant la grille, ce jeune homme que j’avais entrevu à Cannes, et dont la physionomie, après plus de deux ans, restait dans ma mémoire comme l’expression achevée des sentiments les meilleurs et les plus nobles.
J’eus comme un éblouissement. Quel mystérieux hasard l’avait fait s’arrêter là, précisément à cette heure?..
Ce qui est sûr, c’est qu’il me reconnut comme je le reconnaissais. Il me salua en souriant un peu, et je m’enfuis, indignée surtout de ne me point sentir d’indignation de son audace.
Je fis beaucoup de projets ce jour-là. Mais le lendemain, à la même heure, j’étais cachée derrière une persienne, et je le vis, comme la veille, s’arrêter et regarder avec une évidente anxiété…
Bientôt je sus qu’il demeurait tout près de là, avec sa mère, une femme veuve, et que chaque jour deux fois, en allant au Palais et en revenant, il passait devant ma maison.
Elle était devenue cramoisie, elle baissait les yeux, elle balbutiait…
Puis, tout à coup, rougissant de rougir, elle redressa le front, et d’une voix plus ferme:
– Vous dirai-je, monsieur, notre simple histoire?.. A quoi bon!.. De tout ce qui s’est passé, je n’aurais rien à cacher à ma mère, si j’avais une mère. Quelques causeries furtives, quelques lettres échangées, un serrement de main à travers la grille… et ce fut tout.
Cependant, j’eus un tort grave et irréparable… je manquai à la règle de ma vie: la franchise, et j’en suis cruellement punie. Je ne dis rien à M. de Chalusse… je n’osai pas.
Je souffrais de ma dissimulation, je me jurais de tout avouer, mais je m’ajournais de semaine en semaine… Chaque soir, je me disais: «Ce sera pour demain…» et le lendemain: «Allons, je m’accorde encore cette journée…»
C’est que je connaissais les préjugés aristocratiques du comte, je savais quels grands projets d’établissement il caressait pour moi, et il était l’arbitre de mon avenir.
Et d’un autre côté, Pascal ne cessait de me répéter:
– De grâce, mon amie, ne parlez pas… ma position grandit… Il ne faut qu’une occasion pour la mettre en évidence. D’un jour à l’autre je puis être célèbre… Alors, j’irai voir votre tuteur. Mais au nom du ciel, attendez!
Je m’expliquais ces prières de Pascal. Je lisais dans sa pensée que l’immense fortune de M. de Chalusse l’épouvantait et qu’il avait peur d’être taxé de cupidité…
J’attendis donc, avec cette angoisse secrète qui poursuit jusqu’au milieu du bonheur ceux qui ont toujours été malheureux… Je me tus, pleine de défiances, me disant qu’un si beau rêve n’était pas fait pour moi, et qu’il allait s’envoler.
Il s’envola bientôt.
Un matin, j’entendis une voiture s’arrêter à ma porte, et peu après le comte de Chalusse parut, plus froid et plus soucieux que de coutume.
– Tout est prêt pour vous recevoir à l’hôtel de Chalusse, Marguerite, me dit-il, venez!..
Il m’offrit cérémonieusement la main, et je le suivis, sans pouvoir faire avertir Pascal, car je m’étais toujours cachée de Mme Léon…
Une chétive espérance me soutenait.
Je pensais que les précautions prises par M. de Chalusse dissiperaient un peu les ténèbres et me donneraient au moins une idée de ce vague danger dont il me menaçait toujours. Mais non. Il s’était borné, ostensiblement du moins, à remplacer tous ses gens et à obtenir du conseil de l’hospice mon émancipation…
Le juge de paix eut un mouvement de surprise.
– Comment!.. vous êtes émancipée, fit-il.
– Oui, monsieur… Le comte m’a dit que ses hommes d’affaires n’avaient trouvé que ce moyen d’atteindre un certain but qui ne m’a pas été expliqué…
– En effet, murmura le juge, oui, peut-être…
Il s’inclina et Mlle Marguerite reprit:
– Notre existence, dans ce grand hôtel, redevint ce qu’elle avait été à Cannes… plus retirée même s’il est possible… Le comte avait considérablement vieilli en trois ans… Il était visible qu’il pliait sous le faix de quelque mystérieux chagrin…
– Je vous condamne à une triste jeunesse, me disait-il parfois, mais cela ne durera pas éternellement… patience, patience!..
M’aimait-il sincèrement? Je le crois. Mais son affection se traduisait d’une façon étrange et désordonnée. Par certains jours, il avait dans la voix une si vive expression de tendresse, que j’en étais remuée… D’autres fois, ses yeux chargés de haine m’effrayaient. Je l’ai vu sévère avec moi jusqu’à la brutalité… et l’instant d’après il me demandait pardon, il faisait atteler et me conduisait chez des joailliers, où il me forçait de choisir les plus brillantes parures… Léon prétend que j’en ai là-haut pour plus de cent mille écus.
Parfois je me suis demandée si c’était bien à moi que s’adressaient ces caresses et ces rigueurs, ou si je n’étais pour lui que l’ombre décevante, le spectre, pour ainsi dire, d’une personne absente…
Ce qui est positif, c’est que souvent il me priait de m’habiller ou de me coiffer de telle façon qu’il m’indiquait. Il me demandait de porter des robes d’une certaine couleur ou de me servir d’un parfum particulier qu’il me donnait.
Vingt fois, lorsque j’allais et venais autour de lui, il lui est arrivé de me crier:
– Marguerite! je t’en prie!.. reste, reste comme tu es là…
Je restais… l’illusion s’évanouissait… Bientôt il lui échappait un sanglot ou un juron, et d’une voix irritée il me criait:
– Va-t-en!..
Le juge de paix ne détachait plus les yeux de sa bague; on eût dit qu’elle le fascinait. Son visage trahissait une commisération profonde, et par moment il hochait la tête d’un air soucieux.
L’idée lui venait que cette malheureuse jeune fille avait été la victime, non d’un fou précisément, mais d’un de ces maniaques redoutables qui ont juste assez de raison et de suite dans les idées pour combiner les tortures qu’ils infligent à ceux qui les entourent.
Plus lentement, afin de mieux fixer l’attention du vieux juge, Mlle Marguerite reprit:
– Si je rappelais à M. de Chalusse une femme jadis aimée, cette femme devait être ma mère. Je dis «devait être» parce que je ne suis pas sûre.
Saisir et suivre le fil de la vérité, avec M. de Chalusse, était presque impossible, tant ses propos offraient de contradictions et d’incohérences, volontaires ou calculées… Il semblait prendre à tâche et se faire un méchant plaisir de dérouter et d’égarer mes conjectures, détruisant le matin les conjectures qu’il avait fait naître la veille au soir.
– C’est bien cela, murmurait le juge de paix, c’est bien cela…
– Dieu sait, cependant, monsieur, avec quelle anxieuse sollicitude je recueillais les moindres paroles du comte… Cela ne se comprend que trop, n’est-ce pas!.. J’étais désespérée de ma situation louche et inexplicable près de lui… Que n’a-t-on pas soupçonné!.. Il avait changé tous les domestiques avant mon arrivée ici, mais il avait voulu que Mme Léon me suivît… Qui sait ce qu’elle a raconté!.. Toujours est-il que, plusieurs fois, le dimanche, en me rendant à la messe, j’ai entendu sur mon passage: «Tenez, voici la maîtresse du comte de Chalusse!..» Oh! aucune humiliation ne m’a été épargnée… aucune.
Il est cependant une chose qui, pour moi, ne présente pas l’ombre d’un doute. Le comte connaissait ma mère. Il en parlait souvent: tantôt avec des explosions de passion qui me faisaient croire qu’il l’avait adorée et qu’il l’aimait encore, tantôt avec des injures et des malédictions qui me donnaient à penser qu’il avait eu cruellement à se plaindre et à souffrir d’elle.
Le plus souvent il lui reprochait de m’avoir sacrifiée sans hésitation ni remords à sa réputation, à sa sécurité.
Il disait qu’il fallait qu’elle n’eût pas de cœur, et que c’était une chose inouïe, incompréhensible, monstrueuse, qu’une femme pût jouir en paix de tous les avantages d’une immense fortune, pendant qu’elle se savait de par le monde une fille, lâchement abandonnée à tous les hasards, misérablement livrée à toutes les horreurs de la misère…
Je suis presque certaine aussi que ma mère est mariée… M. de Chalusse a fait plus d’une allusion à son mari; il le haïssait effroyablement.
Enfin, un soir, étant plus expansif que de coutume, le comte me donna à entendre que le grand danger qu’il redoutait pour moi venait de ma mère ou de son mari… Il a essayé ensuite, selon son habitude, de revenir sur ses affirmations, mais il n’a pu m’ôter de l’esprit que pour cette fois il avait dit vrai… ou à peu près…
Le juge s’était redressé sur son fauteuil, et il cherchait du regard les yeux de Mlle Marguerite…
Lorsqu’il les eut rencontrés:
– Alors, fit-il, ces lettres que nous avons trouvées dans le secrétaire seraient de votre mère, mademoiselle…
La jeune fille rougit… Déjà, elle avait été interrogée au sujet de ces lettres, et elle n’avait pas répondu.
Elle parut délibérer une minute; puis se décidant:
– Votre opinion est la mienne, monsieur, prononça-t-elle.
Et aussitôt, comme si elle eût voulu éviter de nouvelles questions, elle poursuivit avec une certaine volubilité:
– Du reste, un souci nouveau et plus pressant, la menace d’un malheur bien positif, hélas! vint m’arracher à cette perpétuelle préoccupation de ma naissance.
Il y a eu de cela un mois hier; un matin, nous déjeunions, quand le comte m’annonça qu’il attendait pour dîner deux convives.
C’était une telle dérogation à toutes nos habitudes que je restai muette de surprise.
– Positivement, c’est extraordinaire, ajouta gaiement M. de Chalusse, mais c’est ainsi… le loup s’humanise… nous aurons ce soir M. de Fondège et le marquis de Valorsay… Ainsi, chère Marguerite, soyez belle, pour faire honneur à votre vieil ami.
A six heures, ces deux messieurs arrivèrent ensemble.
Je connaissais M. de Fondège, «le général,» comme on l’appelle, le seul ami de M. de Chalusse; il venait nous visiter assez souvent.
Mais je n’avais jamais aperçu le marquis de Valorsay, et même, j’avais entendu prononcer son nom, le matin, pour la première fois.
Je ne le jugeai pas… Il me déplut, dès qu’il parut, jusqu’à l’aversion.
D’abord, il me regarda trop, avec une insistance que ma position fausse rendait pénible, ensuite il se montra trop prévenant.
Pendant le dîner, il parla presque seul et uniquement pour moi, à ce qu’il me parut.
Je me souviens surtout de certain tableau qu’il nous fit de ce qu’il appelait un «bon ménage,» qui me donna des nausées.
Selon lui, un mari ne devait être que le premier ministre et l’humble serviteur des fantaisies de sa femme… C’était son système… Aussi, comptait-il, s’il se mariait jamais, donner à la marquise de Valorsay toute la liberté qu’elle voudrait, de l’argent à pleines mains, les plus beaux équipages et les plus magnifiques diamants de Paris, des toilettes fabuleuses, toutes les satisfactions du luxe et de la vanité, enfin, une existence féerique, un rêve, un étourdissement, un tourbillon…
– Avec ces idées, ajoutait-il en m’épiant du coin de l’œil, la marquise serait bien difficile si elle n’était pas ravie de son mari.
Il m’exaspérait.
– Monsieur, dis-je d’un ton sec, la pensée seule d’un mari pareil me ferait fuir au fond du plus austère couvent.
Il parut décontenancé, «le général,» je veux dire M. de Fontège lui adressa un regard narquois, et on parla d’autre chose.
Mais quand ces messieurs furent partis, M. de Chalusse me gronda.
Il me dit que ma philosophie sentimentale n’était pas de mise dans un salon, et que mes idées sur la vie, le monde, le mariage, le devoir… sentaient d’une lieu l’hospice des enfants trouvés.
Et comme je répliquais, il m’interrompit pour entamer un éloge en règle du marquis de Valorsay, un homme remarquable, assurait-il, de grande naissance, possédant d’immenses propriétés libres d’hypothèques, spirituel, joli garçon… un de ces mortels privilégiés enfin que rêvent toutes les jeunes filles.
Les écailles me tombaient des yeux.
Je compris que le marquis de Valorsay devait être le prétendant trié pour moi entre tous par M. de Chalusse.
Alors, je m’expliquai son programme matrimonial. C’était comme une affiche à attirer la foule…
Et je fus indignée de ce qu’il m’estimait si vulgaire, que de me laisser éblouir par la grossière fantasmagorie de cette vie de plaisirs stupides qu’il m’avait décrite.
Il m’avait déplu, je le méprisai pour l’avoir vu à genoux devant l’argent de M. de Chalusse. Car il n’y avait pas à se méprendre sur l’ignominie du marché que cachaient ses propos légers: il m’avait offert ma liberté en échange de ma dot. Cela est admis, m’a-t-on dit. Or s’il faisait cela pour une certaine somme, que ferait-il donc pour une somme double ou triple…
Voilà ce que je me disais, me demandant toutefois si je ne m’étais pas trompée.
Mais non. La suite confirma mes premiers soupçons.
Dès le surlendemain, je vis arriver M. de Valorsay; il s’enferma avec le comte et ils restèrent plus de deux heures en conférence.
Étant entrée chez M. de Chalusse après le départ du marquis, je vis sur son bureau tous ses titres de propriétés qu’il lui avait fallu montrer sans doute, l’autre voulant savoir bien au juste combien cela lui rapporterait de se marier.
La semaine suivante, nouvelle conférence. Un notaire y assista cette fois. M. de Valorsay prenait ses sûretés.
Enfin, mes derniers doutes furent levés par Mme Léon, toujours bien informée, grâce à l’habitude qu’elle a d’écouter aux portes.
– On vous marie, me dit-elle, j’ai entendu.
Cette certitude m’émut peu.
J’avais eu le temps de me recueillir et de prendre un parti. Je suis timide, mais je ne suis pas faible; j’étais décidée à résister à M. de Chalusse, résolue, au pis aller, à me séparer de lui et à renoncer à toutes les espérances de fortune dont il m’avait bercée.