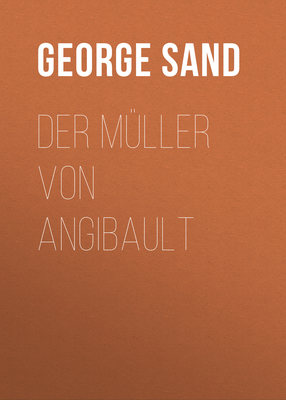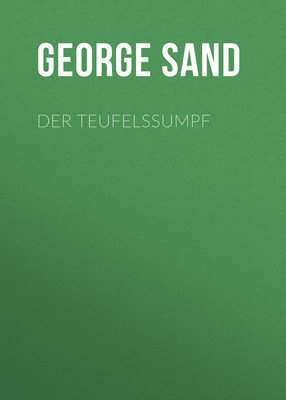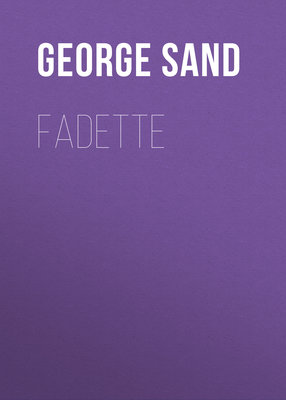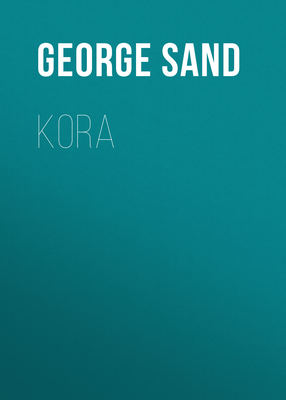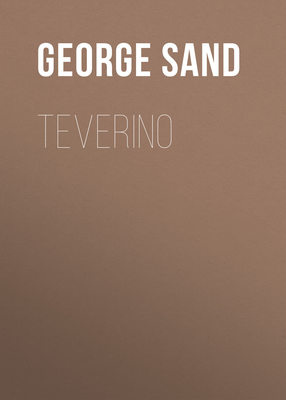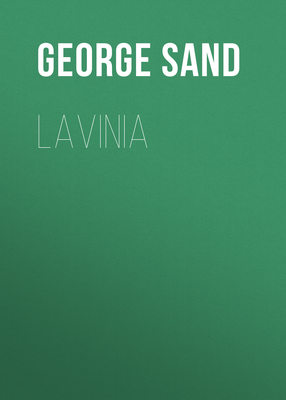Kitabı oku: «Correspondance, 1812-1876. Tome 3», sayfa 14
CCCXXVII
A LA MEME
Nohant, 17 février 1851.
Ma chère mignonne,
Il y a bien longtemps que je veux t'écrire. J'ai été très souffrante de crampes d'estomac et occupée pardessus la tête. Je suis heureuse de toutes des bonnes nouvelles que tu me donnes de ton petit George d'abord, et puis de tes succès dans le monde musical Mais pourquoi ne m'as-tu pas déjà écrit le résultat de ton concert à Nancy?
Il ne faut pas attendre mes réponses pour m'écrire et me tenir au courant de ce qui t'intéresse.
Tu sais bien que je m'y intéresse aussi, moi, et que j'aime à te suivre jour par jour. Si je ne suis pas exacte, ce n'est pas ma faute.
Je suis assez malade, mais non pas dangereusement, et cela n'empêche pas les comédies d'aller leur train et la maison d'être gaie comme de coutume. Nous avons en plus, pour quelques jours, un architecte du gouvernement, qui est venu pour faire réparer l'église de Vic; car tu sauras que cette église est classée parmi les monuments historiques. Cela t'étonne un peu, n'est-ce pas?
Eh bien, cette grange, cette masure si nue, si laide, si insignifiante, elle est au nombre des choses rares et précieuses. Notre nouveau curé, en grattant les murs pour les nettoyer, a découvert, sous trois couches de badigeon, dans le choeur et dans le sanctuaire, des fresques romanes du XIe siècle au moins. J'en ai porté des croquis à Paris, je les ai montrés aux gens compétents et l'église a été classée.
Ces peintures sont barbares, comme tu penses, mais très curieuses, et cela intéressera beaucoup ton mari quand il les verra.
Il n'y a que cela de nouveau ici. Borie est à Bruxelles bien installé. Il vous écrit probablement. Les Duvernet vont bien et me parlent toujours de toi. Maurice et Lambert te disent mille amitiés de grand coeur. Nous t'aimons toujours bien, sois-en sûre, et tu es toujours ma fille chérie.
Embrasse bien Bertholdi et mon George pour moi et pour nous tous.
CCCXXVIII
M. CHARLES PONCY, A TOULON
Nohant, 16 mars 1851.
Cher enfant, je vous ai écrit certainement depuis mon retour de Paris; je vous ai dit que j'y avais passé seulement huit jours, et que j'étais de retour ici à la fin de janvier. Je ne vous ai pas envoyé Claudie, il est vrai; elle n'était pas imprimée encore. Je vous l'envoie. Accusez-m'en réception, ainsi que de ma lettre; car il me semble que la poste n'est pas bien fidèle. Je ne vous mets rien sur la première page, vous savez que la poste s'y oppose.
Ce succès de Claudie, dont vous me faites compliment, a été coupé par la moitié, au beau milieu. Des intrigues de théâtre que je ne sais pas, des directeurs endettés, ruinés, forcés d'obéir à je ne sais quelles volontés (le ministère, dit-on, sous jeu), m'ont suscité de tels empêchements, qu'à la quarantième représentation environ, j'ai dû retirer ma pièce pour qu'elle ne fût pas tuée par le mauvais vouloir. Elle avait fait pourtant gagner beaucoup d'argent à ce théâtre ruiné, et, la veille encore, la salle était pleine. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ces arcanes de la coulisse. Je laisse la gouverne à mon ami Bocage, qui fait de son mieux, mais qui ne peut lutter contre le diable. J'ai donc retiré fort peu d'argent de Claudie. Nous comptions sur cent représentations, et nous sommes loin de compte. Nous aviserons à la faire jouer sur un théâtre plus honnête, s'il y en a, et je prépare une autre pièce; car, mes petites dettes payées, me voilà pauvre comme devant et travaillant toujours sans pouvoir me reposer.
Je voudrais vous écrire longuement. C'est impossible ce soir, et je veux pourtant vous répondre par le courrier.
Je ne connais pas M. Lugi Bordèse. S'il a fait quelque chose sur des paroles de moi, s'il m'a écrit, si je lui ai répondu, je n'en ai pas souvenance. Donc, en tout cas, je ne le connais guère. Je ne sais pas quelle affaire il vous propose; je ne connais pas du tout ces arrangements de publication musicale. Renseignez-vous et ne livrez pas légèrement votre avoir littéraire, sans savoir de quoi il s'agit. Savez-vous que, si Claudie m'avait rapporté dix mille francs nets, mes dettes payées, je comptais vous dire de venir bien vite bâtir un atelier à Maurice? Je ne voulais pas vous le dire avant de savoir si je le pourrais, et j'ai bien fait de ne pas porter vos idées et vos projets sur ce travail, puisque, mes dettes payées, il ne me reste pas un centime. C'est donc pour une autre pièce, si elle réussit sous le rapport des écus, et pour une autre année probablement, si vous êtes libre quand je serai riche. Il faut aussi que je rentre dans la disposition d'une petite maison que j'ai dans le village, et qui est louée à bail, jusqu'en novembre prochain. Je la ferai arranger proprement pour que vous y puissiez loger, si nos projets se réalisent; car, maintenant, avec les arrangements que Maurice a faits dans la grande maison, les amis qui y sont à demeure et le théâtre, il ne me resterait pas un coin grand comme la main pour loger votre famille. Si j'avais eu ce logement libre, je vous aurais fait venir cet hiver pour le calorifère, dont je ne pouvais plus me passer, et que j'ai fait construire par un homme du pays. Mais je n'aurais pas pu vous séparer deux mois, n'est-ce pas? de Désirée et de Solange, et je n'aurais pas voulu vous mettre tous les trois sur un lit de sangle, dans une soupente. Cette question-là m'a empêchée de suivre mon désir, et même de vous en parler.
Espérons que tout ne sera, pas bouleversé en 1852, comme les bourgeois le prétendent. Je crois, au contraire, qu'on ne bouleversera pas assez! Alors, nous pourrons passer six mois ensemble en famille. Dans ce moment, j'emprunte une somme à intérêts pour faire, à mes frais, la publication de mes oeuvres complètes, à quatre sous la livraison. Ce sera enfin le moyen de populariser des ouvrages faits en grande partie pour le peuple, mais que, grâce aux spéculations stupides et aristocratiques des éditeurs, les bourgeois seuls ont lus. C'est une grande affaire dont je confie le soin à Hetzel. S'en tirera-t-il; et m'en tirerais-je moi même? A la garde de Dieu! Je crois que c'était un devoir, le principal devoir de ma vie, et je le remplis à mes risques et périls.
Bonsoir, cher enfant; je vous embrasse de coeur, ainsi que Désirée et
Solange. Maurice vous embrasse aussi.
Borie est en Belgique et m'écrit souvent.
CCCXXIX
A M. EDMOND PLAUCHUT, A PARIS
Nohant, 11 avril 1851.
Votre lettre m'a beaucoup touchée, monsieur, et, dans le service que vous ont rendu les miennes, je vois quelque chose de providentiel entre Dieu, vous et moi. Je n'ai pas l'habitude de répondre à cette foule de lettres oiseuses et inutiles qu'on écrit à toutes les personnes un peu connues dans les arts, et auxquelles le temps et la raison ne permettent pas de donner une attention sérieuse. Mais la première que je reçus de vous me prouva, par sa modestie et sa sagesse, que je devais faire une de ces rares exceptions qu'on est heureux de signaler, et, autant qu'il m'a été possible, j'ai répondu aux discrets et généreux appels de votre esprit délicat et sensé. Je m'en applaudis doublement aujourd'hui en apprenant que mon estime et ma sympathie vous ont assuré celles d'un homme généreux dans des circonstances funestes20. Faites savoir, je vous prie à M. Francisco Cardozzo de Mello, s'il est toujours aux îles du Cap-Vert, que je suis de moitié dans la reconnaissance que vous lui portez. Elle lui est due de ma part, puisque c'est un peu à cause de moi qu'il vous a si bien traité. Mais son bon coeur a été le premier mobile de sa bonne action, et votre mérite en sera la récompense. Si mes sentiments peuvent y ajouter quelque chose, soyez-en l'interprète auprès de lui.
Vous ne me dites pas ce que vous allez faire à Manille21. Croyez que je m'intéresserai cependant à tout ce qui vous concerne et que j'aurai beaucoup de satisfaction à recevoir de vos nouvelles. Je vous envie beaucoup d'avoir la jeunesse et la liberté qui permettent ces beaux voyages, traversés, sans doute, de périls, de souffrances et de désastres, mais où la vue des grands spectacles de la nature et des richesses de la création apportent de si nobles dédommagements. Je pense que vous prendrez beaucoup de notes et que vous tiendrez un journal qui vous permettra de donner une bonne relation de vos voyages.
Ces vastes excursions, de quelque côté qu'on les envisage, et le mieux est de les envisager sous tous les côtés à la fois, ont toujours un puissant intérêt, et vous y trouverez des ressources pour l'avenir. Occupez-vous d'histoire naturelle; n'y fussiez-vous pas très versé, vos collections et vos observations auront leur utilité. Pour ma part, je vous demande des insectes et des papillons; les plus humbles, les plus chétifs, me seront encore une richesse; et, comme je connais quelques amateurs, je pourrais, à votre retour, vous procurer d'agréables relations.
La meilleure manière d'apprêter les papillons et les insectes, c'est de ne pas chercher à les préparer. Quand le papillon est tué et piqué dans une longue épingle, ses ailes se ferment et il se dessèche ainsi. On peut donc en apporter une quantité, debout côte à côte dans une boîte assez petite; et, pourvu qu'ils soient bien plantés et ne se touchent pas, ils ne courent aucun risque. A leur arrivée, on les ramollit, on les ouvre, et on les étale par des procédés très simples, dont je me chargerai. Il faut coller un petit morceau de camphre à chaque coin de la boîte. Vous pourriez aussi apporter des chrysalides de papillons et d'insectes dans du son. Il en meurt, et il en éclôt mal à propos bon nombre dans la traversée; mais il en arrive toujours quelques-unes qu'on fait éclore ici par une chaleur artificielle et qui donnent des individus superbes. Mais ce à quoi je tiens beaucoup plus qu'à mes papillons, c'est à recevoir de vos nouvelles, et, si je puis vous être utile en quoi que ce soit, veuillez vous souvenir de moi.
Adieu, monsieur; mes meilleurs voeux vous accompagnent, et je demande à
Dieu qu'ils vous portent encore bonheur.
Tout à vous,
GEORGE SAND.
CCCXXX
A MADAME AUGUSTINE DE BERTHOLDI, A LUNÉVILLE
Nohant, 5 juin 1851.
Chère enfant,
J'ai été passer quinze jours à Paris; j'en suis revenue depuis environ quinze jours; j'en ai rapporté la grippe, dont je suis guérie par ces dernières chaleurs, mais qui m'a bien fatiguée. Je n'ai pu la soigner, ni me coucher, ni m'arrêter un instant au milieu de mes courses et de mes ennuis de théâtre. Au milieu de tout cela, le profond chagrin de la mort de ma pauvre petite tante m'est tombé sur la tête comme un coup de foudre. J'étais depuis cinq jours à Paris, je n'avais pas eu une minute pour aller la voir. Je lui avais envoyé une loge pour voir la première représentation de Molière. Elle était morte la veille. Afin de ne pas m'accabler et me mettre hors-d'état de veiller à mes affaires, Clotilde n'avait rien voulu me faire savoir. Pendant la représentation, cachée dans les coulisses, je voyais les avant-scènes et la loge que j'avais destinée à ma tante remplie de figures étrangères. Cela m'étonnait et m'inquiétait beaucoup, quoique je n'eusse pas de motifs d'inquiétude. Les acteurs me disaient: «Qu'est-ce que vous avez donc à vous tourmenter de cette loge? Pensez donc à votre pièce! Ça va bien, on applaudit.» Je n'y faisais pas attention, j'avais une idée fixe pour ma pauvre tante. Cependant, le lendemain matin, ce pressentiment était dissipé, je me disais qu'il y avait eu quelque changement dans la distribution des loges, et mon premier moment de liberté fut pour aller chez Clotilde et de là, à Chaillot. Clotilde était à la campagne. Je demande si ma tante est à Paris. «Madame Maréchal? me répond le portier. On l'a enterrée ce matin.» Voilà comment se brise une affection de toute la vie, une affection filiale, je peux dire; car j'aimais ma tante comme si elle m'avait mise au monde, Elle était ma mère autant que ma mère; elle m'avait nourrie de son lait autant que ma mère; elle m'aimait, je crois, autant que sa fille; et elle était si bonne, si égale, si douce, si gaie, si jeune de santé, d'esprit et de coeur! Je ne l'ai pleurée que dans la surprise du premier moment, et j'ai continué à faire mes affaires, mes corvées, et à traîner ma fièvre et ma toux, qui m'ont pris juste à ce moment-là, je ne sais par quelle coïncidence, je sais que ma tante avait un grand âge, je savais que je devais m'attendre à la perdre et à l'apprendre comme cela quelque jour, puisque nous vivions à quatre-vingts lieues de distance. Mais, c'est égal, la résignation ne console pas, et l'idée qu'une chose est inévitable ne la rend pas moins amère. J'y pense et j'y penserai tous les jours de ma vie, pour me dire que, maintenant, je suis tout à fait orpheline. Je ne l'étais pas encore tant qu'elle vivait. Elle a pensé à moi jusqu'au dernier jour de sa vie; sa dernière parole a été: «Donnez-moi donc un journal, pour que je voie si on joue ce soir la pièce d'Aurore. Je veux y aller.» Pendant que la bonne allait chercher ce journal, elle a jeté un cri: on l'a trouvée sans parole, sans connaissance, foudroyée d'une apoplexie pulmonaire, dit-on (je ne sais pas ce que c'est), et, une heure après, elle expirait dans les bras de Clotilde, sans comprendre et sans souffrir, à ce qu'on assure. Dieu veuille qu'elle n'ait pas pu savoir qu'elle quittait la vie! Elle l'aimait, elle se trouvait heureuse partout et toujours. Cette manière de finir est encore un bonheur; mais il aurait pu, il aurait dû arriver dix ans plus tard. Ou bien, il faudrait que des êtres si excellents, si doux, si inoffensifs et si aimables ne finissent jamais. On se retrouve ailleurs, je le crois, je l'espère. Sans cela, il vaudrait mieux ne pas vivre que de passer sa vie à s'aimer pour se perdre à jamais.
Je n'ai pas grand'chose à te dire de Molière, Le public a applaudi la pièce; mais on ne l'a jouée que douze fois. Bocage dit que le directeur n'a pas voulu la faire prendre. Le directeur était, je crois, en pleine déconfiture, le théâtre est fermé. Bocage ne s'accorde pas avec les théâtres où il n'est pas le maître. On y est très voleur, c'est vrai; mais Bocage est un peu terrible avec eux, et je crois qu'il faudra, ou que j'attende qu'il ait un théâtre à lui, ou que je change mes batteries si je veux gagner quelque argent avec mes pièces. Mais. je n'ai pas le coeur à te parler beaucoup de cela aujourd'hui. Je t'enverrai la pièce quand je l'aurai reçue. Je me suis remise au travail, espérant, de l'avenir et de meilleures combinaisons, de meilleurs résultats. Bonsoir, ma chère fille; je t'attends au mois d'août. Je t'aime; j'embrasse mon petit George et Bertholdi. Écris-moi souvent. Maurice t'embrasse; les jeunes gens le saluent très amicalement et humblement. Sois toujours heureuse à ta manière, toi; c'est la bonne!
CCCXXXI
A MADAME CAZAMAJOU, A CHÂTELLERAULT
Nohant, 6 juin 1851.
Oui, chère soeur, c'est une grande douleur pour nous, et c'est à présent que nous sommes tout à fait orphelines; car nous avions conservé, malgré nos cheveux blancs, une seconde mère qui nous chérissait d'un coeur toujours jeune. Elle était si jeune de santé aussi, que ce coup imprévu est bien cruel.
Elle devait aller le soir au théâtre pour voir cette pièce nouvelle de moi; elle avait reçu sa loge, elle se portait on ne peut mieux. Elle disait à son ouvrière: «Allez me chercher un journal, que je voie si on joue ce soir la pièce de ma nièce.» Ç'a été sa dernière parole. On l'a retrouvée mourante sur son fauteuil. Elle a expiré une heure après dans les bras de Clotilde, sans souffrir et sans rien comprendre. Clotilde n'a rien voulu me faire savoir, à cause des occupations où je me trouvais. Le soir, pendant la première représentation, j'étais dans les coulisses, j'apercevais la loge d'avant-scène où elle devait être. J'y voyais des figures étrangères, je m'en inquiétais; j'avais un pressentiment affreux, je ne pensais pas plus à ma pièce que si elle était d'un autre. Le lendemain matin, je cours chez Clotilde, et j'apprends de son portier la triste nouvelle. Je ne peux pas te dire le mal que cela m'a fait. La fièvre et la grippe m'ont prise instantanément. Je suis comme toi, je ne m'écoute guère. J'ai traîné cette vilaine maladie sans me coucher et ne m'en suis trouvée débarrassée qu'il y a deux jours, par une journée de forte chaleur, la seule que nous ayons encore eue ici depuis le printemps.
Le succès de Molière a été bon comme approbation du public, mais nul d'argent. Les théâtres du boulevard sont vides dès qu'il fait beau, et on a joué ma pièce trop tard dans la saison morte. Le théâtre était d'ailleurs en déconfiture, à ce qu'il paraît; car il a fermé brusquement ces jours-ci, et on le reconstitue, je ne sais si c'est avec la même direction.
Je vais tenter autre chose. Il faut s'attendre à bien du travail perdu dans cette partie.
Je viens de recevoir une lettre que le colonel d'Oscar écrit au général Baraguey d'Hilliers, et que ledit général m'a renvoyée pour me faire voir qu'on promettait positivement qu'Oscar passerait maréchal des logis. J'espère, sans être certaine, et je voudrais dire cette bonne nouvelle à Oscar. Mais tu m'annonces qu'ils vont partir, et tu ne m'apprends pas où ils vont. Est-ce qu'ils reviennent en France? Ce n'est pas probable. Les spahis ne quittent jamais l'Afrique; je t'envoie toujours une petite lettre pour lui. Fais-la-lui passer, si tu sais où il est, et change l'adresse, s'il y a lieu. Bonsoir, chère soeur; je t'embrasse mille fois, ainsi que notre bon Cazamajou, que j'aime de tout mon coeur. Maurice vous embrasse aussi tous les deux bien tendrement. Il est revenu de Paris avec moi; c'est le seul qui n'ait pas eu la grippe. Les autres enfants d'ici te présentent leurs respects. J'attends Solange dans quelques jours. Elle est très gentille pour moi à présent, malgré la froideur et la raideur du fond. Mais elle est comme cela, il faut bien aimer ses enfants comme ils sont. Sa petite est charmante. Son mari a des travaux et gagne de l'argent.
Adieu encore, chère amie.
Ta soeur.
CCCXXXII
A M. CHARLES PONCY, A TOULON
Nohant, 6 juin 1851.
Mon enfant, je suis heureuse de l'amélioration de votre sort. Enfin, voilà du pain quotidien. C'est si cruel d'avoir du coeur, des bras, de l'âme, et de ne pouvoir les occuper pour nourrir ceux qu'on aime! La manière dont vous avez été élu est charmante. C'est une vraie victoire.
J'étais à Paris quand cette lettre est arrivée ici; je l'ai trouvée à mon retour. J'avais la grippe et une grosse fièvre que je traînais depuis quinze jours à Paris, n'ayant pas un instant pour me reposer. Votre seconde lettre, me confirme votre satisfaction. Une bonne santé à vous trois! avec cela, tout va donc bien de votre côté. J'ai retrouvé hier un petit imprimé de vous, intitulé Lieds. Je ne l'avais pas vu. On reçoit ici les lettres, journaux et imprimés, le matin. On m'apporte les lettres dans mon lit; mais, les imprimés, sous prétexte de lire les journaux, mes jeunes gens les égarent ou les laissent traîner quelquefois, ce qui revient au même. Si bien que j'ai retrouvé le vôtre en fouillant dans une masse de rebuts où il n'aurait pas dû être. Il y a de charmantes choses dans ces Lieds, et je vois que la vie réelle, à laquelle il faut bien que, riche ou pauvre, on donne la meilleure partie de son temps, n'éteint pas en vous le feu sacré. Si la poésie ne fait pas venir le pain à la maison, du moins elle y conserve la vie de l'âme, et cela, joint aux tendres affections du coeur et de la famille, est encore un grand présent du bon Dieu.
J'oublie de vous parler de Molière.—Non, les tracasseries de la censure n'ont été que vaines menaces. Il n'y avait rien dans la pièce à quoi le mauvais vouloir pût se prendre. Je vous l'enverrai en quatre actes, comme elle a été jouée, et en cinq actes, comme je l'avais faite. Vous y trouverez bien de l'impartialité historique. Vous verrez seulement une scène où, après que divers personnages ont bu à la santé du roi et de la reine, des princes de la Fronde; un chasseur, à ses chiens; une gardeuse d'oies, à ses oies, Molière boit à la santé du peuple. Voilà le mot que la censure voulait absolument ôter. J'ai tenu bon; je les ai défiés d'interdire la pièce. Je les ai priés de le faire, leur disant que jamais plus belle occasion ne se présenterait pour moi de proclamer le jugement et les vertus de la censure. Ils ont cédé, et le mot est resté. Ils sont très bêtes, ces gens-là! si bêtes, qu'on est forcé d'en avoir pitié!
Le public des premières représentations a très bien accueilli ce Molière. Mais je dois dire, entre nous, que le public des boulevards, ce public à dix sous qui doit être le peuple, et à qui j'ai sacrifié le public bien payant du Théâtre-Français, ne m'a pas tenu compte de mon dévouement. Le peuple est encore ingrat ou ignorant. Il aime mieux les meurtres, les empoisonnements, que la littérature de style et du coeur. Enfin, c'est encore le peuple du boulevard du crime, et on aura de la peine à l'améliorer comme goût et comme morale. La pièce, délaissée par ce public-là, n'a eu que douze représentations, peu suivies par lui, et soutenues seulement par les lettrés et les bourgeois. C'est triste à dire. Il ne faut même pas le dire, et surtout il ne faut pas se décourager. La perte d'argent n'est qu'un désagrément; la perte de travail moral, le dévouement inutile sont des chagrins dont il ne faut pas se trop préoccuper; et il n'y a qu'un mot qui serve En avant! en avant!—Bonsoir, chers enfants, Désirée, Solange; je vous embrasse de toute mon âme.