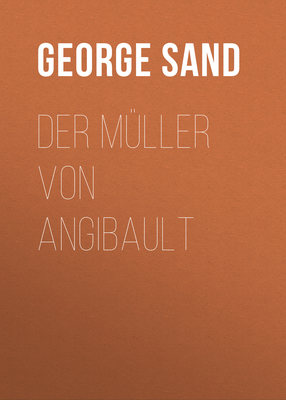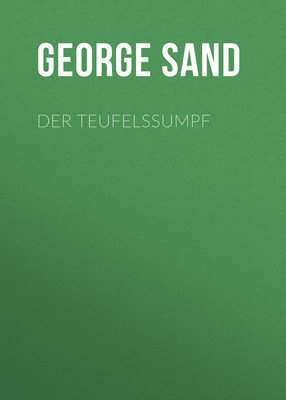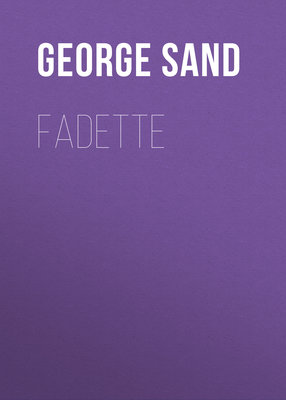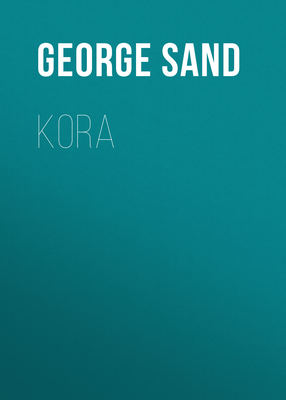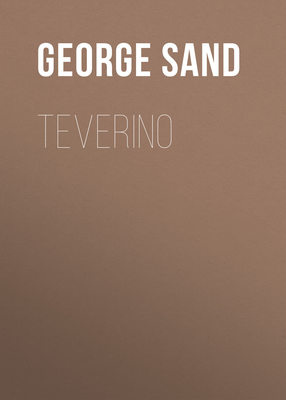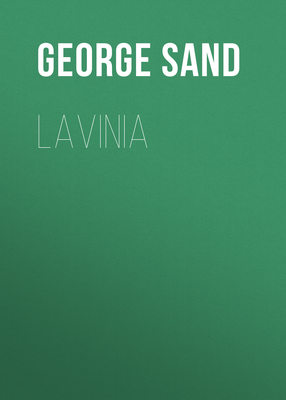Kitabı oku: «Correspondance, 1812-1876. Tome 3», sayfa 6
CCLXXXVIII
À M. EDMOND PLAUCHUT, A ANGOULÊME
Nohant, 14 octobre 1818.
Monsieur,
Les idées que je vous ai exprimées au courant de la plume dans ma dernière lettre sont trop incomplètes pour être publiées. On peut faire sans cérémonie un échange d'idées par lettres; mais il ne faut soumettre au public que ce qu'on a travaillé de son mieux et cela, non par respect de soi-même et vanité d'écrivain, mais par respect pour l'idée même qu'on doit présenter sous la meilleure forme possible. Je m'occupe en ce moment, avec un de mes amis, d'un travail aussi complet, et pourtant aussi court et aussi simple que nous pouvons le résumer, sur la question que je vous ai exposée rapidement dans ma lettre. Cette brochure10 paraîtra incessamment et je vous en enverrai plusieurs exemplaires. Si le principe développé ainsi vous paraît juste et satisfaisant, vous pourrez, par l'action que vous exercez autour de vous, lui donner une extension et l'appuyer de preuves nouvelles; car une idée n'est à personne et son application est l'oeuvre de tous.
Je vous remercie des paroles affectueuses et sympathiques que vous m'adressez personnellement. Mes sentiments n'ont de valeur que parce qu'ils répondent au sentiment des âmes généreuses, et qu'ils le confirment comme ils sont confirmés par lui.
Agréez, monsieur, pour vous et vos amis, l'expression de mon dévouement fraternel.
GEORGE SAND
Je rouvre ma lettre pour répondre à une question que vous m'adressiez, et j'y répondrai mal, parce que je suis comme vous dans de grandes incertitudes en face du fait politique. D'abord, je pense être d'accord avec vous sur ce point: l'institution de la présidence est mauvaise et c'est une sorte de restauration demi-monarchique. Ensuite (le président accordé), faut-il qu'il soit nommé par le peuple ou par l'Assemblée nationale? En principe, il doit être nommé par le peuple, tous les démocrates sont d'accord là-dessus; car le contraire est le rétablissement du suffrage à deux degrés.
Mais, en fait, des républicains très sincères ont voté pour la nomination par l'Assemblée, pensant que les besoins de la politique exigeaient cette infraction au principe. Moi, j'avoue que je déteste ce qu'on appelle aujourd'hui la politique, c'est-a-dire cet art maladroit, peu sincère et toujours déjoué dans ses calculs par la fatalité ou la Providence, de substituer à la logique et à la vérité des prévisions, des ressources, des transactions, la raison d'État des monarchies, en un mot. Jamais l'instinct du peuple ne ratifiera les actes de la politique proprement dite, parce que l'instinct populaire est grand quand Dieu souffle sur lui, tandis que l'esprit de Dieu est toujours absent de ces conciliabules d'individus où l'on fabrique avec de grands moyens de si petits expédients.
Pourtant, le peuple va se tromper et manquer de lumière et d'inspiration dans le choix de son président. Du moins, on le prévoit et on craint l'élection du prétendant. Qu'y faire? En lui laissant son droit, on lui laisse au moins l'intelligence et la foi du principe, et il vaut mieux qu'il en fasse, au début, un mauvais usage que s'il perdait la notion de son droit et de son devoir en secondant avec prudence et habileté les exigences de la politique.
S'il fait un mauvais choix, il pourra aussi le défaire, au lieu que, s'il ne fait pas de choix du tout, il n'y aura pas de raison pour qu'il ne subisse pas celui qu'on aura fait à sa place.
CCLXXXIX
À M. ARMAND BARBÈS, AU DONJON DE VINCENNES
Nohant, 1er novembre 1848.
Cher ami,
Je suis toute triste et consternée de n'avoir pas de vos nouvelles depuis si longtemps. Je sais que vous vous portez bien (si on ne me trompe pas pour me rassurer!). Mais je suis inquiète quand même, parce que j'espérais que vous pourriez m'écrire, et apparemment vous ne l'avez pas pu. N'avez-vous pas reçu une lettre de moi, une seule; car on ne m'a pas fourni, depuis, d'autre occasion, et d'autre moyen de vous écrire. Je n'ose vous rien dire; d'ailleurs, que vous dirais-je que vous ne sachiez aussi bien que moi? Les événements sont tristes et sombres partout; mais l'avenir est toujours clair et beau pour ceux qui ont la foi. Depuis mai, je me suis mise en prison moi-même dans ma retraite, qui n'est point dure et cruelle, comme la vôtre, mais où j'ai peut-être eu plus de tristesse et d'abattement que vous, âme généreuse et forte! j'y ai même été moins en sûreté; car on m'a fait beaucoup de menaces. Vous savez que la peur n'est point mon mal, et nous sommes de ceux pour qui la vie n'est pas un bien, mais un rude devoir à porter jusqu'au bout.
Cependant, ces cris, ces menaces me faisaient mal, parce que c'était l'expression de la haine, et c'est là notre calice.
Être haï et redouté par ce peuple pour qui nous avons subi physiquement ou moralement le martyre depuis que nous sommes au monde! Il est ainsi fait et il sera ainsi tant que l'ignorance sera son lot. Pourtant, on me dit que partout il commence à se réveiller, et en bien des endroits on crie aujourd'hui: «Vive Barbès!» là où l'on criait naguère (et c'étaient souvent les mêmes hommes): «Mort à Barbès!»—Eh! mon Dieu, me disais-je, ce martyre, il l'a déjà subi mille et mille fois, et il l'a cherché à tous les instants de sa vie. C'est sa destinée d'être le plus haï et le plus persécuté, parce qu'il est le plus grand et le meilleur.»
Je fais souvent des châteaux en Espagne, c'est la ressource des âmes brisées. Je m'imagine que, quand vous sortirez d'où vous êtes, vous viendrez passer un an ou deux chez moi. Il faudra bien que nous nous tenions tous cois, sous le règne du président, quel qu'il soit; car la partie, comme vous l'entendiez, est perdue pour un peu de temps. Le peuple veut faire un nouvel essai de monarchie mitigée: il le fera à ses dépens, et cela l'instruira mieux que tous nos efforts. Pendant ce temps-là, nous reprendrons des forces dans le calme, nous apprendrons la patience dans les moyens, les partis s'épureront et l'écume se séparera de la lie. Enfin, la nation mûrira, car elle est moitié verte et moitié pourrie… Et peut-être que, dans cet intervalle, nous aurons les seuls moments de bonheur que vous et moi aurons connus dans notre vie. Il nous sera permis de respirer, et l'air de mes champs, l'affection et les soins de ma famille vous feront une nouvelle santé et une nouvelle vie…
Laissez-moi faire ce rêve. Il me console et me soutient dans l'épreuve que vous subissez.
Adieu. L'ami, l'ami qui vous porte ma lettre, essayera de vous voir. S'il ne le peut, il essayera de vous la faire tenir et de me rapporter un mot de vous. Mon fils vous embrasse tendrement et nous vous aimons.
GEORGE.
CCXC
À JOSEPH MAZZINI, À LONDRES
Nohant, 22 novembre 1848.
Mon ami,
Je vous croyais rentré en Italie, je ne savais où vous prendre; cette énergique proclamation de vous, que j'ai lue dans les journaux, n'indiquait point où vous étiez. Vous avez une existence difficile à suivre matériellement, et le coeur seul s'attache à vos pas, au milieu de mille anxiétés douloureuses.
Comment pouviez-vous croire que vous m'aviez fâchée? Est-ce jamais possible? Non, non, je ne le crois pas. Vous me gronderiez bien fort que je baisserais la tête, reconnaissant que vous en avez le droit et le devoir. Mais, bien loin de là, votre avant-dernière lettre était pleine de tendresse et de douceur comme toutes les autres, et vous ne songiez qu'à me consoler et à m'encourager. Quand je ne vous écris pas, dans le doute de votre situation, c'est par une crainte instinctive de vous compromettre si vous vous trouviez dans des circonstances plus périlleuses que de coutume. Tenez-moi donc toujours au courant, ne fût-ce que par un mot. De mon côté, je vous écrirai un mot seulement pour vous dire que je pense à vous, quand je craindrai que ma pensée sur les événements ne vous arrive mal à propos. Mais vous le savez bien, que je pense à vous sans cesse, et, pour ainsi dire, à toute heure. Votre souvenir n'est-il pas lié à toutes mes pensées sur le présent et l'avenir de l'humanité? N'êtes-vous pas un de ces travailleurs infatigables du grand-oeuvre des temps modernes? Ouvriers qui peuvent bien se compter entre eux; car ceux de la douzième heure forment les masses et il en est peu qui ne se corrompent pas ou ne se rebutent pas, au milieu de tant de revers!
Sans doute l'avenir est à nous; mais irons-nous jusqu'à l'avenir? Peu importe! dites-vous; oui, peu importe pour nous qui sommes dévoués. Mais combien souffrent sans comprendre, et sans pouvoir s'adjurer eux-mêmes! combien succombent dans le pèlerinage, et comment ne pas pleurer amèrement sur les mourants qu'on laisse derrière soi! Notre route est semée de cadavres, et, tandis que l'ennemi fait des cadavres véritables par le fer et le feu, nous sommes environnés de découragements et de désespoirs qui s'asseyent au bord du chemin et refusent d'aller plus loin.
L'état moral de la France, en ce moment, est une retraite de Russie. Les soldats sont pris de vertige et se battent entre eux pour mourir plus vite. Voyez les socialistes divisés, exaspérés, furieux, au moment où toutes les nuances de l'idée démocratique devraient se réunir et se retourner contre l'ennemi commun!
Mais il y a là dedans quelque chose de fatal. Ce ne sont pas seulement les orgueilleux et les intolérants qui ne savent quel nom opposer à celui du prétendant: ce sont les âmes honnêtes et modestes, ce sont les serviteurs les mieux disciplinés de la cause, qui reculent effrayés devant une adhésion à donner au proconsul algérien, au mitrailleur des faubourgs. Lui seul peut nous sauver, dit-on. Sauver notre parti, peut-être! Encore c'est très douteux, d'après sa conduite récente. Mais le peuple est-il un parti? Et cet homme a-t-il la moindre intelligence des besoins du peuple, la moindre sympathie pour ses souffrances, la moindre pitié pour ses égarements?
Si nous lui opposons Ledru-Rollin, quelle garantie nous donne ce caractère impressionnable et capricieux dont on ne saurait dire, depuis le 4 mai, s'il est pour le peuple ou pour une certaine bourgeoisie démocratique qui n'est pas le peuple, et qui manque d'intelligence au premier chef!
Je vais vous envoyer la constitution de Leroux. C'est savant, ingénieux, et très bon à lire dans un temps de calme et de spéculation philosophique. Mais toutes ces formes symboliques, et ces systèmes a priori ne répondent en rien aux besoins, aux possibilités du moment. C'était facile â tourner en ridicule, on l'a fait, et cet écrit n'a servi à rien. Proudhon est bien plus fort que lui dans les théories absolues et personnelles. Mais c'est l'esprit de Satan, et malheur à nous si nous mettons ainsi l'idéal à la porte! Leroux en a trop; mais, pour n'en point avoir du tout, Proudhon n'est pas plus praticable.
Ces esprits-là en cherchent trop long. Il n'en faudrait pas tant pour nous sauver. Je vous enverrai une brochure de Lamennais, et ce que je pourrai rassembler ici, avec un livre que mon ami Borie vient de faire et dont j'ai écrit l'introduction. Vous m'en direz votre avis.
Je ne veux pas vous parler des événements de l'Italie et de ceux qui particulièrement vous intéressent. Il me semble qu'il ne le faut pas, par prudence pour vous. Vous me tiendrez au courant, tant que vous pourrez, et vous savez si je m'y intéresse, si je me tourmente, si je m'afflige et si j'espère et souffre comme vous et avec vous!
Mes enfants vous aiment et me chargent de vous le dire. J'ai toujours hors de la maison, les mêmes douleurs de famille. Je travaille, j'attends le 10 décembre comme tout le monde. Il y a là un gros nuage, ou une grande mystification, et il faut s'avouer impuissant devant cette fatalité politique d'un nouvel ordre dans l'histoire: le suffrage universel.
Adieu, ami.
A vous de toute mon âme.
GEORGE.
CCXCI
À M. ARMAND BARBÈS, AU DONJON DE VINCENNES
Nohant, 8 décembre 1848.
Cher ami,
Voilà trois ou quatre lettres que je vous écris, que je fais porter à Paris, et qu'on ne trouve pas le moyen de vous faire passer, apparemment parce qu'on s'y prend mal, ou qu'il y a entre vous et moi un guignon particulier. Je vous envoie la dernière, pour que vous voyiez que je n'ai pas cessé de penser à vous.
Cette fois, on m'assure qu'on réussira à vous faire tenir ma lettre. Ce qui fait que je n'insiste pas trop, c'est que je n'ai rien de pressé et de particulier à vous dire en fait de politique. Sur ce chapitre-là, je sais ce que vous pensez et vous savez ce que je pense. Ce à quoi je tiens, c'est que vous ne croyiez pas que je vous oublie un seul instant, vous le meilleur de tous. Ce qui se passe au dehors, vous le savez sans doute.
Je présume que vous n'êtes pas privé de journaux, bien qu'après tout, ce serait peut-être un bonheur d'ignorer combien une partie de la France est absurde, aveugle, égarée en ce moment-ci. Mais, malgré l'engouement pour l'Empire, qui est le mauvais côté de l'esprit public, il y a, d'autre part, un changement sensible, un progrès réel dans les idées. Cela est surtout frappant dans nos provinces, où les questions de personnes s'amoindrissent pour faire place, je ne dirai pas à des questions, mais à des besoins de principes. Je ne suis guère contente, pour ma part, de nos socialistes: ces divisions, ces fractionnements sentent l'orgueil et l'intolérance, défauts inhérents au rôle d'homme à idées, et que je leur ai toujours reproché, vous le savez. Mais la volonté de Dieu est que nous marchions ainsi et que nos disputes servent à l'instruction du peuple, puisque nous ne savons pas l'instruire par de meilleurs exemples. Pourvu que ce but soit atteint, qu'importe que tels ou tels laissent un nom plus ou moins pur!
Le vôtre, grâce au ciel, sera toujours un symbole de grandeur et de sainte abnégation. Si vous aviez de l'orgueil, cela vous consolerait de votre martyre; mais l'orgueil n'est pas votre fait, vous êtes au-dessus de lui, et vous ne pouvez vous consoler que par l'espérance de jours meilleurs pour l'humanité.
Ces jours viendront; les verrons-nous? qu'importe? Travaillons toujours. Moi, je prends aisément mon parti de tous les déboires personnels. Mais j'avoue que je manque de courage pour la souffrance de ceux que j'aime, et que, depuis le 15 mai et le 25 juin, j'ai l'âme abattue par votre captivité et par les malheurs du prolétaire. Je trouve ce calice amer et voudrais le boire à votre place.
Adieu; écrivez-moi si vous pouvez, ne fût-ce qu'un mot. Je fais toujours le rêve que vous viendrez ici et que vous consentirez à vous reposer pendant quelque temps de cette vie terrible que vous endurez avec trop de stoïcisme. Je ne comprends rien aux lenteurs ou plutôt à l'inaction du pouvoir en ce qui vous concerne. Il me semble que vous devez être acquitté infailliblement si vous daignez dire la vérité de vos intentions, et répondre un mot à vos accusateurs.
Maurice me charge de vous dire qu'il vous aime. Si vous saviez comme nous parlons de vous en famille! Adieu encore.
Votre soeur,
GEORGE.
CCXCII
A M. EDMOND PLAUCHUT, A ANGOULÊME
Nohant, 13 février 1849.
Permettez-moi, citoyen de défendre le travail de mon ami auprès des vôtres et de vous-même11. Il ne me semble pas que ce travail soit incomplet à son point de vue et vous en seriez plus satisfait si vous vous détachiez du vôtre, comme j'ai été obligée de le faire pour le mien propre. Mais remarquez bien que ce petit livre, est, quoique sous une forme modeste, un livre de philosophie, l'examen d'un principe, bien plutôt qu'un livre de pratique sociale, d'économie politique.
Il s'agissait de poser ce principe et de savoir s'il était juste, s'il était admissible. Il vous paraît tel puisque vous acceptez la préface. Le livre n'est que le développement historico-philosophique de ce principe, que je répète ici pour mieux nous entendre:
La propriété est de deux natures. Il y a une propriété commune, il y a une propriété individuelle.
Lorsqu'en causant, nous arrivâmes à cette formule, M. Borie et moi, notre premier cri fut celui: «Il n'y a guère d'idées nouvelles, et ce que nous avons trouvé là, n'est probablement qu'une réminiscence. Si nous avions tous nos souvenirs bien présents, nous verrions que nous avons lu cela dans les philosophes de toute l'humanité.»
Quant à moi, je n'ai pas d'instruction, quoique j'aie beaucoup lu. Mais je manque de précision dans la mémoire. M. Borie, étant beaucoup plus jeune, eut plus de facilité à retrouver les textes que je n'en aurais eu, et c'est pourquoi il fit très vite ce travail, que j'aurais fait très lentement. Il me semble aussi que son point de départ, car ses opinions ne sont pas absolument les miennes, donnait plus de force à son raisonnement sur la propriété commune. On devait l'accepter mieux de la part d'un esprit hostile au communisme absolu que de la mienne; car, moi, j'ai longtemps cru au communisme absolu de la propriété et peut-être que, même en admettant une propriété individuelle, comme je le fais aujourd'hui, je ferais cette dernière part si petite, que peu de gens s'en contenteraient.
Maintenant, ce que vous reprochez à M. Borie, c'est de n'avoir pas donné un moyen pratique, en définissant d'une manière nette et absolue, ce qui est du domaine de la propriété individuelle et ce qui est de celui de la propriété commune. Voilà où, je crois, l'auteur devait s'arrêter dans un petit ouvrage de cette nature; car les moyens sont toujours une chose arbitraire, une chose essentiellement discutable et modifiable, une chose enfin qui, proposée aujourd'hui par un individu, devient aussitôt beaucoup meilleure si beaucoup d'individus prennent le temps de l'examiner et de la perfectionner. La nature des moyens, selon moi, importe fort peu à priori; et la nature des principes nous est très nécessaire.
Croyez-vous que, le jour où les hommes seront d'accord sur les principes de justice et de fraternité, ils seront à court de moyens? Croyez-vous donc que, même dans ce moment-ci, les moyens n'abondent pas? Est-ce l'intelligence de la pratique qui fait défaut en France? Nullement. Il y a des moyens à remuer à la pelle, et, si nous avions une Assemblée législative composée de socialistes intelligents (certes on en trouverait bien assez pour remplir le Palais-Bourbon), on verrait plus d'un homme de génie apporter son moyen. Ces moyens différeraient; mais, si la même religion sociale unissait les intelligences, on s'entendrait, et, d'amendements en amendements, on formulerait des lois équitables et vraies qui sauveraient la société.
Croyez-vous qu'en fait de moyens, Proudhon n'ait pas, dans sa banque, de quoi rendre la vie matérielle à ce corps épuisé? Et croyez-vous qu'il n'y ait pas d'autres grandes intelligences financières qui végètent dans l'obscurité, par impuissance de se produire? Je dis donc que proposer un moyen pur et simple est une chose puérile, si on ne se sent pas spécialement l'homme du moyen, et si on n'a pas, en outre, le moyen de propager son moyen. C'est dans un concile social, ou du haut d'un journal très répandu, ou du droit d'une grande capacité pratique, qu'on peut venir proposer un système pratique. Mais disséminer le travail des esprits sur une multitude de propositions isolées, c'est ce que je désapprouve.
C'est cette multitude de systèmes pratiques qui nous a empêchés d'en suivre un seul au début de la Révolution. En ce moment, Proudhon parle, et, bien qu'il ne s'inquiète point des principes qui nous préoccupent, je suis d'avis qu'il nous faut l'étudier attentivement et nous tenir prêts à le seconder, s'il est seulement dans la route, ou sur la pente du vrai dans la pratique; car autre chose est de cultiver en soi une religion, et autre chose est de la pratiquer dans la communauté et le consentement de ses semblables. Il faut bien que chacun fasse une concession pour arriver à l'accord qui seul rend la pratique possible, et c'est ce que ferait probablement Proudhon, s'il se trouvait dans un concile organisateur, en présence d'esprits de sa force, agissant vers un but commun.
Je ne sais pas si je me fais bien comprendre; mais, si vous ne me comprenez pas, il y a de ma faute. Voici ce que je veux dire en résumé: C'est que nous devons travailler sérieusement à dégager en nous les principes, et qu'en même temps nous devons nous faire très accessibles et très modestes devant les moyens proposés. Nous devons ne point croire que nous ayons chacun un moyen qui est le seul, et nous bien persuader que les moyens ne se trouvent qu'en commun et par la discussion pacifique. L'erreur de Proudhon, c'est de croire que tout est dans un moyen. Hélas! ce moyen, fût-il parfait, tombe dans le vide, s'il est offert à une majorité récalcitrante. Mais il est bon peut-être que Proudhon ait cette croyance étroite qui concentre sa force intellectuelle.
Quelques hommes ont cette étroitesse de vues et deviennent grands par cela même. Témoin Voltaire et tant d'autres, qui, à force de rejeter ce qu'ils croyaient inutile, se sont rendus utiles et puissants dans leur spécialité. Laissons grandir les hommes pratiques parmi nous et gardons-nous de croire qu'il n'en faille point. Mais gardons-nous également de nous croire tous des hommes pratiques; car, bien qu'il y en ait en France maintenant plus qu'à aucune autre époque, c'est encore et ce sera peut-être toujours une précieuse minorité, par rapport à la population.
Voilà pourquoi je n'ai pas vu avec regret que M. Borie s'arrêtât précisément devant le moyen; s'il a en lui un moyen, c'est après un autre genre de travail, c'est dans un ouvrage spécial qu'il doit l'exposer, s'il le juge à propos. Mais nous n'en sommes pas encore, en France, à ce point de pouvoir présenter simultanément la théorie et l'application. Pierre Leroux y a échoué, malgré son génie.
Remarquez bien. Il y a plus d'un moyen de définir la propriété individuelle et la propriété commune. Proudhon vous dira que tout cela est concilié par son système. Un autre vous proposera une banque hypothécaire; je crois que ce serait le rêve de M. Borie, par exemple, et je connais plusieurs personnes qui croient aussi à ce moyen sous diverses formes. Un troisième viendra et vous parlera de l'impôt progressif; un quatrième, de moyens plus modestes, mais qui seraient immédiatement applicables si l'Assemblée nationale avait seulement un peu de foi et de volonté, la communauté dans le système des chemins de fer par l'État, les assurances mutuelles sous diverses formes, et, toutes, tendant à constituer un fonds social réel; car nous en avons déjà un fictif qui repose sur l'impôt, mais qui est mal assis et ne profite qu'aux riches.
Vous voyez que voilà bien des moyens, et je crois que tous sont bons. Si j'avais la capacité financière, je suis sûre que j'en trouverais dix autres à vous proposer. Je dis qu'ils sont tous bons par eux-mêmes et qu'ils seraient excellents en venant se fondre dans un système consenti par la nation. Mais où est le consentement? Les riches ne veulent pas, et les pauvres ne savent pas. Un principe se formule en trois mots, et s'appuie sur des raisons purement philosophiques. Ces raisons peuvent être facilement acceptées de tous, parce que ce qui est vrai et beau saisit presque tout le monde; qui osera dire que Socrate, Jésus, Confucius et les autres grands révélateurs se sont trompés? Mais, quand on arrive au fait palpable, chacun a son avis, et il faut bien consulter tout le monde pour agir.
Voilà pourquoi les pensées de colère doivent être refoulées en nous, par le sentiment même de la fraternité et de la justice. Nous sommes bien forcés, si nous aimons l'humanité, de la respecter et de regarder comme sacrée la liberté qu'elle a de se tromper.
Eh quoi! Dieu souffre cette erreur et nous ne la souffririons pas? Pourquoi vous indigner contre les riches? Est-ce que les riches seraient à craindre, si les pauvres étaient détachés de l'avarice et du préjugé? Les riches ne font tout ce mal que parce que le peuple tend le cou. Si le peuple connaissait son droit, les riches rentreraient dans la poussière et nous aurions si peu à les redouter, que personne ne se donnerait la peine de les haïr. Notre obstacle n'est pas là; il est parmi nous, et nos plus implacables adversaires, à cette heure, sont, à une imperceptible minorité près, ceux-là mêmes que nous voulons défendre et sauver. Patience donc! Quand le peuple sera avec nous, nous n'aurons plus d'ennemis et nous serons trop puissants pour ne pas être encore une fois généreux.
Quant à moi, je ne veux pas écrire au courant de la plume pour le public en ce moment-ci, et c'est précisément pour ne pas me laisser entraîner par l'émotion. Je ne suis pas toujours aussi calme que je le parais. J'ai du sang dans les veines tout comme un autre, et il y a des jours où l'indignation me ferait manquer à mes principes, à la religion qui est au fond de mon âme. J'obéis donc à la prudence, comme vous le dites fort bien, mais ce n'est pas à cause de moi. Je n'ai pas cette qualité-là pour ce qui concerne ma sécurité personnelle; mais la passion fait du mal aux autres; elle est un mauvais enseignement, un magnétisme funeste. J'ai assez de vertu pour me taire, je n'en aurais pas assez pour parler toujours avec douceur et charité. Or croyez bien que la charité seule peut nous sauver.
Cette lettre est toute confidentielle pour vous et vos amis. Mon nom est, à cause du XVIe Bulletin, un épouvantail pour les réactionnaires, et des relations avouées avec moi pourraient vous compromettre sérieusement, je dois vous en prévenir. Si quelque chose dans mes lettres pouvait vous paraître utile à dire, je vous autorise, pleinement, puisque vous avez un journal, à le reproduire comme venant de vous; car ce ne sont pas les choses que je dis qui effrayent et irritent les gens, c'est mon nom.
En ce qui me concerne, j'ai été forcée de refuser à plusieurs amis d'être leur collaborateur, et, si j'écrivais dans votre journal, cela m'attirerait des chagrins personnels.
Recevez, citoyen, l'assurance de mes sentiments de fraternité.
G. SAND.