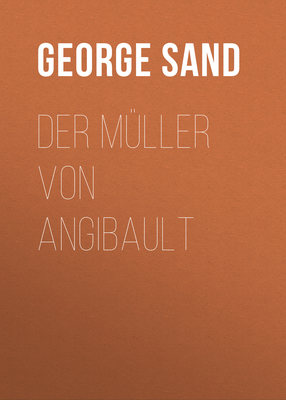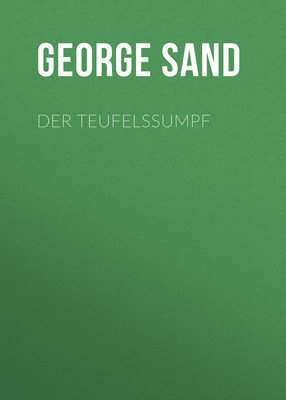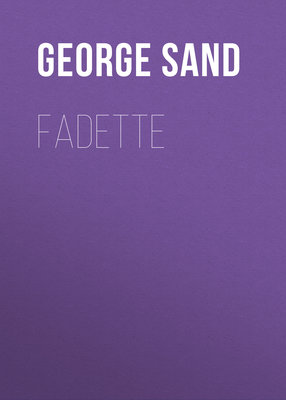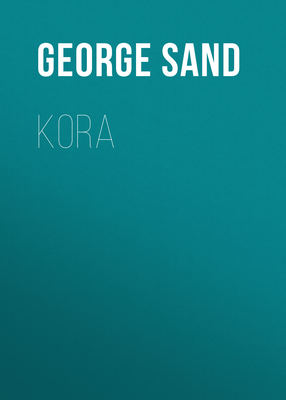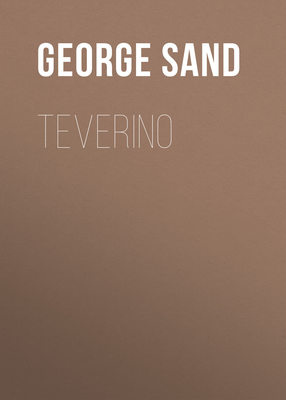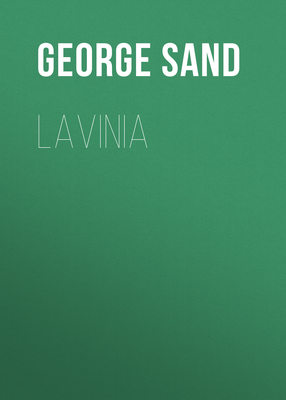Kitabı oku: «Correspondance, 1812-1876. Tome 3», sayfa 8
CCXCV
A M. THÉOPHILE THORÉ, A PARIS
Nohant, 29 mars 1849.
Mon cher ami,
Il faut que je n'écrive point socialisme et fasse le mort pour le moment. Ce n'est pas un engagement que j'ai pris, comme bien vous pensez, mais c'est une contrainte volontaire que je m'impose pour sauver une existence qui m'est plus chère que la mienne. Je vous, dirais cela si nous pouvions causer ensemble.
Attendez-moi donc quelque temps sans parler de moi. Mon bâillon tombera bientôt, j'espère. Ne vous inquiétez point de l'affaire matérielle en ce qui me concerne. Je crois avoir été plus que payée du travail que j'ai fait pour le journal, et j'espère bien, quand la liberté me sera rendue, n'être plus dans les mêmes embarras d'argent, et n'avoir plus à vous en demander pour ma collaboration. Il y a longtemps que je me reproche de n'avoir pas reçu de vos nouvelles directement, regret que vous ne m'auriez pas causé si je vous avais écrit moi-même. J'ai été triste et malade, et je n'ai pas su me défendre d'un effroyable abattement après juin. Cela s'est dissipé pourtant, et j'ai fait un nouveau bail avec la patience et la foi dans l'avenir. Pourtant, les événements officiels ne sont pas plus riants. Barbès à Bourges, l'Italie perdue ou trahie, Proudhon condamné, la réaction triomphante sur toute la ligne! Mais cela n'empêche pas l'idée de faire son chemin, et, jusque dans les provinces les plus arriérées, le peuple s'indigne contre le pouvoir, et de grandes protestations se préparent, non pour les prochaines élections, c'est trop tôt, mais pour un temps qui n'est pas si éloigné qu'on le croirait, à ne voir que la surface des choses.
Courage donc! L'humanité gagnera son procès. Je n'ai pas besoin de vous dire que j'ai suivi vos persécutions et votre espèce d'acquittement avec le plus vif intérêt. Vous ne doutez pas de mes sentiments pour vous et de l'encouragement fraternel que je voudrais vous apporter sans cesse, si, Dieu merci, cela ne vous était point parfaitement inutile, puisque vous avez la persévérance et la foi plus que personne.
Tout à vous de coeur.
G. SAND.
Mon fils se rappelle à votre souvenir.
CCCXVI
A MAURICE SAND, A PARIS
Nohant, 13 mai 1849.
Mon enfant,
Je crois que tu devrais revenir sauf à retourner ensuite s'il ne se passe rien de tout ce que le monde appréhende. Je ne m'inquiète pas follement; mais je vois bien que la situation est plus tendue qu'elle ne l'a jamais été, et, non seulement par les journaux, mais encore par toutes les lettres que je reçois, je vois que le pouvoir veut absolument en venir aux mains. Il fera de telles choses que le peuple, qui est un être collectif et un composé de mille idées et de mille passions diverses, ne pourra probablement continuer ce miracle de rester calme et uni comme un seul homme en présence des provocations insensées d'une faction qui joue son va-tout. La lutte sera terrible; il y a tant de partis ennemis les uns des autres qu'on ne peut en prévoir l'issue, et qu'il y aura peut-être de plus horribles méprises, s'il est possible, de plus sanglants malentendus qu'en juin. Si la République rouge donne, elle donnera jusqu'à la mort; car c'est la République européenne qui est en jeu avec elle contre l'absolutisme européen. Voilà du moins ce que je crois, et cela peut éclater d'un moment à l'autre. Tu ne lis pas les journaux peut-être; mais, si tu suivais les discussions orageuses de l'Assemblée, tu verrais que chaque jour, chaque heure fait naître un incident qui est comme un brandon lancé sur une poudrière.
Reviens donc, je t'en prie; car je n'ai que toi au monde, et ta fin serait la mienne. Je peux encore être d'une petite utilité à la cause de la vérité; mais, si je te perdais, bonsoir la compagnie! Je n'ai pas le stoïcisme de Barbès et de Mazzini. Il est vrai qu'ils sont hommes et qu'ils n'ont pas d'enfants. D'ailleurs, selon moi, ce n'est point par le combat, par la guerre civile que nous gagnerons en France le procès de l'humanité. Nous avons le suffrage universel: malheur à nous si nous ne savons pas nous en servir; car lui seul nous affranchira pour toujours, et le seul cas où nous ayons le droit de prendre les armes, c'est celui où l'on voudrait nous retirer le droit de voter.
Mais ce peuple, si écrasé par la misère, si brutalisé par la police, si provoqué par une infâme politique de réaction, aura-t-il la logique et la patience vraiment surhumaines d'attendre l'unanimité de ses forces morales? Hélas! je crains que non. Il aura recours à la force physique. Il peut gagner la partie; mais c'est tant risquer pour lui, qu'aucun de ceux qui l'aiment véritablement ne doit lui en donner le conseil et l'exemple. Pour n'être ni avec lui ni contre lui, il faut n'être pas à Paris. Reviens donc, si tu m'en crois; j'estime qu'il est temps. Ramène aussi Lambert, je le lui conseille, et je serai plus tranquille de vous voir tous ici.
Je t'embrasse, mon enfant, et te prie de penser à moi.
CCXCVII
A M. THÉOPHILE THORÉ, A PARIS
Nohant, 26 mai 1849.
Cher ami,
Il y a longtemps que je vous dois, que je me dois de vous écrire. J'espérais avoir le temps de vous voir à Paris, où j'ai été au commencement du mois passer trois jours pour affaires. Je ne l'ai pas eu, le temps. Et puis j'espérais vous complimenter sur votre élection et me réjouir avec vous, mais vous avez échoué, quoique avec une grande masse de voix. Enfin, j'ai été malade en revenant ici, toujours malade depuis deux ans, non pas de manière à inquiéter ceux qui tiennent à ma vie, mais de manière à perdre mon temps et à m'ennuyer mélancoliquement sous le poids d'un accablement physique extraordinaire. Je suis dans une phase d'impuissance matérielle. Je ne me sens ni découragée ni ennuyée de rien quand la vie me revient. Mais la vie s'en va par moments, par jours, par semaines entières, et alors je m'ennuie de ne pas pouvoir vivre, et de penser sans écrire. J'en sortirai, car j'ai la volonté de voir encore quelques années. Je suis sûre qu'elles me feront du bien et que je pourrai dire comme ce vieux d'Israël: Et à présent, je puis mourir.
Cet autre empêchement dont je vous parlais et qui ne tenait pas à moi est à peu près hors de cause maintenant. Attendez-moi encore quelque temps et je vous aiderai. J'ai demandé des détails sur Mazzini: je veux faire sa biographie; mais ne l'annoncez pas; car, si ces renseignements n'arrivaient pas, je serais forcée de manquer de parole, et puis le travail annoncé me déplaît toujours. Il faut ensuite trop bien faire et cela me décourage. Au reste, vous allez bien sans moi. Votre journal n'est pas mal fait, comme vous le disiez. Je trouve, au contraire, que vous êtes en grande progression de talent et de clarté, et j'ai remarqué des articles de vous qui étaient non seulement bons, mais beaux. Maintenant, je suis fâchée de cette espèce de polémique avec le Peuple. Vous êtes trop batailleur, vous avez le diable au corps. Vous êtes trop rancunier aussi. Pourquoi ne voulez-vous pas que le National en revienne? Vous savez bien que, personnellement, j'ai, même depuis le temps de Carrel, à me plaindre du National plus que qui que ce soit. C'est une race d'esprits qui ne m'est nullement sympathique; c'est peut-être ce qu'il y a de plus déplorable, de plus irritant, dans les temps où nous vivons, que de voir ceux qui ouvraient jadis la marche vouloir nous la fermer à nous, peuple, parce qu'ils sont au bout de leurs idées et de leurs jambes, et qu'ils ne peuvent pas supporter qu'on les dépasse. Mais, enfin, les voilà arrivés à ce point qu'il leur faut nous suivre, ou mourir, et, s'ils essayent de faire un pas, ne leur tendrons-nous pas la main? N'est-ce pas à nous d'être les chevaliers de la Révolution, comme ce beau peuple de Février, comme Barbès, notre chevalier-type?… Est-ce que l'opinion, le parti du National ne sont pas maintenant dans une situation à faire pitié? Je ne connais guère les hommes de Paris qui représentent cette couleur; mais il y en a dans nos provinces, il y en a beaucoup parmi les élus que le peuple a choisis comme socialistes, et je vous assure que ce ne sont pas des traîtres, que ce sont des hommes sincères qui ont ouvert les yeux. Nous n'aurions certes pas eu un si beau résultat dans les départements, où l'on proclame le triomphe de la liste rouge, si nous n'eussions admis que les socialistes de la veille, et je crois qu'à Paris, si nous n'avons pas eu la majorité socialiste dans l'élection, c'est que nous avons voulu trop accuser le socialisme pur dans le choix des individus.
Je sais bien que vous me trouvez trop bonne femme. C'est vrai que j'ai toujours été du bois dont on fait les dupes; mais n'est-ce pas le devoir de toute religion, que la confiance et le pardon? Vous l'avez dit plusieurs fois, et, aujourd'hui encore, ce n'est pas une secte que nous formons, c'est une religion que nous voulons proclamer.
Et puis je suis fâchée aussi que vous vous mettiez en bisbille avec Proudhon. Je sais bien les côtés qui nous blessent et qui ne nous irons jamais en lui. Mais quel utile et vigoureux champion de la démocratie! quels immenses services n'a-t-il pas rendus depuis un an! Cela fait mal à tous ceux qui voient les choses naïvement et d'un peu loin, de vous trouver en guerre un beau matin ensemble, quand on a besoin que les forces vives de l'avenir marchent d'accord. Et songez que c'est le grand nombre qui voit comme cela. On lit le pour et le contre, et on conclut en disant: «Ils ont raison tous deux à leur point de vue. Donc, ils ont tort de ne pas réunir leurs deux raisons dans une seule qui nous profite.»
Cela ressemble à un paradoxe, à des raisons de malade pour mon compte; mais la majorité de la France est femme, enfant et malade. Ne l'oubliez pas trop. Il faut des flambeaux comme votre esprit ardent et jeune. Je ne voudrais pas souffler dessus. Mais je voudrais aussi ne pas vous voir brûler trop, en courant, ce qui peut être conservé et ce que nous serons bien forcés d'avoir avec nous quand la flamme sera partout.
Bonsoir, mon ami. Croyez que mon coeur est avec ceux qui combattent, avec vous, par conséquent.
GEORGE.
CCXCVIII
A MAURICE SAND, A PARIS
Nohant, 12 juin 1840.
Ah! mon cher enfant, tu devrais bien, revenir! Ce choléra m'épouvante, et tu as beau avoir payé ton tribut en douceur, tu respires un air empesté et tu peux retomber malade. D'ailleurs, nous sommes toujours sous le coup d'un branle-bas général. Ces affaires d'Italie sont plus graves que tout ce qui s'est passé. Je ne vis pas tant que tu seras à Paris dans cette funeste saison. Dans toutes les lettres qu'on m'écrit de Paris, on me dit que je devrais te faire revenir, qu'il meurt douze cents personnes par jour, et cela sur documents officiels que le Moniteur et les journaux ne publient pas. Je ne sais pas te contrarier, ni rien exiger de toi, mais tu devrais bien toi-même mettre un terme à mes angoisses.
Qu'est-ce que le plaisir de voir l'Exposition au prix de ce que tu risques et me fais risquer; car tu sais bien que ta vie est la mienne, et que je ne te survivrais pas.
Nous avons eu fort peu d'orages; il paraît qu'il y en a eu un terrible à Paris. Il a dû pleuvoir des cheminées, et puis les sergents de ville assomment les étudiants et les jeunes gens de vos quartiers. Quelles mauvaises circonstances pour être loin les uns des autres! Reviens donc dans ton nid, et attends de meilleurs jours pour aller travailler au Musée; car ce n'est pas dans ce moment-ci que tu pourrais y faire un travail soutenu et utile. La réponse de ton père te parviendra aussi bien ici.
Nous avons eu aujourd'hui nombreuse compagnie. Camus, avec un jeune homme très bien de Châteauroux; Fleury, Périgois, Desmousseaux, Laussedat, Gustave Tourangin, Lumet, et le nez de Germann. Lumet est un vigneron d'Issoudun aussi grave et absolu que Patureau est malin et persuasif. Il a une tête magnifique, distinguée; une pénétration, une fermeté, une éloquence extraordinaire par moments, et tout cela avec le langage paysan et des manières nobles comme ne les ont plus les grands seigneurs.
Non, les hommes supérieurs ne manquent pas dans le peuple; il ne s'agit plus que de les mettre à leur plan, et cela ne tardera guère.
Bonsoir, cher petit Bouli. Je suis presque guérie. N'en déplaise à ton ordonnance, plus je reste dans l'eau, mieux je m'en trouve; chacun a son tempérament. Moi, j'ai un peu de celui des poissons ou des grenouilles. Nous étions dans l'eau l'autre jour pendant l'orage. Il pleuvait à verse; mais la rivière était tiède, presque chaude, et c'est bien décidément un proverbe très sage, et non un paradoxe, que Gribouille se jetant dans l'eau de peur de la pluie.
Reviens donc! il fait si bon ici, et tu es si mal là-bas! J'en souffre dans tes os et je ne jouis de rien sans toi. Pôtu part décidément jeudi; sa soeur va mieux, mais sa famille veut absolument voir cette masse de graisse. Je ne pourrai travailler que quand tu seras là. Je n'ai le coeur à rien sans toi. Je t'embrasse mille fois.
CLXCIX
A JOSEPH MAZZINI, A ROME
Nohant. 23 juin 1849.
Ah! mon ami, mon frère, quels événements! et comment vous peindre la profonde anxiété, la profonde admiration et l'indignation amère qui remplissent nos coeurs? Vous avez sauvé l'honneur de notre cause; mais, hélas! le nôtre est perdu en tant que nation. Nous sommes dans une angoisse continuelle.
Chaque jour, nous nous attendons à quelque nouveau désastre, et nous ne savons la vérité que bien longtemps après que les faits sont accomplis. Aujourd'hui; nous savons que l'attaque est acharnée, que Rome est admirable, et vous aussi. Mais qu'apprendrons-nous demain Dieu récompensera-t-il tant de courage et de dévouement? livrera-t-il les siens? protégera-t-il la trahison et la folie la plus criminelle que l'humanité ait jamais soufferte? Il semble hélas qu'il veuille nous éprouver et nous briser pour nous purifier, ou pour laisser cette génération comme un exemple d'infamie d'une part, d'expiation de l'autre.
Quoi qu'il arrive, mon coeur désolé est avec vous. Si vous triomphez, il ne m'en restera pas moins une mortelle douleur de cette lutte impie de la France contre vous. Si vous succombez, vous n'en serez pas moins grand, et votre infortune vous rendra plus cher, s'il est possible, à votre soeur.
CCC
AU MÊME
Nohant, 5 juillet 1849
Mon frère et mon ami,
Allons au fond de la question, puisque vous le voulez. Laissons de côté mon dégoût, et mon découragement, comme une situation toute personnelle qui ne prouve rien pour ou contre vos vues et moyens. J'avais à dessein omis, dans ma dernière lettre, de répondre à ce que vous me disiez de Louis Blanc, parce que je ne voulais pas en venir à vous parler de Ledru-Rollin. Je trouvais inutile de confier au papier des jugements qui, par le temps de police qui court, peuvent toujours tomber dans les mains de nos ennemis.—Mais, puisque vous y revenez, je vous dois de m'expliquer.
Vous faites de la politique, dans ce moment-ci, rien que de la politique. Vous êtes au fond aussi socialiste que moi, je le sais; mais vous réservez les questions d'avenir pour des temps meilleurs, et vous croyez qu'une association toute politique entre quelques hommes qui représentent la situation républicaine telle qu'elle peut être, en ce moment, est un devoir pour vous. Vous le faites, vous surmontez vos répugnances (vous m'écriviez cela dans la lettre à laquelle j'ai répondu), vous croyez enfin qu'il n'y a rien autre chose à faire. Il est possible; mais est-ce une raison pour le faire? Là est la question.
Vous voyez les choses en grand; vous faites bon marché des individus; vous admettez l'homme, pourvu qu'il représente une idée; vous le prenez comme un symbole, et vous l'ajoutez à votre faisceau, sans trop vous demander si c'est une arme éprouvée. Eh bien, pour moi, Ledru-Rollin est une arme faible et dangereuse, destinée à se briser dans les mains du peuple. Soyons juste et faisons la part de l'homme. Je commence par vous dire que j'ai de la sympathie, de l'amitié même, pour cet homme-là. Je suis, sans aucune prévention personnelle â son égard, et, tout au contraire, mon goût me ferait préférer sa société à celle de la plupart des hommes politiques que je connais. Il est aimable, expansif, confiant, brave de sa personne, sensible, chaleureux, désintéressé en fait d'argent. Mais je crois ne pas me tromper, je crois être bien sûre de mon fait quand je vous déclare, après cela, que ce n'est point un homme d'action; que l'amour-propre politique est excessif en lui; qu'il est vain; qu'il aime le pouvoir et la popularité autant que Lamartine; qu'il est femme dans la mauvaise acception du mot, c'est-à-dire plein de personnalité, de dépits amoureux et de coquetteries politiques; qu'il est faible, qu'il n'est pas brave au moral comme au physique; qu'il a un entourage misérable et qu'il subit des influences mauvaises; qu'il aime la flatterie; qu'il est d'une légèreté impardonnable; enfin, qu'en dépit de ses précieuses qualités, cet homme, entraîné par ses incurables défauts, trahira la véritable cause populaire. Oui, souvenez-vous de ce que je vous dis, il la trahira, à moins que des circonstances ne se présentent qui lui fassent trouver un profit d'amour-propre et de pouvoir à la servir. Il la trahira, sans le vouloir, sans le savoir peut-être, sans comprendre ce qu'il fait. Ses aversions sont vives, sinon tenaces. Il verra dans les grands événements de petites considérations qui l'empêcheront de faire le bien et qui satisferont sa passion, son caprice du moment. Il transigera pour les choses les plus graves, par des motifs dont personne ne pourra soupçonner la frivolité.
C'est l'homme capable de tout, et pourtant c'est un très honnête homme, mais c'est un pauvre caractère. Il ira à droite, à gauche; il glissera dans vos mains. Il brisera devant vous avec un ennemi; le lendemain matin, vous apprendrez qu'il a passé la nuit à se réconcilier. Rien de plus impressionnable, rien de plus versatile, rien de plus capricieux que lui, vous verrez!
Vous me direz que vous savez tout cela; vous devez le savoir, puisque vous le voyez, et qu'il y a en lui une certaine naïveté, aimable mais effrayante, qui ne permet pas de douter de sa nature, après un mois ou deux d'examen. Il n'en faut même pas tant à des gens plus clairvoyants et moins optimistes que je ne le suis parfois. Vous me direz donc que cela vous est égal; que, puisqu'il est l'homme le plus populaire du parti républicain en France, vous l'acceptez comme l'instrument que Dieu place sous votre main. Qui a tort ou raison de vous ou de moi? Je ne sais; mais nous avons une disposition tout opposée. Vous n'avez pas besoin d'estimer et d'aimer beaucoup un homme pour l'employer, pour le juger propre à l'oeuvre sainte.
Moi, je suis capable d'estimer et d'aimer, comme individu privé, un homme aimable et bon; je le défendrais comme tel avec chaleur contre ses ennemis, je voudrais lui rendre service, je partagerais ses chagrins. J'ai plusieurs amis dont je ne goûte pas les idées, dont je n'approuve pas la conduite, et que j'aime pourtant et à qui je suis très dévouée, dans tout ce qui est en dehors de l'opinion. Mais dans l'action générale, c'est autre chose. Si je faisais de la politique, je serais d'une rigidité farouche. Je voudrais sauver la vie, l'honneur et la liberté de ces hommes-là; mais je ne voudrais pas qu'une mission leur fût confiée, et rien ne me ferait transiger là-dessus, ni la considération de leur talent, ni celle de leur popularité (la popularité est si aveugle et si folle!), ni celle d'une utilité momentanée. Je ne crois pas à l'utilité momentanée. On paye cela trop cher le lendemain, pour qu'il y ait une utilité réelle.
Voilà donc, pour la France, le chef de l'association politique formée sous le titre du Proscrit12. Il est possible que la nuance que cet homme représente soit la seule possible en fait de gouvernement républicain immédiat: on doit respect à cette nuance pendant un certain temps.
Je ne la combattrais donc pas, si j'étais homme et écrivain politique, tant qu'elle ne ferait pas de fautes graves, et surtout tant que nous serions en présence d'ennemis formidables contre lesquels cette nuance serait le seul point de ralliement. Mais je ne pourrais plus mettre mon coeur, mon âme et mon talent à son service. Je m'abstiendrais jusqu'au jour où ce parti deviendrait le persécuteur avoué et agissant d'un parti plus avancé qui représenterait davantage la raison et la vérité par le peuple. Ce jour, hélas! ne se ferait pas longtemps attendre.
Votre âme ardente me répond, je l'entends d'avance, qu'il ne faut jamais s'abstenir, pas une heure, pas un moment!
Je sens la beauté mais non la vérité rigoureuse de cette réponse; je crois que tout le mal vient de ce que personne ne veut jamais s'abstenir pendant un temps donné. Les uns y sont poussés par leurs passions, les autres par leur vertu, c'est le petit nombre. Mais quiconque serait bien pénétré de l'esprit de l'histoire et de la nature des lois qui régissent les destinées humaines, saurait se mettre en retraite pendant certains jours, et se dirait «J'ai dans mon âme une vérité supérieure à celle que les hommes acceptent aujourd'hui, je la dirai quand ils seront capables de l'entendre.»
C'est pour la politique seulement que je dis cela; car, en restant sur le terrain philosophique, socialiste, si vous voulez, on peut et on doit toujours tout dire, et aucun gouvernement n'a le droit de l'empêcher. Les idées ont toujours le droit de lutter contre les idées. Seulement, il y a des temps où les hommes ne doivent pas combattre contre certains hommes; sans motifs puissants et pressants.
Vous me direz encore que je fais, entre la politique et le socialisme, une distinction arbitraire, et que j'ai combattue moi-même mainte et mainte fois. Lorsque je l'ai combattue, c'était contre les politiques précisément qui faisaient, au point de vue du National, ce que le Proscrit est bien près de faire en excluant les hommes à système. Les hommes du Proscrit s'intitulent socialistes aujourd'hui; mais, croyez-moi, ils ne le sont guère plus que ceux d'hier. Ils admettent le programme de la Montagne, c'est quelque chose; mais, pour quiconque tendrait à le dépasser un peu, ils seraient tout aussi intolérants, tout aussi railleurs; tout aussi colère était le National en 1847. Ils ne sont pas assez forts pour vaincre par le raisonnement: ils vaincraient par la violence, ils y seraient entraînés, forcés, pour se maintenir, et ils se retrancheraient sur les nécessités de la politique. Par le fait, la politique et le socialisme sont donc encore choses très distinctes pour eux, quoi qu'ils en disent, et il faut bien que les socialistes s'en tiennent pour avertis. Il y a donc, aujourd'hui encore, nécessité à distinguer ce qu'il faut faire et ne pas faire dans une pareille situation.
Si Ledru-Rollin et les siens étaient, au pouvoir, et que je fusse écrivain politique, je croirais faire mon devoir, comme socialiste, en discutant l'esprit et les actes de son gouvernement; mais je croirais faire une mauvaise action, comme politique, en attaquant les intentions de l'homme et en publiant sur son compte, ou en disant tout haut à tout le monde ce que je vous écris ici. Je ne voudrais pas conspirer contre lui par la seule raison que je ne me fie point à lui. Je retrancherais enfin l'amertume et la personnalité qui sont, malheureusement, la base de toute polémique jusqu'à nos jours.
Mais je ne suis pas, je ne serai pas écrivain politique, parce que, pour être lu en France aujourd'hui, il faut s'en prendre aux hommes, faire du scandale, de la haine, du cancan même. Si on se borne à disserter, à prêcher, à expliquer, on ennuie, et autant vaut se taire.
Emile de Girardin a la forme quand il veut; il n'a pas le vrai fond. Louis Blanc a le fond et la forme. On ne s'en occupe point. Il se doit à lui-même d'écrire toujours, parce qu'il a un parti et qu'il ne peut l'abandonner après l'avoir formé. Mais, en dehors de son parti, il est sans action.
Et parlons de Louis Blanc maintenant, puisque vous le voulez. Pour moi, c'est lui qui a raison, c'est lui qui est dans le vrai. Vous me parlez de ses défauts personnels. Il a les siens, sans doute, et certainement Ledru-Rollin est plus conciliant, plus engageant, plus entouré, plus entourable, plus populaire par conséquent. Mais, dans la vie politique, Louis Blanc est un homme sûr. Que m'importe que, dans la vie privée, il ait autant d'orgueil que l'autre a de vanité, si, dans la vie publique, il sait sacrifier orgueil ou vanité à son devoir? Je compte sur lui, je sais où il va, et je sais aussi qu'on ne le fera pas dévier d'une ligne. J'ai trouvé en lui des aspérités, jamais de faiblesse; des souffrances secrètes, aussitôt vaincues par un sentiment profond et tenace du devoir. Il est trop avancé pour son époque, c'est vrai. Il n'est pas immédiatement utile, c'est vrai. Son parti est restreint, et faible, c'est vrai; il n'aurait d'action qu'en se joignant à celui de Ledru-Rollin. Mais voilà ce que je ne lui conseillerai jamais; car Ledru-Rollin ne s'unira jamais sincèrement à lui, et travaillera désormais plus qu'autrefois à le paralyser ou à l'anéantir.
Louis Blanc ne peut plus être solidaire des frasques du parti de Ledru-Rollin, Il ne le doit pas. Qu'il reste à l'écart, s'il le faut; son jour viendra plus tard, qu'il se réserve! Est-ce qu'il n'a pas la vérité pour lui? est-ce qu'il ne faudra pas, après bien des luttes inutiles et déplorables, en venir à accorder à chacun suivant ses besoins? Si nous n'en venons pas là, à quoi bon nous agiter, et pour quoi, pour qui travaillons-nous? Vous voudriez qu'il mît sa formule, dans sa poche pour un temps, et qu'il employât son talent, son mérite, sa valeur individuelle, son courage, à faire de la politique de transition. Moi aussi, je le lui conseillerais, s'il pouvait se joindre à des hommes comme vous; s'il pouvait avoir la certitude de ne pas fermer l'avenir à son idée, en l'accommodant aux nécessités du présent; si chacun de ses pas prudents et patients vers cet avenir n'était pas rétrograde; si enfin il pouvait et devait se fier.
Mais il ne le peut pas. Ledru-Rollin le trahira, non pas sciemment et délibérément, non! Ledru dit comme nous quand on l'interroge. Il comprend le progrès illimité de l'avenir, il est trop intelligent pour le contester. Sous l'influence d'hommes comme vous et comme Louis Blanc, il y marcherait. Mais la destinée, c'est-à-dire son organisation, l'entraînera où il doit aller, à la trahison de la cause de l'avenir. Si je me trompe, tant mieux! je serai la première, dans dix ans d'ici, si nous sommes encore de ce monde et s'il a bien marché, à lui faire amende honorable. Mais, aujourd'hui, ma conviction est trop forte pour me permettre d'associer mon nom au sien dans une oeuvre dont le premier acte est de rejeter, de honnir, de maudire Louis Blanc en lui imputant, comme mal produit, le bien qu'il n'a pu faire et qu'on l'a empêché de faire.
C'est là, cher ami, une des causes de mon découragement. J'estime qu'on se trompe, que vous vous trompez aussi sur un fait, que vous n'avez pas mis la main sur un véritable élément de salut pour la France, et par conséquent pour l'Italie, dont la cause est solidaire de la nôtre. Je me dis qu'il n'y a pas à lutter contre le courant qui vous entraîne à ce choix, et je m'abstiens, toujours triste, toujours attachée à vous par la foi la plus vive en vos sentiments et par l'affection la plus tendre et la plus profonde.
Votre soeur,
GEORGE.